Jean Guillou, Widor et Vierne, Augure
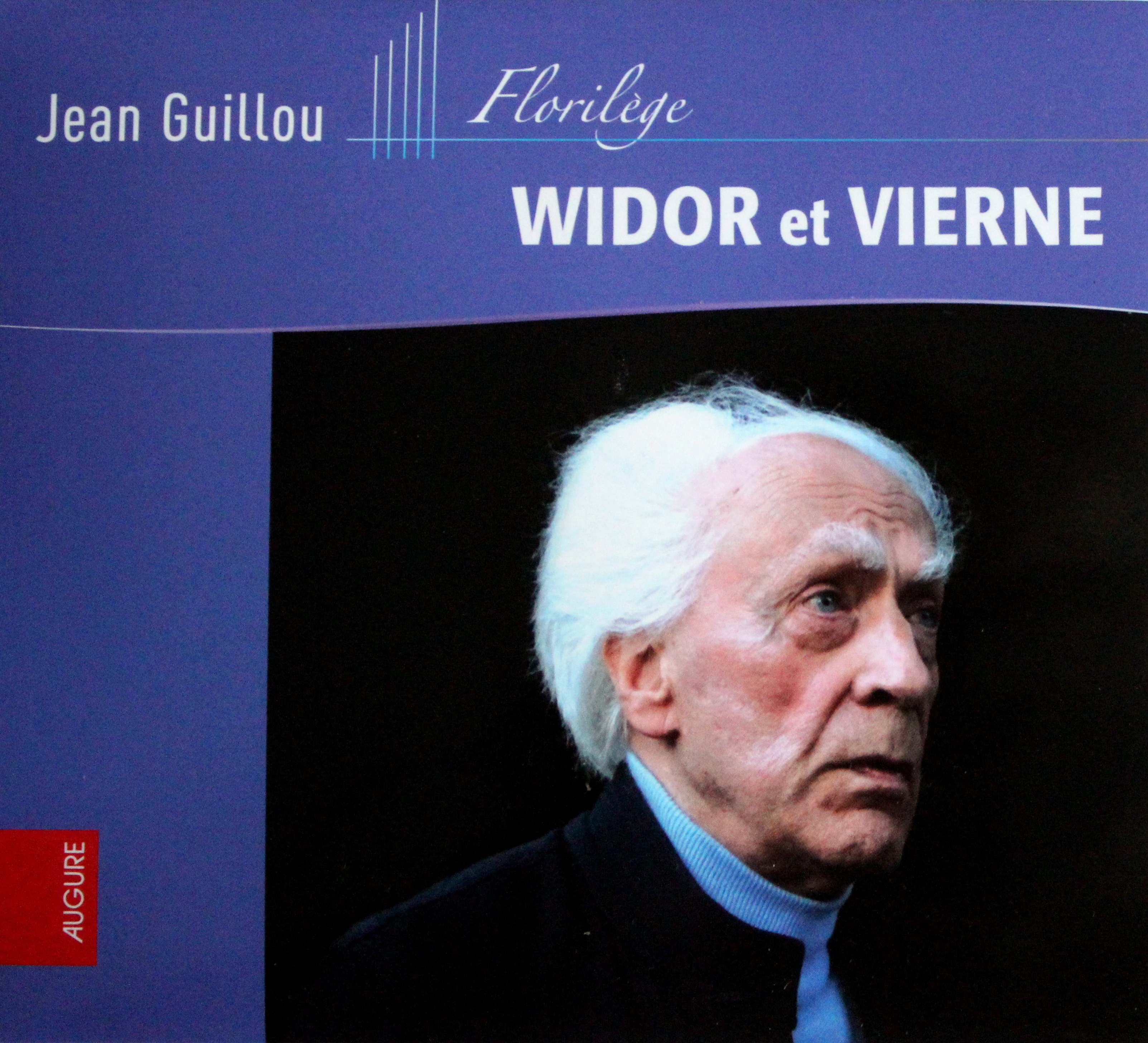
Augure nous faisant l’amitié de nous fournir notre pain guilloutique régulier, la série de chroniques posthumes commence vraiment avec ces quelques lignes de la onzième notule. En ce jour d’hommage à la vedette, célébré sans doute malgré lui à Notre-Dame, nous avons donc choisi à dessein d’ouvrir la fête mortuaire avec ce disque, dernier phonogramme compilé du vivant de l’artiste, avec son approbation et avec la générosité coutumière des disques d’Augure – le présent opus propose 78’ de sons. De patchwork, il sera question à propos de cette compil’ Widor + Vierne, puisque ce florilège assemble des prises dissemblables : live et prise unique, dans différents endroits… parfois même pour une même pièce. Ainsi, l’Allegro de la Cinquième symphonie de Charles-Marie Widor est capté à Saint-Laurent, à Rotterdam, tandis que les éditeurs ont choisi, pour la Toccata de la même symphonie, la version gravée à Saint-Matthias, à Berlin – sans doute parce que le second volume des lives à Saint-Matthias incluait déjà l’Allegro de la Cinquième. Bref, une question s’impose : cette œuvre de mémoire, qui s’inscrit dans le travail rigoureux et passionné de l’association Augure, vaut-elle comme trace d’un grand interprète ou mérite-t-elle aussi l’intérêt des mélomanes non guilloumaniaques ? Seule manière d’esquisser une réponse : écouter de toutes nos deux oreilles et, si l’émotion s’en mêle, du cœur itou.
L’Allegro de la Sixième symphonie de Widor (9’30 avec cadence !) est l’un des tubes des organistes. Enregistré en 1979, ce premier mouvement associe la solennité d’un tutti dynamique au quasi détaché qui permet à l’interprète de faire respirer et de rendre plus intelligibles les accords qui cinglent l’église. Le pari de l’exécution réside dans ce désir schizophrène de maintenir la pompe sans négliger la vitalité, la liberté et même la facétie : au-delà de la coquetterie d’un virtuose souhaitant montrer combien il virevolte avec aisance – il se le peut permettre, le bougre –, la registration de la pédale (20 jeux disponibles !) avec quelques jeux aigus (quatre registres de pédale entre un et quatre pieds !) ne manque pas d’ironie pour l’arrivée du passage en La. Une cadence pyrotechnique ajoute « beaucoup d’effet » à ce qui, déjà, n’en manquait pas. Celui qui n’a pas frissonné devant une telle débauche d’agilité puissante persillée de malice ne frissonnera décidément jamais et, après tout, tant pis pour sa mouille.
La Cinquième symphonie de Widor est expurgée de ses mouvements centraux pour n’offrir que le premier et le dernier de ses membres. Certes, dès l’Allegro (10’), on décèle çà et là des montages perfectibles (ainsi, celui de 0’07, piste 2, fait sursauter !) ; mais la qualité des bandes originales, déjà quadragénaires, est sans doute plus en cause que le travail de fourmi réalisé par Jean-Claude Bénézech et ses acolytes auguriens. Le mouvement premier permet d’entendre de nouvelles sonorités, des fonds aux petites flûtes que l’artiste éclaire de façon multiple en jouant habilement avec la pédale d’expression. Après quoi, le musicien s’éclate et transforme la partie-à-doubles-croches en « Vol du bourdon ». Ce n’est pas absurde, c’est croquignolesque, pétillant et éminemment spectaculaire. Les modulations sont enlevées avec évidence ; et, si le son n’est pas toujours parfait, l’éventuel manque de définition des graves n’empêche certes pas de suivre les débauches de virtuosité et d’élan vital, symbolisées par la pulsion des accords détachés de la coda avec, pour conclure, la p’tite tierce picarde qui va bien. Il faut alors bondir à Saint-Matthias de Berlin, en 1983, pour profiter d’une toccata enlevée en moins de 4’. Hénaurme tube d’organistes elle aussi, la pièce, jouée ici dans sa version de 1918, fonctionne autour d’un ostinato emporté tellement vite que l’on se demande si les claviers n’ont pas brûlé après le passage de ce grand malade de la vitesse, obligé de swinguer les accords répétés pour avoir le temps de les faufiler. Le jaloux pointera quelques arrangements avec la lettre de sa partition (par ex. à 2’20, changement d’octave de la pédale après le ré bémol, na), quelques confusions, la fatigue aidant (3’10). Le propos n’est certes pas là : cette toccata plaira aux amateurs de technique et de performance, comme elle pourra laisser sur la touche ceux qui aiment admirer des artistes associant une technique surhumaine à un souci de donner à entendre de la musique, pas uniquement des quadruples saltos vrillés. Il est clair que cette berlinade n’a point été effleurée par semblable souci… hélas, à notre très-pas-humble goût.

La Deuxième symphonie de Vierne est un monstre de 33’33 que Jean Guillou a enregistré le 3 juillet 2003 dans son fief de l’époque, Saint-Eustache. L’Allegro (7’) s’engage dans la voie de la liberté, chère au maître qui joue à domicile. Curieuse impression que cette ouverture dépenaillée : surprise, certes ; mais aussi gâchis apparent du groove qu’a réellement écrit Louis Vierne avec syncopes, échos, contretemps, etc., qui n’avait peut-être pas besoin que lui fussent ajoutés quelques déséquilibres apocryphes. Désarçonné, l’on profite davantage du voyage dans les multiples couleurs de l’orgue – alléluia, y a de quoi faire – que de la promenade viernoise. En fait, cette volonté de secouer la partition s’apaise petit à petit et nous permet de jouir, allons donc, de cette musique à la fois ressassante (un même motif pointé passe et repasse), inventive (ses déclinaisons ne manquent pas de stimuler l’écoute) et ambitieuse (elles font voyager l’auditeur dans l’instrument et dans la musique). Le Choral (8’) s’ouvre sur un majestueux trait de pédale dont l’artiste semble avoir évacué les huit pieds pour rendre d’emblée l’atmosphère – sombre – du mouvement, par opposition à celui qui a précédé, et ce, grâce au 32’ ou aux 16’ les plus sourds. La relative faiblesse de la prise de son rend ce discours plus suggestif que clair. Le propos peut justifier cette posture, oscillant de modulations en modulations, d’Agitato en Largo et retour, de flûtes tremblantes en ensemble d’anches. Une évidence : le crescendo final démontre une science de la registration fascinante. Le Scherzo (moins de 4’) est pris pied au plancher. On y gagne en énergie, en vitalité et en spectaculaire – il faut se le fader, ce mouvement, qui plus est à ce tempo ! – ce que l’on perd en poésie, en dépit des magnifiques sonorités de Saint-Eustache. Comme souvent avec le Jean Guillou interprète, l’appréciation de l’exécution ne relève guère du jugement mais révèle les préférences de chaque auditeur. Mais écou(r)te-t-on Vierne par Guillou pour entendre Vierne ou Guillou ? Vous avez demi-heure.
Le Cantabile (7’) ne laisse pas de défier le Larghetto grâce à l’allant de l’organiste, d’une part, et, d’autre part, grâce au toucher énergique marquant le lead confié d’abord au Cromorne. L’écriture, fort complexe (c’est un euphémisme), est un terrain de jeu gourmand pour l’ardeur de l’interprète qui fait en effet sonner le Wagner qu’il affirme déceler non sans convaincre (2’53, 3’33). Ce quatrième mouvement n’est sans doute pas le passage le plus sexy de Louis Vierne, faut l’dire, hein, on n’est pas dans du pomme-pet-deup, mais aussi bien joué sur un orgue aussi adapté, c’est sans doute l’un des plus émouvants. Le Final (moins de 8’) permet à l’interprète de renouer avec, et d’une, une virtuosité plus exubérante, et de deux, la liberté. Ici, les effets d’attente nous semblent, prétentieux que nous assumons d’être, mieux venus, moins outrés, plus au service du discours du compositeur que dans l’Allegro. Les cornets sonnent ; les basses grondent ; les ruptures de rythme et les contretemps instabilisent, je tente, joyeusement l’écoute ; les contrastes éblouissent ; les modulations passent comme courriel en 5G – hé-hé ! remotivation d’un syntagme figé, et hop ! – ; les progressions ou changements de registration rendent justice à l’orgue joué ; le détaché-alla-Guillou (6’27) fait merveille – bref, seul regret : une prise de son qui, seize ans plus tard, n’est évidemment plus à la hauteur des standards attendus, ni dans le dessin des graves, ni dans le ciselage des tutti (7’17, va-t’en entendre les traits de pédale…). Pourtant, la déficience phonographique porte témoignage et n’altère pas l’appréciation d’une performance techniquement impressionnante et musicalement incapable de laisser quiconque indifférent. En somme, cette version est à acquérir en seconde intention, pour contrebalancer l’idée que l’on a pu se faire, à partir d’interprétations plus sages, de ce qu’est ou de comment se joue une symphonie de Louis Vierne en général… et la deuxième en particulier.
Est venue l’heure des compléments de programme, à commencer par le Carillon de Westminster, mégahit extrait des Pièces de fantaisie de Louis Vierne. Avec une honnêteté amusante, l’éditeur avoue n’avoir pas su choisir entre deux versions… et propose donc ses deux finalistes – en les séparant sur la set-list pour éviter la lassitude de qui écouterait le disque en continu. La première est issue d’un enregistrement à Saint-Bavo de Haarlem en 1979. Foudroyée en 5’ (Olivier Latry la joue en 6’45, on n’est pas sur le même saucisson), cette version a l’intérêt de l’exceptionnel, au sens d’inouï. C’est au-delà du brillant et, pourtant, en dépit de la beauté de la pédale et de l’équilibre des registrations, cela nous paraît plus vain et confus qu’ébouriffant (écouter par exemple piste 9, autour de 3’11). Quoi que cela ne manque pas d’une certaine saveur, on imagine plus, à l’occasion d’un bis, une tentative de record du monde de vitesse qu’une interprétation sensée et profonde. Comme dirait notre chouchoute Esther Assuied proposant une interprétation autrement plus passionnante de la Danse de la mort de Franz Liszt : noise.
La seconde version, qui clôt le disque, est issue des gravures du 3 juillet 2003 à Saint-Eustache. Moins hâtive, moins soufflante que la première (« irrégularités dès la deuxième mesure, confusion dès la septième », note avec satisfaction le très-médiocre organiste bouffi de jalousie haineuse), cette proposition est beaucoup plus séduisante musicalement : les différents plans sonores sont caractérisés, les sonorités sont magnifiques malgré une moins bonne prise de son, l’énergie de la main droite ne contamine pas l’ensemble de l’exécution, les mutations de registration sont splendides, et les imperfections de cet enregistrement sans doute « dans les conditions du direct » (pédale à 4’21… et suivantes, par ex.) n’ont guère d’importance pour un tel document. Là, on entend de la musique, bon sang !

Dans la même série que le Carillon, l’Impromptu est aussi un tube d’organiste constitué d’une farandole qui s’ébroue irrégulièrement pendant près de 4’. Également enregistré le 3 juillet 2003 à Saint-Eustache, il débute sur un curieux hoquet dès la troisième note et s’accompagne de quelques broutilles qui, loin de faire oublier la qualité des justes notes, valorisent l’intérêt d’un enregistrement sinon à la va-comme-je-te-pousse, du moins à la bonne franquette, comme si l’artiste nous gratifiait d’un récital privé, une fois les portes de la grande église close. Donc ça sature parfois, ça bouscule sciemment, ça pose ou ça accélère quand ça veut, ça trébuche si ça s’présente (piste 12, 2’39, par ex.), mais ça vit, nom d’un p’tit mouton, ça vit ! Le Scherzetto, techniquement hypermoins ardu que les autres pièces, est joué (sur le 3 claviers-40 jeux de Middelbourg) de façon bousculée, comme pour cacher la relative facilité sous une urgence facétieuse… peut-être aussi excitée par la bruyante présence humaine audible piste 10, 0’13. S’inspirant de la registration officielle, Jean Guillou n’y ajoute pas moins sa marque avec les tremblants qui lui sont chers. Le résultat est plus personnel que susceptible de combler l’amateur guindé de Vierne – mais écoute-t-on une interprétation pour retrouver des notes en son ou pour écouter la cohérence entre les notes théoriques et la mise en pratique par un médiateur artistique ? (Nan, même moi, j’ai décroché en cours de phrase, pas de panique.) Enfin, la Toccata, enregistrée itou à Middelbourg, est lancée sur un rythme de fou. Ce devait être très, très spectaculaire en direct ; c’est à la fois vertigineux et guère intéressant à l’écoute, à moins de chercher sottement les scories (ainsi de la pédale à 1’05) de cette cavalcade démentielle et un peu creuse.
En somme, cette Toccata est à l’image du disque : Jean Guillou avait la virtuosité virevoltante qui le laissait libre de risquer des tempi de guedin. Certes, cette performance circassienne a beau marquer le petit musicien, elle peine, en soi, à l’émouvoir. En revanche, quand la technique superlative s’associe à une science de la registration et à un souci de faire palpiter une œuvre sans se contenter d’en faire un tremplin pour histrion, genre Tryphon Tournesol sur patins à roulettes, là, on tient quelque chose, et quelque chose d’une puissance que peu oseront défier. En ce sens, ce disque est doublement important pour qui veut connaître voire approfondir sa connaissance de l’interprète guilloutiste : il permet d’entendre ses fabuleux excès et d’écouter son art d’interprète. Les deux ne vont pas souvent ensemble, mais leur duel fait le prix de ce disque anthume, supérieurement édité avec un livret mentionnant la composition de chaque orgue et dévoilant une présentation trilingue qui associe les mots du maître à ceux de ses plus fervents et pertinents supporters.
Acheter le disque : ici.
Consulter nos précédentes chroniques de disques guilloutiques : là.

