Jean-Luc Thellin, Intégrale Bach 1, Organroxx
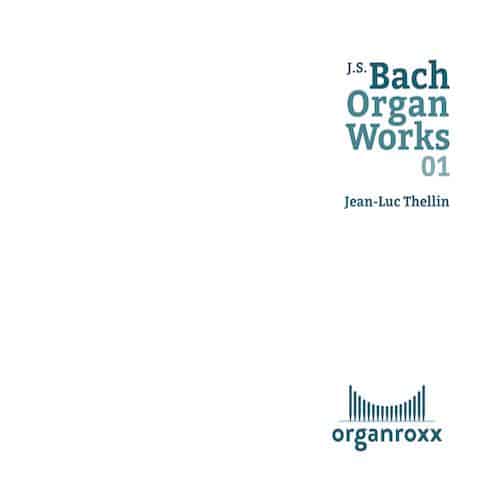 L’avertissement
L’avertissement
Soyons précis, pour une fois (de plus) : Jean-Luc Thellin, familier aux lecteurs de ce site, m’invite régulièrement à le remplacer à sa tribune. La chronique qui suit peut donc être considérée comme biaisée, et elle l’est. Aussi s’attachera-t-on, dans cette notule, à justifier nos applaudissements par des arguments reléguant le danger du lèche-bottisme à la plus congrue des portions – en espérant que cette portion puisse être, in fine, considérée comme négligeable, voire au contraire – ça fait hypermystérieux, comme formulation, alors je garde même si pas très clair, euphémisme.
Le projet
L’avantage de l’orgue, c’est qu’il appelle souvent à des défis insensés. Entre des restaurations ou créations d’instruments à plusieurs millions d’euros (ne compensant guère les destructions lentes ou abruptes d’autres monuments), des innovations perpétuelles (tel ce toucher progressif pas encore au point mais prometteur), des tentatives nouvelles comme cet orgue électronique de haute qualité manigancé par Pascal Vigneron pour développer les grandes orgues au-delà des églises, voici que se faufile une intégrale Bach signée Jean-Luc Thellin alors même qu’une intégrale pour claviers de Bach se développe ailleurs sous les doigts plus connus de Benjamin Alard… et que l’on nous annonce la fin du disque physique. Le label Organroxx, issu de la webradio du même nom, prend le contrepied de cette fadaise et ose, donc, relever ce défi monumental avec, à la tête du projet partiellement financé par crowdfunding, un presque-jeune Belge, titulaire du Stolz en décomposition de Notre-Dame de Vincennes et récemment nommé prof d’orgue à Chartres.
En sus d’un design original, d’une modernité assumée (QR codes intégrés) et d’un souci du produit concret (un livret dépliable permettant de lire l’intégralité du programme et un autre stipulant la composition et toutes les registrations : les organophiles, maniaques friands de ces détails qui donnent chair à leurs fantasmes, vont a-do-rer cette attention, même si les variations d’abréviation entre composition et registration ne simplifient pas toujours la lecture), le projet s’annonce surtout singulier par son aspect géographique : l’intégrale sera l’occasion d’entendre non point un catalogue des œuvres par numéro d’opus mais une série de récitals éclairant l’ensemble de l’œuvre à la lumière d’orgues variés. Acceptons-en l’augure, ce qui ne veut rien dire, en l’espèce, mais je trouve que ça ponctue bien cette intro.
Le disque
Le premier instrument à passer sur le grill est l’orgue Thomas de Saint-Vincent à Ciboure. On regrette – c’est le rôle du critique snob – que, sur le livret, la colorisation de l’image en bleu passé ne rende pas raison de la beauté esthétique de la chose (voir photo infra). Quant à la conception sonore de la Bête, elle revendique le modèle hollandais, qui fait écho au désir de Jean-Luc Thellin dans ce premier disque : rendre raison de l’importance de la facture d’Allemagne septentrionale dans les compositions de Johann Sebastian Bach.
Concrètement, l’ascension de l’Everest bachistique commence par le Fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542. L’interprète attire notre attention sur trois points : l’aspect autobiographique (évocation de la mort de la première épouse du compositeur), l’aspect géographique (fugue autour d’une chanson flamande) et l’aspect musicologique (influence de l’écriture nordique mêlant liberté et contrepoint). D’emblée, l’on est saisi : le son est exceptionnel, enveloppant l’auditeur dans un mélange incroyable de puissance profonde et de netteté des notes – il n’en manque pas dans les guirlandes ouvrant le prélude ! Cette esthétique euphorisante est renforcée par le choix interprétatif distinguant nettement la partie libre à triple croche, façon récital, et la partie polyphonique, que rythme une pédale précise et sans concession. La différenciation des registrations alloue aussi sa part de lisibilité et de charme à la première partie. Même si – sauf erreur de notre part –, les deux livrets ne font pas mention des conditions d’enregistrement par Paul Baluwé, ces six premières minutes donnent l’impression d’un enregistrement réalisé dans l’énergie d’une séance brève privilégiant la prise « sur le vif » plutôt qu’un abus de patch.
C’est dire si l’auditeur vicieux que nous sommes aussi, en sus du critique snob, attend de tester l’interprète dans la fugue prise avec allégresse mais sans précipitation – en témoignent les ornements choisis avec goût et distribués avec parcimonie, ou les options de partition comme ce la aigu à 2’35 quand d’autres versions auraient privilégié un sol (ça, c’est pour montrer que l’on a écouté, sinon ça fait vraiment davantage promo que critique). Force est de constater que Jean-Luc Thellin évite l’écueil de la récitation, qui consisterait à déverser sagement un propos convenu. En effet, le discours est régulier mais il respire, par ex. quand le son est coupé un peu plus tôt qu’écrit pour préparer l’arrivée d’une nouvelle phrase. Ni précipitation, ni facétie, mais çà et là des audaces éclairant le propos (trait de pédale coupé donc boosté ensuite, piste 2, 2’59 ; main gauche jouée quasi détachée à 4’57, sans doute pour éviter un fond sonore uni qui noierait le ressassement obsessionnel du thème entonné à la main droite ; insistance sur des notes inattendues, tel ce mi bémol à 5’49 secouant l’auditeur dans la péroraison ultime, comme si cette relative majeure du sol mineur préparait, presque inconsciemment, la « tierce picarde » à venir). Un regret : le fade out rapide, qui traduit sans doute la faible réverbération de l’église ; mais, à l’évidence, une interprétation qu’il était pertinent de placer en ouverture de bal, tant elle met en appétit.

Or, la saga suivante ne s’annonce pas moins passionnante. Jean-Luc Thellin opte pour les remix de cantates connus sous le titre de « chorals Schübler » (BWV 645-650), du nom de l’imprimeur. Saute d’époque, puisque la pièce précédente datait de 1720 et celles-six de 1740, mais cohérence puisque les six chorals bestofisent des airs écrits « entre 1724 et 1731 » donc, à une vache près, pas si loin.
C’est le tube dit « Choral du veilleur » qui sert de péristyle à cet édifice. Par souci de ne pas baguenauder sur le chemin de ce redoutable trio, l’interprète peut parfois donner l’impression de hâter plus que de raison la main droite. Sans doute cette impression naît-elle d’avoir écouté d’autres versions moins dynamiques ou plus réverbérées ; cependant, l’on imagine que la so-called bousculade fait surtout écho au texte de la cantate BWV 140, qui appelle clairement les endormies à se secouer les saucisses : « Wo seid ihr klugen Junfrauen? Wohl auf, der Bräutgam kömmt! » (Où êtes-vous, sages vierges ? Debout, le fiancé arrive !). C’est cette nécessité à se presser à la rencontre du « Bräutgam » sacré que joue Jean-Luc Thellin, rappelant qu’exécuter un golden hit exige aussi de l’interpréter. Même énergie pour la supplique du BWV 646 où le pêcheur désespéré cherche à soulager ses angoisses grâce à « ein Gnadentröpflein fliessen » (une ’tite goutte de pitié, j’traduis approximatif). La conjonction entre les tourments et l’aspiration à la rédemption s’exprime par le paradoxe d’une pédale de 4’, c’est-à-dire au son aigu, à laquelle le musicien ajoute un cornet de 2’, envoyés à la lutte mystique pour colorer le Fagott de 16’. Outre la dextérité du musicien, c’est donc l’usage intelligent de l’instrument utilisé qui est ici appréciable.
« Wer nun den lieben Gott » poursuit dans la veine dynamique pour rappeler que « celui qui croit au Dieu tout-puissant n’a pas construit sur du sable ». Au quintaton du troisième clavier répond la pédale en quatre pieds, enrichissant le voyage sonore de l’auditeur. « Meine Seele erhebt den Herren », autrement dit, le Magnificat, explore les fonds en les faisant dialoguer avec la sesqualtiera. « Ach bleib bei uns » supplie le Seigneur d’accorder au fidèle un don pas évident : le « Beständigkeit », le don de constance. Jean-Luc Thellin rend ce trio comme il se doit, avec des fonds puissants et un solo déjà expérimenté dans la fantaisie d’ouverture – cette fois, la flûte renforce le corps du son quand le bourdon liminaire valorisait la décomposition d’un simili-cornet, presque tremblant, en 4/3/2. L’artiste ne se détourne pas de son option directe, sans ritendo, non pas comme une démonstration technique mais comme une interprétation musicale de l’exigence de foi du croyant, stipulée par le texte, qui veut garder vivants « Wort und Sakrament » jusqu’à son dernier souffle. En dernière position de la série, « Kommst du nun, Jesu » s’inspire de la cantate BWV 137, laquelle ne contient pas ce texte mais demande aux « Psalter und Harfen » de se réveiller pour laisser sonner la musique. Dès lors, l’interprète a fort à faire, créant pour l’occasion une registration qui associe des fonds, un 8/4/3 au grand orgue et une pédale en tirasse 4. Le tout est faussement léger, réellement maîtrisé et totalement joyeux, concluant une exécution des Schübler où le sens l’emporte sur l’effet facile ce qui n’est pas, on l’aura compris, sans paraître pertinent.
Le faux diptyque BWV 539 associe un prélude manualiter à une fugue colossale, que Bach « a transposée en démineur », dit la notice (faut pas demander une relecture à des correcteurs qui n’y connaissent rien et confondent d mineur ou ré mineur avec un film hollywoodien, voyons – même réflexion pour le plenum A 5 qui est un plenum à 5 et non un plenum en demi-A4, ou pour cet étrange buxtehude évoqué en bas de casse autour de la BWV 565). Voici venue l’occasion pour l’organiste de jouer sur une registration minimaliste : bourdon et quintaton de 8 pour le prélude, flûte de 8 et prestant de 8 (avec tirasse sur la flûte). Deux intérêts pour l’auditeur – d’une part, assumer que, malgré sa génétique, ce diptyque est un diptyque, donc unifier la registration sur des quasi fonds fait sens ; d’autre part, remettre au centre du projet son originalité, en l’espèce son désir d’explorer des orgues exceptionnelles au gré de chaque ensemble de pièces rassemblé dans un disque. Or, un instrument ne se goûte pas que par son plenum le plus brillant. Explorer ses huit pieds mettrait certes en danger un interprète friable, sans le filet du brio sonore, mais le danger est ici absent ; en réalité, cette proposition sonore permet à l’auditeur d’en attendre davantage de la Bête. Plus encore, l’organiste semble avoir effectué des recherches musicologiques que son livret n’évoque pas, justifiant des variantes comme le la aigu tenu mesure 21 alors que les éditions traditionnelles le constituent en deux croches détachées. Cette volonté de précision alimente un discours très clair en dépit d’un prestant qui semble inégalement harmonisé (les graves explosent en contraste des médiums) ; pourtant, la clarté du rendu n’est en rien la traduction de la photographie de Jean-Luc Thellin, ci-dessous, genre beau gosse sage et posé : il est habité en profondeur (écoutez les choix de toucher de la pédale : tantôt trois fois plus posée que dans les éditions habituelles – troisième temps de la mesure 39, tantôt parfaitement raccord avec le legato de la main gauche, 3’25 ou 4’27). Bref, tout cela n’est pas juste une piste de plus accrochée à l’intégrale Bach, mais bien la continuation d’une proposition minutieusement préparée, pensée et réalisée ; et l’on se réjouit que le résultat soit à la fois grand public – car exécuté sans pari prétentieux gageant que l’interprète prime sur le compositeur éventuellement à coup d’arguments pseudo musicologiques – et parfait pour les organomaniaques, car les options de l’artiste sont à la fois incontestables et tout à fait subjectives.

La Partita « Sei gegrüsset, Jesu Gütig » BWV 768 salue Jésus le bien gentil avec un refrain, selon le texte du choral : il est bon de se pomponner avec l’amour du tout-puissant et de mourir dans cet amour tout-puissant (je synthétise à peine). L’interprète solennise le choral servant de péristyle en offrant une partie de cette pièce manualiter à la pédale associant un 16’, donc grave, au jeu du clavier. Les variations s’articulent ensuite autour d’un évident plaisir à faire frétiller les jeux cachés de l’orgue. Règnent les fonds discrets et les flûtes de 4’ en solo (associées ensuite, c’est malin, au quintaton et à la « quintfluit » de 3’) avant qu’une anche n’éclaire la cinquième variation comme pour mieux contraster avec la sixième variation, développée sur un seul clavier. Les mixtures sortent pour la septième variation à trois parties. La huitième variation indiquée à 24/16 comme un bon vieux blues à 12/8, est l’occasion de goûter la jolie « openfluit » de 4’ autant que l’aisance de l’interprète. La neuvième variation décale la pédale dans l’aigu du grand orgue reproduit le cornet composé dès la fantaisie première (bourdon 8, flûte 4’, Nasard 3’, Sifflet 2’). Avec une juste solennité, l’affaire se conclut sur un petit tutti, solennel à souhait, préparant l’auditeur au mégatube qui l’attend.
En effet, les Toccata et fugue BWV 565 qui concluent le disque sont à l’orgue ce que la Joconde est à la peinture. Ces 9’30 seront parcourues sur un même plein jeu – toujours ce désir de cohérence et d’unité de couleurs pour mieux laisser la place à la musique plutôt qu’à la magie éblouissante des variations de sonorités, susceptibles de distraire l’auditeur. Dès la toccata, on est saisi par l’association entre rigueur de l’interprétation (doubles parallèles) et liberté de l’inspiration (respirations éclairantes sans être démonstratives, création d’espaces silencieux, arythmies sporadiques et précises dans les lancements ou arrivées de traits en triples croches). La fugue, elle, ne finasse pas : son début va droit, grâce à un tempo allant qui évite judicieusement la tentation de la cavalcade ou l’ensuquement dans la majesté du bariolage. L’attention au texte (la de la main gauche omis par les éditions courantes, à 0’48) est couplée avec à une réalisation soignée (légèreté des doubles répondant au trait de la pédale, 1’15 ; ornementation virtuose, 3’38) n’empêchent pas les effets d’attente contenus avec art et les choix juste en matière de lié-détaché qui pimpent une scie ainsi, ha-ha, débarrassée des excès de show-off dont elle a plus d’une fois été affublée – et dont l’adaptation comique par Cameron Carpenter est une caricature assumée. Cette version, sérieuse, rappelle que la Toccata et fugue par excellence, pourtant peut-être pas de Bach et sans doute pas pour orgue à l’origine, n’a pas besoin de grandes embardées pour bien sonner ; elle convient idéalement à une intégrale dont le premier volume, en résumé, signale en fanfare l’arrivée magistrale d’un p’tit presque-jeune dans une discographie pourtant pléthorique. Une telle audace, une telle technique, une telle qualité du son engagent le critique à pousser les curieux à se risquer ici pour découvrir de plus près le phénomène Thellin.

