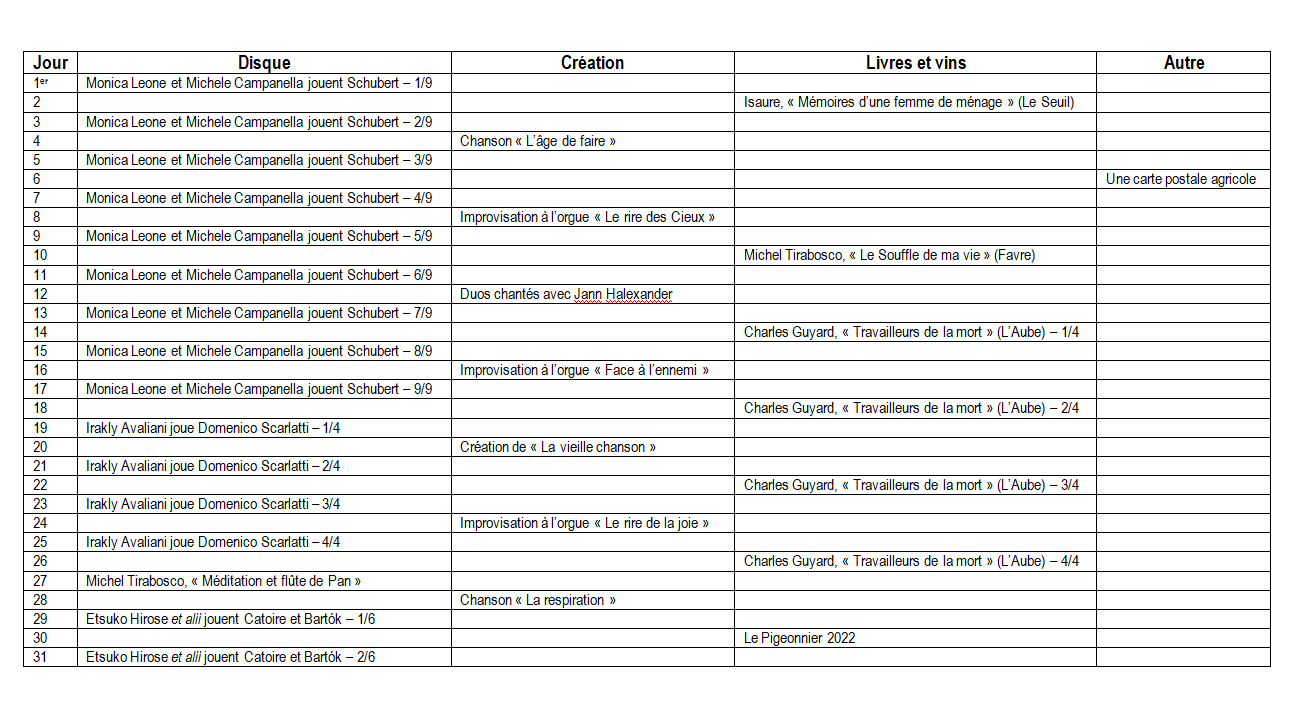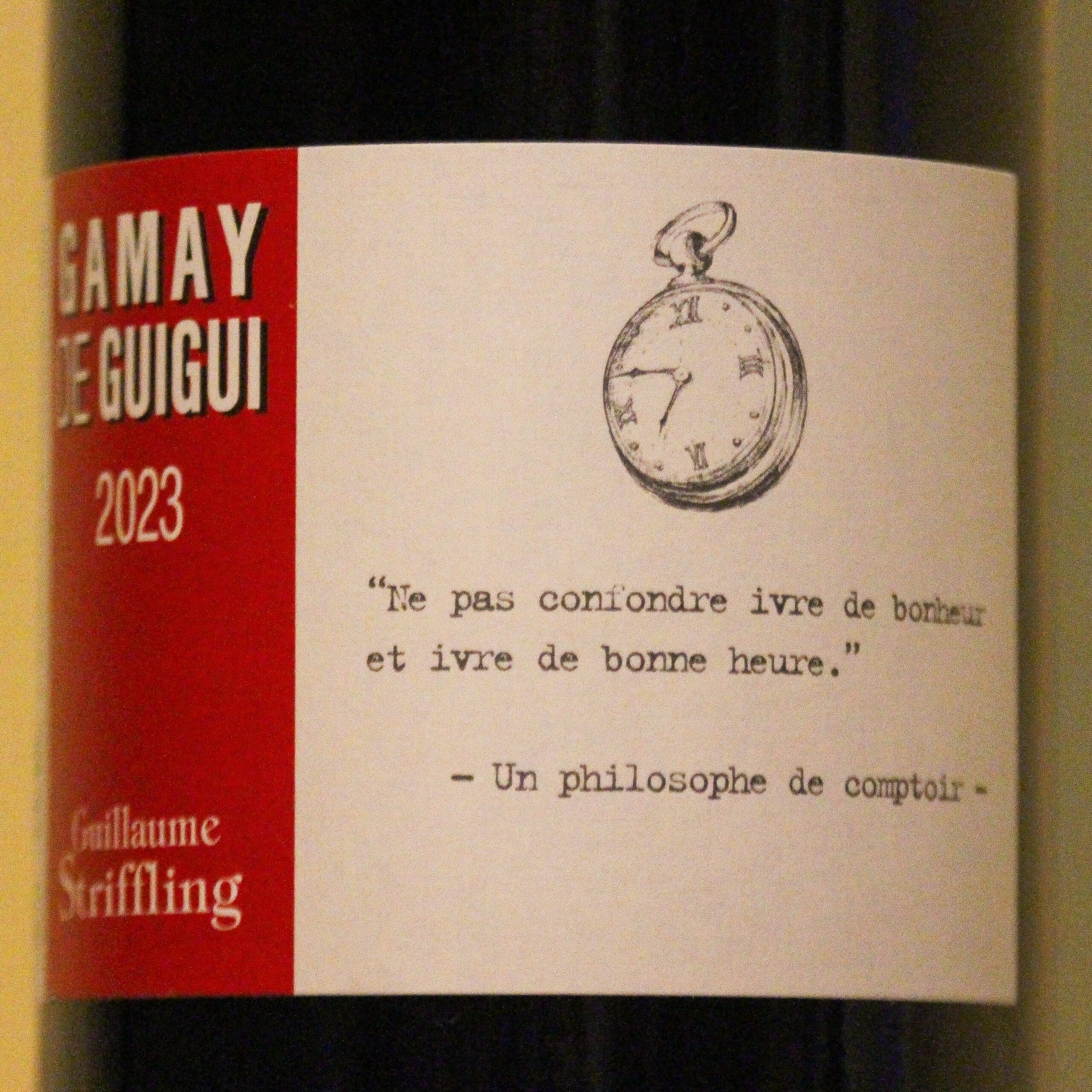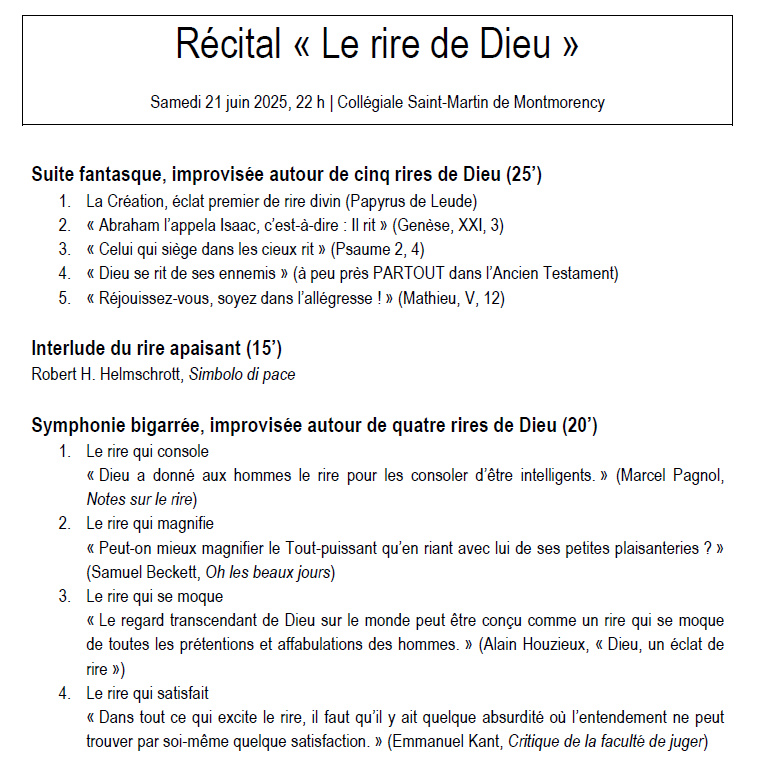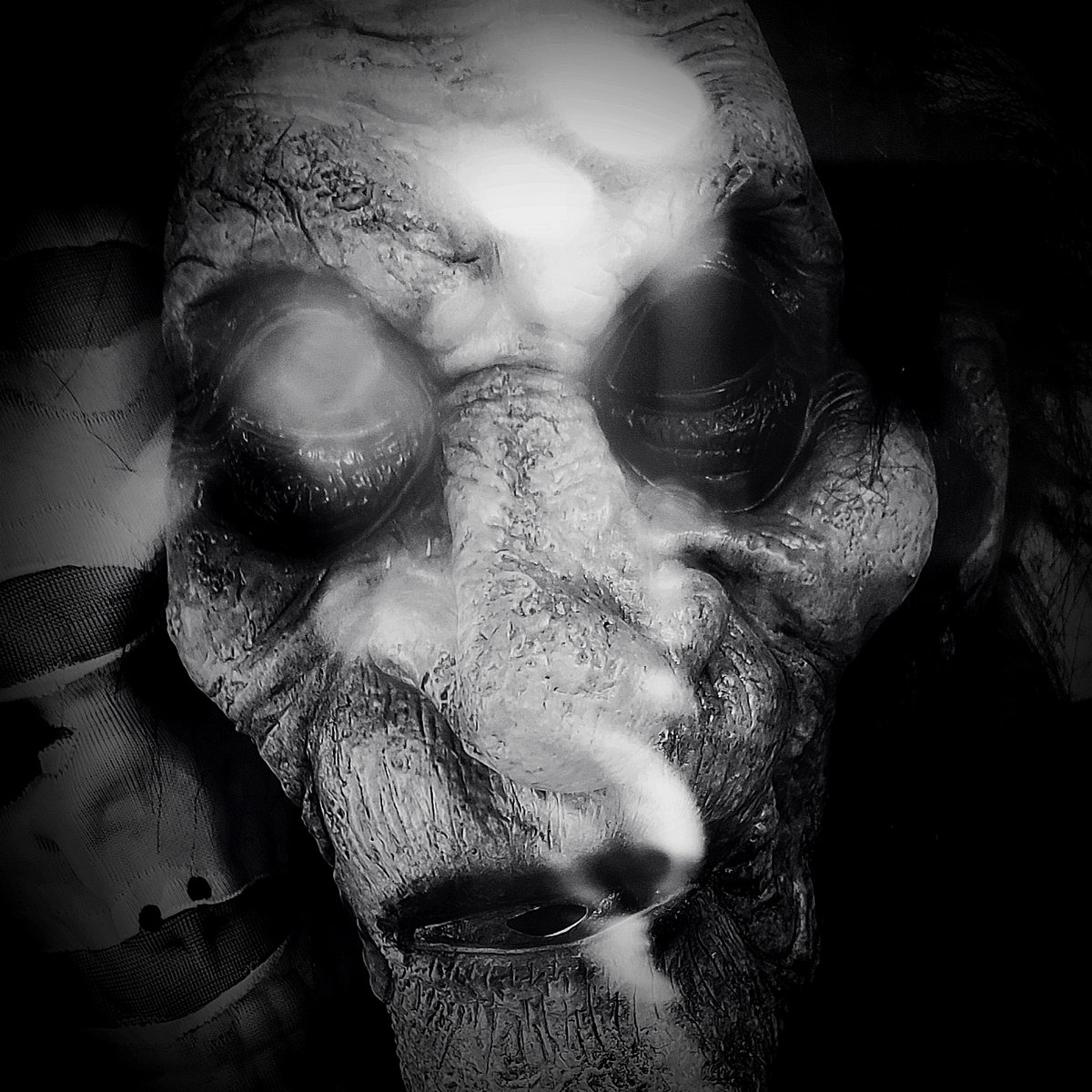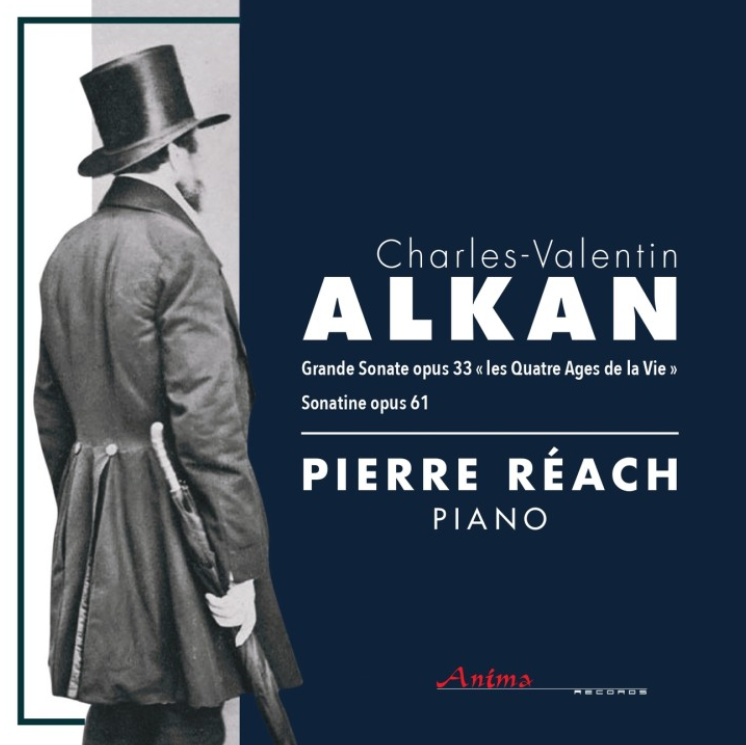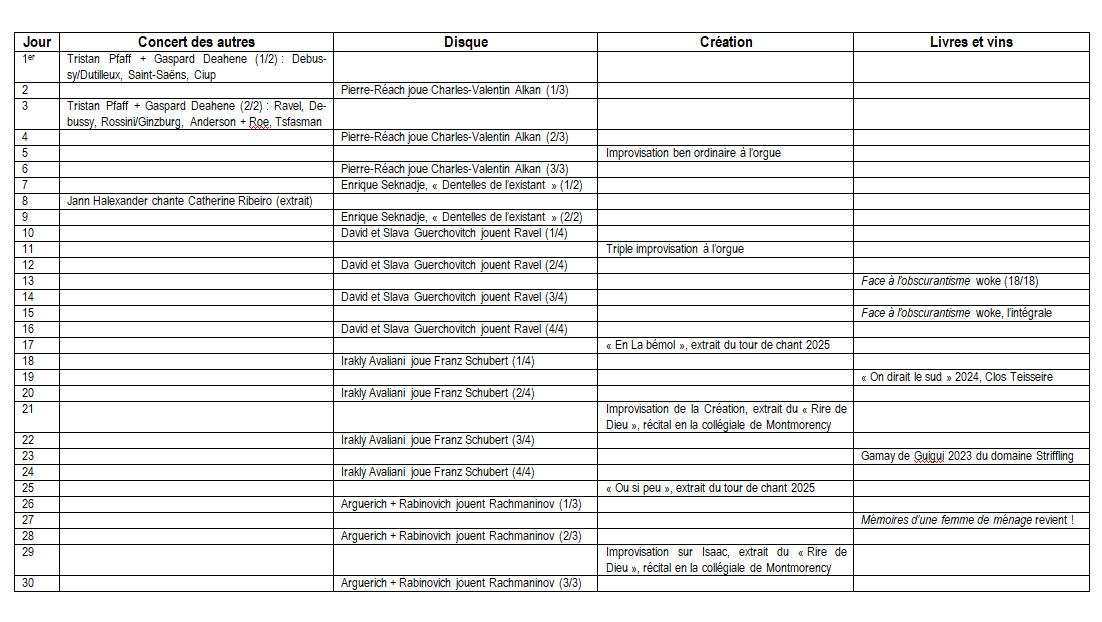Programme quasi jazz pour l’Orchestre national d’Île de France, ce vendredi d’octobre : Gershwin et Ravel sont au menu, à un prix défiant quasi toute concurrence (en gros, moins de la moitié des prix habituels).
Sous la direction de Wayne Marshall, qui est à Denzel Washington ce que Paavo Järvi est à Vladimir Poutine, le concert s’ouvre sur la brève ouverture (4′) d’Of Thee I sing de George Gershwin. D’emblée, on note un souci du swing que manifeste la réussite des nombreux breaks (changements de rythme) exigés par cette bande-annonce où le compositeur laisse entrevoir des thèmes qu’il développera dans son musical. Le Concerto pour piano et orchestre (30′) qui suit est un morceau plus conséquent, avec, originalité, le chef d’orchestre au piano. De nouveau, la précision des changements de battue séduit. L’orchestre a proposé ce même programme quatre fois en banlieue avant de se frotter aux micros de France Musique ce soir-là. Avec de solides répétitions, c’est sans doute ce qui explique l’efficacité de ces ruptures bien menées et vitales dans un Concerto qui, pour l’auditeur, a malgré tout quelques « tunnels » peu stimulants. Le long deuxième mouvement semble se diluer faute de direction, et les nuances ne sont pas assez diversifiées pour capter l’auditeur. Le chef-pianiste fait ce qu’il peut pour dynamiser le troisième et dernier mouvement, mais on soupçonne que l’absence de direction complète incite l’orchestre à la prudence et le limite dans ses contrastes sonores. Après un bis rag et blues à souhait, il est temps d’attaquer la pause chips-jambon beurre-Coca (ou couscous-Boulaouane, chacun sa came).
La seconde partie du concert glisse du côté de Maurice Ravel, mort la même année que Gershwin (sauf selon le programme qui, à plusieurs reprises, le donne mort en 1837 : vu le peu de texte à relire, est-ce bien raisonnable de payer des gens pour cela, s’ils ont tout loisir de laisser pareilles coquilles, avec un « q » ?). Le Tombeau de Couperin (18′) déroule ses danses (festons du prélude, forlane, menuet, rigaudon) avec une nette volonté du chef de bien caractériser les différents rythmes. L’aspect un brin systématique de cette composition (soli de différents pupitres, variations parfois un brin répétitives), qui pointe sous des syncopes plaisantes et des harmonies séduisantes, est bien masqué par une dynamique qui rend raison de l’aspect chorégraphique de la pièce. La faiblesse de certains solistes (la trompette de Nadine Schneider semble à la rupture – peut-être la conséquence d’une prise de risques jolie mais pas tout à fait maîtrisée dans les piano ?) et une certaine retenue dans les tutti atténuent légèrement – sans le remettre en cause toutefois – le plaisir d’écoute. Vient alors le tube du Boléro, et cette surprise préparée par l’homme à la caisse claire : un rythme liminaire lancé à fond les ballons. Pas sûr que cela était prévu, mais l’effet est saisissant. Bon gré mal gré, l’orchestre suit cette option de course en avant, d’allant, de force en mouvement. Cette option héroïque, que nous n’avions jamais entendue, nous paraît d’autant plus pertinente que l’orchestre peine à sonner avec puissance comme certaines grosses formations osent le faire. Aussi cette vivacité, légère et euphorisante, redynamise-t-elle la scie aux oreilles des auditeurs. Lesquels peuvent, dès lors, regretter un manque de tension musicale (mais non un manque de couleurs) et de corps dans le plenum final, enlevé sans rubato. Mais c’est là l’option choisie par l’homme à la caisse claire et adoptée, forcément, par Wayne Marshall et ses complices. Pour les fanatiques de gros orchestre sérieux, une version alternative ; pour le spectateur curieux et gourmand, une interprétation gouleyante comme un vin jeune et agréablement râpeux.
En conclusion, un programme dynamisant joué avec originalité par un orchestre motivé sinon parfaitement épanoui – bref, une bonne soirée.