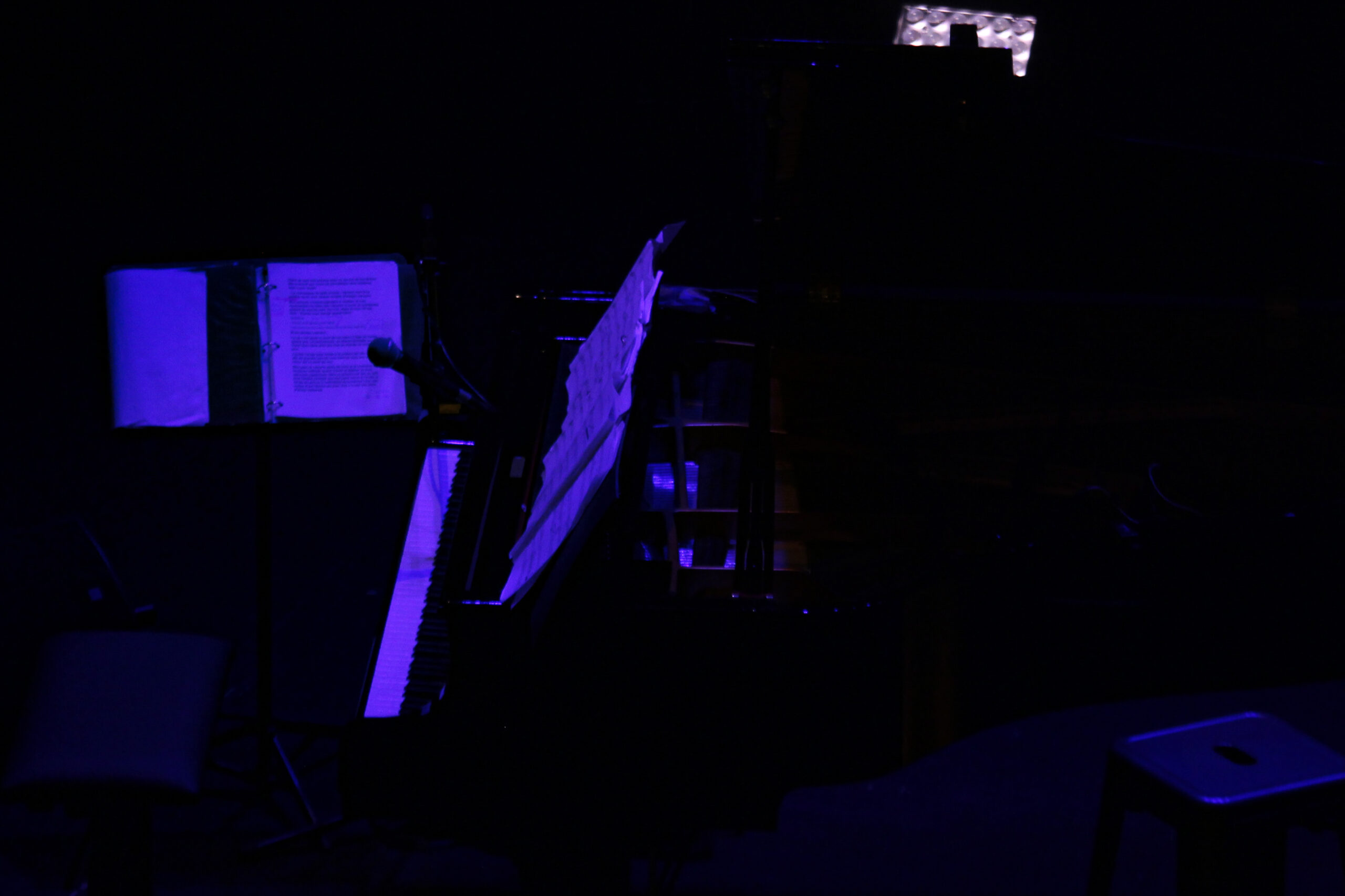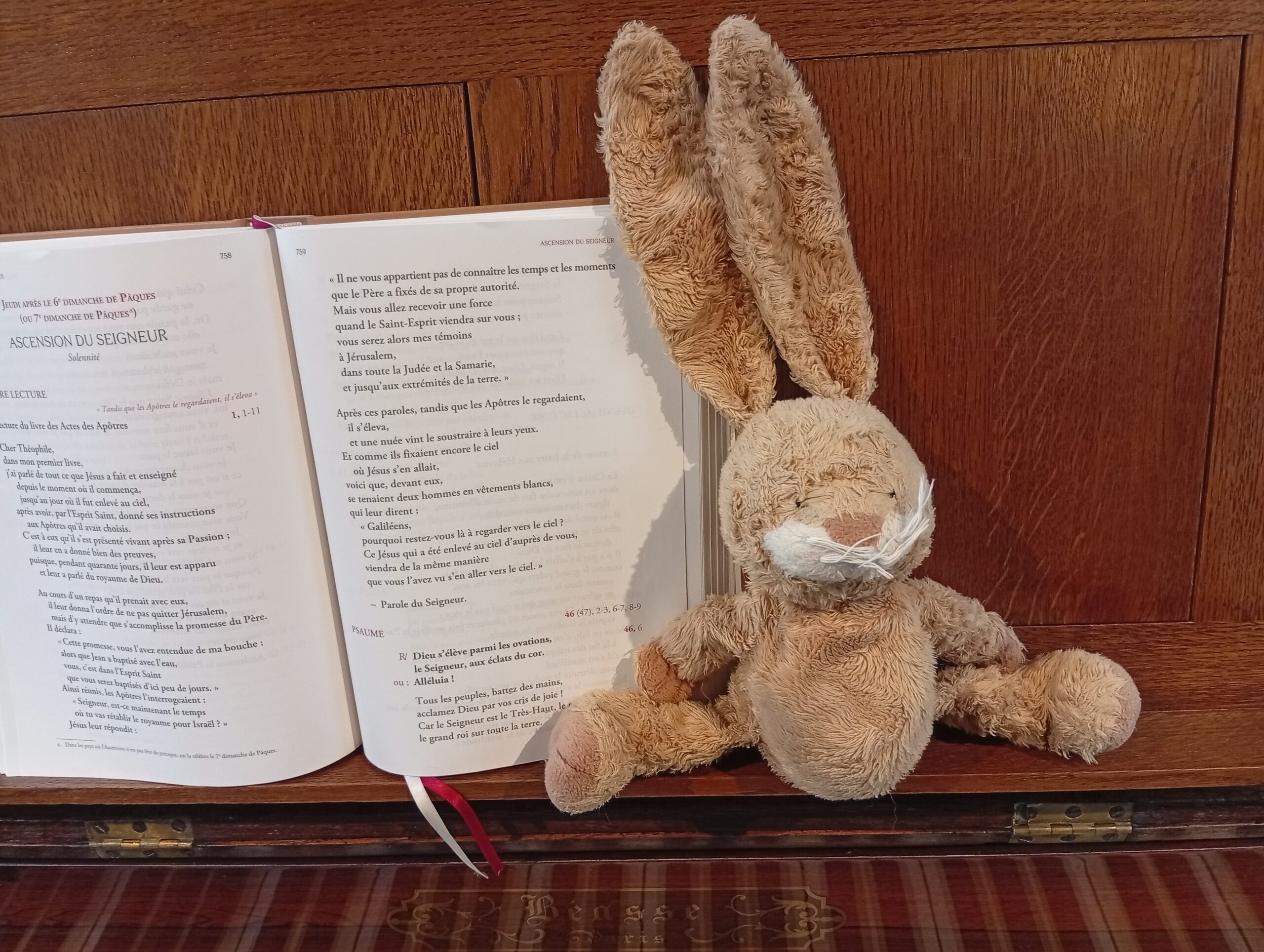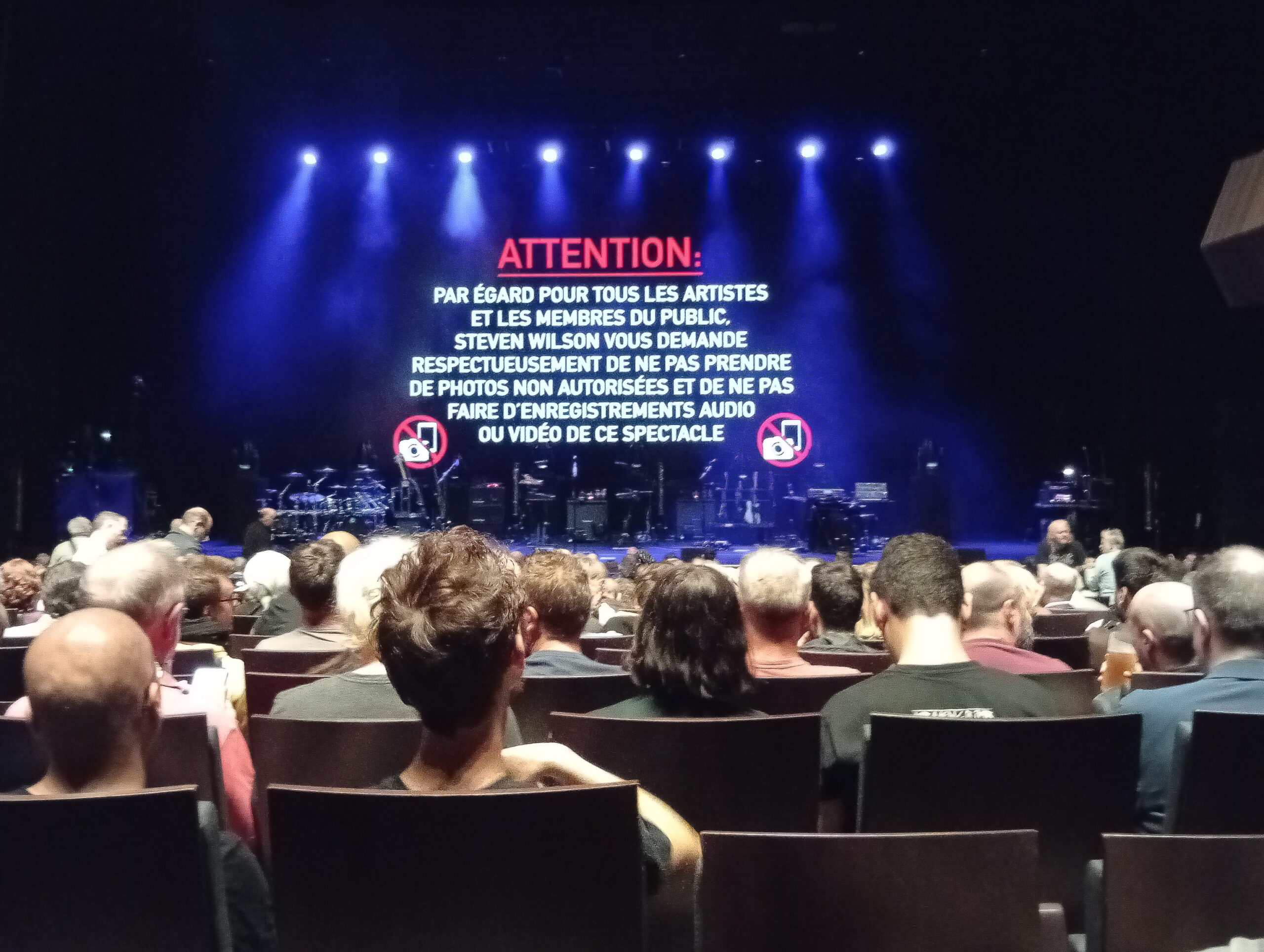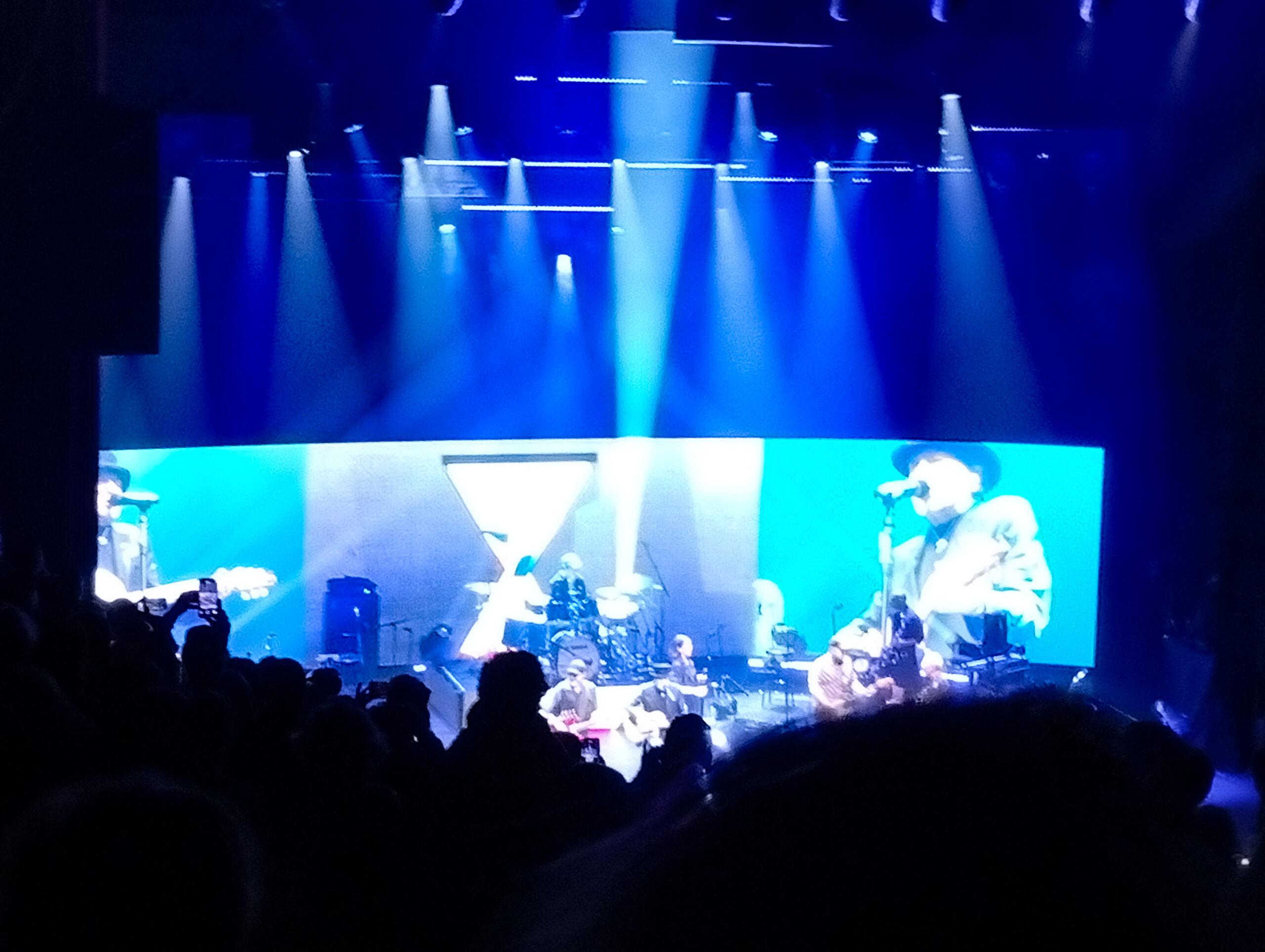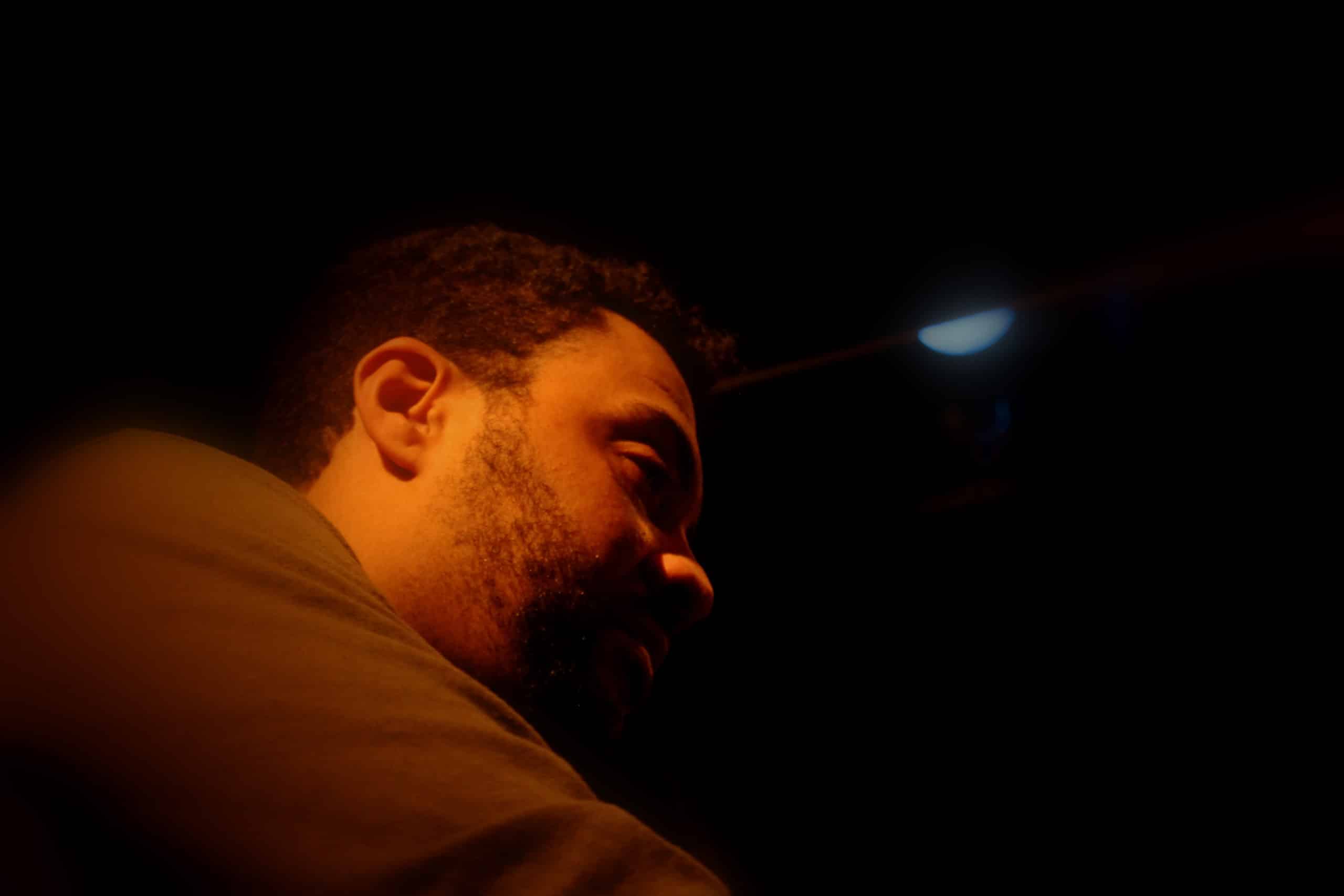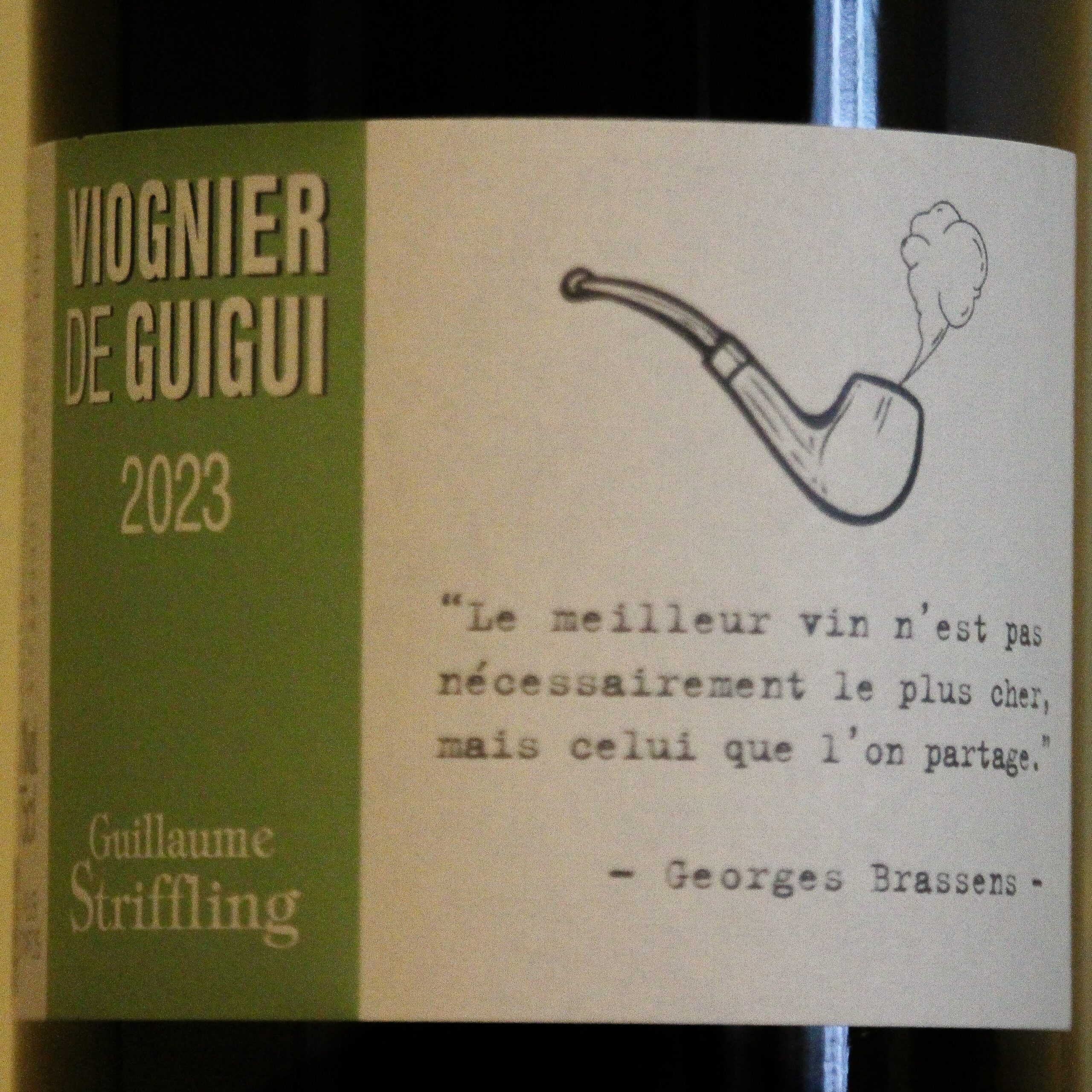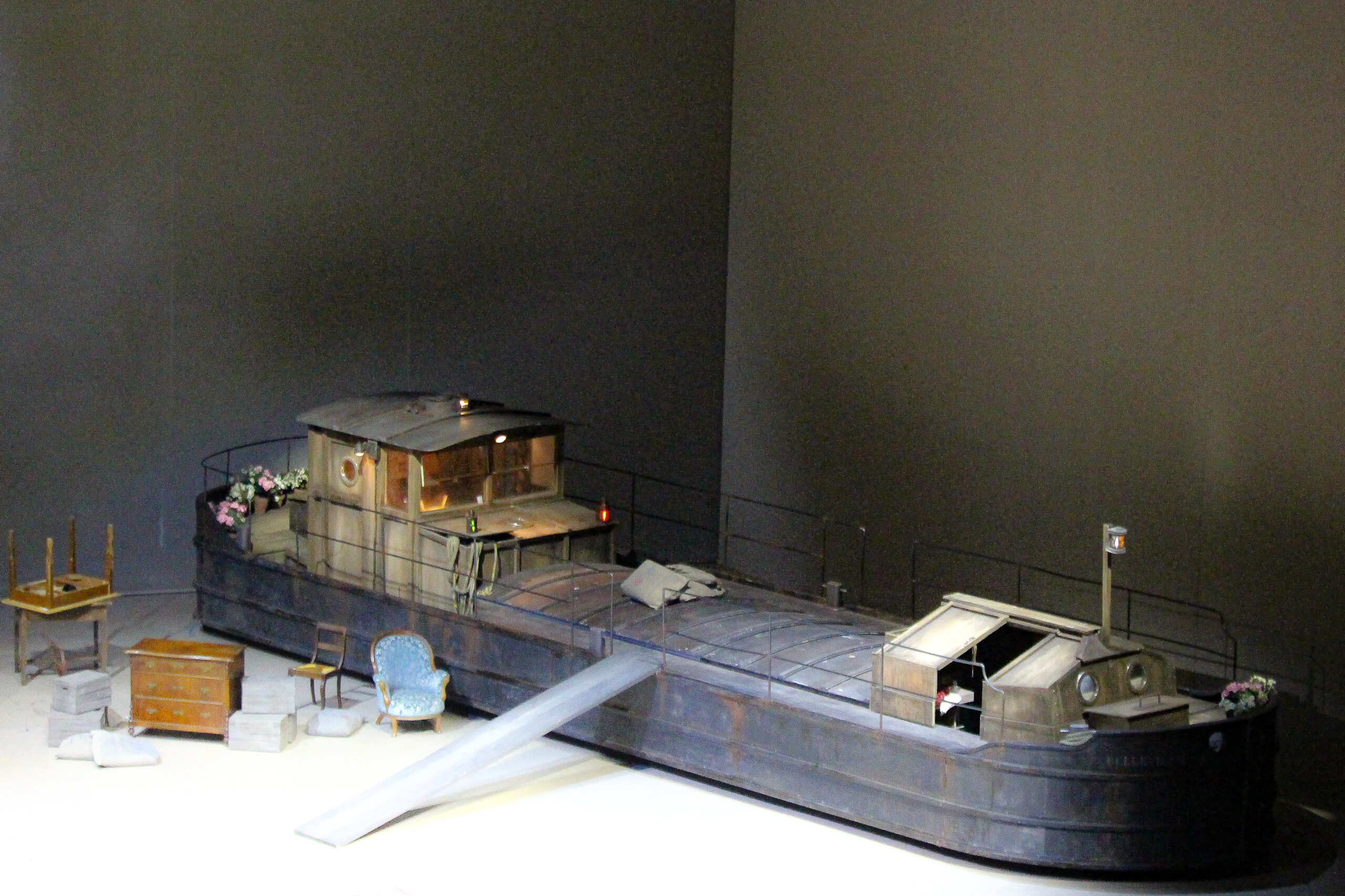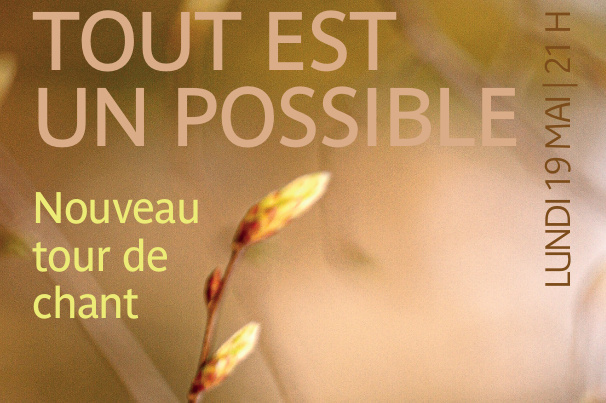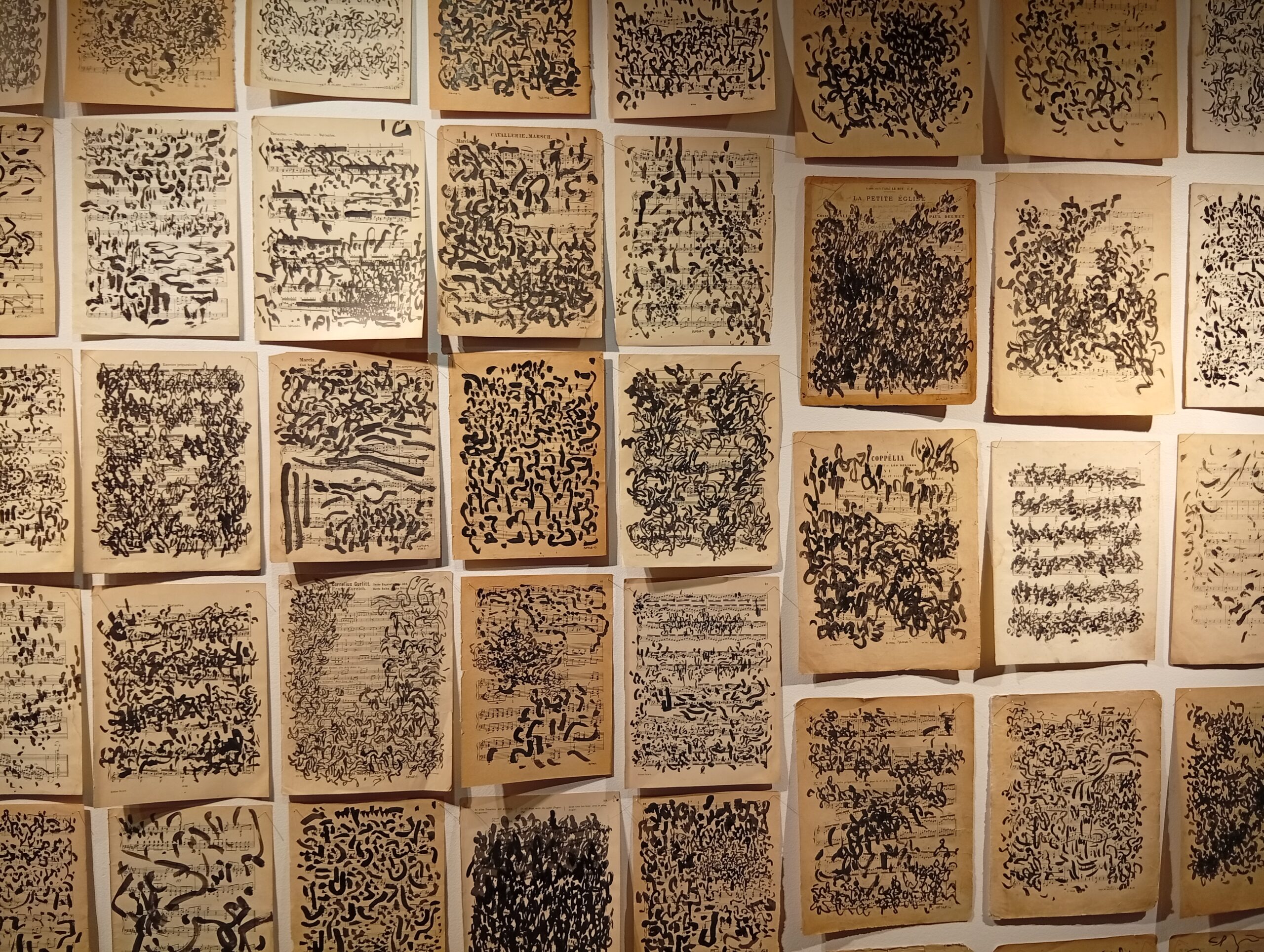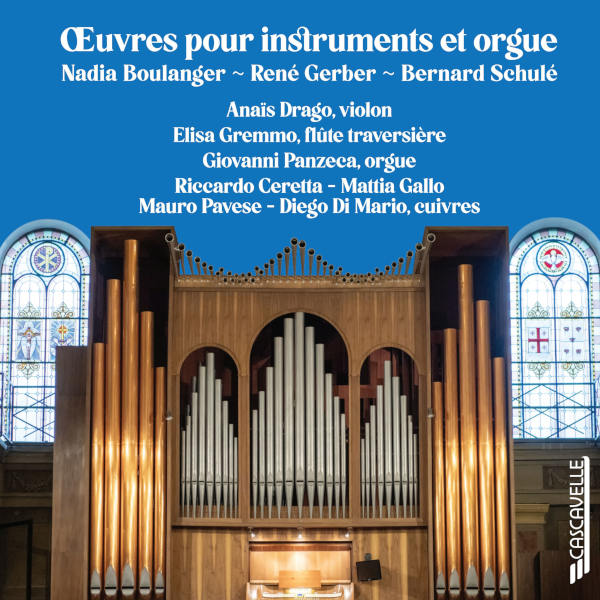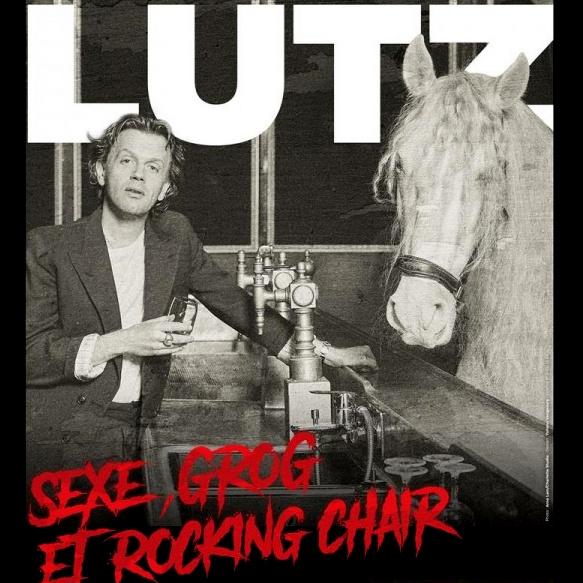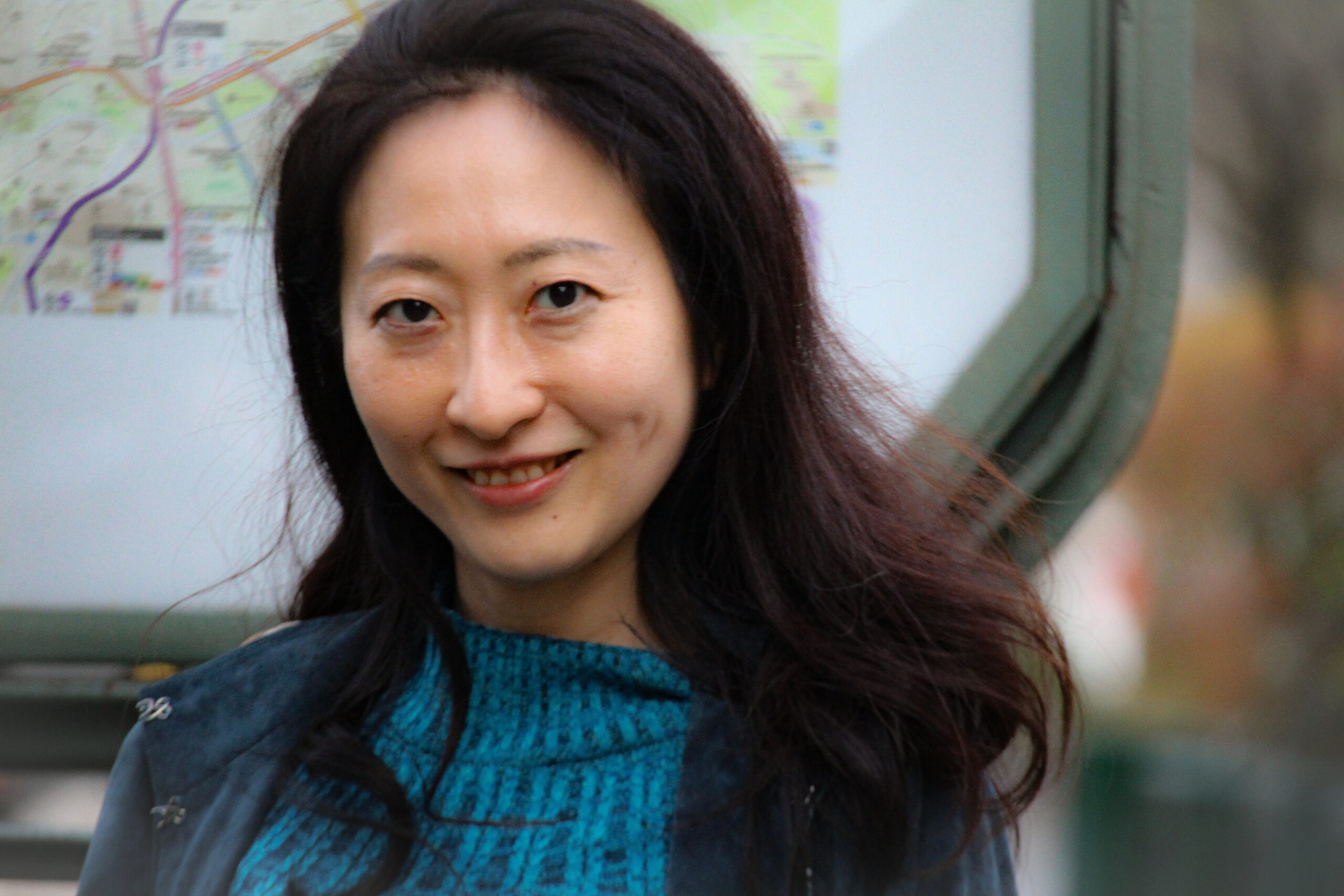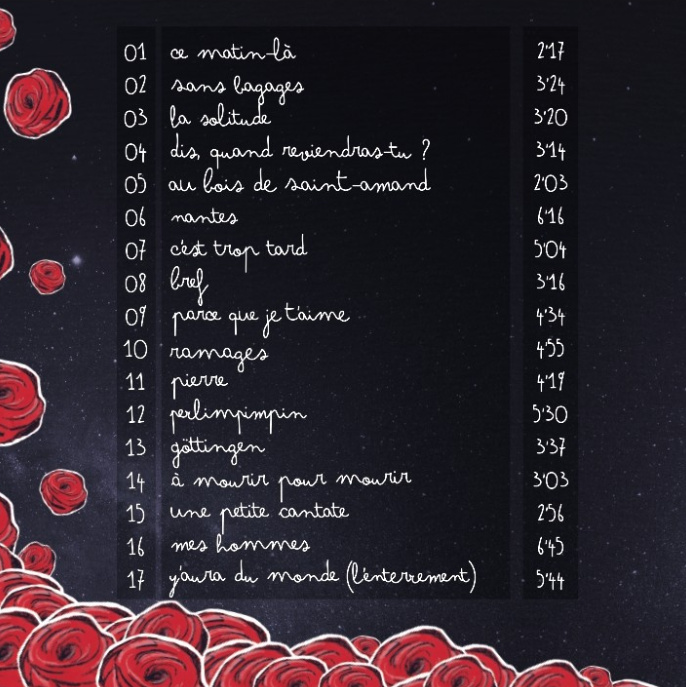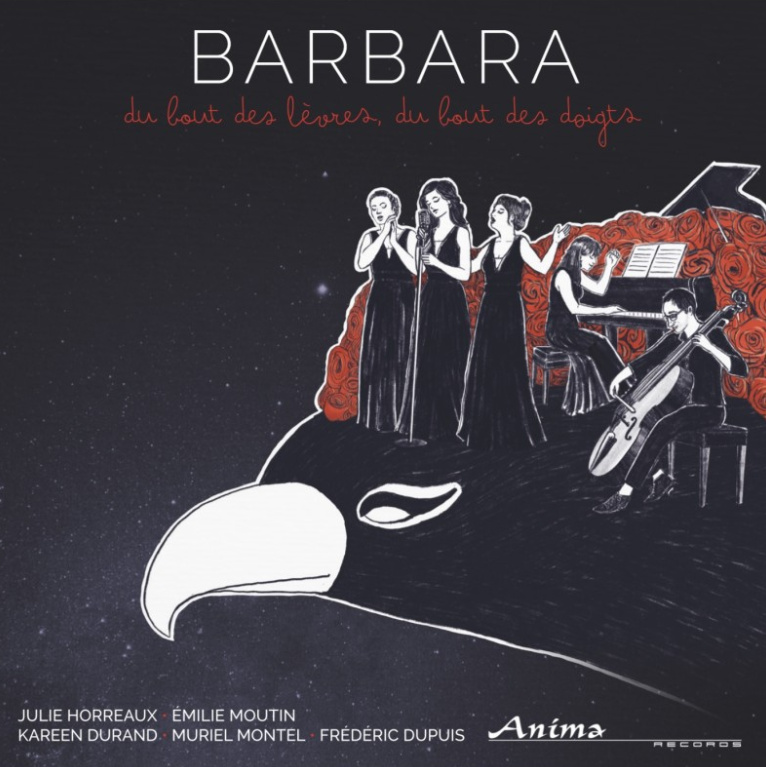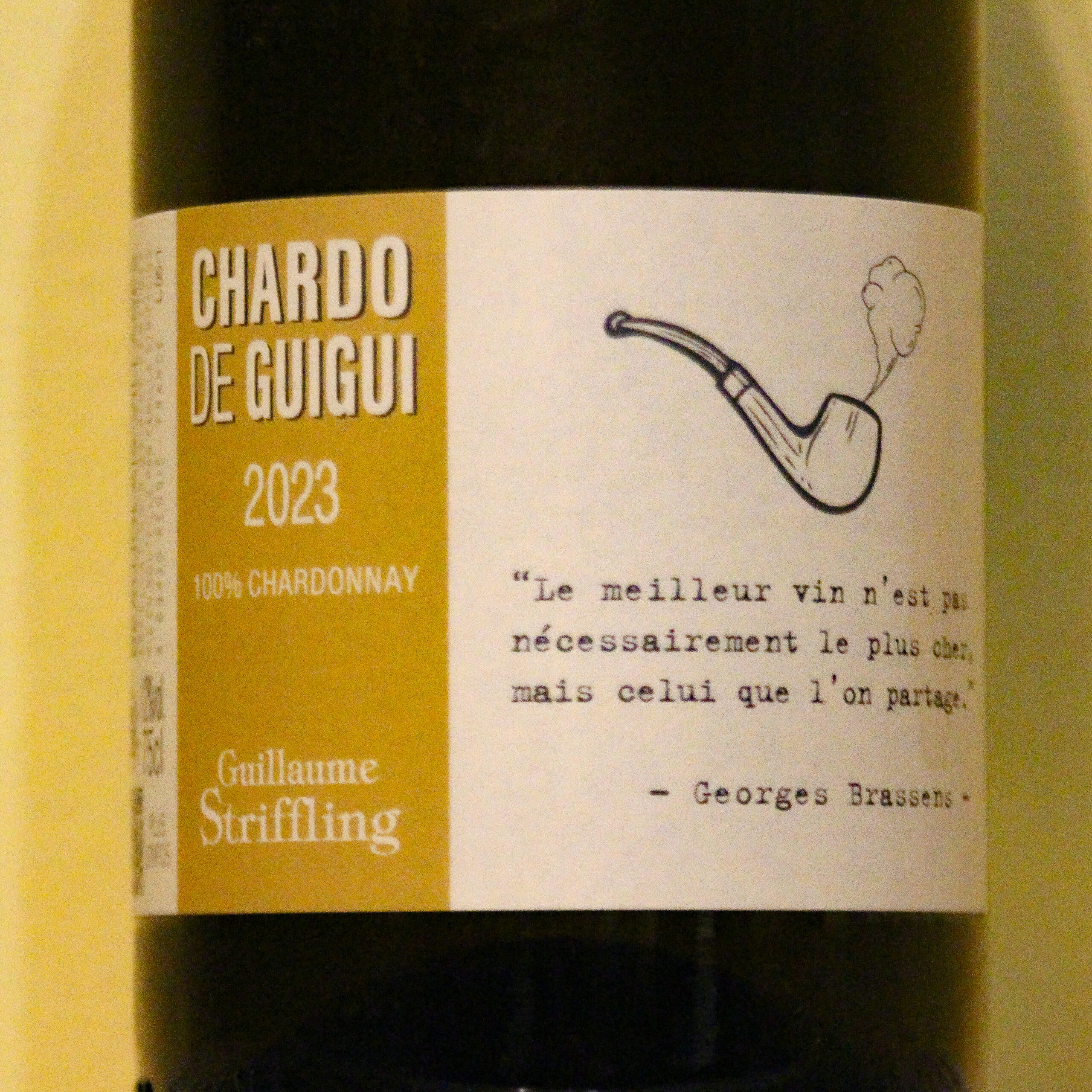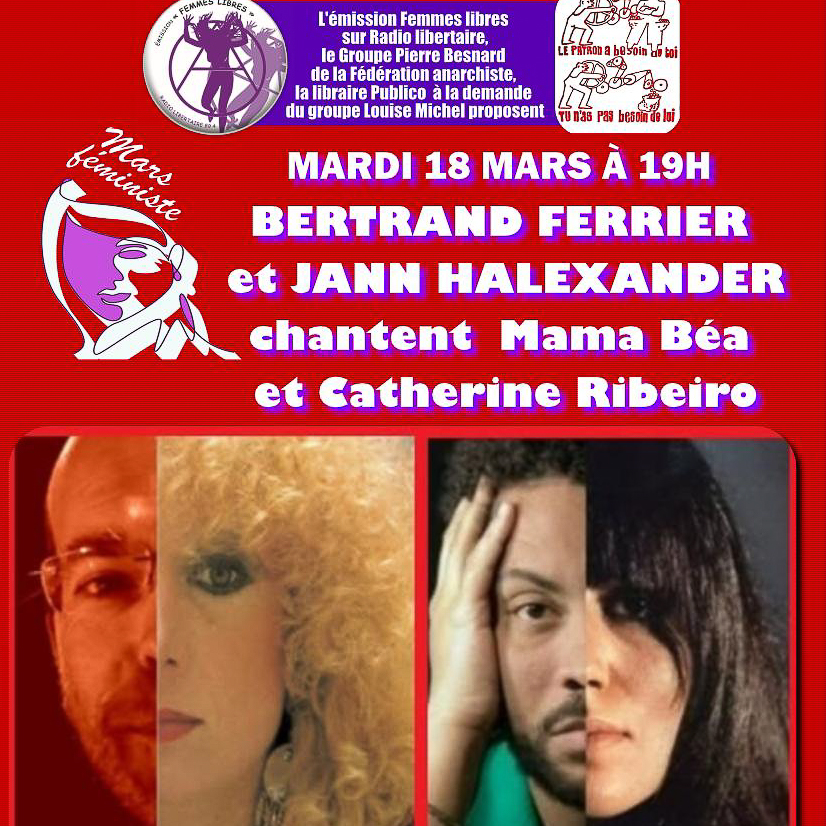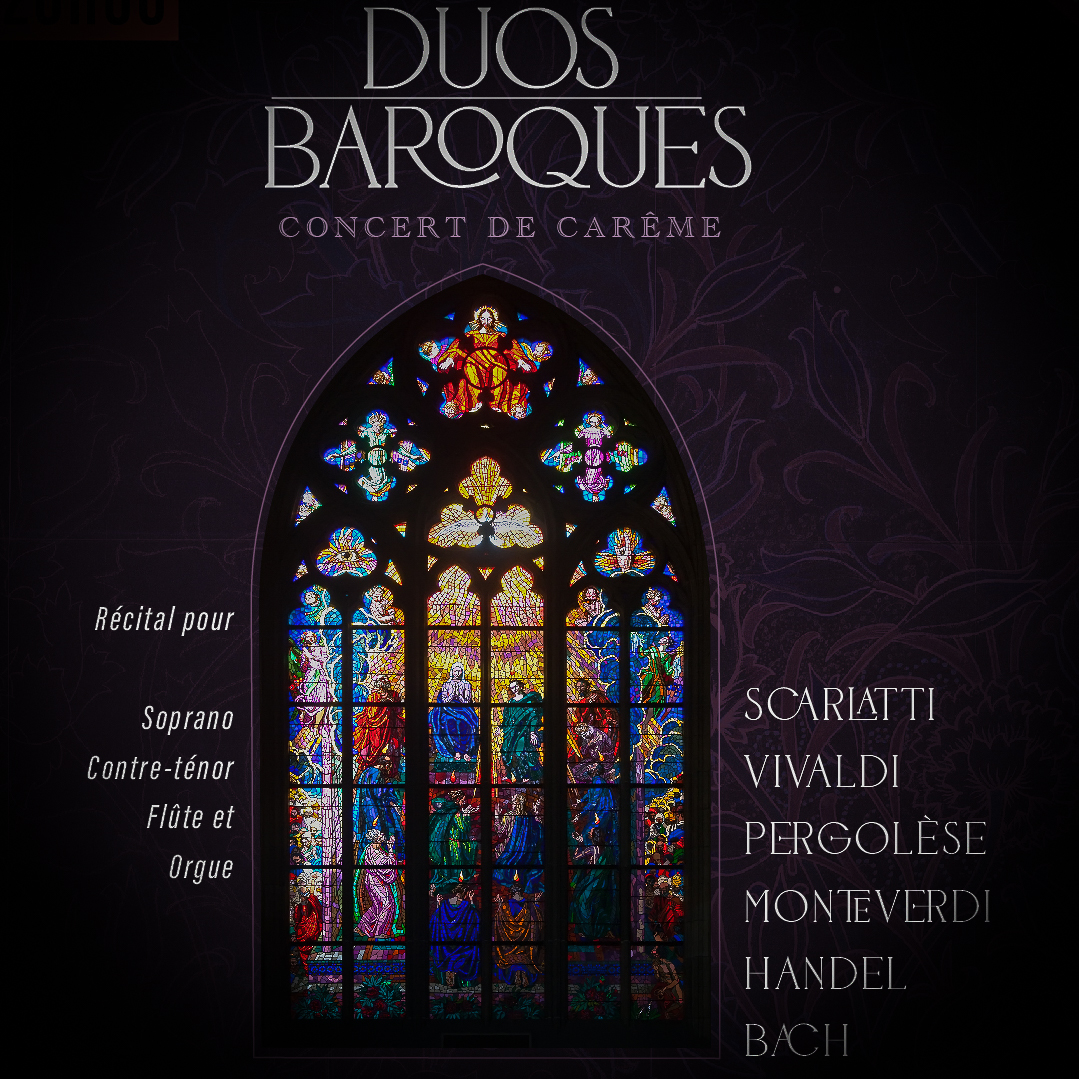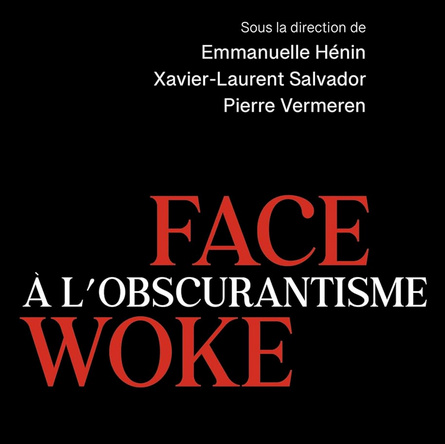
Le wokisme est une forme de lamento perpétuel, enfermant ses adeptes dans des postures victimaires souvent intéressées. Ainsi, récemment, l’annulation d’un projet d’exposition au centre Pompidou-Metz a ajouté un énième couplet à cette chanson. Claire Tancons, commissaire dudit projet, y a vu une préférence accordée à la « monographie d’un artiste européen [entendre :Blanc, en l’espèce il s’agit de Maurizio Cattelan] face à une exposition collective d’artistes racisés [caribéens] souvent relégués au second plan de l’histoire de l’art et des musées ». Le commanditaire lui oppose trois arguments :
- le succès de l’exposition Cattelan est une bénédiction pour l’institution ;
- l’exigence de la commissaire en matière d’emplacement disponible n’a cessé d’augmenter ;
- devant ces prétentions, l’équation budgétaire est devenue intenable.
Cet argument aurait pu être entendu par Claire Tancons, qui ne semble pas indifférente à la monnaie. Il est même probable que l’aspect pécuniaire joue fortement dans l’accusation de racisme qu’elle porte car, en sus
- des 100 000 € touchés grâce à la Ford Foundation par son « association » et officiellement « alloués aux recherches et aux voyages » de la commissaire,
- des 50 000 € « versés [par la fondation] pour abonder sa rémunération », et
- des 26 000 € « alloués par le Centre Pompidou-Metz pour ses honoraires »,
elle escomptait fort toucher un p’tit quelque chose à l’achèvement du boulot (in : Le Monde, 21 juin 2025, p. 25). Dame, le magot est souvent un bon carburant pour les indignés intéressés… Dans cette perspective des procès en racisme et mépris divers, le succès des thématiques woke intrigue par
- l’importance des stéréotypes qu’il charrie tout en dénonçant le rôle des stéréotypes dans les haines individuelles et collectives,
- la bêtise crasse et assumée qui anime ou qu’adoptent nombre de ses représentants, signe que l’intelligence est un luxe inutile pour convaincre des déjà-convaincus,
- sa tentation d’imposer des éléments de langage à l’ensemble des citoyens et à déduire de leur relatif rejet le bienfondé de leur croisade, et par
- sa difficulté à prendre en compte ce que l’on pourrait appeler la réalité du réel.
Ce tout tantôt, le rapport annuel 2025 de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) le rappelait à deux titres complémentaires. Le premier titre concerne les phrases interdites, celles qui caractérisent les « discours de haine ». Parmi les tabous rappelés par Le Monde du 19 juin 2025, p. 15,
- « l’islam menace l’identité de la France » (même si le terme « menace » pourrait être remplacé par « modifie » : de très nombreux quartiers témoignent physiquement de cette mutation, le nier relève de l’absurde et cela n’a rien d’islamophobe, certains pourraient se réjouir de cette mutation au nom d’Allah ou de l’inclusivité),
- « les Roms exploitent les enfants » (« les Roms » est sans doute maladroit, mais le scandale devrait être l’exploitation des mineurs par de nombreuses filières roms et l’incapacité de l’État à lutter efficacement contre ce trafic, non le fait de le constater), et
- « la plupart des immigrés viennent en France pour profiter de la protection sociale » (on écrirait mieux « en venant en France, la plupart des immigrés bénéficient d’une protection sociale », ce que l’on peut juger joyeux ou choquant, selon son orientation sociopolitique).
À force de nier des évidences, le discours woke ne rejoint l’incantation du vivre ensemble que pour se décrédibiliser en tentant de substituer un voile idéologique au constat socio-anthropologique documenté par
- les faits,
- les statistiques et
- les études
et par ce que peut constater tout un chacun – la coïncidence entre le savoir des savants et le bon sens est suffisamment rare pour qu’elle soit appréciée ! Le second titre défiant la capacité du wokisme à prendre en compte la réalité du réel est que, loin d’être ces racistes délétères qu’il est de bon ton voire indispensable de vouer aux gémonies pour exalter les « communautés » souffrantes, les Français sont tolérants. C’est la CNCDH qui le pose noir sur blanc :
La tolérance des Français résiste aux discours de haine. (…) Contrairement à ce que prêchent les prophètes de malheur, décrivant la France comme un pays de camps retranchés, le socle républicain est solide.
Cela n’exclut certes point des haines dont, du reste, la supposée majorité peut être l’auteur et la victime, surtout quand la doxa insiste pour la désigner comme le bouc émissaire à éliminer ou, selon le jargon en vigueur, à « déconstruire » ; mais cela invalide la croyance en un pays dangereux pour « les minorités », croyance de base du wokiste soucieux de défendre les opprimés puisque la veuve et l’orphelin ne font plus recette.
C’est en s’appuyant sur sa perception du réel que Renée Fregosi, socialiste septuagénaire passée de la philosophie à la science politique, se lance dans une dénonciation de la « dhimmitude volontaire » en deux parties. La première partie dénonce la soumission de l’Occident aux musulmans et à l’islam, soumission qui est le prix d’une apparente tranquillité, selon le principe du dhimmi, statut réservé au mécréant payant jadis pour ne pas être massacré là où régnaient les fans de Mohammed. Selon elle, « l’islamo-complaisance occidentale tend à l’adoption d’une dhimmitude volontaire ». Elle présente la société française comme tétanisée par le « totalitarisme islamique ».
Deux conséquences : l’islamo-gauchisme et l’islamo-clientélisme, d’une part; d’autre part, l’islamo-négligence, qui consiste à trouver l’islamisme acceptable comme compensation des risques liées à l’éternelle montée de l’extrême-droite, sans doute la plus grande réussite du pétainiste mitterrandien. Le but est « la déconstruction de la laïcité » au profit de la notion d’inclusion.
Pour alimenter ces logiques, le wokisme (enfin !), dont le « point aveugle » est la « soumission des femmes en islam ». Le bras armé du wokisme serait donc le néo-féminisme qui argue que voiler les filles, c’est les libérer de la domination des hommes (pour soutenir cette thèse, Renée Fregosi cite Renée Fregosi, ce qui est moyen convainquant), propos qu’évoquait Dieudonné M’Bala M’Bala dans son sketch du « Conseil de classe » où le voile était quasi présenté – avec l’humour qui seyait alors – comme le string du Maghreb.
En fait, peu importe ce qui précède, j’espère d’ailleurs que vous ne l’avez pas lu. Ce qui intéresse l’auteur est d’arriver au cœur de son propos : « Les woke rejoignent l’antisémtisme musulman », sans évidemment préciser qui sont lesdits woke ni pourquoi beaucoup de musulmans éprouvent dans la rancœur, euphémisme, à l’endroit d’Israël. Les pages qui suivent semblent avoir été sponsorisées par quelque agence d’influence israélienne. Elles s’enfoncent dans la vase d’une longue et piètre diatribe. Sans évoquer les juifs israéliens vent debout contre celui qui, selon l’expression de Jean-Michel Barrot, ministre des Affaires étrangères, est « coupable d’atteintes au droit international (colonisation, déplacements forcés de population, blocage de l’aide humanitaire, frappes sur des civils…) » (in : Le Monde, 3 juillet 2025, p. 3) (en oubliant les procédures judiciaires extrêmement graves à son encontre), sans évoquer la présence chougnasseuse et soumise – dhummique, en somme – de François Bayrou ou – la présence du bègue de Pau étant fort postérieure à la publication de l’article – de ses prédécesseurs au dîner du CRIF, ce qui devrait choquer la laïciste ulcérée qu’elle est, mais apparemment de façon choisie, la scienço-politologique pose que, si l’on n’est pas solidaire
- d’Israël,
- de son líder máximo et
- des crimes contre l’humanité qu’il ordonne pour masquer ses turpitudes,
c’est que – magnifique chantage à l’antisémitisme s’il en est – l’on est
- antisémite (ben voyons),
- sous « l’influence du bolchevisme » (sic) et, allez donc, c’est pas mon père !
- solidaire de l’attentat du 7 octobre 2023.
En d’autres termes, ce recueil d’articles confirme qu’il part en sucette. Espérons que le dernier texte en lice, qui s’intéresse à l’égalité entre les sexes, puis l’épilogue relèveront le niveau – mais pas forcément : s’ils le baissaient, quelle performance ce serait !