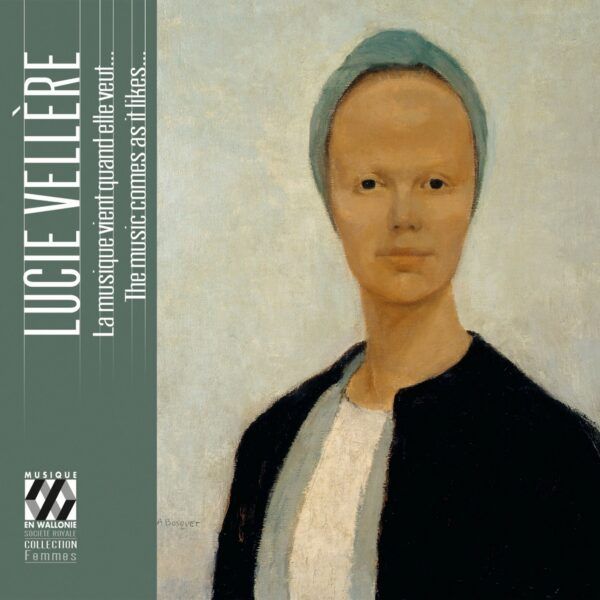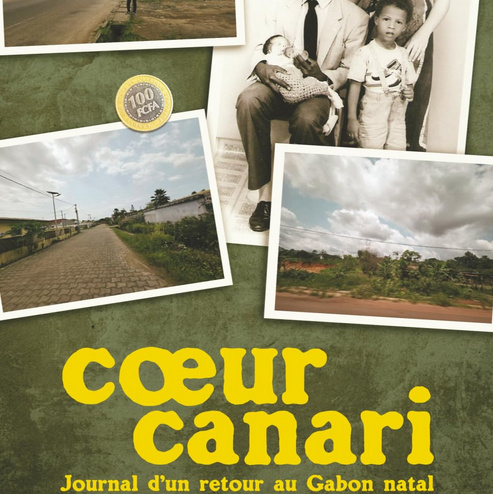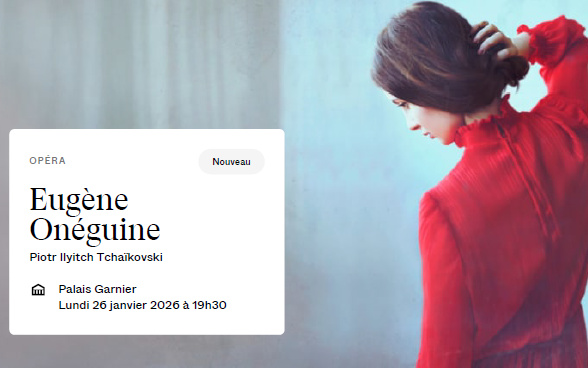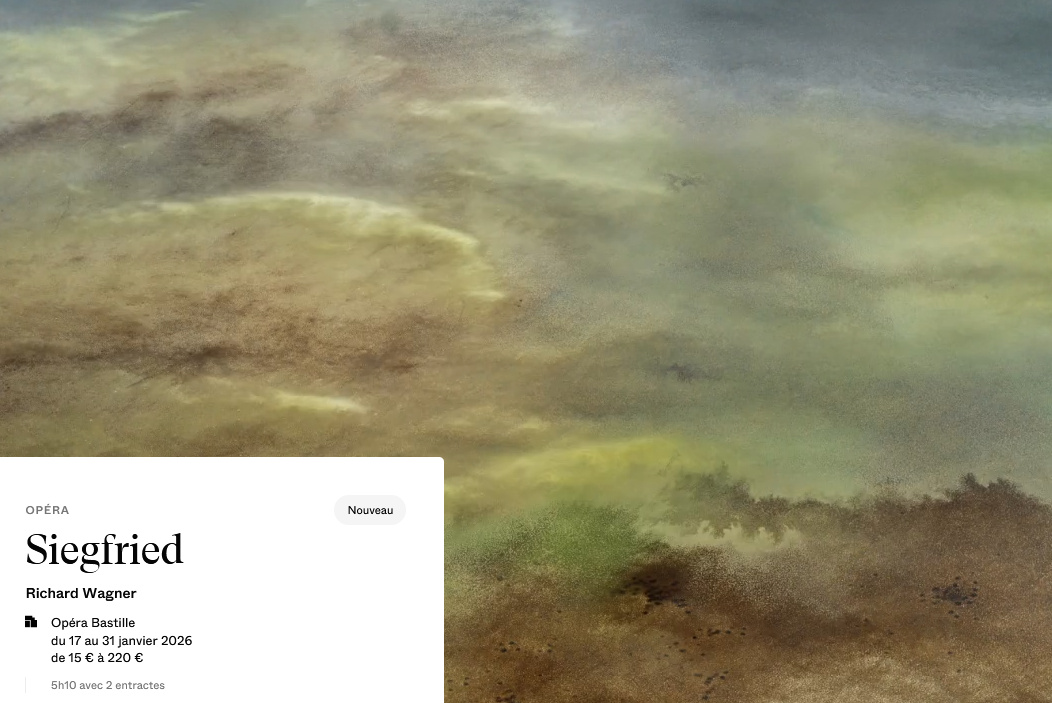Après avoir fait œuvre de mémoire, en remerciement du grand entretien accordé par le pianiste monumental qu’est Philippe Entremont, il est temps de revenir au présent, donc à Philippe Entremont. En effet, en attendant de devenir prof à la Schola Cantorum, lui qui regrettait d’avoir été berné quand il était sur le point d’enseigner au CNSMDP, l’homme qui fêtait ses 85 ans ce 7 juin vient de publier un nouveau disque grâce au soutien, alla Guillou, de sa base italienne dont il parlait dans l’entretien. Grâce aussi à la prise de son remarquable de Joël Perrot, qui tire le meilleur d’un piano équilibré quoique peut-être un peu fragile. Grâce enfin à une volonté qui va au-delà de celle d’un Trompe-la-Mort pour qui c’est pas la veille, bon Dieu, de ses adieux (prévus dans trente ans, d’après ses déclarations).
Au programme, cette fois-ci, mal défendu par un livret bancal perclus, en français, de fautes orthotypo, quatre sonates de Ludwig van Beethoven, dont de beaux mastondontes – et une inquiétude, liée au précédent album de l’interprète (et d’un de ses élèves). En effet, s’y oyaient massivement des bruits de vie – respiration et râles – certainement rassurants pour ses proches mais pouvant paraître quelque peu envahissants pour les mélomanes peu habitués à une telle débauche d’humanité dans un contexte de studio. Cette fois, les preuves qu’une machine ne joue pas sont, longtemps, moins perceptibles – les gourmands attendront la piste 2, 1’08 ; mais, jamais content sans doute pour avoir l’air d’un critique, l’on s’étonne que les pistes ne soient pas fade-outées plus tôt pour éviter les bruits conclusifs, dispensables.
Pourtant, l’affaire commence avec originalité par la « petite » Vingtième sonate en deux mouvements. L’Allegro ma non troppo enveloppe l’auditeur de notes propulsées par un toucher précis et délicat. Le tempo est allant et sinueux, donnant astucieusement une certaine bancalité énergisante à une musique qui, sans cela, suinterait le post-mozartien simplement mignon. Cette bancalité s’articule autour d’un souci de varier les attaques et de risquer çà et là un effet d’attente décalant l’entrée de la main droite au-delà du temps fort. Elle n’est ni faiblesse, ni coquetterie. Au contraire, elle rend justice du triple frisson qui, avec discrétion, irrigue la partition :
- duel entre binaire et ternaire ;
- fragilité du ternaire (une appogiature peut imposer treize notes pour douze) ;
- frottement entre majeur et mineur après la reprise.
Le Tempo di minuetto offre un contraste intéressant via l’association entre un toucher délicat et une pédale parfois très généreuse. Rien de surjoué toutefois : la partie en Do n’est pas prise trop « martialement » afin de souligner la construction ABA. Le résultat est une sonate légère et concise, exécutée sans enrubanneries visant à affrioler les jolis marquis, mais avec une personnalité qui met en appétit pour la suite.
Surgit alors la Quatorzième sonate qui doit son succès au marketing posthume d’un mec qui a confondu une procession funèbre avec une balade de lovers au clair de lune, enough said (je traduis pour les monolingues : il suffit, Saïd). Le seul mouvement connu – au sens Radio Classique du terme – de la sonate est pris sans obsession métronomique. Si la rythmique ternaire est bien dessinée, elle s’acoquine volontiers avec de légers rubato, ritardendo jouant parfois sur l’imitation de l’hésitation (1’39), et effets d’attente main gauche / main droite (0’31), comme pour donner à entendre l’investissement par l’artiste du mégatube sans pour autant trahir la partition. Certaines notes sont-elles avalées dans telle prise de risque du pianissimo (dernier si dièse, 3’16) ? Cela donne paradoxalement vie à une interprétation qui trouve une voie spécifique entre les trois dangers :
- le chichiteux (je donne de l’importance à chaque note),
- le mécanique (je ne donne de l’importance à aucune note), et
- l’hyperchopinien (je me la pète grave en dissolvant la mesure à l’aune de ma sensibilité).
L’Allegretto bascule de do dièse mineur en Ré bémol. Selon que l’on aime l’authentique ou que l’on déteste le fredonnement popularisé par Glenn Gould, l’on appréciera plus ou moins d’entendre l’artiste chanter les notes qu’il joue (piste 4, 0’16 à 0’18, par ex.). On l’aura pressenti : ce n’est pas ce que nous préférons ; mais sans doute est-ce le contrepoint authentique de l’investissement du musicien dans un mouvement qui, sans cela, pourrait sonner longuet en dépit de sa brièveté. Heureusement, Philippe Entremont fait l’effort de contraster le trio qui unit :
- massivité des accords tenus,
- swing des contretemps, et
- légèreté des noires piquées.
Les choses sérieuses commencent vraiment avec le Presto agitato en do dièse mineur. Une critique obsédée par la partition estimera à bon droit que toutes les notes des arpèges brisés ne semblent pas parfaitement audibles (les mesures 3-4, par ex., à l’aller comme au retour de la reprise, semblent avoir été allégées sans hésitation) ; mais même cette pulsion partitionnellistologique devra souligner l’énergie qui sourd, en particulier, de la gestion des accents (blanches pointées après les trilles, tandis que bariole la main gauche). Cette qualité minimise les petits arrangements avec les notes, car elle enflamme la partition et la rend moins démonstrative qu’entraînante. Quel groove, en effet… au point que, comme la partition, le piano menace même de céder (fa dièse grave à 4’09) !
La Trentième sonate, solidement ancrée sur ses trois mouvements, se profile par une alternance entre Vivace ma non troppo et Adagio espressivo. L’alternance des deux mouvements est interprétée avec énergie et souci du contraste frontal, même si l’enregistrement semble garder trace des tournes de page (plage 6, 1’04 ou 3’02, par ex.), ce qui eût sans doute pu être optimisé. Défiant le métronome, séduit une certaine liberté quasi rubato dans laquelle Philippe Entremont se complaît avec justesse. Le Prestissimo en mineur s’accompagne de râles à notre goût – prétentieux, c’est patent, mais sincère – excessivement sonores, qui gâchent un brin le plaisir dynamique suscité par l’interprète. Gardons plutôt en tête l’effort efficace qu’il manifeste pour nuancer avec exigence.
L’affaire se conclut par un hénaurme Andante molto cantabile ed espressivo, deux fois plus long que les deux premiers mouvements réunis. L’affaire revient en majeur et s’acoquine de variations. Admettons que, au disque, l’écoute pâtit de ces râles intempestifs qui, pour être authentiques, finissent, à cette dose, par perturber l’écoute (piste 8, 0’12 à 0’14, 0’24, 2’28 à 2’30, 3’36, etc.) d’autant que s’y ajoutent les supposées tournes fort bruyantes (3’57, par ex., 8’04, etc.). C’est d’autant plus chagrinant que l’artiste veille à faire sonner avec intelligence les évolutions harmoniques (mesures 13-14, descentes fa # – mi – ré #), essentielles pour ne pas perdre l’auditeur dans un incipit engoncé entre solennel et fastidieux, qui ne décolle guère avant la Deuxième variation, laquelle permet de goûter trois qualités qui justifient l’attente :
- une impressionnante palette de sonorités,
- un large spectre d’intensités, et
- une attention particulière qui semble apportée à différenciations des attaques, l’ensemble séduisant comme le swing insistant des contretemps dans la Troisième variation.
Oubliant les passages un brin savonnés (absolument, se permettre ce genre de commentaire est fat, mais écoutez les dissonances approximatives à 9’33 ou les triples souvent avalées dans le cœur le plus redoutable de la Sixième variation : peut-être conviendra-t-on que s’en tenir à une louange univoque afin de complaire l’entourage de l’artiste, ses admirateurs et ses intermédiaires, serait, autant que concerné nous sommes, plus mensonger que flatteur), on se laisse aussi emporter par la tonicité contrastée de la Cinquième variation aux accents faussement fugués, et par l’apaisement largement arpégé du finale. En somme, en dépit de ce qui peut passer pour telle ou telle scorie, on est saisi par l’ambition de faire chanter une sonate complexe et polymorphe – et être saisi, plutôt que se morfondre d’ennui devant un produit trop ripoliné, peut faire partie des joies de l’auditeur de disque (si, ça existe encore, ce genre de zozo, par exemple, eh bien, je dirais, en toute immodestie, moi, voilà).
La redoutable Vingt-troisième sonate en fa mineur conclut un programme fougueux et sans complexe. L’Allegro assai liminaire est presque aussi long que les deux mouvements suivants. Le bougre ne manque ni d’autorité ni de liberté dans son incipit chaloupé. La partie à doubles croches gronde comme il sied, en dépit d’une pédale très généreuse. La tonicité et l’envie contrastent de façon intéressante avec le floutage permis par le sustain. Il y a du brio dans ce plaisir de dégourdir les saucisses sans retenue, et en jetant parfois aux orties, bordel, l’élégance qui n’est pas toujours de mise dans les passages remuants de LvB.
L’Andante con moto en Ré bémol est curieusement attaqué subito, avec une gravité notoire, en dépit de bruits parasites (1’59, 3’46, 4’35, 4’57, etc., faut bien laisser croire que l’on a écouté l’intégralité de ce mouvement un brin lancinant quand on ne devine pas les guirlandes de triples croches qui se préparent sous la placidité des doubles) qui rappellent, positivons comme à un carrefour tant que l’on n’y travaille point, le côté vivant d’une captation, fût-ce en studio. Toutefois, le mouvement permet aussi d’apprécier cette technique du crescendo qu’enseigne le patriarche du piano, sur une vidéo de masterclass diffusée par Qobuz : « Si tu arrives forte au bout d’un crescendo, tu ne repars pas forte sur ton crescendo suivant, voyons ! » Émane ainsi un souci du son global, où pointe sans doute le biais orchestral de Philippe Entremont.
Pour conclure l’aventure, l’Allegro en fa mineur est pris « attaca », cette fois comme l’exige la partition. Il s’affiche toutes voiles dehors, non sans risques. En dépit des défis techniques, Philippe Entremont tâche, lors des modulations, de ne pas oublier de nuancer quelles que soient les trépidations du moteur en doubles croches. De même, il ose poser les accents qui vont bien, semblant judicieusement déstabiliser une machine plus emballée que mécanique. Point de reprise, cette fois : on va direct au Presto conclusif, et l’affaire est ainsi rondement emballée.

En conclusion, ce disque témoigne bien d’un artiste sempervirens qui, s’il doit en rabattre un peu, de sa perfection virtuose d’antan, refuse de s’en tenir à un ploum-ploum de bon aloi pour pianiste blanchi sous le harnais. Parfois, le snob se focalisera donc sur des imperfections qui semblent objectives et qui rassureront le pianiste médiocre qu’il fut ; souvent, il laissera chanter, en opinant du chef, un artiste qui n’oublie jamais que jouer du piano, c’est, quand tout va bien, moins aligner des notes que faire de la musique – et, visiblement, pour Philippe Entremont, à cette aune-là, ma foi, ça ne va pas trop mal, youpi.
Acheter le disque : c’est, par exemple, ici.