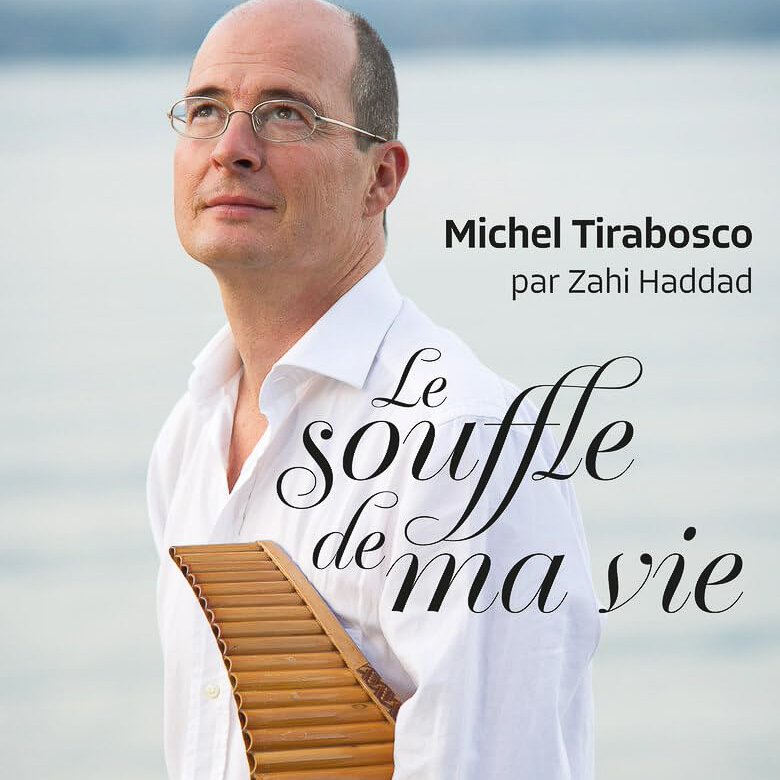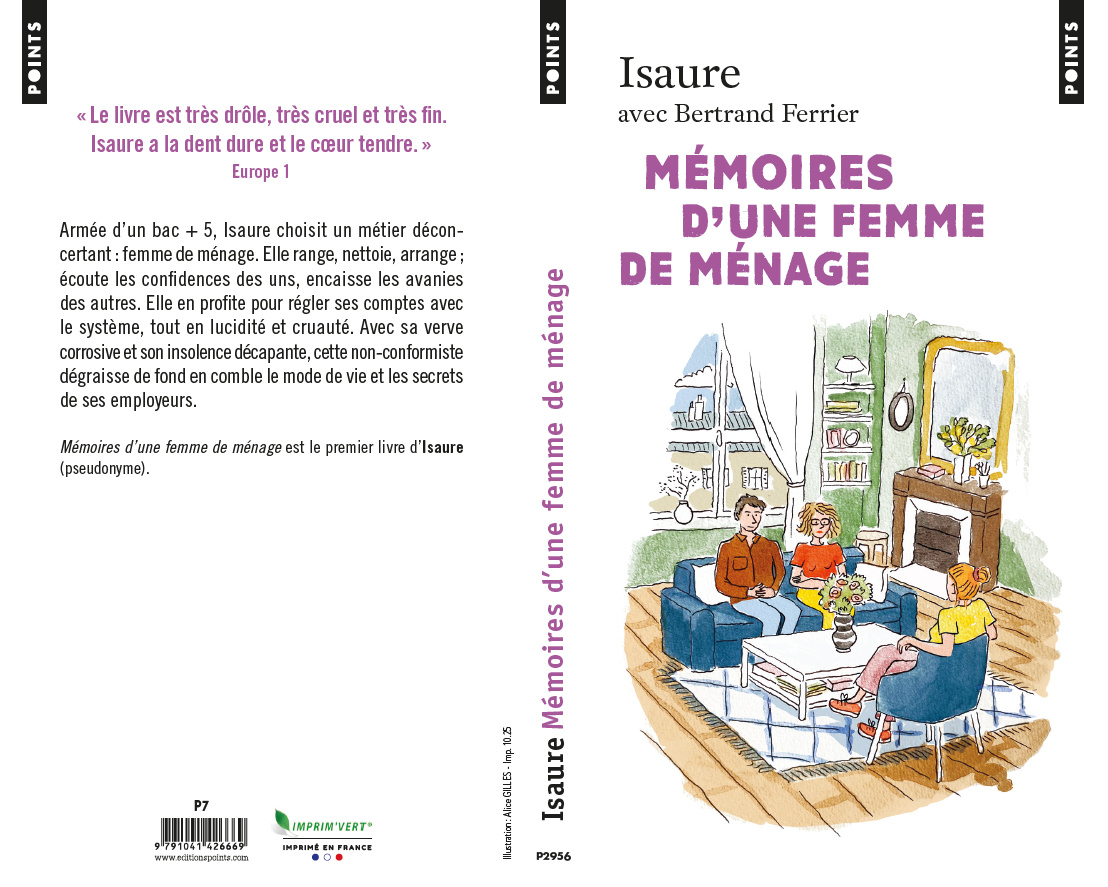Au cours d’un récital, les prises de parole de Jonathan Benichou-Rabinovitch sont toujours empreintes
- d’intériorité,
- d’intensité et
- de cette rare tentation du pas de côté
pour énoncer et mesurer la portée de ce qui est énoncé. Gabriel Fauré était d’une race différente. En 1894, celui qui est rarement dépeint comme un boute-en-train infatué écrivait pourtant, après avoir composé son sixième nocturne : « La musique moderne de piano un peu intéressante est rarissime », ce qui rappelle à quel point la prétention, même cachée, est importante pour oser composer. Le pianiste du soir étant compositeur, il doit vivre avec cette tension entre
- la nécessité d’écrire,
- le refus de se laisser aller au contentement de soi, et
- l’hybris qui préside à toute écriture,
- au début,
- à la fin ou
- après la fin, devant le public, quel qu’il soit.
L’interprète-créateur qui s’apprête à claquer une pièce pianistique majeure de celui qui ne fut point QUE le compositeur du Requiem ou du Cantique de Jean Racine (en Ré bémol, franchement, ça t’aurait coûté quoi de l’écrire un demi-ton en-dessous ? la crédibilité, c’est la lourdeur de l’armature, tu crois ?) présente la composition en attente comme « une des œuvres
- les plus mûres,
- les plus sereines et
- les plus sages »
du zozo. Il l’envisage comme la traversée d’un tunnel. Dès qu’il engage le voyage, il pose sans poser. Il pose
- les phrasés,
- les nuances,
- le débit.
L’interprète
- adopte un tempo mesuré,
- se laisse la liberté de respirer, et
- utilise l’accent pour aérer la mesure
sans précipiter un ton rugueux contre un son étouffé, comme s’il souhaitait préserver le fantasme que suscite l’idée de « nocturne ». Or, même si l’atmosphère peut sembler nocturne, on sent chez Jonathan Benichou-Rabinovitch une volonté
- de clarté dans l’énonciation,
- de caractérisation dans l’exposé des différents registres et
- d’agencement dans le spectre chromatique.
Pas hypersensible à cet effort, la nana devant nous essaye de s’occuper. Elle
- bisoute avec insistance la manche du compagnon qui, clairement, l’a traînée ici,
- s’évente bruyamment avec son programme A4,
- scrolle le fil de sa discussion WhatsApp et
- entreprend de photographier son choupinou qui peine à masquer son escagassement (mais la nana a des nichons et semble amoureuse, alors bon).
Heureusement indifférent à ces embrouillaminis de lovers pas égaux devant Fauré, l’interprète s’ancre dans une poésie non pas de l’éthéré mais
- du questionnement,
- de l’expectative et
- du doute,
proposant ainsi une version intense donc intensément énigmatique. Apparemment soucieux de contraste, le pianiste frictionne le nocturne au Rondo de la 42nd Street d’Olivier Greif, joué récemment lors du concert-évenement donné collectivement en hommage au compositeur. Il le caractérise en trois points :
- c’est une composition de jeunesse qui
- s’inspire de l’esprit jazz de Broadway et
- virevolte autour du standard que cite son titre.
Ce soir-là, le rondo a des airs de danse de Saint-Guy.
- Le rythme est effréné ;
- l’urgence frôle la précipitation ;
- l’empressement ne cesse de s’emballer.
Jonathan Benichou-Rabinovitch a envie d’en découdre. Ce halètement est idéal pour contraster avec le second motif, plus
- retenu,
- grave et
- hésitant.
Le spectateur est scotché par la puissance avec laquelle l’énergumène réussit à projeter la musicalité spécifique à chaque compositeur dont il interpole les œuvres. Pour ce monument virtuose d’Olivier Greif, il parcourt avec
- aisance,
- urgence et
- vertige
les lignes de crête d’une partition aussi sèchement découpée qu’une falaise atlantique. Chemin faisant, l’interprète révèle la plasticité du temps musical.
- Le tempo tournoie,
- la mesure se métamorphose,
- le discours se suspend puis s’accélère.
Ça étincelle mais, dans ces escarbilles, il n’y a pas que du brillant. Le pianiste fait ressentir d’autres émotions, dans ce souvenir paradisiaque.
- Ici point une mélancolie,
- çà une hésitation,
- là un regret.
Jonathan Benichou-Rabinovitch a la grâce des musiciens qui
- n’ont pas peur de la contradiction,
- veulent renverser l’univocité, et, alléluia,
- ne croient pas à une exégèse marmoréenne.
Or, alors que le concert aurait pu briser là, voilà que nous attend le Deuxième concerto de Camille Saint-Saëns, version deux pianos. Après les hourrah, une pause s’impose pour l’interprète-régisseur et ses spectateurs, ne serait-ce que pour attiser la hâte d’ouïr ce qui se fomente et dont nous rendrons compte dans une prochaine et dernière notule sur ce concert. À suivre !


















































![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)