
« Ceci n’est pas un concert d’orgue » : peut-être le titre eût-il mieux convenu que ce pas très aguichant, euphémisme, « Berlioz, 150 ans après ». En tout cas, ceci est un concert avec orgue, mais qui aurait mérité, mieux que l’intéressant livret proposé par Michel Roubinet, une explication de son fomenteur, en un mot, Yves Lafargue. Car ceci est, à tout le moins, un concert qui interroge sur le projet qui le sous-tend. En clair ou presque, celui qui vint pour profiter du grand orgue de la Maison risque de repartir déçu, alors même qu’un bon organiste – en présence du maître Daniel Roth, ça vaut mieux –, une excellente altiste et une brillante mezzo (de remplacement, pourtant) étaient au rendez-vous. Dès lors, pourquoi diable prétendre être déçu ? Tâchons d’y répondre dans cette petite notule, qui ne peut passer sous silence, notre côté CGT et médius tendu bien bien haut vers le Pharaon et son lèche-cul des service pubik, la tristesse des « agents de sécurité » que nous croisons à l’accueil, transformés en comédiens d’aéroport alors que, précisent certains lorsque l’on discute, « on n’a quand même pas été embauché pour ce truc ridicule ».
Le concert s’ouvre sur la problématique de base : un récital avec orgue doit-il être spectaculaire ? À notre sens, non, pas forcément, même si l’on paye l’acrobate en rémunérant le musicien, mais avec une condition – qu’il expose une personnalité, une singularité, une dissonance. La dissonance d’Yves Lafargue est patente plus qu’épatante, bref. Peu lui chaut d’impressionner, de satisfaire ou de wower (je tente) les spectateurs. Il joue ce qu’est-ce qu’il veut, surtout ce qu’est-ce que les autres ils jouent pas en concert.
Deux pièces d’Alexandre-Pierre-François Boëly, issues de l’opus 18, ouvrent le bal. L’Andante con moto et la Fantaisie plus fugue témoignent d’un instrumentiste sérieux – trop, peut-être – qui aime les ondulants, refuse avec justesse la mollesse ou les retards et néglige sciemment le manque de réverbération de la salle. En exécutant en concert ces pièces plus à leur place dans une cérémonie religieuse où les guitares risibles de piètres amateurs n’auraient pas pris le pouvoir, l’interprète indique la voie qui sera la sienne durant cette prestation : show-off, non-non, audace oui-oui.

Et ce n’est que la première des deux grandes questions avec lesquelles il interpellera le public. La seconde est incontestablement : pourquoi l’orgue ? Telle est la question que pose toute transcription, mais singulièrement la transcription d’orchestre qui sonne comme un piano avec du ploum de pédalier dedans – pour mémoire, nous avons récemment abordé des questions autour de la transcription en dialoguant avec Cameron Carpenter et en applaudissant le talent de Vincent Genvrin. La première intervention de Karine Deshayes, un peu en dedans, propulse la captive et son texte rappelant la relativité du génie de cet arriviste éhonté qu’est Hugo (« Je ne suis pas Tartare / Pour qu’un eunuque noir / M’accorde ma guitare, / Me tienne mon miroir », peste). L’incarnation de la mezzo ne fait aucun doute, pas plus qu’elle n’en faisait lors de la consternante production bastillo-troyenne, mais le texte peine à parvenir au balcon.
Ce n’est pas le cas du son, splendide, de Lise Berthaud. Cette beauté du son, qui n’est certes pas antithétique d’une interprétation engagée, se poursuit sur les extraits des Troyens. Les extraits des Nuits d’été permettent d’apprécier à nouveau l’incarnation de Karine Deshayes, sa voix magnifique (souffle, justesse, intentions)… et, sans doute, son paradoxe : doit-elle chanter pour le micro juste devant elle ou pour l’ensemble de la salle ? Son choix fait grincer les dents du pseudocritique posé au balcon et incapable de capter une syllabe du texte pourtant proféré avec émotion, conviction et savoir-faire. L’incapacité de l’orgue, en dépit des prouesses de l’interprète-adaptateur, à rendre l’intérêt de « L’île inconnue » (le bariolage bavard semble pataud plus qu’il ne valorise la partition) poursuit la première partie de la double interrogation : pourquoi ces transcriptions qui, osons être prétentieux, semblent vaines ?
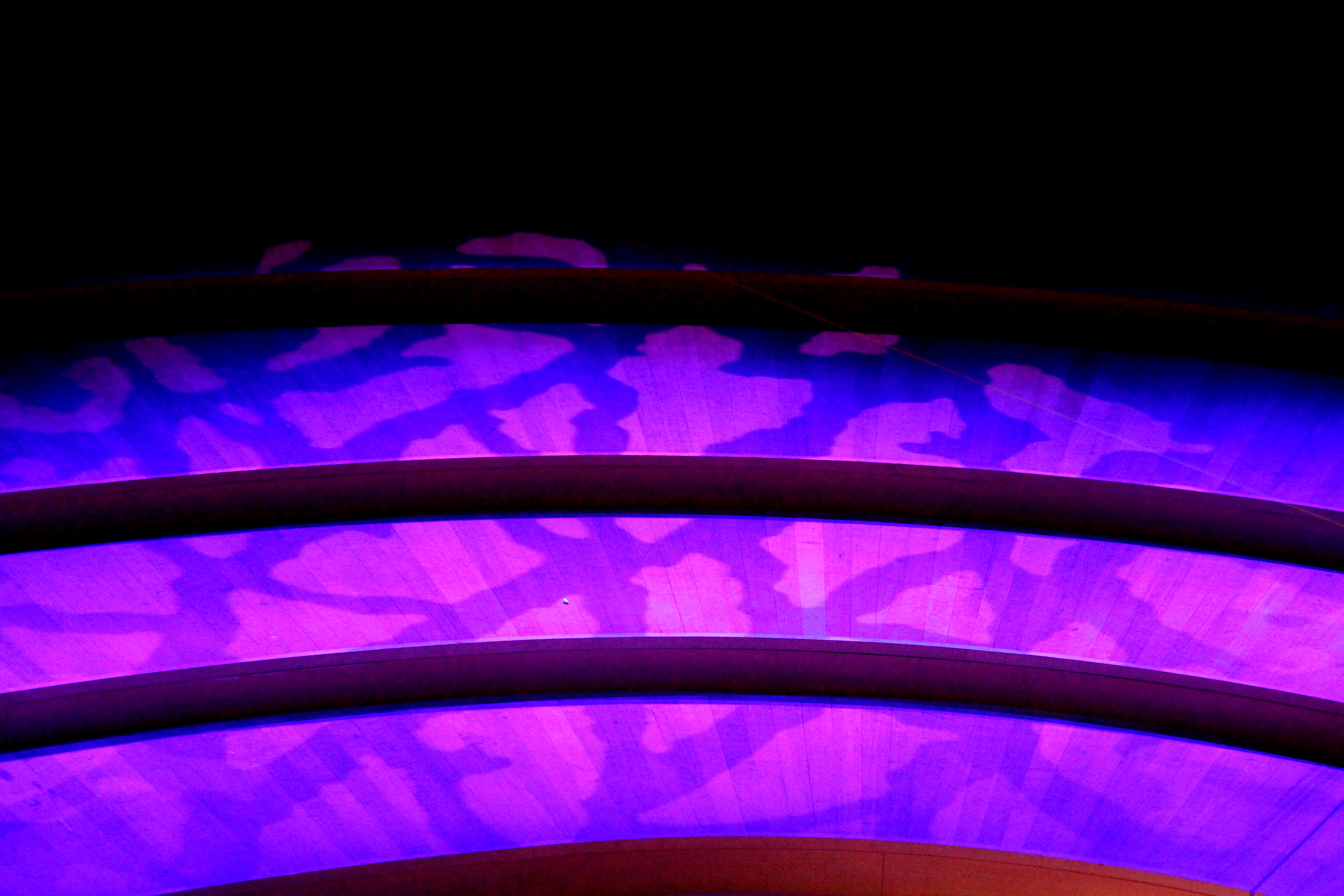
L’offertoire en sol mineur de César Franck, qui mène à la mi-temps, confirme la seconde partie de notre doute : pourquoi jouer ici ces pièces pas écrites pour le concert, comme leur titre l’annonce ? L’interprète n’est presque pas en cause : il y met de l’âme, et la péroraison de la pièce est jouée avec l’autorité solennelle de rigueur – mais à quoi bon ? Ces œuvres visant à accompagner l’office ne montrent certes pas un César impérial ; leur rapport avec les « Nuits » n’est pas évident aux ouïes du clampin ; surtout, l’orgue Grenzing paraît disproportionné en regard de ces compositions peu captivantes.
L’Andantino en sol mineur dudit César Franck qui inaugure la seconde partie – non, pas de notre doute, ha-ha – rejoint cette impression. L’organiste fait un effort et de registration et de nuances via les boîtes expressives ; il démontre sa sensibilité en osant même çà et là quelque ralenti supérieurement senti. Reste la perplexité. Pourquoi cette musique anecdotique, fût-elle bien jouée ? Une pièce contemporaine – pourquoi pas une proposition d’Yves Lafargue – nous aurait paru, dans notre prétention de pseudocritique, plus appropriée.

Le principal intérêt du présent concert est donc, on l’aura compris, d’interroger l’intérêt d’une transcription en tant qu’elle est susceptible de mettre en beauté et l’œuvre d’origine et l’instrument d’arrivée. La « Marche de pèlerins » extraite de Harold en Italie illustre cette problématique. Lise Berthaud y brille comme soliste et comme accompagnatrice. L’orgue y fait dignement ploum-ploum. Reste que la question paraît se poser, quelque snob parût-elle : quel intérêt musical cette proposition maîtrisée, fonctionnelle et bien interprétée – c’est déjà bien, en un sens – revendique-t-elle ? En dépit de notre bonne volonté, avouons que l’on peine à la déterminer.
Quand La Damnation de Faust s’impose, la « Ballade du roi de Thulé » souligne le plaisir d’interprétation de la mezzo (même si, passés les graves, on ne comprend rien, pardon, à ce qu’elle profère), la richesse de l’accompagnement de Lise Berthaud et la précision du ploum-ploumeur. La « Marche hongroise », dans la transcription de Henri Busser, gagne en sérieux ce qu’elle perd en facétie, en notes ce qu’elle oublie en effets, en précision ce qu’elle obère en musique (chais pô, j’essaye). L’ultime « Romance » claque grâce aux piani de l’altiste, à l’expressivité de la mezzo très attentive à ses partenaires, et au rythme assumé par la pédale de l’organiste. La villanelle joliment reprise en bis n’ôte point les trois questions : pourquoi cette proposition d’arrangements ? pourquoi cette sous-utilisation de l’orgue, en dépit de l’effort de registration ? et pourquoi ce choix de pièces pas terribles pour orgue seul ?

Peut-être parce que ceci n’était pas un concert pour orgue. Soit. Mais cela apaise si peu notre déception que l’on n’ose le supputer.
La réponse d’Yves Lafargue
Bonjour, Bertrand Ferrier. Je vais essayer de livrer quelques notes, sans céder au plaidoyer point par point, ni au contrit « Ben oui, mais… ».
Donnée de base : j’ai voulu ce programme, oui. Voici le paragraphe que j’avais proposé à RF pour éclairer sur mes intentions : « L’organiste qui veut rendre hommage à Berlioz doit se garder de le faire seul ! Ainsi, pour un portrait aussi juste qu’original, trois musiciens vont conjuguer trois ingrédients indispensables : la voix, ambassadrice privilégiée du compositeur ; le timbre chaleureux de l’alto, instrument romantique par excellence ; et le relief orchestral, assuré par l’orgue de l’auditorium. » Relief interne de l’orgue qui s’est peut-être un peu émoussé à partir du moment où j’ai décidé d’associer l’alto à presque toutes les pièces vocales. Écrire ces transcriptions pour alto et orgue s’est révélé un artisanat passionnant.
En tête du premier projet de programme : « Autour d’un anniversaire : Hector Berlioz (11 décembre 1803 – 8 mars 1869). Transcriptions à l’orgue seul – Mise en regard avec des pièces d’orgue de son temps – Partie de récital vocal accompagné à l’orgue – Pièces interprétées en duo et en trio. » On m’aurait demandé mon avis pour un titre, je crois que j’aurais mis « berlioziade » dedans.
Ceci n’est donc pas un « concert d’orgue » : le programme est modelé par le projet. Cependant, j’ai voulu qu’y figurent d’authentiques pièces d’orgue (du temps de Berlioz) : j’ai choisi pour cela des œuvres que je trouve belles, significatives, et complémentaires du reste du programme : l’Offertoire en sol mineur de Franck, par exemple – la seule pièce à résonance liturgique du concert, sachant qu’au XIXe encore, l’offertoire est le moment où l’organiste oublie le mieux les contraintes du culte. J’ai cru déceler dans cette pièce des terrains communs à Berlioz et à Franck : éloquence, chromatisme, étrangeté (mes. 98-107), fugato, superposition de thèmes. Pour moi elle peut figurer au concert et sur un grand instrument, sans contresens.
À quel public ai-je donc pu penser ? J’avoue, pas en priorité à un public de concerts « d’orgue », mais plutôt aux personnes venues entendre Lea (puis Karine), Lise, et du Berlioz. Aviez-vous eu connaissance du programme à l’avance ? Si oui, vous avez dû hésiter à venir, et vous auriez peut-être bien fait de renoncer. Merci d’être venu, et merci pour votre compte-rendu.
PS : Bien que je semble aimer les ondulants, je n’en ai pas utilisé le 27 mars.




































































