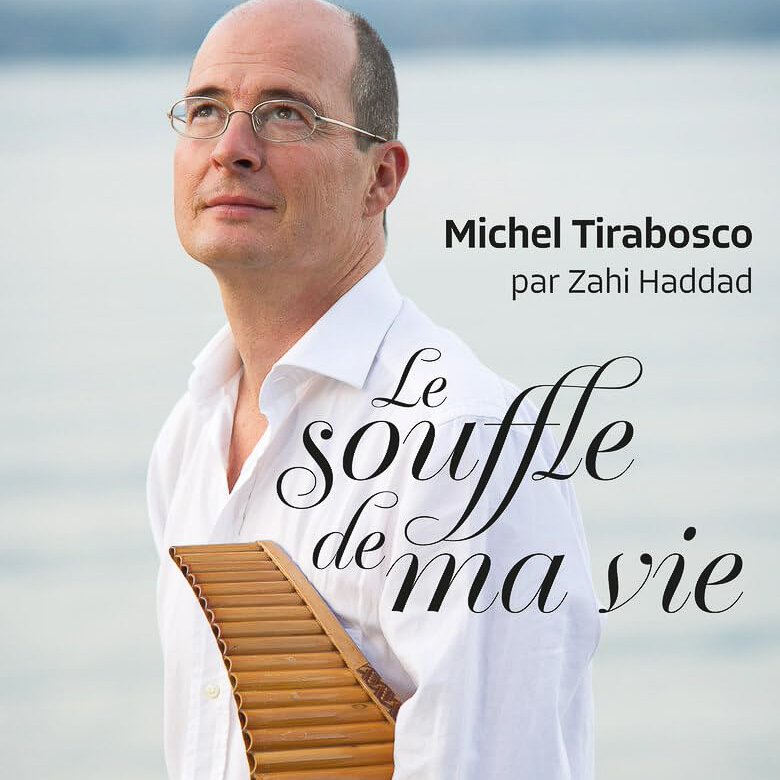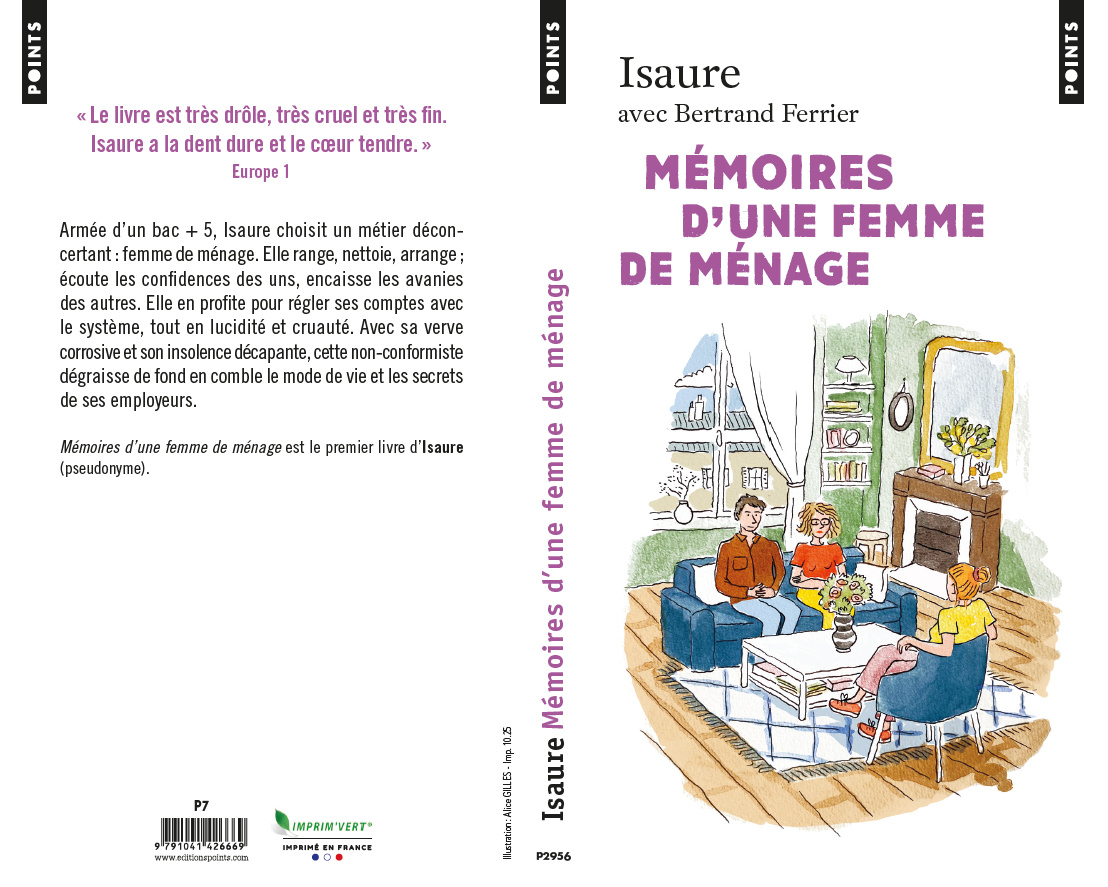Le récital donné le 19 juin par Jonathan Benichou-Rabinovitch à la mairie du huitième arrondissement aurait pu s’arrêter avant le Deuxième concerto pour piano de Camille Saint-Saëns. Il aurait pu également s’arrêter après. C’était prévu ainsi. Mais croire cela, c’est mal connaître Jonathan Benichou-Rabinovitch. L’artiste revient donc avec La Princesse disparue, une partition qu’il a composée autour d’un conte
- allégorique,
- symbolique et
- métaphorique
du rabbi Nahman où la princesse « cache une force créatrice ».
- L’écriture entre méditation et tensions,
- le balancement entre consonance et trouvailles harmoniques, ainsi que
- l’interprétation entre narrativité et expressivité
diffractent l’évidence du son en suggérant une multitude de possibles.
- Accords arpégés,
- pédalisation habile,
- sens de l’agogique,
- variété de l’accompagnement que surplombe une ligne mélodique fracturée,
- large spectre de nuances et
- fin suspendue
participent d’une écriture
- de l’hypnose façon récit dont on veut connaître le fin mot,
- de l’apocalypse – au sens étymologique – espérée et
- du secret qui fascine car, dès qu’on a cru le dissiper, il se dérobe et réapparaît sous une autre forme.
Le récital aurait encore pu s’arrêter là. Mais croire cela, c’est mal connaître Jonathan Benichou-Rabinovitch. Le voici qui semble vouloir synthétiser son concert avec les « Oiseaux tristes » extraits des Miroirs de Maurice Ravel, écho au « Rappel des oiseaux » de Jean-Philippe Rameau qui ouvrait le récital, mais aussi au presto du concerto de Camille Saint-Saëns qui hésitait, comme les « Oiseaux tristes », entre battue binaire et 12/8. La concentration lunaire de l’artiste lui permet de se détacher de la température élevée ensuquant la salle pour proposer, plus qu’une synthèse, un éloge de la synesthésie. Mettant à profit avec une virtuosité très intériorisée une partition toute en miroitements et résonances, il semble vouloir
- peindre avec le son,
- raconter avec l’harmonie,
- évoquer avec les couleurs des différents registres
pour aller au-delà de la dimension programmatique du titre et envoler ses auditeurs. Bien sûr, le récital aurait encore pu s’arrêter là. Mais croire cela, c’est mal connaître Jonathan Benichou-Rabinovitch. Cette fois, il ne veut ni ajouter (comme avec le premier encore) ni synthétiser comme avec le deuxième bis : il veut prolonger. Soit, donc, une pièce dans la même tonalité (mi bémol mineur) commençant, une octave plus grave; sur la même note qui concluait les « Oiseaux tristes ». Dans cette définition à peine cryptique, chacun aura reconnu, qui en douterait ? l’Étude-tableau op. 39 n°5 de Sergueï Rachmaninoff.
Un gardien tente d’interrompre l’exécution en faisant cliqueter son trousseau. Il est plus de 22 h 30, il doit fermer. Tandis que le piano résonne, des négociations s’engagent avec le vigile pour obtenir un délai de grâce de cinq minutes avant l’expulsion. Le pianiste semble n’en avoir cure, préférant mettre le feu à son piano. Il y a
- des escarbilles,
- des crépitements, et
- de hautes flammes
jusqu’à l’apaisement des braises puis des cendres. Cette fois, le récital ne peut que s’arrêter là. Même Jonathan Beinchou-Rabinovitch doit s’y résoudre, laissant aux spectateurs fondus sur leurs chaises le sentiment d’avoir assisté à un moment
- impressionnant,
- audacieux et
- mémorable.
Retrouver les chroniques précédentes
1/4 : Jean-Philippe Rameau
2/4 : Franz Liszt
3/4 : Gabriel Fauré et Olivier Greif
4/4 : Camille Saint-Saëns


















































![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)