
Après la première partie qui développait une suite de danses de Johann Sebastian Bach, Herbert du Plessis vire de cap et s’intéresse au répertoire russe post-romantique. Premier compositeur à voler sous ses doigts, Nicolaï Medtner est à la fois reconnu et méconnu. Sa dixième sonate, l’opus 38 n°1 en la mineur décapsule une série de « Mélodies oubliées » généralement intitulées « danzas » ou « canzonas », ce qui crée un lien théorique avec la première partie. L’incipit de l’œuvre saisit par
- le swing de la nostalgie tranquille,
- la liberté de l’énoncé ondulant et
- la versatilité de l’humeur qui inclut un jeu sur
- le tempo, souple,
- le phrasé, sans cesse en adaptation, et
- les nuances, d’une saisissante variété.
Le pianiste y exprime un mélange étonnant
- de tension,
- de retenue et
- de langueur.
Comme à son habitude, Herbert du Plessis se préserve de surdramatiser le propos. Pas de grands effets de contrastes ou de mimiques torturées. Tout passe par
- la caractérisation,
- la suspension,
- la gestion de l’acoustique qui permet de savourer la projection du son et l’habileté de la pédalisation, ainsi que par
- l’art de la respiration, à la fois salvatrice et comme inquiète de ce qui va suivre.
Cette lecture à l’os projette l’auditeur dans un tourbillon où frayent
- les retournements de caractère,
- les changements de couleur et
- l’alternance fondue entre la virtuosité qui explose çà et le retour au calme qui apaise là le propos.
L’artiste prend soin de faire briller les registres de son instrument. Il trouve
- de l’écho dans les graves,
- de la radiance dans les médiums et
- de l’air envolant dans les aigus,
même si cette ouverture vers les airs ne permet jamais de s’extraire longtemps de la condition humaine que pourrait symbolise le leitmotiv glissant le long la sonate.
Quatre préludes opus 23 de Sergueï Rachmaninov bouclent la set-list dans un ordre soigné. Le quatrième en Ré flatte l’oreille grâce à
- la sérénité de l’exposition,
- la profondeur du développement et
- la densité de la méditation.
Herbert du Plessis place en deuxième position le cinquième prélude en sol mineur, tube pour marteaux s’il en est. L’interprétation
- gronde plus qu’elle ne sautille,
- joue les caméléons en déjouant le risque d’une univocité réductrice, et
- privilégie l’énergie à la fougue vibrionnante.
Chaque segment est soigné :
- la partie lyrique se teinte sporadiquement d’un suspense savoureux ;
- la transition cultive l’ambiguïté avec malice ; et
- le retour du thème liminaire finit de combler le spectateur.
Le sixième prélude en Mi bémol ressemble à une conversation où bavardage de la senestre et accords aigus semblent débattre, hésitant entre
- conciliation,
- harmonie fusionnelle et
- divergence radicale.
Le concert se conclut avec un autre golden hit, le deuxième prélude en Si bémol. La patte du Plessis s’y imprime nettement, via sa capacité à organiser l’écoute sans aseptiser le propos. Le musicien
- maîtrise la partition mais ne donne pas cours ;
- construit sa vision de l’œuvre mais ne fige pas ;
- éclaire l’enchevêtrement de notes mais ne cherche pas à éblouir.
Le résultat permet d’apprécier
- la verve de Rachmaninov,
- les mutations thymiques, et
- l’expressivité du travail sur le volume sonore
qui donnent le sentiment oxymorique d’une virtuosité tranquille dont l’assemblée, nombreuse, ne manque pas de se délecter. Évidemment, un bis est réclamé, on sait s’tenir ! Le musicien avait, ô hasard ! prévu le coup. Il se lance donc dans la mélodie russe dite « Le rossignol » que Franz Liszt a transcrite. L’interprète sait en tirer le suc :
- plaisir de la musique populaire,
- agilité digitale et
- charme des sautes de registre, notamment les aigus (logique, vu le titre) mais pas que.
L’inconvénient de cette musique ne se fait pas attendre. Un autre bis est exigé. C’est une « Berceuse » de Piotr Ilitch Tchaïkovsky que choisit de susurrer Herbert du Plessis. Il en rend
- l’hypnotique balancement,
- la complémentarité entre des graves profonds et une mélodie joliment dessinée, ainsi que
- la science duplessistique, et hop, de la suspension qui rend tellement plus savoureuse la réexposition.
Autant dire que le pianiste échoue à endormir le public. Un autre bis est exigé car, ici, c’est Paris. Le musicien cède une dernière fois à son public insatiable et lance sur le carnet une valse tubistique de Frédéric Chopin dont il fait scintiller l’énergie, la légèreté et cette sensation de liberté, jubilatoire voire enivrante, que procure l’agogique quand elle est appropriée, signifiante et magnifiquement touchée. Un dernier triomphe, évident et nécessaire, est fait à Herbert du Plessis ; puis il est temps de revenir à la vraie vie. Deux mois plus tard, il est joyeux de se ressouvenir de ce récital !
Moult autres chroniques sur Herbert du Plessis sans quitter ce site ? C’est ici.

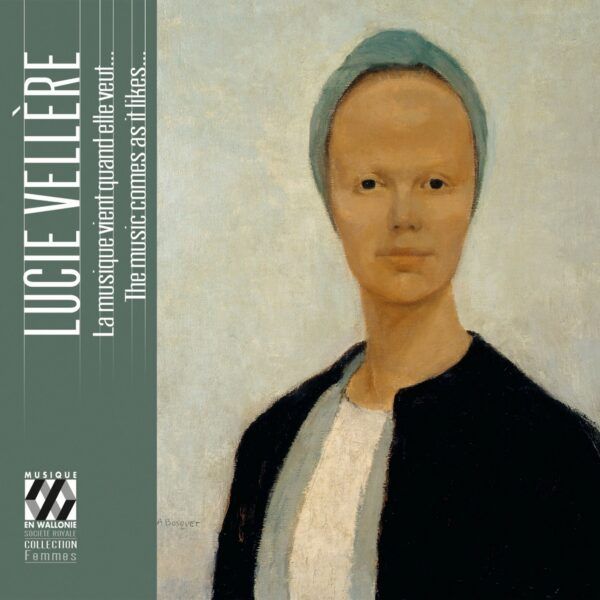

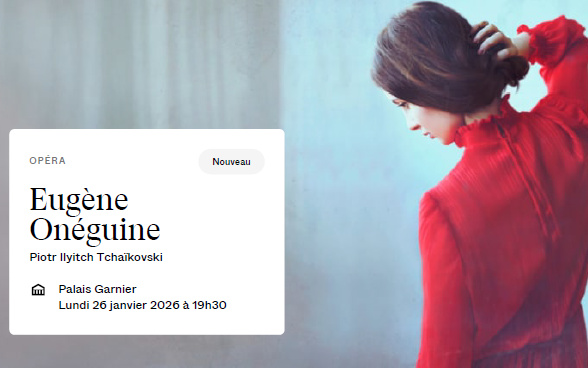

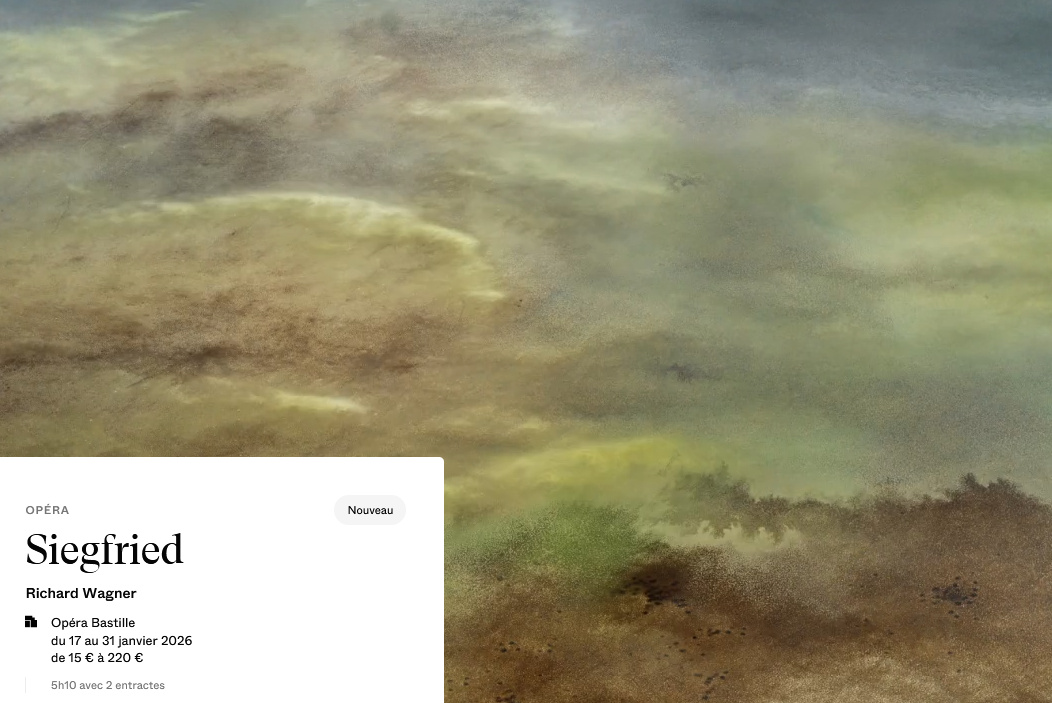














































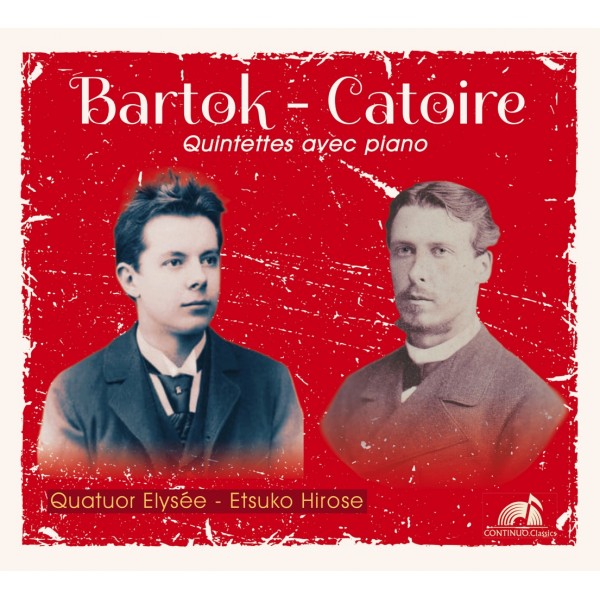

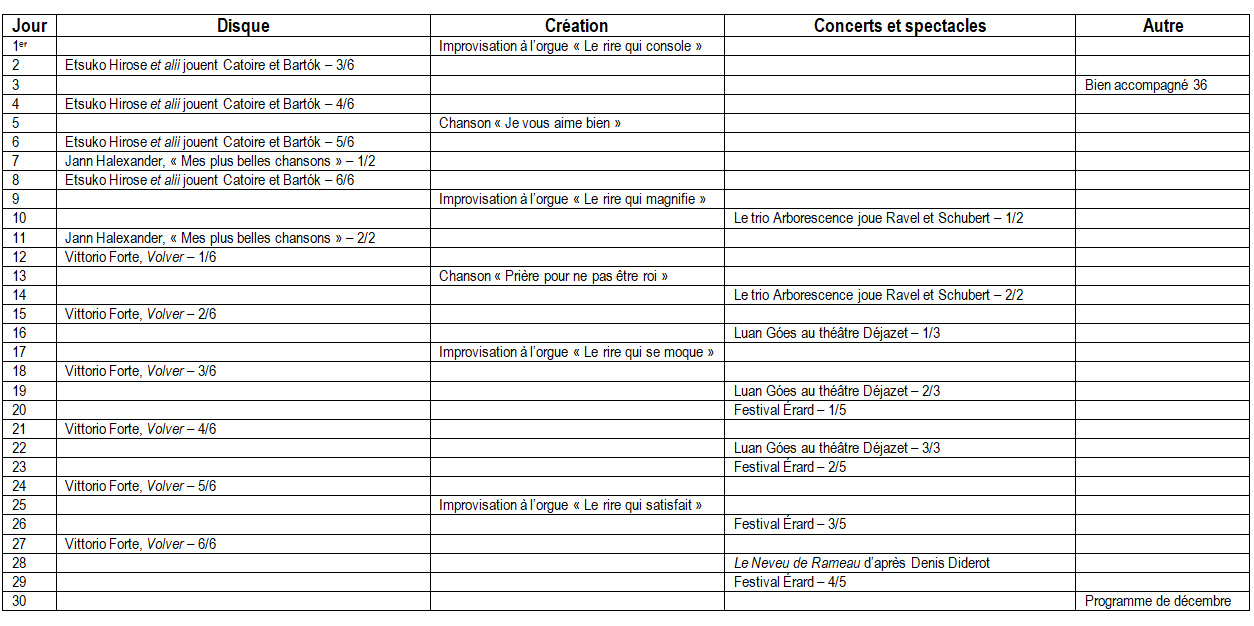

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)






