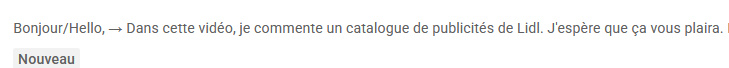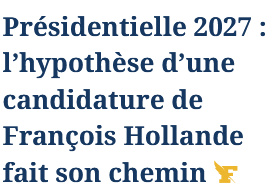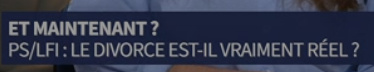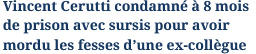Juste le plaisir.
- Celui d’Arsène (les prénoms cités ont peut-être été changés), le gros en T-shirt blanc qui rêve de faire des roulades sur scène, si possible en câlinant le chanteur.
- Celui de Kéké, le zozo aux allures de rappeur tout en noir qui tente de battre le record de slams réussis en une soirée (en quantité plus qu’en temps dans les airs).
- Celui des spectateurs dans la fosse tentant d’enquiller, à défaut de wall of death, mosh sans danger et circle pit bon enfant.
- Celui de Martine ou Ghislaine de la compta, qui serre fort les poings et se dandine avec fougue durant tous les concerts du soir comme si elle dansait sur du Philippe Lavil.
- Celui de l’auteur de ces lignes qui avait envie de retrouver le kif des concerts 104-110 : jamais en dessous de 104 décibels, capés au-dessus.
Comme à chacune de nos expériences à l’ex-Loco pour un concert de metal,
- l’accueil est propre,
- l’ambiance est conviviale, et
- même la bière est buvable.
De quoi découvrir des groupes dont on ignore tout, pour un prix d’entrée cossu (30 balluches) mais un service rendu impeccable. La surprise va venir de God Complex, groupe qui se produit juste avant les vedettes canadiennes. Surprise pour le public mais aussi pour les musiciens, le chanteur répétant qu’il ne s’attendait pas à une telle ambiance pour leur « dernier concert en Europe » avant la tournée au Royaume-Uni. Le son est sévère, réduit à
- l’hystérie de la basse,
- au rush de la batterie et
- la rage de la voix.
Avec des guitares inaudibles, tout se joue sur
- l’énergie,
- l’urgence et
- l’envie.
Les leveurs de rideau ferraillent sans temps mort, de sorte que les spectateurs s’enjaillent de plus en plus, tant dans la salle qu’en crapahutant sur scène entre zicos et preneur d’images. Le répertoire semble peu connu des métalleux, mais les Anglais envoient du son sans relâche, et la magie du mouvement fonctionne. Le triomphe fait au groupe, disproportionné en théorie, est parfaitement justifié : on a bien bougé les cervicales.
Counterparts se présente vers 21 h 35. Côté plus, seize ans d’activité, sept albums au compteur ; côté moins, nihil novi sub sole depuis 2024 et une formation instable. Le groupe déverse une musique essentiellement incarnée par le chanteur, où les torrents de décibels s’éclairent parfois de quelques breaks permettant de presque entendre une guitare saignante à souhait. Le set paraît maîtrisé mais trop monolithique, presque mécanique, jusque dans la manière de s’adresser au public et dans la hâte de chasser les spectateurs – pourtant disciplinés – s’aventurant quelques secondes sur scène. De même, le jeu de lumières, léché, ne compense pas le sentiment que, ce soir-là, manque la flamme du live susceptible d’envoler les spectateurs.
Pourtant, les soixante-cinq minutes de concert assument un univers affirmé et spécifique, entre dark et gore. En émergent des suppliques de survie sanguinolente où dialoguent
- imagerie religieuse,
- iconographie sacrificielle (« A Martyr left alive », dernier titre vidéoclipé) et
- fascination pour la suffocation enflammée (« Bound to the burn »).
Les textes, inaudibles en concert, dessinent un imaginaire torturé (« With loving arms disfigured »), obsédé par la dimension concrète de la mort (« Wings of nightmares ») et l’abandon qui fout la rage (« Now I want to watch your skin rust and slowly grow discoloured » dans « Choke », ou « If I could, I’d murder you myself » dans « Unwavering vow »). L’auteur est envahi par la conviction d’être mort avant même de l’être (« Paradise and plague »). Dès lors, c’est la colère qui les inspire, lui et ses acolytes, notamment dans « Thieves », censée être une fredonnerie contre les abus en tout genre. Le chanteur s’y dépeint comme un redresseur de tort qui envisage de « remove the arms of unrepentant thieves ».
Plus globalement, les grommellements expriment une sensation de toute-puissance oxymorique car à la fois divine et destructrice (« I will absolve you of your sins and hurl you into hell myself » dans « Your own knife », ou « Purgatory burned as I fought alongside the flame » dans « To hear of war ») s’exprimant par une aspiration indécrottable à la violence extrême (« No lamb was lost, no love was lost, I’d kill to keep them both alive » dans la chanson éponyme). L’horizon est la mort, la mort, toujours recommencée. Le plus grand rêve du narrateur serait même d’être endormi dans un cercueil de verre pour que l’on se souvienne du sourire d’un homme happé par la noirceur de ses inclinations (« Stranger ») le poussant
- à haïr « the fact that I’m alive » (« Witness »),
- à s’interroger : « I remain / why remain? » (« Praise no artery intact ») et
- à supplier que l’on « put a fucking bullet in [his] head » (« Monument »).
Pour boucler le concert, « Heaven let them die » reprend des bouts de texte de « A Martyr left alive », dont il constitue la seconde partie. Lui succèderont deux bis expédiés : « Love me » spécifiant toutefois qu’il n’y a plus rien à aimer… même si le chanteur finit en criant son amour pour son fils Kuma, un temps à l’article de la mort suite à un cancer. Du travail sérieux mais
- trop peu investi scéniquement,
- trop haché rythmiquement après la première demi-heure (que de pauses dans le noir avec une bande-son banalissime !), et
- trop précipité sur la fin
pour susciter l’enthousiasme que l’on aurait aimé exprimer. Entre bien et wow, il y a un fossé qui, à notre impression pas humble mais honnête, n’a été ni comblé ni franchi ce soir-là par Counterparts.



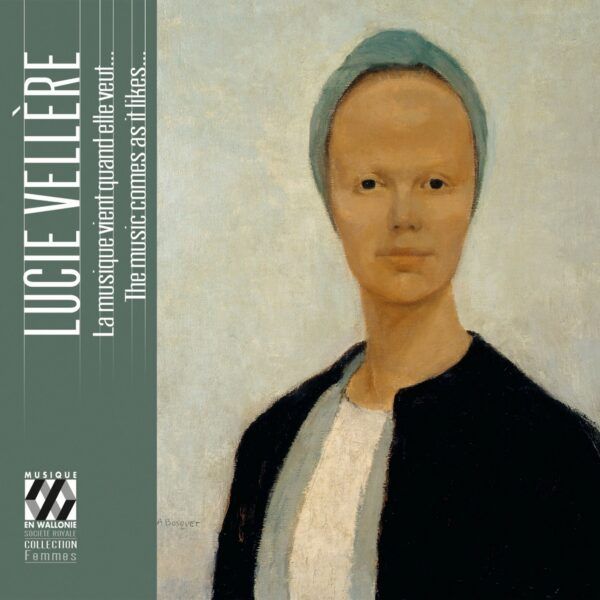





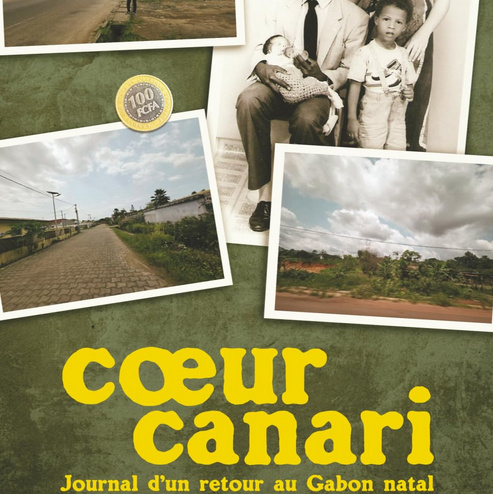


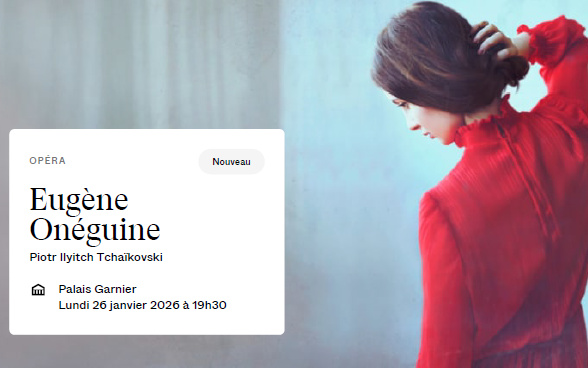
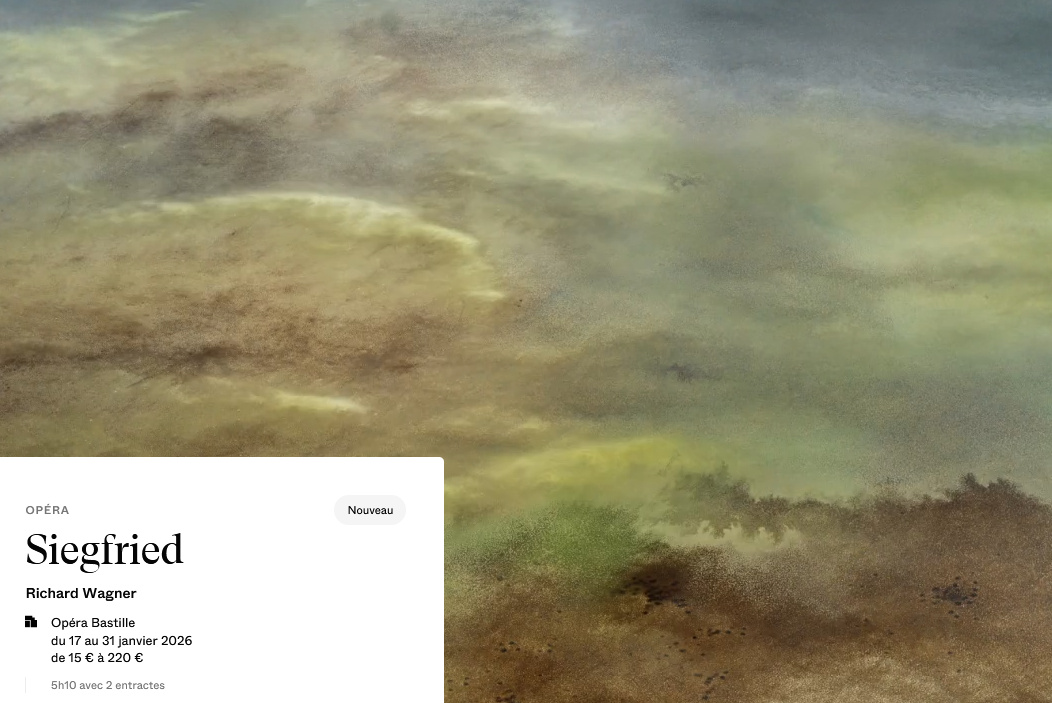














































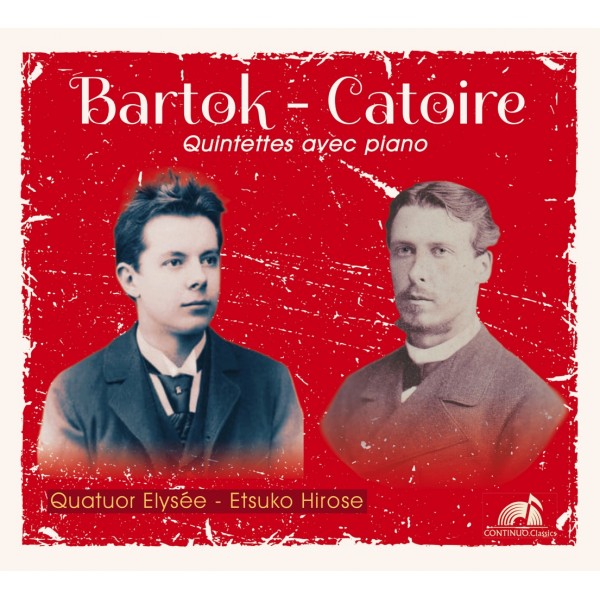

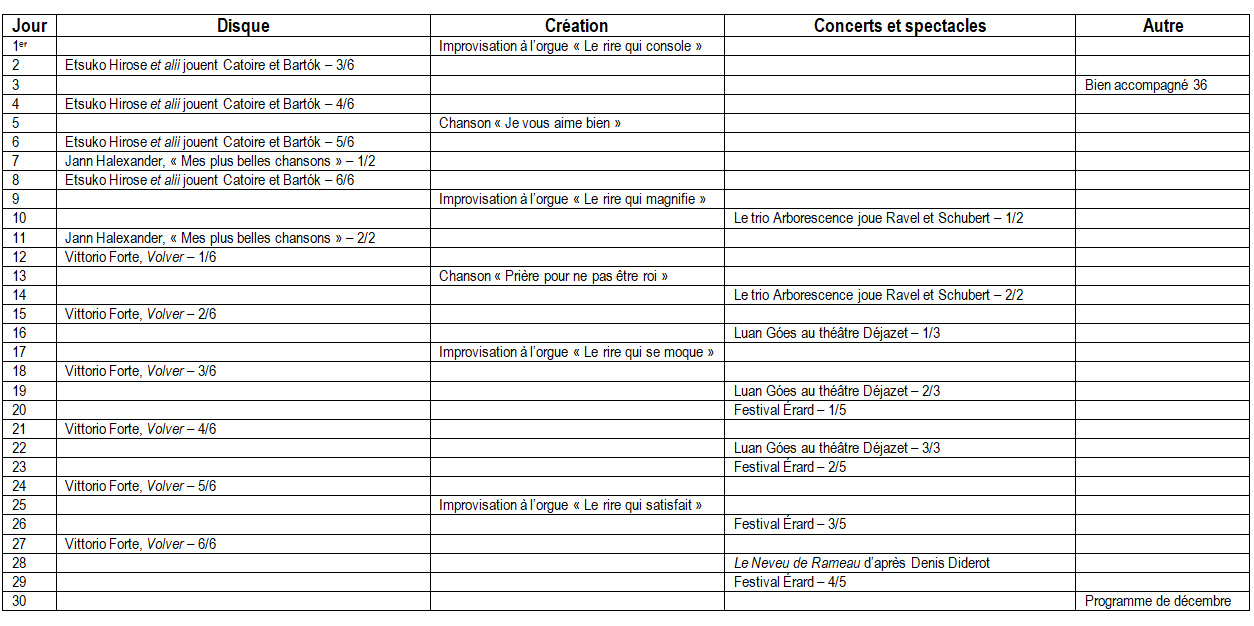

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)