
Triple mise en situation
C’est, premièrement, l’histoire, signée Julie Otsuka, d’une double déportation, et ça n’a pas grand-chose à voir avec la Shoah – même si une douche vise, suppute-t-on, autant à évoquer la quête de l’impossible purification qu’à laisser un peu d’ambiguïté. Grâce à Richard Brunel, c’est, deuxièmement, une pièce de théâtre – paraît-il – qui a buzzé au Festival d’Avignon 2018. Et c’est, troisièmement, un spectacle donné à la Manufacture des Œillets d’Ivry-sur-Seine jusqu’au 25 janvier.
Double résumé
La première déportation est une importation. Rejetés par les Blanches et les autres Asiat’, les Jap’ mâles importent des femmes par le truchement d’une marieuse véreuse, promettant aux uns des vierges, aux autres des semblables-à-verge ayant, eux, réussi aux States. À peine descendues du bateau, les nénettes se font troncher bien baiser violer défoncer ça dépend. Puis elles travaillent aux champs. Puis elles vivent le bon vieux racisme blanc de base anti-niakwés, puis le racisme interasiatique. Puis elles sont bonniches et se font parfois engrosser par le patron, moyennant un bifton quand ça s’présente. Puis elles travaillent dans des ateliers de confection. Puis elles enfantent. Puis leurs enfants s’éloignent de leur culture et tentent de s’américaniser. Puis la guerre fait de leurs familles des suspects. Puis elles sont déportées avec leur marmaille. C’est la deuxième déportation, une déportation pour de bon. En conclusion, une Américaine de base raconte son étonnement devant la disparition des braves Jap, le chagrin de ses enfants, avant que le temps ne fasse son œuvre et considère que, le courrier débordant aux portes des pavillons, la mémoire déclare cette destruction américaine hors saison.

Le spectacle simple
Voici donc l’adaptation à succès d’un roman à succès itou, écrit par une obsessionnelle : « Son premier roman, Quand l’empereur était un dieu, raconte l’internement des familles nippo-américaines » ; son deuxième roman, Certaines n’avaient jamais vu la mer, titre ridicule vu l’original – The Buddha in the Attic –, reprend une partie finalement non incluse dans le premier. D’emblée, une question éclate : s’agit-il d’une adaptation ou de la transposition basique d’un roman ? Nombreux sont les clichés de la TVF (la théâtralisation vite fait) qui maculent cette déclinaison pourtant signée d’un « comédien et metteur en scène de théâtre et d’opéra » (d’où, suppute-t-on, la présence synthétique de Nathalie Dessay, lors d’un long monologue final où on la fait quand même et parler et chanter). Citons-en quatre, à titre d’exemples :
- l’impression, comme le soufflait une lycéenne à l’issue de la représentation, d’avoir assisté pendant deux heures à la « lecture d’un livre audio » ;
- l’inscription physique du livre dans la scénographie (chapitres et sous-chapitres affichés en fond scène) ;
- l’utilisation de techniques dignes d’une mauvaise MJC. Genre la radio qui déverse les nouvelles opportunément ou, pis : « Nos enfants nous demandaient où étaient passés leurs camarades. / L’ENFANT : – Où sont passés nos camarades ? », Seigneur, ten piedad ;
- la quasi absence de moments vraiment dramatiques, où la récitation s’efface au profit des corps, des mouvements et de leur langage propre (exceptons la fin de l’avant-dernier chapitre qui, partant, nourrit plus les regrets qu’elle ne les dissout).

Ajoutons à nos griefs, quelque subjectifs semblassent-ils :
- les incohérences incompréhensibles sans, nous n’en doutons point, formation poussée (pourquoi certaines Japonaises sont-elles jouées par des Japonaises comme Kyoko Takenaka ou la jolie Yuika Hokama – ce n’est pas une insulte, et d’autres servies par des Asiatiques non-nippones ou par, carrément, des Françaises ?) ;
- les bizarreries de la sonorisation inégale ;
- l’apport peu intelligible d’une vidéo remplaçant sporadiquement les actrices en fixant longuement d’autres actrices (ou les mêmes) récitant un texte ou attendant la fin de la séquence ;
- l’utilisation d’un décor associant les topoi du théâtre in, avec les praticables partiels et mobiles, et les clichés qui font opéra moderne (ah ! le tapis de trucs que les acteurs doivent nettoyer à temps, ah ! ah, cette douche qui permet de faire mouiller les filles, façon Huguenots cheap, ah !) ;
- la saturation d’une bande-son omniprésente, soulignant la conscience de l’adaptateur que le texte ainsi propulsé ne suffit pas (toujours Véronique Pestel, même si c’est mal dit : « … et la musique est là pour ne pas qu’on s’ennuie »).
Dans ce contexte, en dépit des efforts louables de la plupart des actrices anonymes (le « nous » l’emporte sur le « je ») et des quelques acteurs réduits à des clichés, on peine à se laisser traverser par une quelconque tension ou compassion artistiquement puissante. En deux heures de temps, c’est quelque peu fâcheux.

En conclusion (nulle)
Ce qui précède explique notre enthousiasme mitigé pour cette nouvelle production programmée au Théâtre des Quartiers d’Ivry – un lieu hyper difficile à trouver mais fort chaleureux quand on y débaroule (super hall d’accueil avec bar accessible et minibanquettes confortables dans la salle, aux places hélas non numérotées)… malgré un « dossier pédagogique » ridicule et une distribution de programmes perfectible (par chance, nous en subtilisâmes un sur une table : pas de programme distribué à l’intérieur – WTF ?). Notons que le récit déroulé devant nous n’est pas inintéressant, utilisât-il la technique bien connue de l’accumulation contradictoire soulignant l’identité (toutes des Japonaises) et la singularité (le « nous » collectif ne saurait masquer les aléas de dame Fortune).
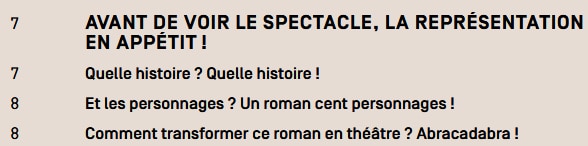
Notons en sus que, le jour où nous nous glissâmes dans l’enceinte, un débat avec l’auteur new yorkaise concluait la rencontre. Cette bonne idée en cachait une mauvaise : mieux vaut payer un animateur. Pourquoi ? Une intuition, comme ça. Mais ça évitera de laisser la place à un débat débile, du style : « J’adore le cinéma, n’empêche, au niveau théâtre, y a d’autres pièces comme ça ? », ou : « Apparemment, il y avait des actrices japonaises sur scène, c’était fait exprès ? ». Bref, malgré la présence sur scène de deux chiens aussi mimis qu’inutiles, une proposition sérieuse mais curieusement plate car, as far as we’re concerned, peu dramatisée, par paresse ou, préfère-t-on suborodorer, respect paralysant du Texte Original, sur un sujet pourtant rare et susceptible de vibrer d’une émotion tant humaine que politique.





































































