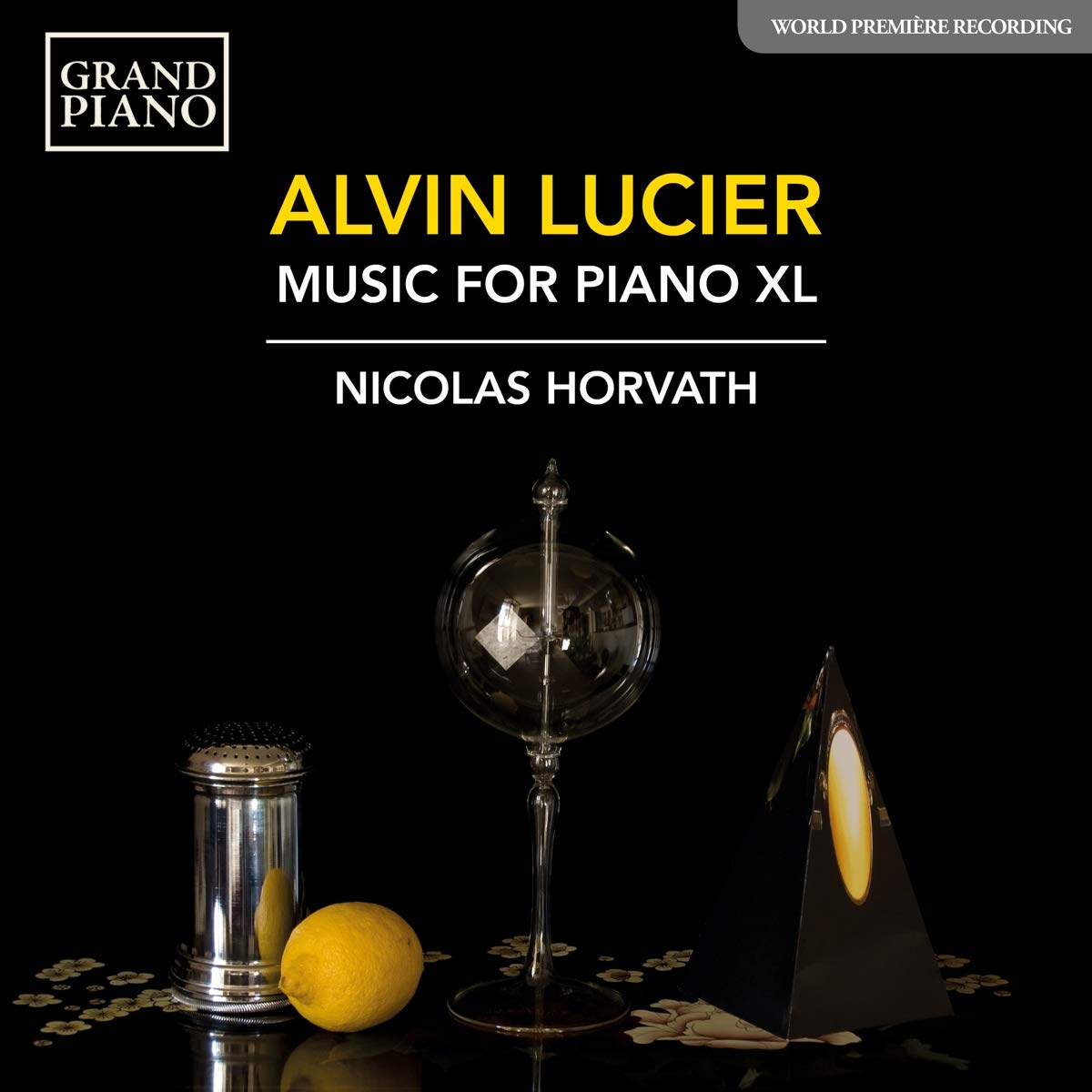
Après avoir été
- le musicien classique qui fricote, lascif, avec la scène harsh noise,
- le jeunot à brushing qui claque son Liszt et ébaubit l’assistance par sa virtuosité,
- le spécialiste de la musique minimaliste puis d’Erik Satie,
- le praticien des concerts de 12 à 24 h sans quitter la scène,
Nicolas Horvath a noué un partenariat fructueux avec Grand Piano, un label chapeauté par Naxos, où la diversité de ses projets lui permet d’échapper à la monomanie. Pour maints pianistes, la spécialisation a le côté rassurant de l’étiquette, ce qui leur donne du prix ; pour quelques originaux, cette expertise devient vite une chape réductrice sous laquelle la musique finit par sonner comme une ratiocination de fonctionnaire jauni à l’idée avant l’âge. Devinez dans quel camp émarge le présent pianiste, en sachant que, après nous avoir fait découvrir les sonates de Brillon de Jouy, il nous offre une nouvelle embardée, cette fois dans les eaux de la musique expérimentale.
Music for piano with slow sweep pure wave oscillators est une pièce d’Alvin Lucier, né en 1931, où le piano dialogue avec « deux ondes balayant un registre de quatre octaves » et frottant avec l’unisson, comme un accordeur cherchant la note juste. Originellement, le défi durait 15’. Désormais, il existe en version XL de 65’ et a été créé en octobre 2020 par Nicolas Horvath en personne, qui précise, à propos de la version studio : « Il n’y a absolument aucun montage » (d’où des bruits de live, comme à 7’45 ou à 1 h00’39, par ex.) et ajoute, dans une formule géniale : « Parfois, le son du piano peut paraître très bizarre [voir à 18’23, par ex.], mais c’est tout à fait normal. »
Tout commence par une oscillation qu’un fa4 et un mi bémol4 viennent défier. Par petites touches, le piano inspire et aspire les ondes, jouant avec les résonances pour esquisser une atmosphère embrumée. Autour des contours à la fois nets et imprécis sculptés par les notes du piano, les ondulations tissent un halo d’une densité variable. Rapidement, l’écoute suscite un effet paradoxal, qui tient à la fois de l’hypnose atmosphérique et du suspense consistant à attendre la prochaine note voire à anticiper l’intervalle (en temps et en hauteur) qui viendra nourrir les ondes ou varier l’atmosphère.
Des événements réjouissent l’auditeur soucieux d’action, tel ce premier accord, vers 6’25, ou la première octave simultanée, vers 9’50. Cependant, la composition fait trop confiance à son principe de clusters mouvants, libérés en pointillés par le piano, pour multiplier les accidents ou les surprises. Il semble qu’Alvin Lucier pose un geste où le dépouillement est lui-même l’événement – on pense à un feu : de temps en temps, on remet une bûche dans l’âtre, mais c’est la flamme qui éclaire, réchauffe et fascine, pas la bûche.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=U3oGyCLaI8A[/embedyt]
Les variations d’attaque (15’10, par ex.) ne sont pas davantage, en soi, des mutations ou des à-coups : elles ne sont que du minerai pour les oscillateurs, au même titre que
- la durée des notes,
- leur résonance immédiate et
- leur hauteur.
Des effets de distorsion ou de tremblement (22’25) se faufilent çà, évoquant parfois la guimbarde plus que le gong (46’34) ; et des pédales proches du larsen grincent là, comme pour appeler l’auditeur à se déprendre d’une logique vectorielle, qui le conduirait d’un point A vers un point B. Nous ne sommes point devant l’inaccessible château de Kafka qu’il faudrait absolument pénétrer. Au contraire, tout se passe comme si, à une dynamique narrative (tel morceau respire la tristesse ou la pétillance) voire archétypale (on reconnaît des formes et des carcans qui nous indiquent où on se situe, dans le morceau, et comment ça devrait se développer), Alvin Lucier et son interprète substituaient une rhétorique de l’engoncement oxymorique, si si, puisqu’il s’agit de s’enfoncer dans une atmosphère sonore – sauf que, pour s’enfoncer, il faut accepter de ne pas bouger, c’est là qu’est l’os. L’audition est donc partagée entre
- la nécessité de l’événement (la note qui tombe pour nourrir les oscillations) et
- le désir de la perpétuation (le son contemplé étant comme perturbé par les notes nouvelles, qui nous empêchent de nous lover dans un va-et-vient confortable).
La notion même de note, juste ou fausse (29’41), est remise en cause par l’impossibilité d’accéder à la justesse, incompatible avec l’oscillation. L’effet produit s’apparente à une fragmentation liquide de la musique :
- fragmentation, car division du son en plusieurs possibles à travers les vibrations ;
- liquide, car fluidité des oscillations perpétuelles.
De la sorte se construit et se déconstruit la saisissabilité – et hop – de la musique, faisant écho aux propos contradictoires en apparence qu’Alvin Lucier a tenus : « Lorsque j’écris une œuvre, je dois dé-composer, ne pas composer. » Il ne s’agit pas de ne pas peindre en peignant comme tout bon destructureur d’intemporarité ! Il s’agit de ne pas laisser l’acte compositionnel devenir une fin en soi, au détriment du projet qui le motive ou de l’idée qui l’anime. Pour Alvin Lucier, la mise en forme d’une idée doit se libérer des procédés enseignés lors des études de composition, assimilables à un bruit ambiant empêchant de saisir une parole – la substance de l’œuvre à écrire.
Face au brouhaha d’un certain classicisme, fût-il moderne, Nicolas Horvath élabore une chorégraphie à la fois statique et mouvante. Au mouvement de l’ondulation répond l’itération stable du procédé, concomitante de l’annihilation du temps. En effet, si l’on ne se peut repérer dans un espace aux contours mouvants, l’on ne peut davantage se repérer dans une temporalité qui se dérobe faute de développement, de dynamique et de récit. Écouter cette musique revient à se débarrasser de la rigidité kantienne qui nous pousse sans cesse à chercher comment nous orienter dans la pensée. De fait, l’ondulation entraîne la suspension
- de la géographie cognitive (il faut se perdre dans l’œuvre) et
- de la chronologie orientée (on ne sait jamais si on se trouve au début, au milieu ou à la fin du morceau).
La répétition d’une même note à différentes hauteurs, autour de 46’45, suivie de sa dégradation illustre la dérobade des repères. Quelle est ou serait la bonne note ? et comment se projeter vers l’avenir du morceau quand son langage est à la fois translucide (on voit bien comment « ça marche ») et déstructuré (l’agencement des notes n’obéit pas à une logique de phrase mélodique) ? C’est précisément cette perte de repères qui laisse à penser que la maximisation de Music for piano with slow sweep pure wave oscillators, passant de 15′ à 65′, est une idée judicieuse. Il faut du temps pour « perdre son temps ». Dès lors qu’il échappe à la pulsion de suspense évoquée supra, l’auditeur peut entrer dans la logique de suspens. Alvin Lucier n’abolit pas le temps : il suspend son vol en libérant la musique de sa mécanique narrative (parlera-t-on de mécanique contique ?), comme semble le suggérer le ralentissement des événements vers 56’40.
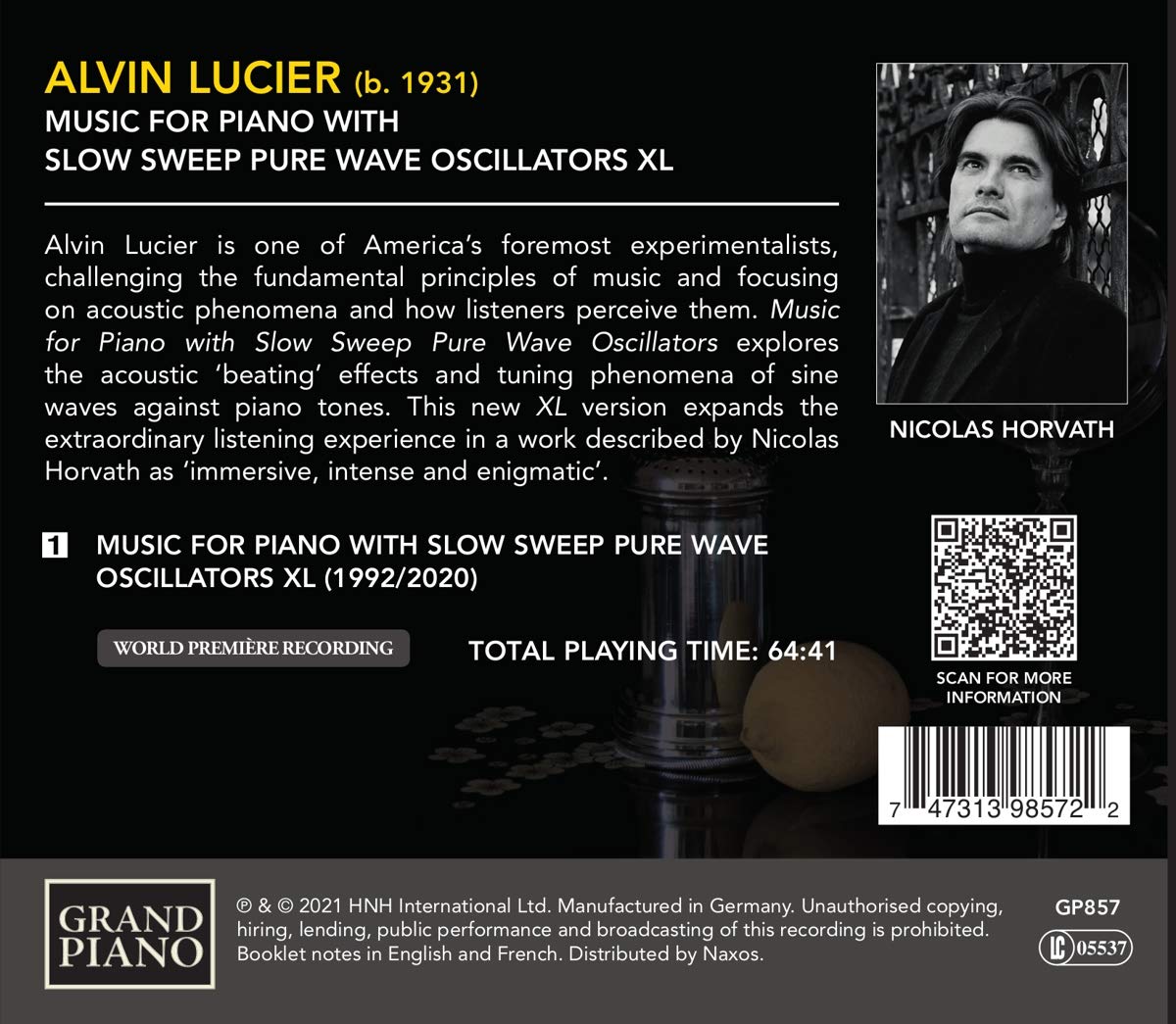
Ainsi passe-t-on de la musique expérimentale à la musique expériencielle. Le compositeur part d’un procédé technique pour proposer une expérience à celui qui écoutera sa musique. Or, par un procédé spéculaire, cette expérience consiste à déterminer la nature même de l’expérience. En effet, d’ordinaire, l’expérience d’écoute est bien balisée : on est ému, on est content de reconnaître un truc que l’on connaît, on admire le musicien pour sa technique de ouf, etc. Ici, rien de commun. L’émotion se construit par la mise en signification subjective de sons non reliés entre eux et de leur résonance ; la partition est enregistrée en première mondiale, impossible de la re-connaître ; le musicien ne déploie pas une technique virtuose mais offre d’entendre une partition inouïe jusqu’ici. Partant, pour l’auditeur, tout est à construire.
1’ d’oscillations jusqu’au silence n’est donc pas de trop pour nous sortir de la transe suspensive et nous ramener vers la vraie vie. Nous y revenons avec la conviction renouvelée que la fausse vie, comme la fausse note, est souvent plus intéressante que la vraie, surtout quand elle est portée par des découvertes de cet acabit !
Pour acheter le disque, c’est ici.
Pour l’écouter en intégrale, c’est là.







































































