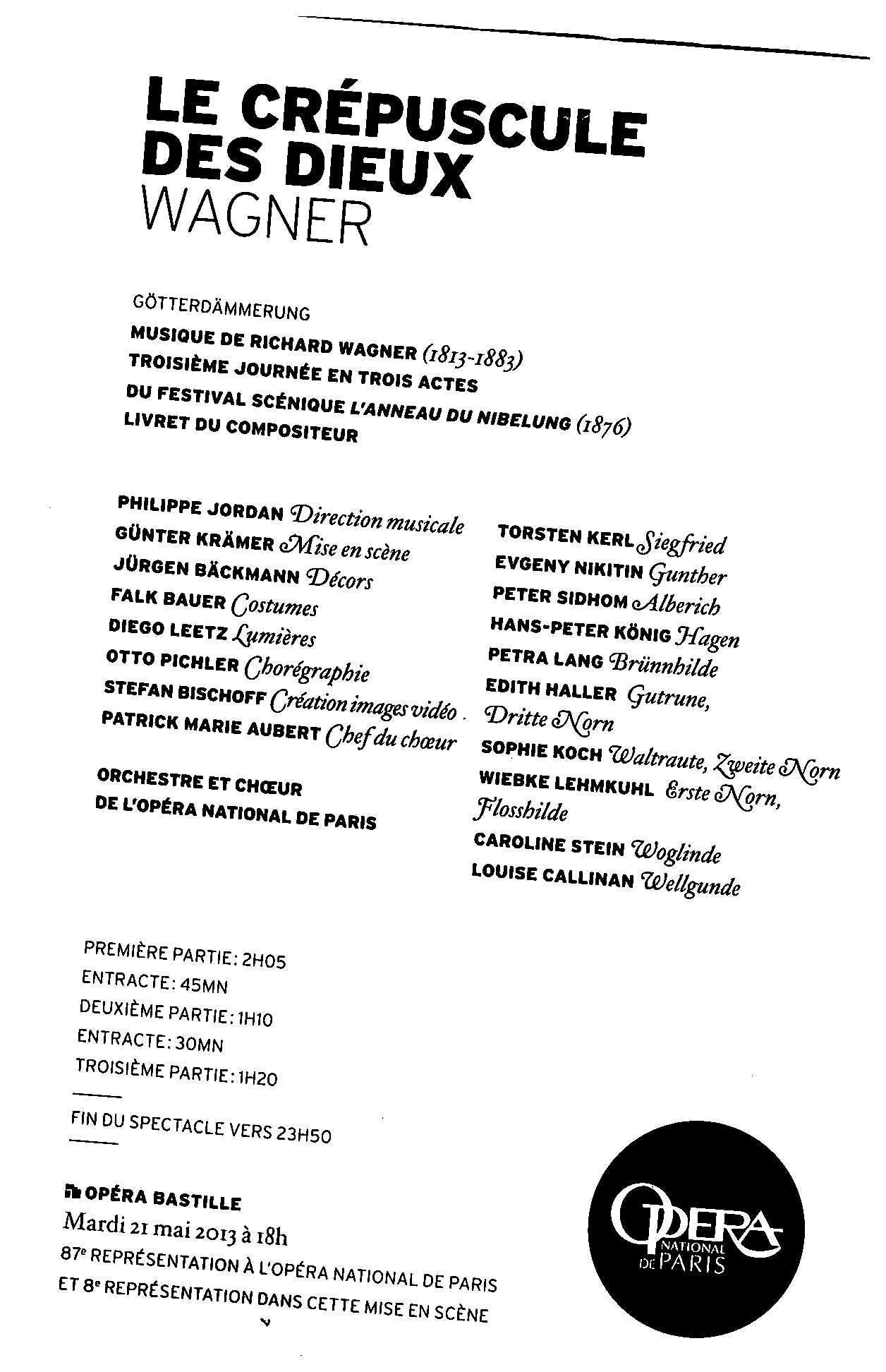Formidable, malgré la nullité des à-côtés (mise en scène, décors, costumes) : tel est le sentiment qui anime l’auditeur à la sortie du Crépuscule des dieux tel qu’il fut donné lors de la première de la reprise…
L’histoire : après que les Nornes constatent que rien ne va plus, Brïnnhilde laisse partir Siegfried qui, sous prétexte d’exploits à accomplir, ne supporte pas de rester à la maison (prologue). Le vaste premier acte envoie Siegfried plonger dans le piège ourdi par les Gibichungen. Hagen conseille son demi-frère Gunther d’accueillir le héros, de lui faire boire un philtre pour qu’il lui conquière Brünnhilde sous ses traits et qu’il épouse Gutrune, sa sœur. De son côté, Waltraute tente de convaincre sa sœur Brünnhilde de lui rendre l’anneau du Rhin pour remonter le moral des dieux, mais Brünnhilde dit nein. Siegfried, lui, remplit la mission confiée par Gunther (acte I).
Chez les Gibichungen, quand tout le monde est de retour, ça castagne. Alberich accuse son fils Hagen d’être un mou du slip. Hagen accuse Siegfried d’avoir trahi Gunther. Brünnhilde accuse Siegfried d’avoir trahi tout le monde. Gutrune accuse Siegfried de l’avoir trahie, etc. Hagen en profite pour demander conseil à Brünnhilde sur l’art de tuer Siegfried, traître à tous : il suffira de lui tirer une lance dans le dos (acte II).
Au cours de la chasse du lendemain, les filles du Rhin manquent de récupérer l’anneau. Échouant, elles annoncent à Siegfried qu’il va mourir dans la journée ; il s’en fout. Pourtant, Hagen ne tarde pas à l’assassiner. Pressé de reprendre l’anneau au mort, il tue aussi Gunther. Mais Brünnhilde récupère son héritage (l’anneau) et se jette à son tour dans le bûcher où barbequioute Siegfried – avec son cheval Grane, ce qui est dégueulasse. C’est la grande scène de l’immolation, que les filles du Rhin concluent en reprenant l’anneau purifié avant de tuer Hagen, et c’est la fin (acte III).
La représentation : en dehors de l’aspect sportif (le spectacle commence à 18 h, il finit à minuit), le Crépuscule conclut avec force le cycle de L’Anneau du Nibelung. Au programme, puissance des cuivres, vivacité des cordes, éclat des bois et exploitation éhontée de nombreuses possibilités, voire impossibilités, de la voix humaine. Pour apprécier pleinement ces performances, il faut, à Paris, faire abstraction d’une scénographie honteuse. Décor cheap (tourniquet, écran vidéo, vaisselier en guise de rocher sacré, vide pour figurer tout : tout le budget est pas passé là dedans, quand même ?), costumes étonnamment signés (combien fut payé Falk Bauer pour mettre les hommes en costard ou en robes ?), mise en scène de niveau zéro (au sens propre : la signature Günter Krämer, c’est l’immobilité – d’Alberich, des guerriers, de Hagen handicapé en chaise roulante), ajouts consternants (conclusion de tout le Ring par une projection de jeu vidéo façon first-person shooter : c’est aussi profond que d’émettre un gros, gros prout en plein enterrement)… Il n’y a rien à sauver de cette pitoyable pantalonnade.
Heureusement, tout le reste est magnifique. L’orchestre, ce soir-là, est en grande forme. La sonorité est belle, les solistes sont irréprochables (on se réjouit presque que le trompettiste couaque en dialoguant avec Siegfried : tout cela n’est donc pas truqué !), les contrastes sont maîtrisés, Philippe Jordan est à son affaire.
Côté vocal, après l’élimination du maillon faible qu’était l’insauvable Alwyn Mellor, ce sont trois Brünnhilde qui sont réquisitionnées pour la série de Crépuscule au programme. Pour la première, Petra Lang est de sortie. Son rôle est énorme. Pourtant, pas un signe de faiblesse dans sa conduite vocale. Son parti pris est tenu de bout en bout – c’est celui d’une Brünnhilde blessée, intraitable, enragée. Pas de grâce, non, pas douceur, même dans le duo d’amour liminaire. L’option peut surprendre, mais elle paraît cohérente avec une voix résistante et puissante. Bien sûr, même pour des cantatrices de cette trempe, il est difficile de repartir dans les médiums après avoir claqué un suraigu ; mais quelle force a sur scène cette furie ! Ce n’est pas une belle Brünnhilde, c’est une Brünnhilde de haute volée, pour qui la dignité l’emporte sur l’émotion. En définitive, c’est une Brünnhilde impressionnante que campe Petra Lang, parfaitement à la hauteur de cette montagne.
Curieusement ouhouhté par une partie de Bastille, Torsten Kerl, spécialiste du tout aussi monstrueux rôle de Siegfried, est en forme. Certes, le début du II manque de puissance (préparation des difficultés à venir ?) ; certes, les aigus du III paraissent de plus en plus difficiles à atteindre ou à escamoter ; mais ce sont des détails. Le ténor tient parfaitement son personnage, entre cabotinage (ses poses préférées : la scrutation, eh oui, d’une femme de la tête aux pieds avec une petite moue ironique, et la position allongée, genoux et mains battant l’air) et mine amusée d’un Siegfried simple qui ne semble jamais comprendre les enjeux de son histoire. Là encore, le parti pris est très personnel ; il offre, en sus d’une performance vocale de très haute tenue (puissance, intensité, interprétation), un effort de présence scénique particulièrement stimulant, qu’humanise une envie de se gratter alors que la mort est censée avoir déjà rigidifié son cadavre.
Aux côtés des vedettes, on apprécie l’énorme et classique Hagen de Hans-Peter König, bloc impénétrable qui déroule sa basse puissante comme à la parade, malgré, suppose-t-on, un rhume (recherche désespérée d’un mouchoir pendant l’acte II, tissu retrouvé pour l’acte III). Gêné par de saugrenues lunettes fumées qui tombent sans cesse et s’oublient parfois, Evgeny Nikitin est un Gunther ni mémorable ni honteux. En fait, parmi les seconds rôles, on a envie de bravoter spécialement Edith Haller, Gutrune (et troisième Norne) longtemps contenue, dont la puissance éclate au dernier acte et donne envie d’en entendre davantage ; et Sophie Koch, Waltraute (et deuxième Norne, une nouveauté par rapport à la production 2012) très digne bien qu’elle joue un combat perdu d’avance face à Brünnhilde. Le chœur de l’Opéra, dirigé par Patrick Marie Aubert, sans avoir un énorme travail, contraste joliment au deuxième acte, entre tonitruances festives et chuchotis étonnés, même s’il reste à faire encore un petit effort de coordination scénique (les gars du premier rang ne sont pas tous liés pour le balancement chorégraphique, sommet de la mise en scène krämerienne).
En conclusion, il est vraiment rageant d’avoir affaire à une production aussi faible esthétiquement et scénographiquement, car la qualité de l’orchestre, la beauté des ensembles, l’excellence de chaque soliste valent absolument d’être vues et entendues car, comme disait l’Autre, malgré la nullité de la bande à Günter Krämer, tout le reste est juste et (drôlement) bon.
Opéra Bastille, 21 mai 2013
22 mai 2013