
C’est à un plaisir coupable, donc délicieux, que nous invitent la violoncelliste Cyrielle Golin, son complice Antoine Mourlas qui partage le piano avec Mary Olivon, et le violoniste du National Hector Burgan. En effet, flotte toujours un parfum de naphtaline bourgeoise shootée au capitalisme décomplexé sur le répertoire dix-neuvièmiste spécialement conçu pour les salons des nantis qui, heureuse époque, n’avaient point à se déplacer pour partager quelques notes avec des ploucs. La Hausmusik se consommait, par définition, par nature et par construction sociale, at home, entre soi et parfois, classe appréciable, par soi. Dans cette perspective, les compositeurs et arrangeurs disposaient d’une arme redoutable : le piano à quatre mains, orchestre salonnard parfait pour lequel un immense stock – parfois brillant, parfois fonctionnel – d’arrangements ont été écrits.
Forts de cette mode, certains compositeurs ont spécifiquement composé pour la formation ici mise en évidence : violon, violoncelle et piano à quatre mains. L’un des plus obstinés dans cette voie s’appelle Hermann Berens. Ses quatuors troisième et quatrième encadrent ce disque original, qui revendique de ne proposer que des premiers enregistrements mondiaux, tadaaam ! L’opus 72 ouvre le bal avec un projet, clair, répliqué par l’opus 80 qui bouclera l’album – s’agit de pas mollir.
En témoigne le premier mouvement, tour à tour Allegro molto, Con brio et Presto. Le grave profond de Cyrielle Golin ouvre le bal, vite rejoint par l’ample tessiture de ses complices. L’énergie sourd d’un mélange riche comprenant
- des accents indispensables au swing,
- l’équilibre mouvant des voix,
- les tensions-détentes des nuances,
- la synchronisation tonique et
- une écriture incitant tour à tour les convives
- au dialogue,
- à la confrontation et
- à la conversation partagée.
En moins de cinq minutes,
- le tuilage accelerando du mouvement,
- la circulation du lead et, paradoxalement,
- la relative pauvreté mélodique valorisant la pulsation versus l’émotion suspensive
nous précipitent sans merci vers le deuxième mouvement, Andante, certes, mais con moto s’il-vous-plaît. Un piano mélancolique ouvre le bal, rejoint par le violon et le violoncelle en accompagnateurs de luxe ; puis une partie énergique semble créer une embardée. Illusion : l’esprit liminaire, plus retenu, reprend le dessus. L’alternance entre accents et ligne mélodique n’occulte pas la réutilisation obstinée du thème par les pianistes seuls, l’alternance majeur-mineur répondant à l’alternance précitée.
- Les mutations monothématiques,
- les variations d’effectif et
- la relative brièveté du mouvement
contribuent à éviter que ne se délite jamais le charme d’un bavardage aux évolutions sciemment lisibles.
Un Scherzo vivace où flottent presque quelques cancans d’Orphée, version ternaire, permet aux interprètes de briller par leur capacité à laisser se développer la phrase puis à la pimper d’accents ou de rugissements opportuns. Roulades, arabesques et gracieux unissons des cordes en profitent pour se dérober aux tentacules tentants de la musique jolie afin de conter fleurette à une musique charmante, la différence est d’importance, qui travaille à capter l’attention de l’auditeur. En effet, la Hausmusik est moins une musique que l’on écoute pour admirer un compositeur que pour kiffer un moment de bon aloi en séante compagnie. Stipulons que, n’en déplaise aux snobinards qui tentent de régenter le bon goût musical contemporain, la seconde possibilité n’est pas en soi moins valable ou moins sapide que la première.
Ce premier voyage chez Hermann Berens s’achève sur un Allegro vivo e scherzando. Le piano énonce le thème élancé que les cordes frottées tendent à transformer en galop sans écraser l’élégance sous le poids de l’allant obligé.
- Notes répétées,
- échos,
- variations d’intensités et de couleurs
font scintiller une musique qui, bien qu’elle exige dextérité et synchronisation de ses interprètes, miroite joliment, bien au-delà de l’artisanat sûr du compositeur.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=R137bZ8pQKo[/embedyt]
De Felix Mendelssohn, familier du piano à quatre mains, les artistes ont choisi l’Ouverture en do mineur composée pour une représentation de Ruy Blas dans une transcription de Carl Burchard. Le Lento inaugural de l’orchestre (hors cordes) est confié au piano dont la capacité de résonance sied à cet incipit dramatique. Le violon récupère la partie de… violon qui ouvre l’Allegro molto, sitôt interrompu par le retour du motif liminaire. L’alternance est utilisée par trois fois. La partie vraiment lancée, le piano est à la fois l’orchestre et le métronome, le chargé d’harmonie et le duo de clarinettes puis la flûte doublant le violon. La transcription rend avec délectation l’oscillation – d’où sourd la tension – entre
- inquiétude mélancolique,
- sursauts sforzendi et
- gammes inversées.
Le retour du Lento interrompt la cavalcade un temps avant qu’un rythme entre swingué et saccadé – la faute aux contretemps – laisse émerger un deuxième motif par le truchement du violoncelle, bientôt secondé par le violon. Le mashup des deux motifs s’appuie sur
- de remarquables crescendi,
- des fortissimi puissants mais non tonitruants et
- une respiration commune qui séduit.
En dépit d’un finale davantage destiné à produire un gros effet orchestral qu’à faire fondre l’âme des mélomanes, les répétitions mendelsohniennes passent crème en si bonne compagnie, comme un pousse-café (crème) et ses charmantes petites sœurs quand on ne veut vraiment pas quitter les collègues pour regagner la solitude de sa chambre d’hôtel.
De province, l’hôtel. Genre un deux-étoiles surcoté de La Roche-sur-Yon. Oh, mon Dieu, La Roche-sur-Yon, voilà, c’est exactement ça. Et ça se passerait en novembre, un mois typique de La Roche-sur-Yon. Pas que de La Roche-sur-Yon, mais quand même surtout de La Roche-sur-Yon. Et ton voisin de chambre serait un psychopathe qui jouerait au squash contre le mur mitoyen de ta chambre depuis le début de l’après-midi en commentant ses actions avec la voix de Thierry Rolland. Mieux : d’Arlette Chabot. Non, encore mieux : de Coluche. Même si ce n’est pas le sujet principal de cette recension, précisons-le pour ceux qui prendraient le flux en route.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=VPkP5dK6qzs[/embedyt]
Troisième compositeur à se présenter sur notre gramophone, Ferdinand Hummel est sélectionné via sa sérénade Im Frühling (Au printemps) op. 37. Une Randonnée de 7′ profite des beaux jours pour progresser entre solennité et joie progressive que l’arrivée du violon vient parachever. De petites pauses pour contempler le paysage n’empêchent pas le rythme de la marche de s’imposer. Des séquences variées contredisent la monotonie intrinsèque à la marche et au ressassement thématique.
Bien valorisé par la prise de son fine et claire de Jean-Christophe Banaszak, techniquement détaillée dans le livret, l’équilibre que chaque musicien trouve par rapport à ses confrères sait être ductile, souple, fluide, plus stimulant que sagement respectueux. Ainsi, le quatuor guide l’écoute dans les mutations de la partition et même dans ses dissonances (3’40). Le piano, souvent réduit aux utilités, est parfois appelé à prendre ses responsabilités, par exemple pour relancer le groove après la suspension de mi-chemin. On mentirait en prétendant être resté pantelant d’ébaubissement, et hop, devant l’inventivité de la musique ou de la mini-orchestration. Il n’en reste pas moins que les interprètes savent trousser avec grâce ce qui, en soi, pourrait passer davantage pour une curiosité que pour un moment pimpant.
Une ronde de 4′ arrive alors pour balancer entre ternaire populaire et traitement classique. C’est léger et savamment mimi. L’attention
- aux ralentis sporadiques,
- à l’allant global et
- aux nuances collectives
paillette, et pourquoi pas ? le mouvement en dépit de répétitions parfois proches de la redite. Une mélodie d’1’40 offre d’abord le premier rôle au violoncelle avant que le violon ne prenne le lead du lied (Dieu que c’est drôle). La jolie coda laisse le piano avoir les derniers mots pour conclure une virgule dessinée avec savoir-faire et habileté.
Un « Joyeux retour à la maison » de 5′ conclut la grande bal(l)ade sur un accord de cordes d’abord en opposition avec le piano. Ensuite, les archetiers semblent se retrouver avec les frappeurs de cordes sur le plaisir maximal de la promenade : l’urgence de boire un coup – et, de préférence pas que de l’eau claire.
- Le large spectre de nuances,
- les modulations d’atmosphère ainsi que
- la conjonction
- de sautillements,
- de vague nostalgie et
- d’inexplicable gaieté
proposent in fine une image musicale du printemps qui ne manque ni d’autorité (le lourd finale en témoigne) ni de malice, heureusement.
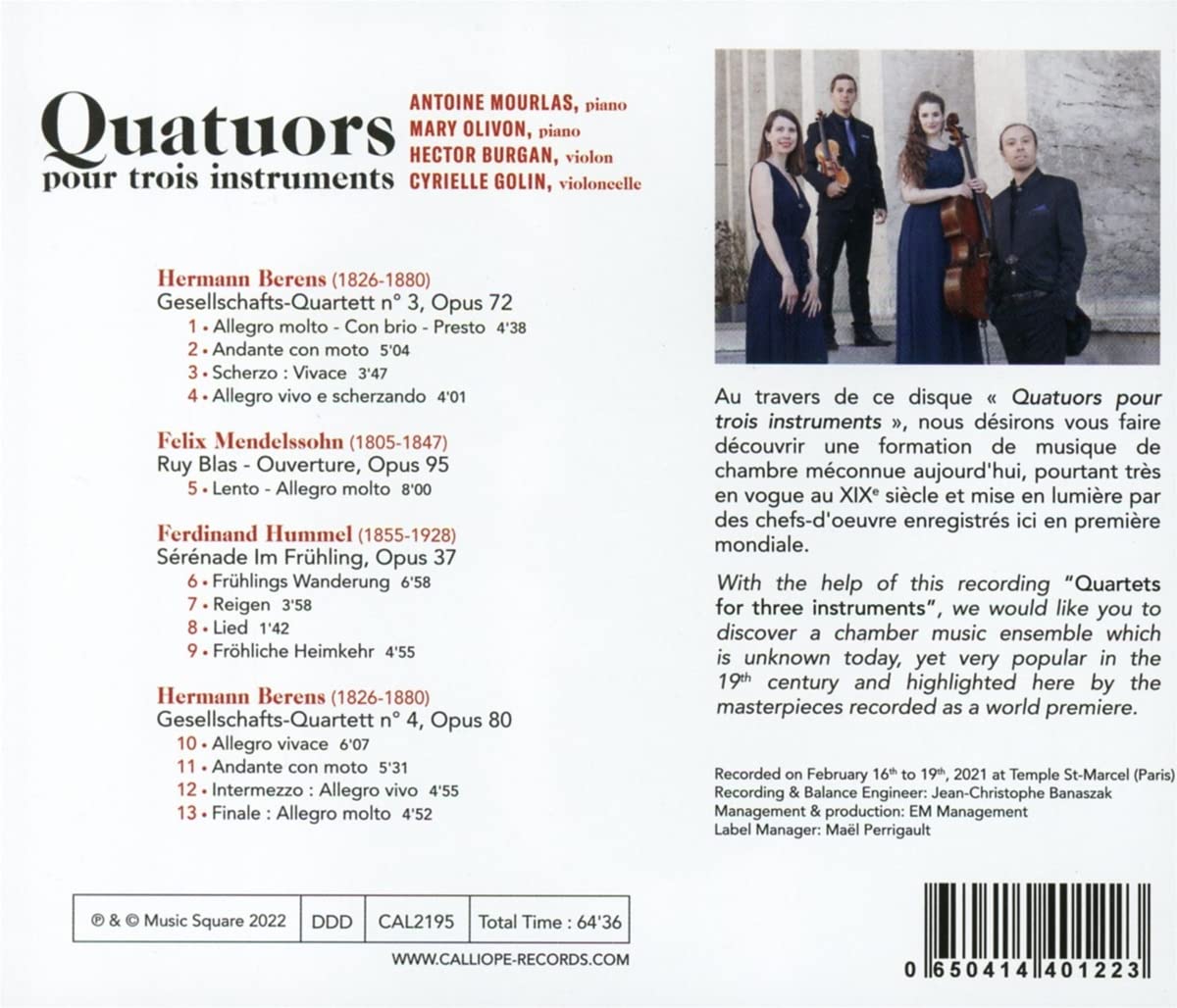
Fin de partie avec le dernier quatuor de Hermann Berens, opus 80, composé huit ans après le troisième. L’Allegro vivace liminaire se décapsule avec une énergie inquiète où le piano ne s’en laisse pas conter, tandis que de discrets bruits de grincement, plancher ou chaise (1’12), contribuent à la vitalité de l’enregistrement en lui évitant d’être trop lisse – toujours important de s’attarder sur un détail pour laisser croire que l’on a vraiment écouté le disque.
- Unissons,
- questions-réponses,
- confrontations,
- échos,
- échanges de rôles entre
- accompagnement,
- contrechant et
- première voix
animent un mouvement qui secoue science et art de la composition dans le shaker d’une agitation virtuose. Qu’importe le finale pour le moins convenu,
- de nombreuses trouvailles,
- moult rebondissements et
- force contrastes
lancent la partition sur des bases à la fois savoureuses et créatives, parfaites pour quatre musiciens résolument musiciens (si).
Comme dans le troisième quatuor, le deuxième mouvement est un Andante con moto. L’affaire fait dialoguer cordes frottées et frappées dans un échange à quatre raffiné que n’effarouchent pas
- unissons exécutés au cordeau,
- embardées rugueuses et
- lyrisme élégant.
De surcroît, la gestion
- du tempo,
- de l’expressivité et
- du jeu entre ombres et lumières vives
témoigne de la réflexion profonde menée de concert par les interprètes.
L’intermezzo, griffé Allegro vivo n’échappe pas à leur exigence. S’y mêlent, notamment,
- légèreté recherchée,
- accents francs du collier,
- délicatesse dans le rendu des guirlandes de notes,
- art des contrastes et des transitions,
- virtuosité individuelle et capacité de jouer ensemble (ainsi de l’admirable mutation autour de 3′),
bref, un coquetèle idéal pour faire goûter cette musique inconnue comme si elle était adoubée comme un pilier du répertoire depuis un siècle et demi.
Le finale, exigé Allegro molto, part sur les chapeaux de roue. À ce stade, les ingrédients sont connus – brusques contrastes, unissons entre piano et violon ou violoncelle, interversion des rôles… – de sorte que la surprise s’estompe. Pour autant, le plaisir ne s’atténue guère. À la découverte qui continue, s’ajoute le plaisir d’être désormais quasi familier avec une esthétique efficace et des interprètes aux petits soins jusqu’au BRAOUM final.
En conclusion, voilà un disque appuyé sur
- un répertoire singulier et cohérent,
- une construction associant variété d’intérêt (indispensable à un programme conçu comme un tout) et consistance, et
- une interprétation plus que soignée : vibrante.
De quoi offrir une écoute associant plaisir, intérêt et frustration, les soixante-quatre minutes de l’enregistrement paraissant finalement très courtes. Oui, il est fort malséant de terminer une critique enthousiaste sur une critique, eh oui, mais nul doute que les quatre compères ont connu, dans leur carrière, des vacheries autrement plus vaches.
Pour écouter le disque (avec le son pourri mais pratique de YouTube), c’est ici.
Pour acheter le disque, c’est, par exemple, là.
Pour cyberretrouver les artistes, cliquer sur leur nom : Antoine Mourlas, Mary Olivon, Hector Burgan, Cyrielle Golin.






































































