
C’était pas un jour à aller voir l’anti-Lang Lang qu’est l’exceptionnel Vittorio Forte.
Parce que, après tout, on parle beaucoup des artistes dans les compte-rendus de concert, mais faudrait aussi parler du public, parfois. Public qui n’a pas forcément beaucoup dormi, qu’attend peut-être une moche journée le lendemain, qui s’est peut-être engueulé (ou pas assez engueulé) avec qui de droit ou pas de droit, et qui, in fine, part au concert plus chafouin qu’illuminé. Ça arrive.
Or, s’il est un peu malin, ça arrive aussi, ledit public sait que, ce 17 février, Vittorio Forte a concocté un programme pas du tout fait pour lui. Soit, y a du lourd, niveau noms – du Schubert, du Liszt, du Brahms et « du Rachma », mais grattons la surface : le zozo qui vient au salon d’exposition Kawai ce jour-là, sorte d’oasis culturel dans un quartier parisien voué à rester éternellement « en devenir », ce mec-là, quel que soit son sexe, sait qu’il n’aura droit ni à un programme rieur, ni à un programme explosif, ni à rien qui incite à la facétie, à la charade, au rébus ou au bon mot. Pas vraiment le genre de Vittorio Forte, et certainement pas l’option choisie ce soir… d’autant que le talent de cet incroyable pianiste jure assez avec le positionnement affiché par Kawai France sur son site.
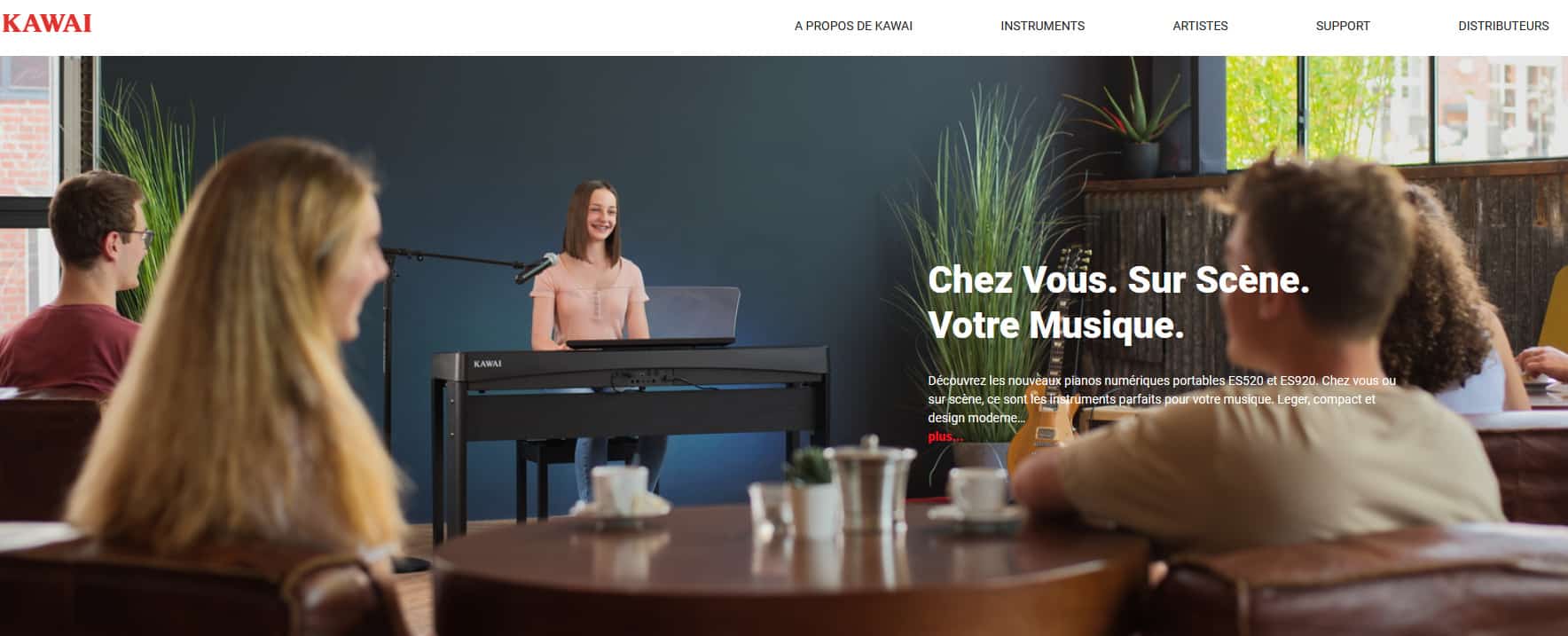
Au programme, pas de préadolescente mimi tout plein s’apprêtant à chanter une merdouille dans un énorme salon de blancoss étonnamment jeunes (ou un peu vicieux) en s’accompagnant sur des sons de synthèse, alléluia, mais un récital puissant structuré en deux parties, elles-mêmes articulées en deux fois 25’/15′, en gros, que l’artiste, fidèle à son habitude, tient à présenter – même chafouin, le zozo vient pour ça aussi : le pianiste a les mots pour donner sens
- à sa set-lis(z)t,
- à sa cohérence et
- à son ressenti.
Ses mots, préparés et spontanés, savent à la fois guider et s’abstenir de tout projet didactique (on se doute que le public chafouin et très imaginaire évoqué tantôt n’aurait pas supporté le moindre pédagogisme). Face au risque de lourdeur enseignante, Vittorio Forte fait un pas de côté.
- Il parle de Schubert, cet inconnu découvert par Brahms et par Liszt, devenu cet éléphant du répertoire alors qu’il a longtemps été moins qu’une souris, un peu comme Bach avant Mendelssohn, pour les organistes.
- Il parle de la sinusoïde pianistique chez Brahms – les débuts puis plus rien puis le génie.
- Il parle du snobisme qui a salué le talent sans limite d’Earl Wild car, quand on sait tout jouer, c’est qu’on ne sait rien jouer, les spécialistes experts le savent.
Et il se met à jouer les trois Klavierstücke D946 de Franz Schubert.
L’Allegro assai est lancé sur un rythme intense. Ce tempo tonique permet de laisser plus de place à la respiration en évitant de donner l’impression de ralentir, ce qui nuirait au vrai changement de tempo. Dans cette forme ABA, le mouvement lent exige de rendre l’introspection en lui évitant tout maniérisme et en emmagasinant, en quelque sorte, l’énergie nécessaire pour aborder la dernière partie renouant avec l’urgence requise. L’Allegretto permet à Vittorio Forte de relever quatre défis :
- rendre charmant le charmant, donc déjouer le risque de mignonnerie ;
- assurer les contrastes et la continuité du discours en différenciant attaques et accents sans rogner sur la clarté ;
- différencier les voix (lead mélodique, accompagnement, rythmique) ;
- rendre les reprises moins répétitives que spécifiques en les montrant irisées différemment lors de leur re-présentation.
Défis largement relevés !
L’Allegro final jaillit avec tonicité après une longue résonance, signe du souci qu’a Vittorio Forte d’interpréter non point trois pièces séparées mais un ensemble de trois pièces. L’interprète n’a pas peur de l’éruption musicale, mais il vaut mieux qu’un brillant pyromane du piano : il n’a donc pas peur non plus de la méditation, au contraire – sachant jouer, id est étant capable de tout jouer, il sait aussi laisser la place à l’intériorité sans avoir besoin de boum-boumer façon foufou. Est-ce à dire que l’excellence est lénifiante ? Certes non : jamais l’interprète ne néglige pas pour autant la pulsation essentielle, ni la volonté de faire sonner les différents registres – ne serait-on convaincu de son intégrité absolue, on le jurerait mandaté par Kawai pour louer la qualité de l’instrument, et ce ne sera pas la seule fois ce soir-là. Le musicien creuse les beautés de la pièce en évitant à la fois les embardées fofolles hors-sujet (mais que l’on imagine tentantes) et les déformations d’atmosphères si pénibles dans certaines exécutions, le terme est juste, de Schubert (virtuosité tonitruante versus ennui morfondu chargé de valoriser la virtuosité tonitruante, etc.). Le résultat est hypnotisant.
Dans le petit auditorium, l’auditoire pourtant acquis à la cause du pianiste est saisi. De l’autre côté de la rangée, le vieux a fini par passer d’une consultation de sa montre toutes les deux minutes à une tous les mouvements ; et la Japonaise italianophone m’a demandé si elle pouvait s’asseoir devant moi pour mieux apprécier les mains du pianiste en me remerciant environ mille fois de lui avoir cédé une place qui ne m’appartenait pas. Ceux qui étaient venus pour du show sont émus ; ceux qui étaient venus grognons, ne visons personne, sont cueillis.

Ils sont donc mûrs pour trois lieder de Franz Schubert transcrits par l’autre Franz – Liszt, forcément Liszt. « Fruhlingslaube » donne sa foi au printemps en intimant au pauvre cœur d’y croire, d’oublier son tourment, car tout va changer. Oublions l’aspect politique de la chose et goûtons le changement de feeling. À présent, l’eau clapote. Le thème chante au soprano puis à la basse. Vittorio Forte fait vivre
- la mélodie,
- la régularité du courant (ou de la foi dans ce monde censé être plus juste chaque jour),
- les accents sans lesquels sourdrait l’ennui, et
- les respirations essentielles pour donner corps au riche propos synthétisé et boosté par Liszt.
« Auf dem Wasser zu Singen » (« À fredonner sur l’eau » ou « sous l’eau », selon l’opéra de Lille) semble évoquer, mais c’est quand même pas super clair, la fugacité du temps à laquelle le poète escompte échapper – tu penses, c’est un poète. Mimant l’avancée d’une nef, le swing prend le pouvoir. Parallélismes et polyphonies enrichissent le propos sans embarrasser les mains apparemment immenses de l’interprète. Vittorio Forte excelle pour faire passer la complexité pour de la simplicité premium sans lui ôter sa profonde efficacité, finale lisztien inclus.
« Gretchen am Spinnrade » (« Marguerite au rouet ») n’est qu’une histoire de frustration sexuelle imaginée par des mecs qui rêvent d’une nana dont le corps a soif d’eux et rêve, sous leurs baisers, de mourir – scénario et fantasme simples, basiques, efficaces. Cette pulsion érotique motiva-t-elle le jeune compositeur à faire de la rythmique du rouet comme moteur de la mélodie ? Il trouve en Vittorio Forte un héraut à sa mesure. La brillante – aussi discrète tentât-elle de se faire – mécanique digitale du pianiste et sa sobriété émotionnelle n’ôtent rien à la vibration propre à la transcription, ni aux emportements spectaculaires – dont on suppute les fondements humains – exécutés avec une hauteur de vue appréciable.
Pour nous remettre de cette fougue intérieure, un hénaurme entracte de cinq minutes est annoncé. Ne vous égaillez pas trop vite, de grâce : il va vraiment durer trois cents secondes, et c’est heureux tant on a hâte d’ouïr la suite.
À suivre…






































































