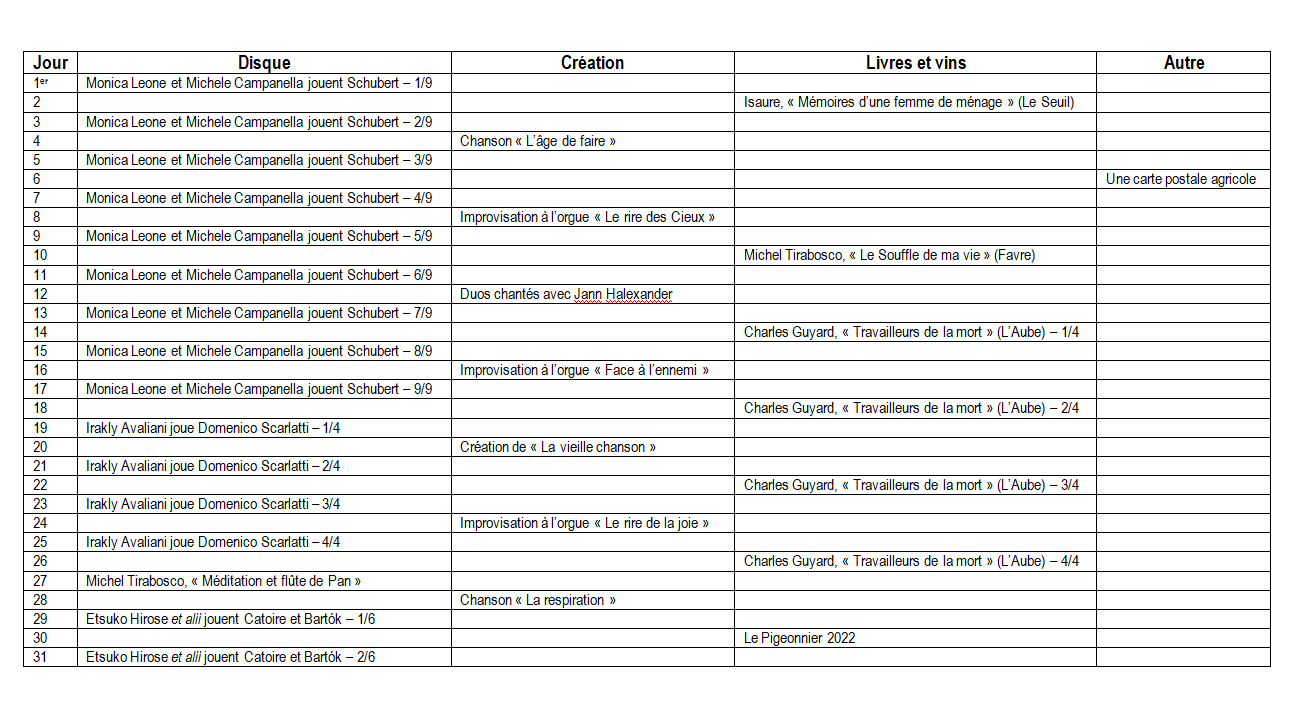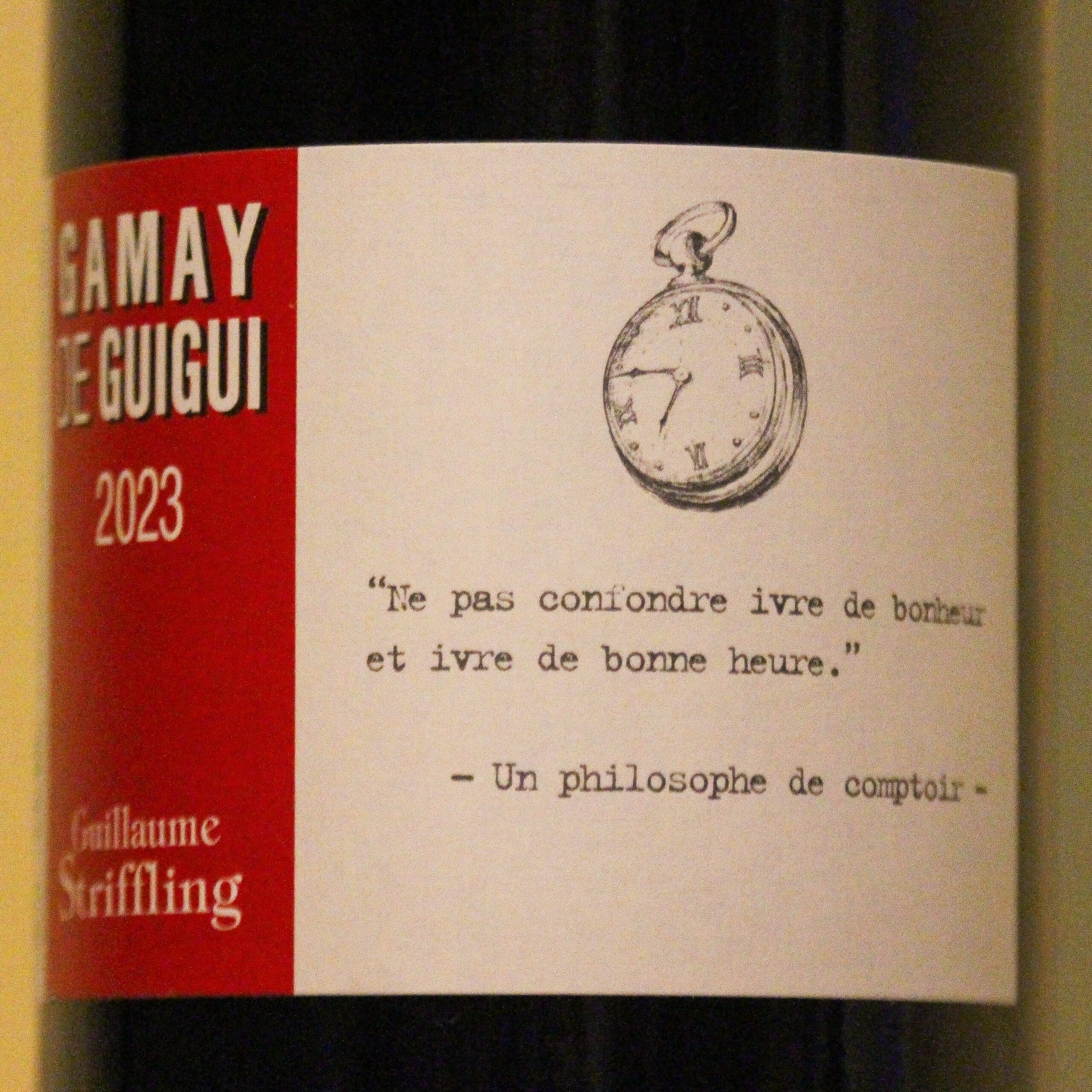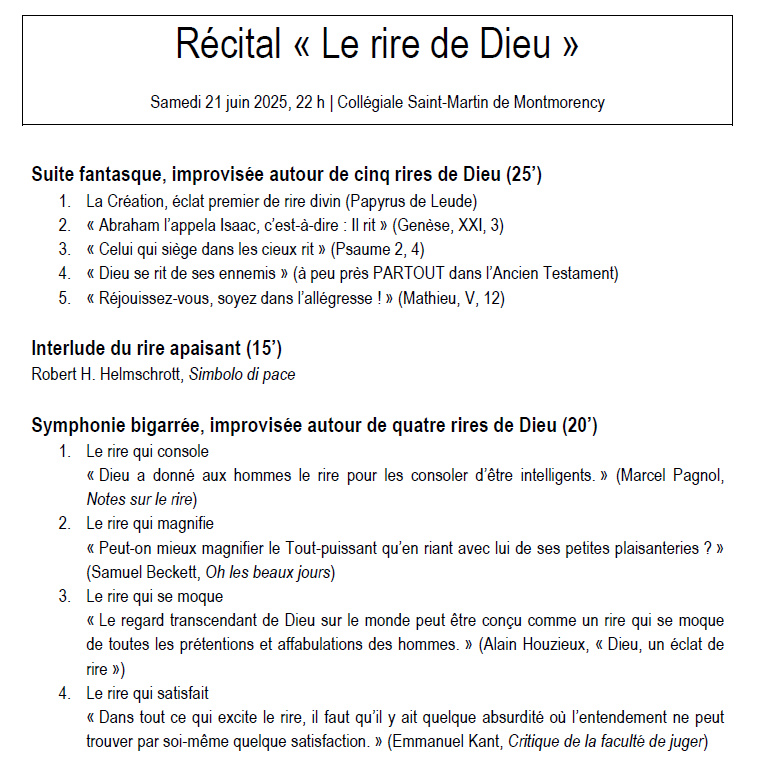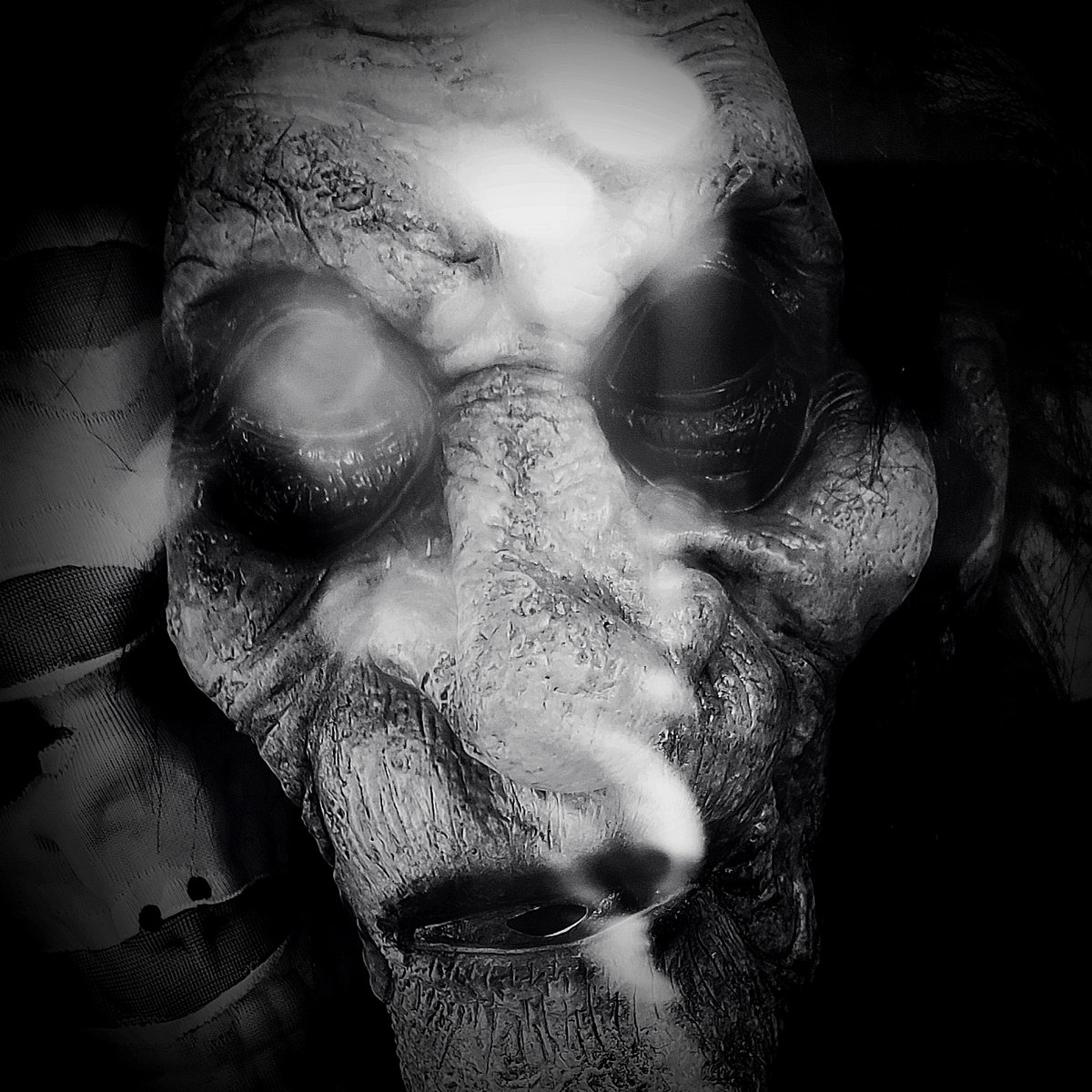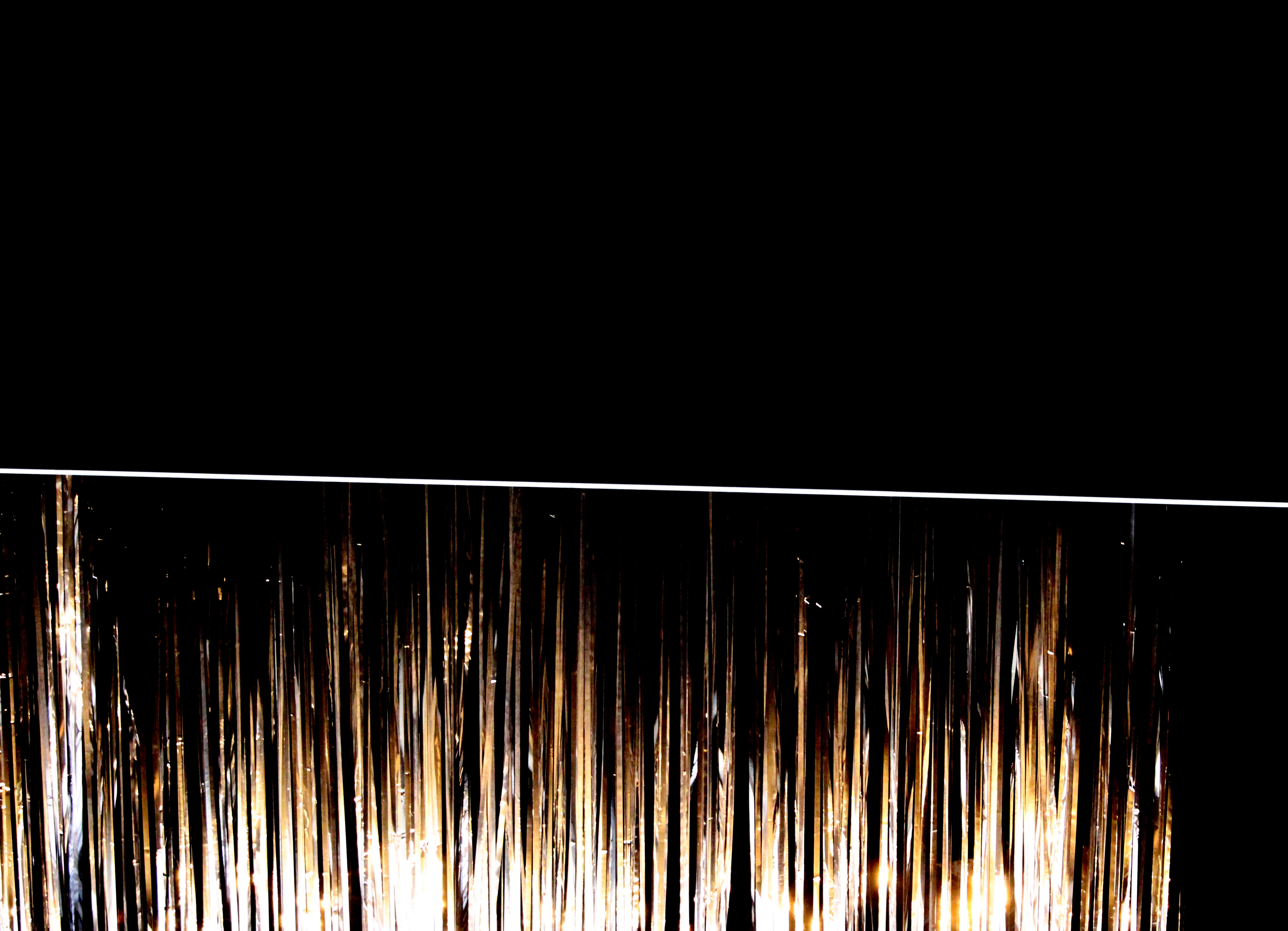 Honteuse et éhontée, la mimise en scène de Claus Guth de La Bohème poursuit et accélère la dégringolade artistique de l’Opéra de Paris.
Honteuse et éhontée, la mimise en scène de Claus Guth de La Bohème poursuit et accélère la dégringolade artistique de l’Opéra de Paris.
Pourtant, grâce à une copine trompettiss qui s’était glissée dans la salle à l’occasion d’un stage, nous étions averti : l’ère du grand n’importe quoi ne cesse de dégrader l’intérêt de l’opéra façon Lissner, ce faquin ignorant et sot. En version 2017, La Bohème se déroule dans manière de station spatiale, avec longues séances de bruitage, texte supplémentaire (en anglais s’il vous plaît pour les ploucs du haut), cosmonautes qui caressent les chanteurs et double inutile qui « signe » Claus Guth et fait dépenser des sous pour un parasite ridicule, peut-être l’un des plus exécrables mimes jamais vus sur une scène parisienne – désolé, Paul Lorenger, t’es la star de la soirée, mais je te conchie car tu n’as rien à foutre sur la scène. Rien au sens de : rien. Bien. Note que c’est pas personnel. Enfin, je pense que, sur ce que tu montres ce soir, t’es un mauvais, sans doute bien introduit, mais ma colère à ton encontre s’appuie, il est vrai, sur un ensemble de considérations escagassées, à suivre infra.

En effet, tout exaspère : l’incohérence du projet (dans la composition de Puccini, le drame est parfaitement localisé, il exige un Paris dix-neuviémiste, pas un cosmos où le temps est compté), l’ajout d’éléments inutiles (jongleurs, cosmonautes et acrobates sans virtuosité), la dilution du propos (c’est l’histoire de couples qui s’aiment absolument et se confrontent à la finitude humaine représentée par la jalousie et la mort, pas une histoire de cosmonautes qui vont boire des coups), la médiocrité de l’ambition (vulgarité de la pole dance et du rideau de lamé, pauvreté de l’imaginaire, trahison du livret et de la musique)… Oui, tout hérisse. Au point que l’on a du mal à se laisser émouvoir par ce drame naïf donc touchant, tout sauf cosmique, fondé sur l’expectative de la tragédie humaine (Mimi, l’héroïne, va crever) et sociale (les filles sont obligées d’être des putes, sinon elles ne survivront pas, mais, même ainsi, elles ne survivront pas).

Du coup, comme on s’ennuie un peu, on échafaude d’autres mises en scène. Dans une cuvette de chiottes, par exemple : on vous fournit de la belle musique, mais vous n’êtes qu’une bande de merdeux, public qui payez votre place comme des nazes.
Dans un égout, où les chanteurs seraient tous déguisés en rats par référence à la sinistre mémoire nauséabonde (Mimi ne meurt plus de tuberculose mais de peste, qu’est-ce qu’on s’en fout, d’autant qu’elle périt, la friponne, tandis que des soldates de la Wermacht, seins nus, patrouillent en pétant – la Bête immonde n’est pas morte, restons vigilants et charlies).
À l’Élysée macroniste (Mimi meurt étouffée par la pression du peuple qui en veut toujours plus et finit par l’asphyxier pendant qu’un écran rappelle la grandeur de Brigitte et du Medef).
Dans la jungle (la vie est une dure lutte, il faut être une sacrée guenon et ressembler à Nafissatou Diallo pour y survivre quelque temps).
Dans une HLM des années 1970 (avec diffusion de tubes de Renaud avant, pendant et après la représentation, surtout s’il est mort depuis)
Dans un camping-car, en attendant le tour de France qui n’arriverait qu’après la mort de Mimi.
Dans – oh, ça va.

Dans un tel contexte, entre une menace de mort que nous proférons avec une tendre sincérité (« Déjà que je peux pas regarder cette merde, si tu continuez de m’empêcher d’écouter le troisième tableau en parlant, je te tue tous les deux. Sans déconner, j’le fais ») et un soupir d’exaspération, difficile d’apprécier la prestation des chanteurs ainsi ridiculisés ou de l’orchestre si mal mis en valeur. Nicole Car, applaudie jadis en Tatiana, fait ce qu’elle peut pour garder, avec sobriété, de la tenue à son grand rôle si abîmé par cette ordure de Claus Guth. Benjamin Bernheim, qui remplace Atalla Ayan en Rodolfo, témoigne d’une belle technique à laquelle manque avec fureur voire furieusement, à notre sens, le charisme et l’art de la scène (bon sang, quand tu veux mimer l’émotion, arrête de te prendre la tête entre les mains pour te caresser les cheveux, surtout quand tu te filmes en gros plan selon cette astuce déjà ringarde d’auto-filmage retransmis). Artur Ruciήski s’épanouit petit à petit en Marcello brimé. Mais la vedette attendue, quoique médiocre performeuse à la pole bar, ce qui est loin d’être une critique, sauf de cette merde de Claus Guth, je crois que le message est passé, reste la resplendissante Aida Garifullina qui, depuis avril, n’a rien perdu ni de sa technique, ni de son charme magnétique. Pourtant, pas besoin de la faire apparaître en nuisette, contrairement à ce que croient les salopards de metteur en scène, même si on comprend l’objectif de cette dénudation : cette artiste, aidée par une maîtrise vocale remarquable, irradie dès qu’elle entre sur le grand plateau de Bastille.

Avec la vitalité de Nicole Car et la bonne volonté d’Artur Ruciήski, cela pourrait suffire à sauver la représentation. L’insultante débilité de la pseudo mise en scène l’empêche. Que Gustavo Dudamel, la seule justification du Sistema, semble peiner à énergiser un orchestre en terrain connu ne compte guère. La soirée est (irrémé)diablement gâchée. Avec un tube comme La Bohème, un plateau vocal et un orchestre comme celui de l’opéra, c’est vraiment dégueulasse, et ce serait plaisir de peinturlurer Claus Guth avec quelques fèces bien faisandées, pour lui exprimer justement notre ire devant un tel scandale.

































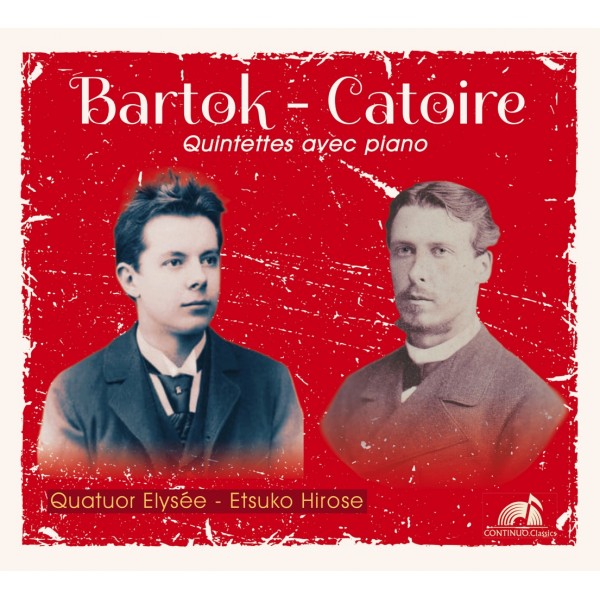

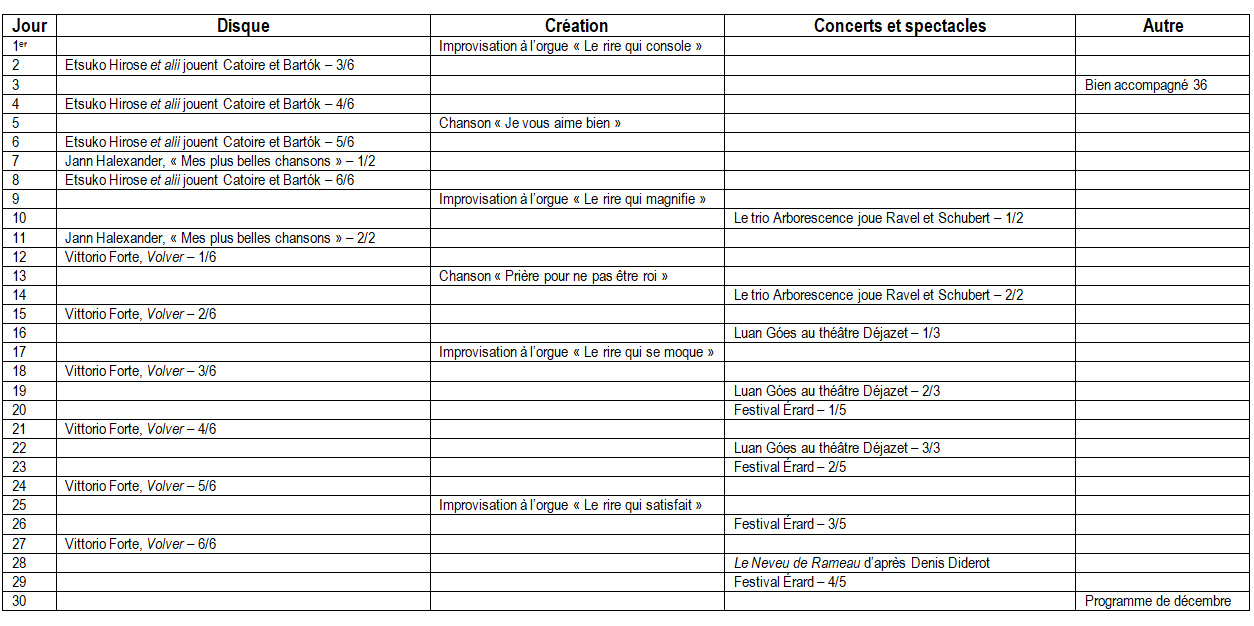

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)