
Après un trio de Ravel rêche et audacieux, le trio Arborescence ose contrevenir à la logique chrono pour s’immiscer dans les charmes du premier trio en Si bémol majeur de Franz Schubert. Mais avant, les deux têtes pensantes parlent. Alors que les artistes ont eu l’élégance d’éviter les pénibles pensums qui consistent à expliquer aux crétins qui viennent écouter de la musique ce qu’ils doivent apprécier, Rachel Koblyakov et Florimond Dal Zotto s’embourbent dans un étrange sketch convivial mais d’un inintérêt absolu. Tous les chanteurs un peu dignes le savent, l’interchanson (ou son absence) est un truc qui se travaille presque plus que la chanson elle-même. Ici, le spectateur admiratif de la performance émouvante proposée jusque-là sent monter une gênance inattendue devant le stand-up qu’esquissent les deux très bons musiciens à l’origine du projet. On veut bien
- la spontanéité (mais pas trop longtemps, dans ce contexte),
- l’envie de dissiper la chape de sérieux compassé qui épuise souvent les cérémonials de musique savante (mais qui n’a pas que des inconvénients),
- le désir de démystifier voire de dissiper l’aura pseudo sacrée qui enveloppe les Interprètes Classiques quand ils entrent en scène (même si pourquoi, en fait ?).
Reste que l’intermède
- claudicant,
- peu clair et
- superfétatoire
suscite un mélange
- de grand malaise tant son propos dissone avec la haute exigence artistique jusque-là démontrée et
- de curiosité perplexe devant ce quelque chose d’inattendu qui advient et signale probablement que le projet Arborescences sonores paraît avoir besoin d’un coaching scénique afin
- d’étayer son projet,
- d’affirmer sa singularité et
- de ne pas dégrader son intérêt musical par l’amateurisme inattendu de sa présence non-instrumentale face spectateurs.
Heureusement advient la musique et ses ambitieuses quarante minutes. Grâce à l’énergie déployée par les artistes, l’allegro moderato liminaire capte par
- la vigueur des intentions,
- les échos entre les musiciens et
- les changements de rôles (ainsi du piano ploum-ploumiste çà, soliste accompagné là).
Ici, le trio est à son affaire. On apprécie le souci
- de nuancer,
- d’aérer,
- de caractériser et
- de jouer ensemble, c’est-à-dire
- l’un avec les autres,
- l’un contre les autres ou, alla Guitry,
- l’un tout contre les autres.
S’interpolent donc
- de la légèreté au milieu de la tension,
- de la tension boostant la légèreté et
- des volte-faces qui secouent une partition qui, pardon Franz, donne parfois l’impression de s’étendre un peu too much.

Le deuxième mouvement, un andante un poco mosso, permet aux musiciens de se lover dans un ternaire rendu avec souplesse et de triologuer, si si :
- solos,
- duos,
- trios,
- mélodie énoncée par un leader ou partagée à deux voire trois.
Le son est
- soyeux,
- élégant et
- profondément tourmenté.
Les interprètes ont visiblement travaillé un combo gagnant :
- la synchro,
- les attaques et
- les phrasés.
Même s’il semble que le siège de la violoniste craque au moindre mouvement de son corps, ce qui ajoute de la vie au live mais peut distraire l’attention de façon importante, l’essentiel est là :
- la parole circule,
- les intentions se complètent,
- les modulations nourrissent manière de conversation.
Le troisième mouvement, un scherzo suivi d’un allegro, redynamise la dispute en mode joyeux.
- Questions-réponses,
- commentaires et
- enthousiasmes unanimes
agitent les trois comparses. Ça
- sourit,
- trépigne,
- s’exaspère,
- change d’avis mais jamais ne lâche l’affaire,
signant une performance d’une belle densité avant l’avènement du dernier mouvement.

Double comme le précédent, cet acte ultime est un rondo et un allegro vivace. Son ouverture coïncide avec le temps
- du sautillement,
- des gambades et
- des chamailleries.
Ça sent
- le serpolet,
- les chansons de Francine Cockenpot,
- les chevaux mâchant un picotin, un sourire triste au museau.
Les artistes ont le geste ample :
- large spectre de nuances,
- vaste panel d’atmosphères,
- ambitieuse palette d’échanges
- (amènes
- soupe-au-lait,
- légers,
- aigre-doux,
- furibonds…).
Voilà probablement la force de la proposition du trio Arborescence : toujours interroger la forme du trio.
- Quel rapport entre les trois personnages régit tel passage de la partition ?
- Qu’est-ce qui rapproche les partenaires et, donc, les différencie ?
- Comment définir à la fois leurs relations et leurs identités ?
Certes, ces questions planent sur toute musique de chambre ; mais elles sont plus ou moins prises à bras-le-corps. En l’espèce, le triomphe fait au trio semble lié
- à cette très riche mise en question de l’évidence,
- à ce désossement du vivre-ensemble pré-établi,
- à cette reconstitution de l’invention schubertienne étalonnant, titillant et réglant le rapport des trois intervenants.
Un bis
- apaisé,
- recueilli,
- intériorisé
conclut l’aventure. Pour autant,
- électricité,
- inquiétude,
- changement de modes en arche
dessinent un parallélisme Brahms/Schubert qui rend raison aux Arborescences sonores d’avoir enfreint leur code d’honneur pour présenter ce concert en ouverture de deuxième saison. Saluons
- le succès de cette initiative indépendante,
- l’étonnante symbiose musicale du soir entre les partenaires, et
- la vibration du public avec cette manière de jouer une musique souvent fascinante.
Au moment où nous écrivons ces lignes, trois autres épisodes sont prévus… en attendant les prochains. Olé !





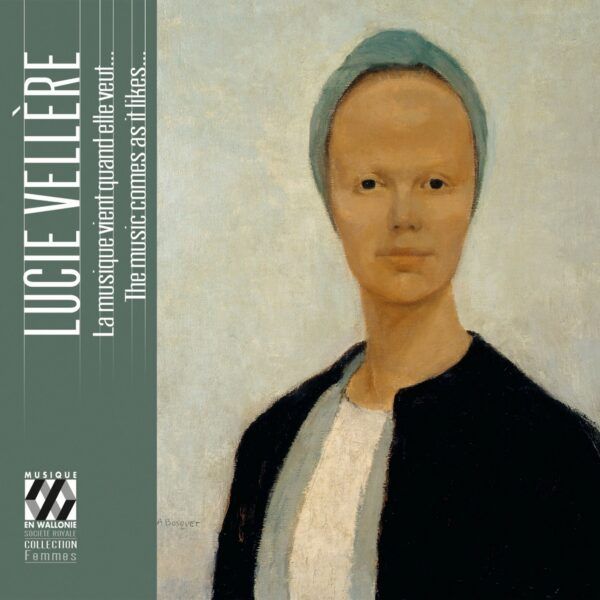



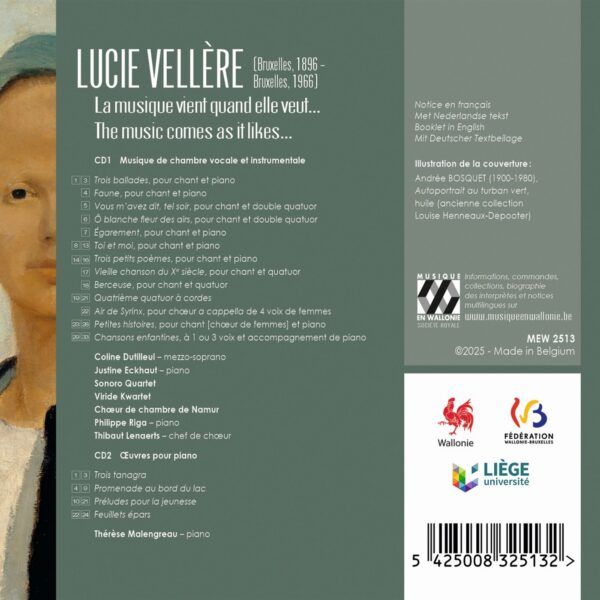

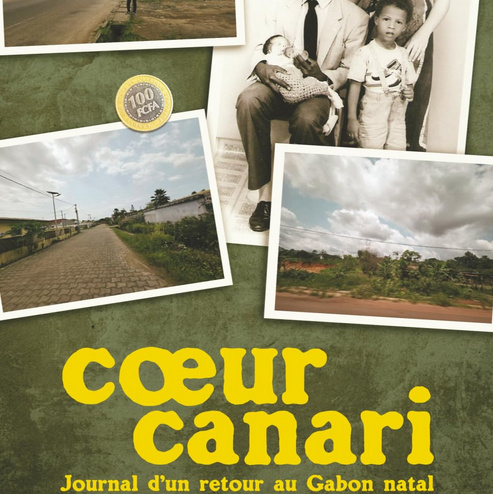


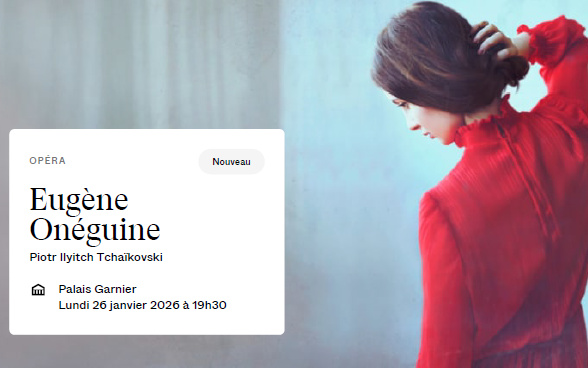
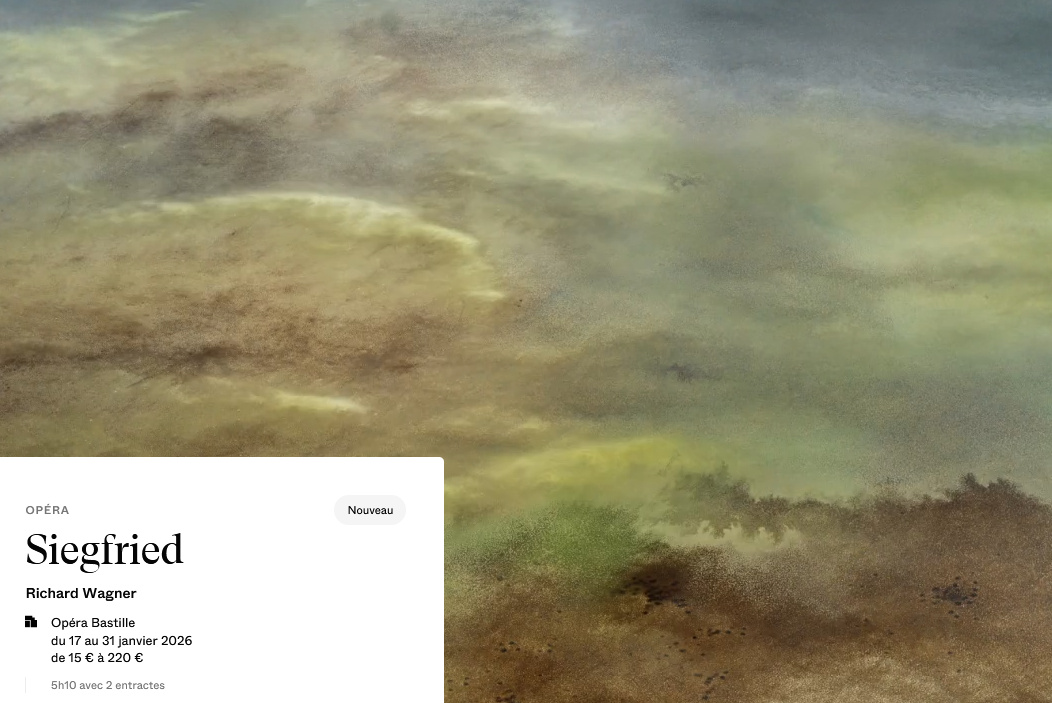

















































![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)