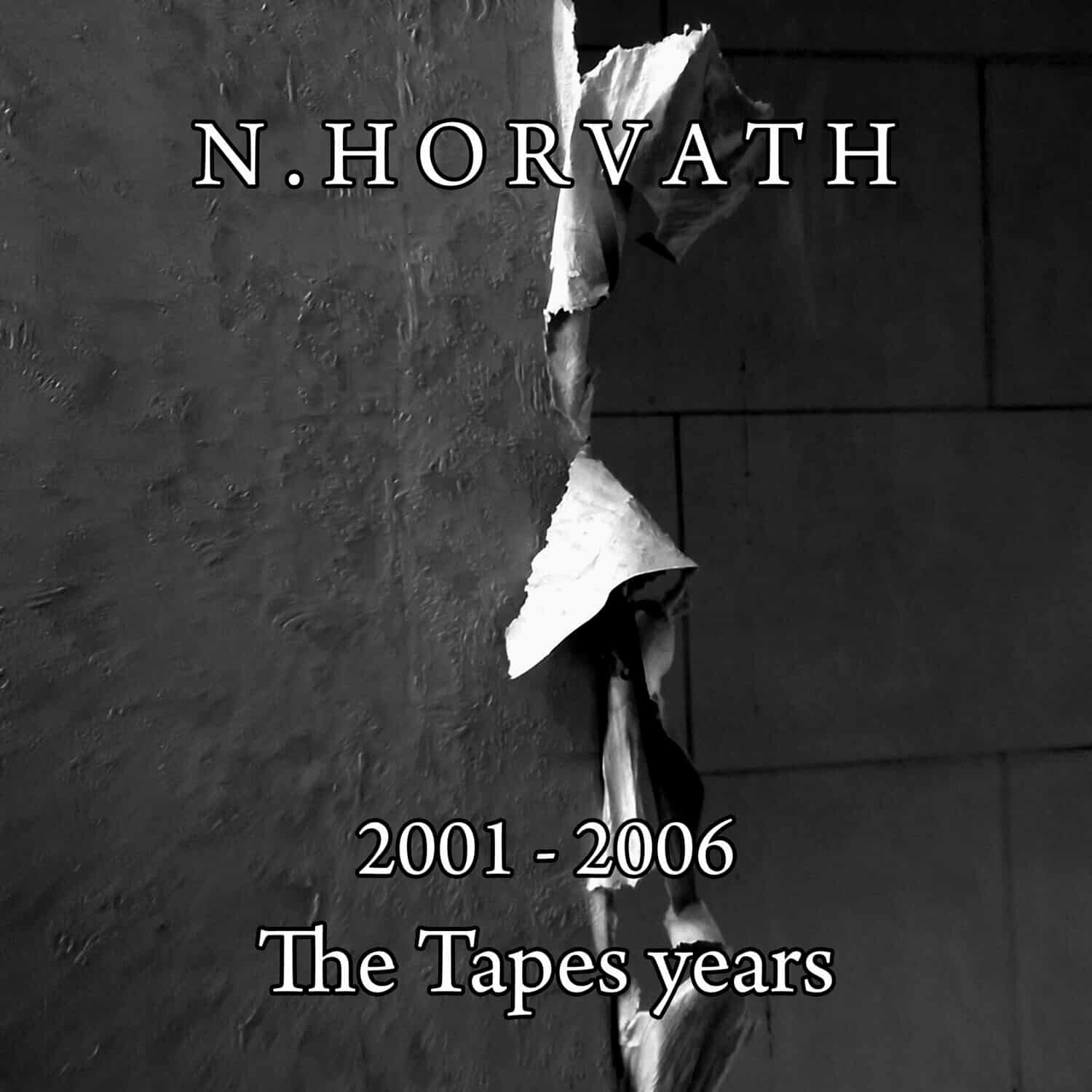Deux péristyles à cette manière de critique.
D’une part, parler de Nicolas Horvath, personnage récurrent de ce site. Le zozo au brushing est un pianiste virtuose, entendu dans le monde entier, coutumier de la Philharmonie de Paris et interprète d’innombrables ou presque disques allant de Liszt à Glass en passant par Czerny et Satie ainsi que des compositeurs peu connus. C’est également le vrai fomenteur d’initiatives farfelues comme ces 24 h monomaniaques autour de la plus répétitive des pièces de Satie, données notamment à la Cité de la musique devant une salle comble, ou ces douze heures de musique offertes devant chez lui ou près des lieux révolutionnaires autour des musiques minimalistes mais pas que. Donc, du très lourd et du fantasque. Il se trouve que, ces derniers temps, l’homme a eu tendance à se réconcilier avec lui-même et à assumer une partie de sa vie où il fut une figure de proue du harsh noise indé. Pour un musicos classique, ça fait mauvais genre. Aujourd’hui, il admet sa passion pour cette musique et ces sons, allant jusqu’à proposer pour une somme presque amusante (30 €) un résumé de six ans hors des sentiers battus à travers des repiquages et gravages homemade quoique tout à fait captivants.
D’autre part, admettre que, en harsh noise, nous ne connaissons rien. Mais, à force de discuter avec l’olibrius, à force de critiquer ses disques de musique savante, à force de l’entendre en concert trrrrès sérieux, il nous sembla pertinent d’attaquer l’Horvath par sa face la plus sombre. Après tout, n’avions-nous pas suivi, nous, l’ignorant de musique actuelle, l’Ensemble InterContemporain jadis, avant d’abandonner en voyant qu’ils s’acoquinaient avec des nullasses ridicules comme Fanny Ardant ? Du coup, assumer notre ignorance, notre curiosité et notre gourmandise ne nous ébroue guère. Il s’agit simplement de partager un ressenti. Que celui qui accroche s’accroche ; que les autres décrochent. Dans tous les cas, le résultat est le même. Comme ne cesse de stipuler le poète : life is life, lala, la, lala. So, let’s go.
D’autant que le premier disque est exclusivement confidentiel – ce qui, pour un admirateur de Jean-Jacques Goldman, est forcément bon signe. Il s’intitule : Never shared material. Grâce à lui, nous rentrons dans les archives et la genèse d’un fabricant de bruits organisés. Et c’est palpitant.
2001
Après un travail liminaire articulé autour de l’inspiration, de la respiration et de l’expiration, Nicolas Horvath présente deux pièces de 12’46, un rythme qu’il semble apprécier.
Le premier essai de 12’46 examine le son en tant que contraste avec le silence. Le bruitage (eau, grattage, vent, petit tonnerre, rafales, métal, sons synthétiques) sculpte des possibles tantôt univoques, tantôt métissés, que la suspension du son rend désirables. Les micro-événements stimulent l’interrogation. Notre pulsion hypothético-déductive tente de les relier. Pourtant, nulle coordination, nulle progression. Juste une forme de tachisme sonore qui dispose des éléments, façon narration dégingandée où l’angoisse et la surprise seraient partie prenante. À 9’15, une explosion va néanmoins dynamiter la piste et enflammer l’atmosphère. Une pulsation régulière s’impose. Hurlements, sifflements et vociférations sonores ne disparaîtront en fade-out que 2’45 plus tard, suivis par 0’45 de silence, comme si le monde décrit par la track avait lui aussi été gobé par la longue déflagration… et qu’il ne restait plus que le silence à contempler.
La seconde proposition de 12’46 présente frontalement des sonorités synthétiques inquiétantes. Ça ondule. De sourdes sirènes stridulent. Tout ça dessine, fors l’oxymoron, une sorte de pérennité de l’instable. Expliquons, ou tentons de. Le titre précédent travaillait sur le surgissement. Celui-ci creuse la veine du paysage hypnotique, à la fois sempiternellement identique et différent obstinément. Derechef, vers 9’10, un grondement dissipe la constante. Entre feu grésillant et bruits d’autoroute nocturnes, les quelques hauteurs de note graves habillent l’espace sonore d’une sorte de cadre mouvant où l’écoute se fixe sur les crescendi/decresecendi creusant leur tombe vers le grave, jusqu’à l’extinction en fade-out, vingt secondes avant la fin de la piste.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UmQd-XF6g1k[/embedyt]
2002
Le troisième titre préparatoire pèse un quart d’heure. L’ambiance part sur un tourbillon étrange, quasi diabolique, qui se prolonge autour de coups de gong sporadiques. Des consonnes chuchotent. La stéréophonie saisit l’auditeur. Des stridences dialoguent avec ce mystère métallique et spatialisé. Un vent presque abstrait souffle entre deux transmissions imprécises. Vers 5’45, des turbulences accentuent les différences d’intensité. Nicolas Horvath joue sur un projet long-termiste opposant une continuité apparente à une irrégularité de l’instant. Des récurrences de motif font surgir des intervalles de notes dans l’aigu que l’univers bruitiste fomenté par le noisyman se plaît à avaler. Face à des rythmiques insuffisantes, le flux principal se révèle le plus énergique, donc le plus fort. L’auditeur s’installe dans manière de spatiodrome sciemment mal isolé. De son observatoire auditif, il perçoit et les bruits et les ondes émanant de cet espace. Face à ces vibrations, les événements sonores tels que des secousses métalliques obsédantes se révèlent impuissants à dompter le continuum. Celui-ci, confirmant sa domination, finit par les annihiler. Un brutal fade-out renvoie à l’idée d’infinitude du rêve et de continuation imaginaire d’une ligne persistante.
Sans concession sinon le recours à la durée chérie de 12’46, le quatrième titre propose la première version de la démo du projet A.E.P. Accords métalliques et ondulations hypnotisantes ouvrent ce premier test A.E.P. Nicolas Horvath joue sur le grondement grave, sa proximité ou sa disparition, son intensité ou sa transformation. La narration s’abstrait de tout cosmétique. Les hauteurs, souvent articulées en trois temps, tiennent lieu de guide général, en dépit du floutage assuré par la disposition sonore – latérale (travail sur les effets stéréo), diachronique (récurrence et mutation des sons) ou profonde (proximité des sons). Vers 9’, un épisode orageux et granulaire renoue avec le goût dichotomique de l’artiste pour, d’une part, la maîtrise rigoureuse du son et, d’autre part, la jubilation de la saturation. La fin en fade-out fait mourir sans précipitation les ondulations caractéristiques et laisse 24 secondes pour en goûter la résolution.
Le disque d’inédits se termine sur la première version de la démo de Dapnom. Émergeant du silence, des couches sonores s’approchent, énigmatiques et planantes, tantôt superposées, tantôt successives. Les sons événémentiels, entendus comme les anecdotes qui enrichissent le flux principal, hésitent entre métal et synthèse. Nicolas Horvath joue moins sur la narration chronologique (qui supposerait une progression repérable, avec crescendi, suspense et cliffhangers) que sur la narration spatiale. Si, ça veut dire quelque chose, genre : c’est sur la répartition stéréophonique du son que se construit la logique du morceau. En effet, la diégèse assume sa ductilité en fomentant un paysage articulé entre
- continuité du grondement,
- effets de zoom par rapprochement des objets sonores et
- sonorités allogènes laissant entrevoir un au-delà de l’évidence, assez fragmentaire pour titiller la curiosité.
Est-ce la mer ou l’espace qui gronde, autour de 5’ ? Contemple-t-on une grève, la tête sous l’eau, ou une centrale nucléaire possédée par des esprits plus intrigants que démoniaques ? L’indiscernabilité de l’atmosphère capte l’attention. Grâce à un flux bruitiste, le créateur renvoie l’auditeur à son propre imaginaire. Rien de facile dans ce procédé en construction : il faut à la fois susciter l’envie d’imaginer et donner du grain à moudre au moulin de nos fantasmes. Cela se passe moins par l’événement ponctuel que par le malaxage de la durée. Le potentiel d’évocation dépendra donc de la conception sonore que chacun se fait de géographies mentales. En clair ou presque, l’écoute projette le curieux dans des domaines métonymiques, où le détail renvoie à un tout spécifique à chaque auditeur. À titre d’exemple, celui-ci est libre de choisir s’il se trouve, par la magie horvathienne…
- … sur le bord d’une jetée tempêtueuse (8’50),
- … au cœur d’une zone industrielle épuisée par sa nationale au grondement sans fin (9’25),
- … devant une vieille voie de garage d’on ne sait quel train ou quel tacot fatigué (10’10),
- … dans la chambre d’un HP où les murs les plus enfermants sont les petites pilules bleubleues et roroses qu’il faut avaler devant le costaud en blouse blanche de service (11’), ou
- … sur le seuil d’un polar nordique où des lambeaux de gris dessinent les contours d’une ville désespérément mouillée et froide (11’40).
Selon l’expression du musicologue (il s’est produit à l’opéra Garnier, c’est dire) Gad Elmaleh, « c’est à la guise de l’imaginaire ».
Il y a, chez Nicolas Horvath, cette capacité à jouer au jokari avec la balle de nos représentations intérieures. Son art du son et du mixage lui servent de raquette. Jamais lassante, la proposition métisse la continuité qui permet de suivre la piste jusqu’au bout, et les mutations internes qui saisissent ou surprennent (cris, évolutions, répétitions, déformations, interruptions, contrastes, épuisements, tuilages, cahots, chaos…) jusqu’à l’épuisement brutal du sujet, cette fois sans fondu au silence.
En conclusion, pour ceux qui aiment que l’on leur narre des histoires dont ils sont non pas les héros mais les interprètes, ce premier volume constitue une très gourmande mise en bouche auriculaire, idéale que l’on puisse ou non partir dans les contrées vacancières dont l’on rêve pour nous ou nos abonnés IG.