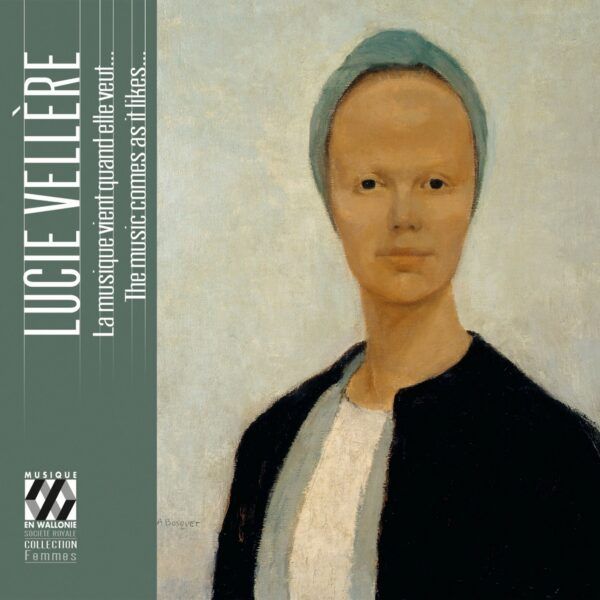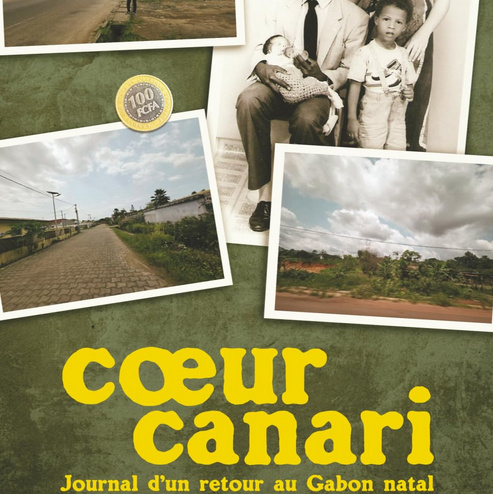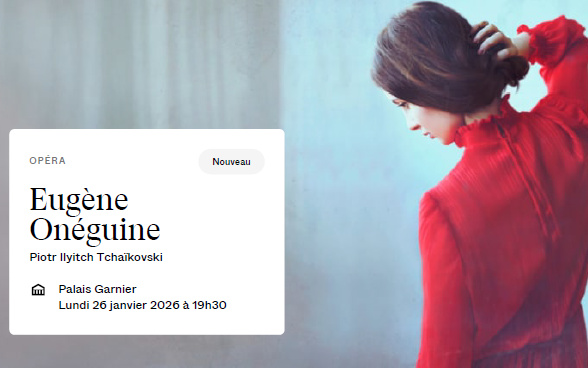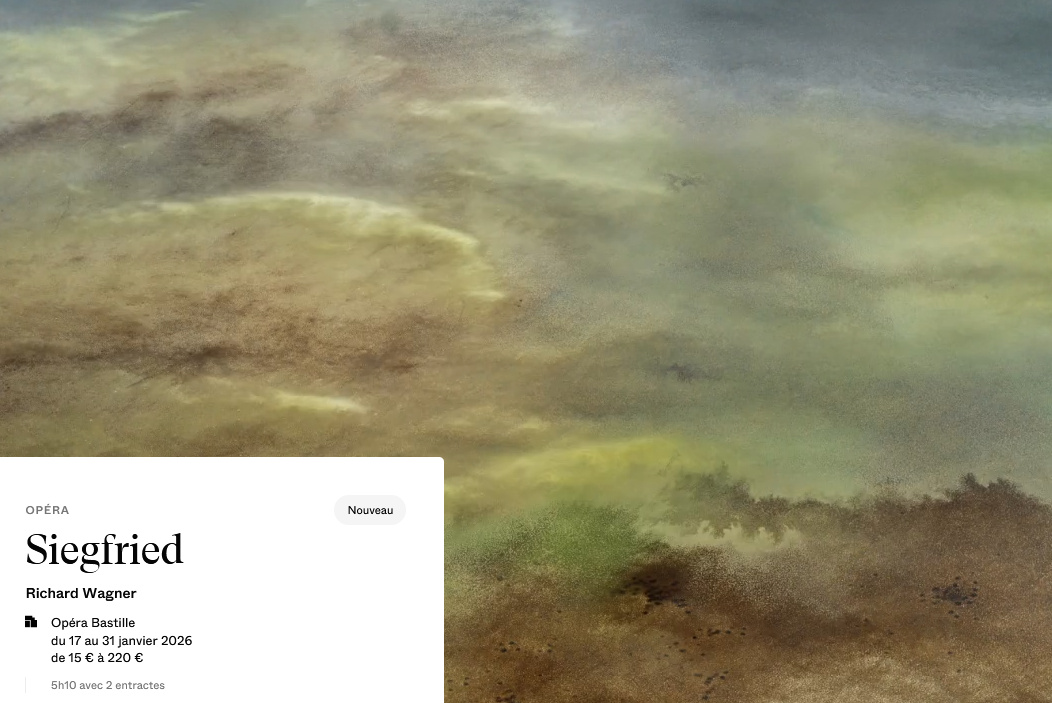Vertuchou, c’est bon. Le monde s’écroule, mais je vais goûter un opéra avec chœurs massifs, solistes innombrables (faux : ils sont quinze) et orchestre massif (c’est Chostakovitch qui a fini le travail). Que demande le peuple ? Du pain ? Bon, on verra plus tard.
Au programme, ce soir, La Khovanchtchina de Modeste Moussorgski, dans la reprise d’une mise en scène à succès signée Andrei Serban. L’action (4h, dont 40′ pour deux entractes) : les Khovanski père et fils tentent de pousser leur avantage politique pour prendre le contrôle de la Russie. Le père, un sacré obsédé qui possède même son harem de putes persanes (même si les danseuses n’ont pas trop l’air d’origine iraniennes), et le fils veulent se taper la même nana, prénommée Emma. Marfa, l’ex du fils veut récupérer ledit fiston, Andrei, chanté par Vladimir Galouzine. Des religieux réacs tentent de sauver le pays en prônant les valeurs de l’ancienne Russie. Un coup d’État poignarde le père Khovanski. Le fils rejoint son ex, qui l’oblige à crever avec les religieux, lesquels, poussés par leur leader, décident, sous la pression de leurs ennemis, de cramer, alors que les renégats sont graciés par le tsar. C’est donc, disons-le, plutôt compliqué et carrément triste.
La musique, elle, est une jouissance continue, entre clichés russes, trouvailles harmoniques, spécificités de Moussorgski (dissonances exquises, unissons magiques, sublime alternance solistes / ensemble / orchestre…) et présence discrète de Chosta, le « réalisateur » des derniers actes. Malgré un livret confus, la magie moussorgskienne fonctionne, portée par une mise en scène qui stabylote la puissance de la partition. On regrette d’autant plus que l’orchestre, pour cette première de reprise, ne trouve pas avec Michail Jurowski un chef capable de le guider : retard du hautbois dès les premières mesures, nombreux et longs décalages avec les chanteurs (ennuyeux, surtout quand la ligne mélodique est redite à l’orchestre), précision irrégulière. Le Chœur de l’Opéra souffre lui aussi, surtout les voix de femmes, fréquemment prises en défaut de justesse et de coordination (départs étalés !) – les basses, elles, s’éclatant avec une ostentation bienvenue, notamment dans les ensembles du dernier acte.
Côté solistes, surprise : ils sont, à l’exception du Coréen obligé (Se-Jin Hwang, seulement passable pour son si bref passage, en regard du brio moyen de ses collègues), tous russes ou presque assimilables. Pour Moussorgski, c’est logique ; mais pourquoi, dans ce cas, ne pas oser un casting 100% français dans les rares ouvrages français ? Par ex., le 12 mai 2010, nous allâmes, gros snob entouré de personnes sensibles, voir Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach : 75 % du casting était étranger, dont Vladimir Kapshuk (Hermann hier, Strechniev aujourd’hui), Yuri Kissin (Schlemil jadis, Varsonofiev cette fois), et l’épouvantable Giuseppe Filianoti, personne ce 22 janvier (ouf !) mais naguère Hoffmann cabotin chantant français comme mon cul parle italien. Serait-il choquant que les impôts français financent aussi, en priorité, les artistes locaux, non par racisme mais au moins pour soutenir la vie culturelle hexagonale ?
Bref, ce mardi 22 janvier 2013, la qualité d’ensemble des solistes sidérait. Soyons explicites : quasi tous perforaient le fondement, voire trouaient le cul. Nataliya Tymchenko claquait ses aigus attendus, dans le rôle d’Emma la sainte-nitouche déjà fiancée, sans pourtant nous esbaudir ainsi que nous eussions aimé, preuve que nous sommes de gros fats et puis c’est tout. Signe, voire canard, peut-être, que les trois grands vainqueurs étaient, assurément, Orlin Anstassov en Dosifei, ex-prince moinifié à la voix surpuissante même quand la fatigue se fait sentir (dans son combat à distance, il l’emportait à notre goût sur le trop uniforme quoique magnifique Gleb Nikolsky en Kniaz Ivan Khovanski) ; Larissa Diadkova, sidérante en Marfa, avec une voix extraordinaire dans tous les registres sollicités – et cet art des transitions entre le médium et le grave, putain de bouducon, c’est énorme ; et Vadim Saplechny, Clerc parfait en acteur burlesque et artiste lyrique sans faille.
En définitive, la soirée fut un pur plaisir d’opéra, malgré un orchestre et un chœur un peu en d’ça de son excellence habituelle. Petit plus positif : pour une fois, la mise en scène sans génie et le décor, d’une grande banalité (on crut revoir en toile de fond ce qui servit pour Le Vaisseau fantôme…), ne troublèrent pas le déroulement de l’œuvre. Réjouissons-nous, chantons alléluia, et profitons de ces moments de bonheur volés aux malheurs à venir. Après tout, le peuple veut toujours du pain et nous ne cracherions pas dessus non plus, de préférence avec des rillettes et un coup d’rouquin pour faire coulisser l’ensemble, par respect pour la paysannerie européenne, hips.
Opéra, 22 janvier 2013
23 janvier 2013