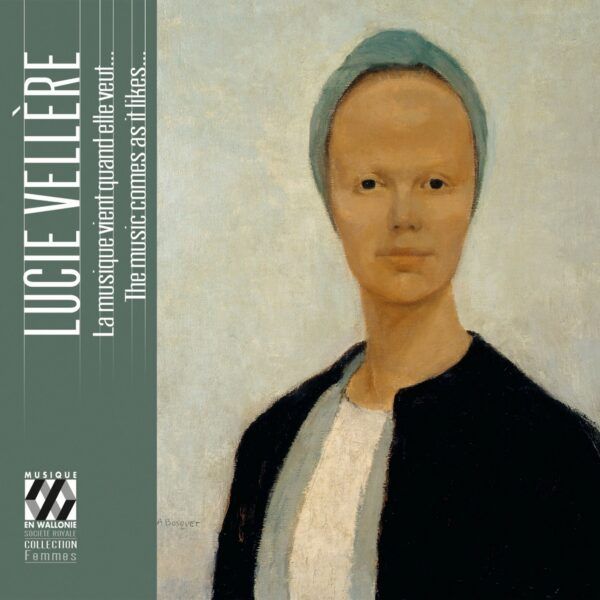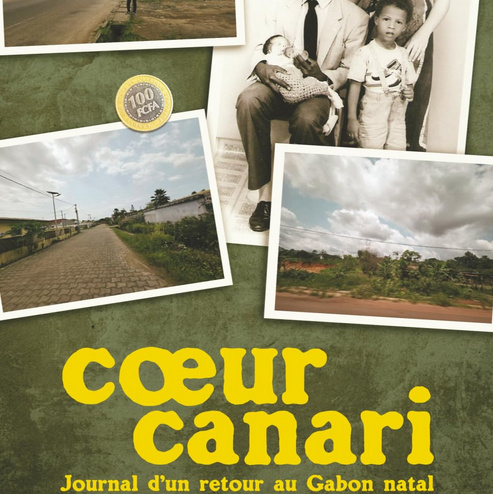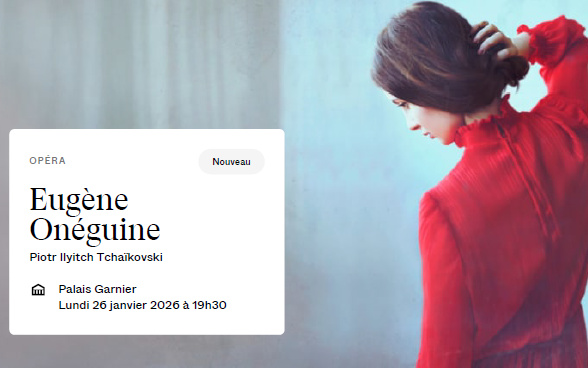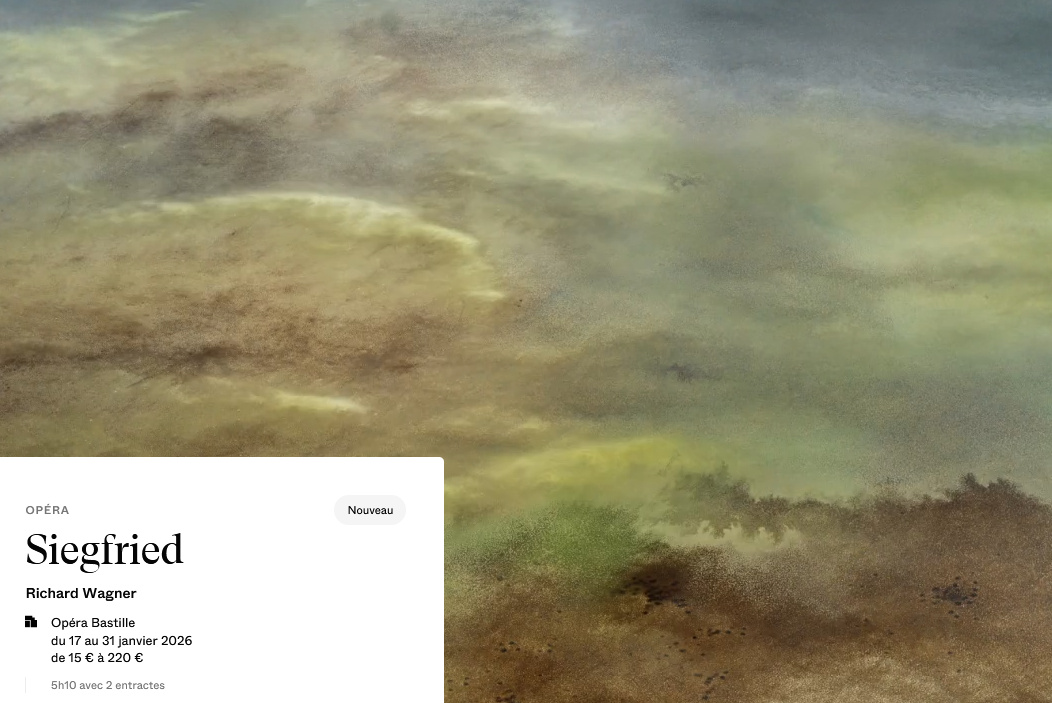Philippe Entremont, l’entretien :
troisième mouvement, la prospective
Philippe Entremont, la première puis la deuxième parties de cet entretien en trois mouvements l’ont montré : l’enregistrement de la sonate D 960 de Schubert est une pierre sur votre chemin.
C’est mieux qu’une pierre dans mon jardin… J’ai eu très peur de votre audace, jeune homme !
Ne vous défaites pas de votre crainte, monsieur. En effet, puisque vous avez fait des choses objectivement folles, à l’échelle du commun des mortels : obtenir des distinctions mythiques dès votre adolescence, jouer un grand concerto de Mozart sous la direction de votre père, être invité et réinvité dans les plus grandes salles du monde, obtenir un succès jamais démenti, former des jeunes artistes que vous avez choisis, diriger des orchestres, enregistrer la sonate de Schubert qui signe la maturité de l’artiste et qui vous tenait tant à cœur, il ne me reste plus qu’à poser la question qui s’impose : pourquoi êtes-vous encore vivant ?
Ben c’est pas ma faute, quand même ! Je vous assure que j’ai rien fait pour. J’ai eu une vie tout à fait normale, donc j’ai commis toutes les bêtises du monde. En revanche, je ne me suis jamais fixé un but. Jamais. Ce qui m’intéresse, c’est d’être bien au moment où je suis sur scène. Voilà. J’ai besoin d’être sur scène. C’est quelque chose que j’estime naturel. Je me sens bien, sur scène. J’adore communiquer avec le public. Je déteste l’esbroufe. Ça ne sert à rien. Vous voulez une réponse définitive ? Très bien : pour moi, ce qui est important, c’est le prochain concert. Toujours. En espérant y faire de mon mieux. Dire que je suis content tout le temps, ce n’est pas vrai. Ne croyez pas ça. Mais, tout de même, il y a des moments très agréables.
Ce sont ces « moments agréables » que vous recherchez ?
Oui. Donner un concert au cours duquel je me sens bien. C’est là où je me sens le mieux : sur scène, devant un piano. Là, ça va. C’est ça mon but. Je n’ai pas l’intention de m’arrêter. Je sais que la fin arrivera. En attendant…
Rêvez-vous toujours de diriger un grand opéra de Mozart – puisque, en 2015, vous annonciez deux rêves : enregistrer cette sonate gravée pour Solo-Musica et diriger un grand opéra de Wolfgang Amadeus ?
Oh, quant à ça, je sais que ça ne se produira pas. Tant pis. Ça ne m’empêche pas d’adorer Mozart, mais le monde de l’opéra est aussi dévorant que passionnant. Maintenant, j’ai besoin de davantage de calme. Je ne me vois plus dans la fosse. Bien sûr, diriger un opéra de Mozart, je serais capable de le faire, je vous le dis tout de suite ! Ce n’est peut-être pas un hasard si, en tant que chef d’orchestre, j’ai connu, travaillé avec et accompagné les plus grands chanteurs. J’ai enregistré avec eux. J’ai fait le dernier disque de Régine Crespin, si je ne me trompe. Un disque que j’aime énormément ? Les mélodies de Strauss avec Sophie Koch. J’ai dirigé le dernier concert de Carlo Bergonzi…
… mais il restera donc ce regret mozartien…
Oui et non. J’ai quand même dirigé un opéra, dans ma vie. Pas n’importe où : à Saint-Pétersbourg. On m’avait demandé de diriger un opéra français. J’étais tout à fait d’accord. Puis j’ai reçu la demande : « Nous voudrions que vous fassiez La Bohème. » « Comme opéra français, on fait mieux », ai-je objecté. Et on m’a rétorqué : « Voyons, ça s’passe à Paris ! »
Ça doit être coton à diriger !
Coton ? Vous plaisantez, jeune homme ! Ce n’est pas coton : c’est l’opéra le plus difficile à diriger. Comme c’était horriblement compliqué, je l’ai fait. Et je dois dire que ça s’est bien passé.
Dans votre livre, vous dites que la soif d’une grande carrière s’accompagne de choses qui ne sont pas toujours très jolies…
Faut pas vouloir. Faut pas compter sur quoi que ce soit. C’est voué à l’échec. Ça paralyse.
Vous, vous dites : je ne m’y suis jamais abaissé.
C’est normal, le mot « carrière » ne m’intéresse pas. Je trouve ça éminemment prétentieux ; et je n’aime pas la prétention. Cela dit, je peux vous raconter un exemple de prétention extraordinaire dans un train. Ça vous intéresse ?
Mes lecteurs et moi sommes tout ouïe.
Mon manteau sur le dos, j’entre dans un compartiment. Un grand type s’y dressait, aussi massif que laid et gros. Rapidement, j’ai appris qu’il était président d’un conseil général… Il était carrément odieux et me regardait de haut, rosette de la Légion d’honneur en évidence. Il me cassait les pieds, multipliant les exigences du genre : « Non, mettez ça là-haut », etc. N’en pouvant plus, j’ai retiré mon manteau, et le type en est resté comme deux ronds de flanc : devant lui, il avait un type qui était commandeur de la Légion d’honneur. Et là, je me suis dit : « Au fond, ça vaut la peine de l’avoir, cette rosette ! » Le pauvre type était décomposé. Sa fierté était si mal placée…
Puisque l’on est dans le civisme et la politique, via ce président d’un conseil général, restons-y un instant : selon vous, un ministre de la culture est inutile.
C’est pas « selon moi » ! On en a confirmation tous les jours.
Vous allez plus loin : à vous croire, la France devrait suivre le modèle des États-Unis, donc s’en remettre exclusivement aux financements privés. N’est-ce pas paradoxal pour quelqu’un qui a lancé sa carrière sur ses années passées au Conservatoire National et sur le prix que celui-ci a décerné ?
Soyons sérieux, et regardons ailleurs. En Amérique, c’est formidable. Tout – la recherche, l’université, la vie culturelle – dépend de l’argent privé. Pour les gens très riches, c’est entièrement déduit des impôts.
Pourquoi un système fondé sur les désirs privés serait-il meilleur qu’un système fondé sur l’intérêt public ?
Vous voulez dire que le système américain a ses défauts ?
Un peu, oui.
Peut-être en a-t-il ; mais, croyez-moi, tout système a ses défauts.
Sauf que, pour vous, le système français n’a que des défauts…
Ne me parlez plus du système français, enfin ! Regardez l’Allemagne. Là-bas, il y a le fédéralisme. Il y a les Länder qui subventionnent ce qu’ils veulent. Prenez Munich, par exemple…
Comme par hasard, vous choisissez un exemple hors norme, lié à la richesse de la Bavière.
Qu’importe ! Vous savez ce qu’ils claquent comme argent pour l’art ?
Ça ne répond pas à la question du rôle de l’État : la Bavière est une région très riche. Qu’ils dépensent beaucoup d’argent pour la musique, c’est joyeux ; mais quid des autres Länder et de leurs habitants ?
Attendez, vous avez vu ce qu’ils en font, les Bavarois, de ce que vous appelez la richesse ? Le plus grand opéra du monde, trois orchestres symphoniques, des orchestres un peu partout… Tout ça est financé par la région ! C’est formidable, il me semble.

Alors, en France, on crée cinq nouveaux orchestres à Paris et on abandonne la Creuse ?
En France, puisque ça vous obsède, il y a beaucoup d’argent dépensé ; mais il est tellement mal dépensé ! C’est ça, le problème. Je suis découragé de voir les ministres de la Culture de tous bords se succéder. Ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Depuis Malraux, on n’a pas eu de vrai ministre de la Culture.
Depuis Malraux ? Ce n’était pas un passionné de musique…
… mais c’était Malraux ! Il y a eu aussi le jardinier… Comment s’appelait-il, déjà ? Ah, oui, Michel Guy [de 1974 à 1976, secrétaire d’État à la Culture car il était horticulteur, mort du Sida en 1990]. J’aimais bien aussi Frédéric [Mitterrand]. Il avait des défauts mais il était engagé. En dehors de cela, quelle collection de zéros ! et, grâce à eux, quelles nominations absurdes à l’opéra ou à la tête des grands orchestres ! C’est d’une absurdité totale et d’une grande méconnaissance.
Vous n’avez jamais eu de grand poste en France.
J’en suis bien content.
Ça ne vous a jamais tenté ?
J’ai failli en avoir un, une fois. On m’avait pressenti pour être professeur au Conservatoire national de Paris. Mais le responsable du recrutement a décidé que j’étais inaccessible : je dirigeais des orchestres, pensez ! En vrai, il ne m’avait pas posé la question. Bref, ne me parlez pas de ça, c’est moche. Et, le plus moche, c’est que ce n’est pas mieux aujourd’hui. Dommage.
Les relations de pouvoir doivent être compliquées, avec des personnalités plus politiques que compétentes…
Écoutez, un jour, un directeur de grrrande scène vient me voir.
Qui ?
Je ne dirai pas son nom.
Un indice, au moins !
Il dirigeait le Châtelet.
On progresse.
Ce monsieur vient me voir à la fin d’un concert que je dirigeais. Vous savez ce qu’il m’a sorti ? « Ha ! Si nous avions, en France, un chef comme vous ! » Je crois qu’il était persuadé que j’étais Canadien… Voilà où on en est. Bien entendu, vous ne l’écrivez pas, hein !
Vous décidez ce qui est off.
Bon, marquez-le quand même. Ça pourra toujours être utile pour mon livre posthume.
Alors, avant le off, le on. Une presque-dernière-question : comment l’artiste qui vient de sortir un disque écoute-t-il son travail ? Quelle est la part de la satisfaction de la frustration, de…
Je sais que l’on peut toujours faire autrement. Je le souhaite. Sinon, on meurt. Comme disait Stravinsky, tout enregistrement est un cadavre. Moi, j’avance. Depuis, j’ai déjà gravé un autre disque, on peut le dire ? [Son attaché de presse approuve.] Ça s’est très bien passé. Je suis très content du résultat. Pourtant, il n’y a rien d’amusant à faire un disque. Cela exige de faire abstraction. Beaucoup. Il faut penser à l’œuvre. Surtout pas se dire : y a des micros. Là, on est foutus. Faut faire attention à ça.
La spécificité du studio joue-t-elle ?
Énormément. Je crois beaucoup à l’environnement. Y a des salles que j’aime bien, d’autres que je n’aime pas. Pas beaucoup, mais y en a. Et il y a quelques salles que je déteste. Par exemple une qui n’est pas loin de chez moi. On peut y aller à pied. Une fois que l’on est passé devant le palais de l’Élysée, il suffit de [censure]. Mais, non, ce n’est pas le théâtre des Champs-Élysées, très beau théâtre… sauf pour la musique. Moi, je n’aime pas les salles qui n’ont pas d’acoustique. C’est pour ça que des salles comme le Concertgebouw à Amsterdam, c’est merveilleux. Et les salles modernes, il y en a beaucoup d’excellentes.
Même en France ?
Vous savez que, dans ce pays, on a longtemps été victime de Mondial Moquette. Jusqu’à une période récente, ils ont souillé toutes les salles de France. C’était monstrueux ! En plus, certaines salles sont insauvables. Elles doivent avoir une vie et une âme. À Pékin, j’étais aux anges. Toutes les salles sont magnifiques. Imaginez que, en Chine, ils ont construit cent six opéras. Et des géants, attention ! C’est ça, la Chine. Moi, j’ai pris le nouveau train qui va de Shanghaï à Pékin. Y a 1273 km. À côté de leur train, notre TGV soi-disant merveilleux est un tortillard. Leur train est incroyable. On ne sent rien. Il est d’un confort ! J’ai demandé si cette ligne était une incongruité. On m’a répondu : « Non, nous en avons partout ! » Et ce n’est rien – c’est simple : ils ouvrent un aéroport par mois.
Donc l’avenir du transport et de la musique est en Chine ?
Il ne faut pas négliger ce pays. Ils sont très musiciens. J’ai été un des premiers à aller en Chine. C’est fou, ce qu’il s’est passé depuis. Quand vous irez en Chine, vous n’en croirez pas vos yeux. D’autant que ce sera le premier pays à se débarrasser de la pollution. Ils ont pris le problème à bras-le-corps. Du coup, quand j’étais à Shanghaï et à Pékin, il n’y avait aucune pollution. Ils y mettent les moyens. Il faut dire qu’ils sont riches.
Y compris pianistiquement ?
Vingt millions de Chinois jouent du piano. Par conséquent, faut fournir les pianos. Leurs usines de pianos, Renault, c’est de la bibine, à côté ! En plus, ils commencent à avoir de très bons orchestres et de très beaux luthiers – c’est essentiel d’avoir de beaux instruments !
En somme, la Chine vous redonne la confiance que vous n’avez plus dans la France.
Oh, on n’est pas encore morts, mais, culturellement, on s’en approche. Quand le journal télévisé d’une chaîne publique parle en pleurnichant de la succession du « plus grand artiste français »… on se fout du monde, non ? Quand on voit que le président de la République va à l’enterrement de ce Johnny Hallyday, je suis choqué. M. Macron n’y avait pas sa place. Comment peut-il saluer l’un des plus grands évadés fiscaux du pays ? C’est se foutre du monde. Tenter de manipuler un peuple de la sorte, c’est choquant. Et le pire, c’est que je paye ma redevance ! Ça me rend malade. Je préfère les États-Unis. Les gens savent se tenir. Et pourtant, ils ont des entertainers d’un talent plus notoire, quelque sympathique qu’ait pu être ce monsieur. Quand ils meurent, le président se tient à l’écart. Un peu de dignité, que diable ! Tenez, je vais vous le dire, pour conclure notre entretien – un président de la République française qui se comporte comme ça… ça me scandalise. Mieux : ça me dégoûte.