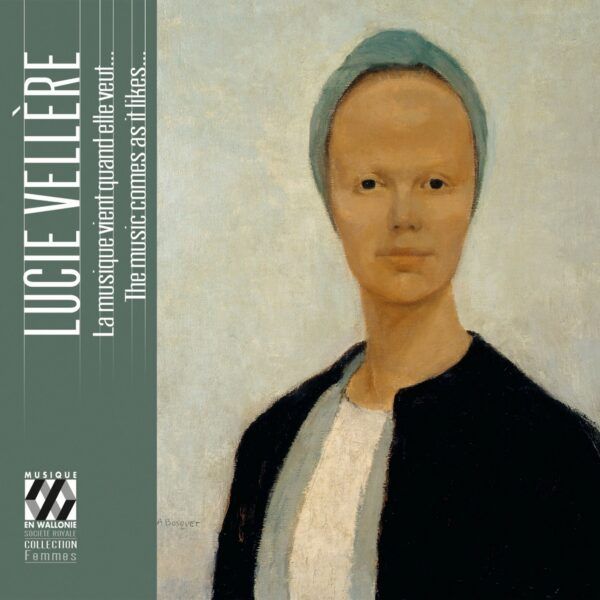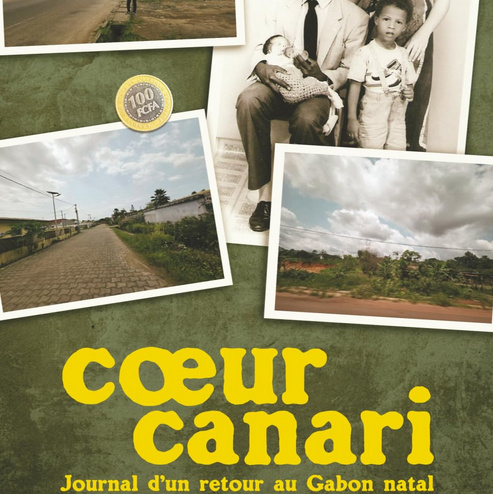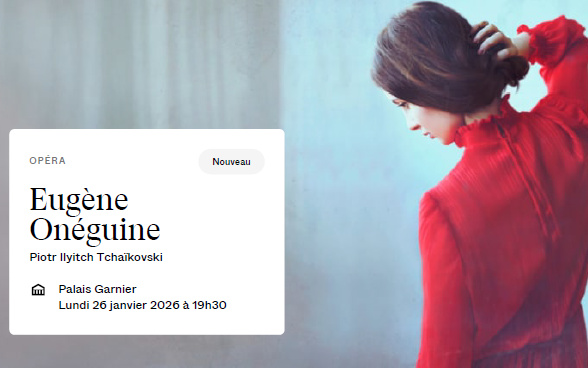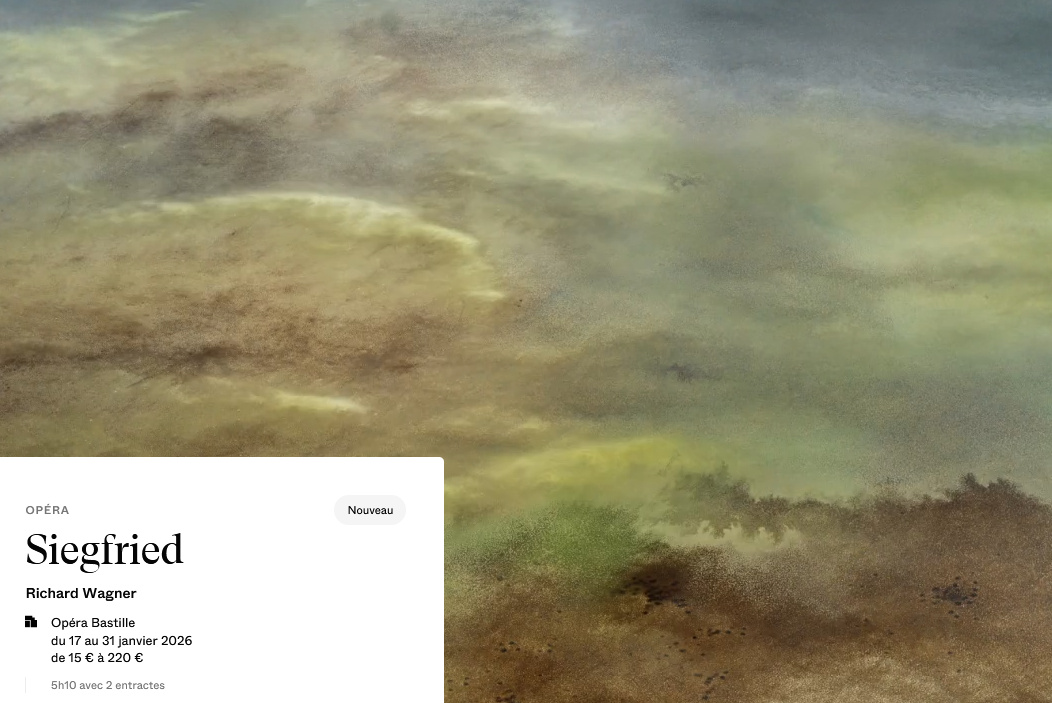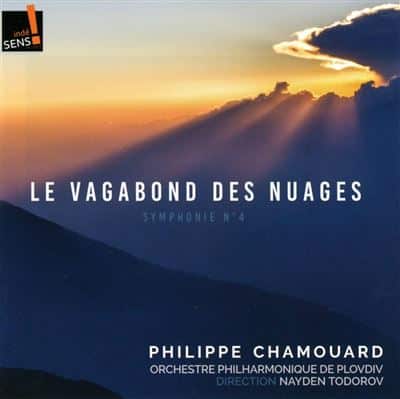
Des compositeurs français pouvant se vanter de faire entendre leur quatrième symphonie (parmi dix !) sur le marché discographique autochtone, il n’y en a pas des millions – d’autant que, en sus de la cinquième précédemment parue chez IndéSENS!, nombre d’autres symphonies persistent chez Hortus, après que le label a abandonné l’aventure. On ignore quels dieux taoïstes bénissent Philippe Chamouard, mais c’est du sérieux ! Quand, en plus, le compositeur en question ne revendique aucun grand prix incontestable de conservatoire prestigieux, l’affaire intrigue. Aussi acceptons-nous, en homme incroyablement généreux, d’y jeter une oreille curieuse, sans le snobisme susceptible de faire sourire celui qui, lisant le CV de l’orchestre bulgare, constate que sa plus grande fierté est d’avoir vu une de ses membresses intégrer un grantorchestre – me rappelle quand, à Jules-Ferry, on nous montrait lors d’une réunion destinée aux naïfs hypokhâgneux, « un admissible » au côté de Delphine, la plus jeune bachelière de France, Niçoise expatriée, bref.
La symphonie « Le Vagabond des nuages », dont le titre fait craindre un temps la proximité avec la voleuse – mais épouse sacémique opportune – si grassement payée pour pondre, en dépit de sa crasse incompétence qui fait encore rire les musiciens créateurs du bousin en présence de Sa Cochonnerie première Manu El Blancoss, le Messager des étoiles (rien à voir, sinon le goût pour la tonalité, ouf), s’ouvre sur un premier mouvement titulé « Le monde de poussière ». La prise de son d’Ivayki Yanev séduit par sa capacité immersive (même sans grande technologie, on se sent englobé dans le flux) et étonne par sa précision trop précise (cliquetis des bois). Le langage musical est furieusement tonal, ce qui n’est pas une critique mais une indication. Entre caisse claire martiale mais légère, cordes envoûtantes et flûte exagérant son vibrato, l’atmosphère résolument cinématographique aspire à figurer, à l’instar des « murs de poussière » cabréliques, le nuage d’ignorance et de sottise qui enveloppe les hommes, leur « agitation incessante », leur « fragilité » et leur caractère consubstantiellement « éphémère », le tout autour de la tonalité, basique, d’ut. La solennité simple n’exclut pas l’éclatement du nuage (piste 1, 4’). Les brefs moments de tension se dissipent pour mieux faire sentir le grondement de l’agitation, ponctué par une timbale sobre et précise. Un snob dénoncera à bon droit la simplicité d’un langage revendiquant le sens de l’efficacité ; un auditeur honnête se réjouira de suivre avec plaisir un film sans visuel. Tous devraient reconnaître la pertinence du compositeur, qui n’hésite pas à faire brièvement swinguer son orchestre (8’10) façon big band d’université américaine, avant que le nuage ne retombe, comme il nous ensevelira tous sous nos basses préoccupations matérielles, selon la conviction taoïste défendue par Philippe Chamouard.
Le deuxième mouvement est plus dramatique. Forcément, il se titule « La porte étroite » et se réfère au chameau de saint Luc. Après un tutti réduit à des cuivres puis à des cordes, effet wagnérien s’il en est (piste 2, 0’06), le compositeur décrit le désarroi de « celui qui se présente devant la porte étroite et s’aperçoit qu’elle se referme ». De brefs soli de basson ou de violoncelle, dialoguant avec hautbois, clarinette et flûte, sont autant de constats d’échec : ça passe pô. De tutti en envolées lyriques, le compositeur offre à l’orchestre, personnage malléable, la possibilité d’exprimer désarrois et espoirs, tensions et épuisements, en les marquant du sceau rythmique des cordes.
Du coup, faute d’ouverture, l’homme s’ouvre à la pensée soufi, celle du troisième mouvement titulé « Le regard intérieur ». Les contrebasses se concentrent sur leur tenue obsédante. La déploration se développe sans prendre son essor – mais assez précise pour que l’on sursaute lors de l’attaque terriblement fausse du mi-ré sur piste 3, 3’07. Elle cherche dix solutions, en un mot ou en deux, dans le collectif orchestral ou dans les soli des premiers nommés, violon inclus. Pourtant, le regard intérieur a beau s’animer des doubles croches des cordes, il s’épuise à scruter l’indicible, « l’inaccessible étoile » de Jacques Brel, frappant sans cesse contre le cœur battu des timbales, qui absorbe cette quête et la désamorce : le regard intérieur n’est rien d’autre que l’introspection, souvent vaine, d’un individu perdu dans son ego.
Une cloche signale la venue, sans apostrophe, des taoïstes du quatrième mouvement, baguenaudant dans la montagne pour « étudier les propriétés des plantes, celles du thé en particulier ». Un solo orientalisant de flûte, toujours aussi vibratoire, symbolise ces « anachorètes », nom classe des ermites provisoires. Il faut passer outre cette signification que sceptiques jugeront, sans doute à juste titre, réductrice donc agaçante – un peu comme ces crétins de la radio israélienne qui s’excusent quand ils diffusent du Wagner : le compositeur indique des ressorts d’écriture, mais cela ne réduit pas sa composition aux seuls adeptes de sa spiritualité, de même que l’on peut saluer le métier d’Alain Krotenberg sans être franmac. Comparaison d’autant moins gratuite que celui qui n’entend pas Tristan à piste 4, 4’12, mérite félicitations pour sa concentration exclusive sur l’œuvre qu’il écoute. Des à-plats orchestraux traduisent la contemplation à peine troublés par quelques notes de trompette. La partition refuse le spectaculaire, comme en témoigne le fragile solo entre le hautbois et le violon soliste. Les propositions se délitent dans le tapis des cordes qu’ornementent flûte, sorte de cor anglais et manière de contrebasson.

Prend la suite un petit concerto pour violoncelle, intitulé Madrigal d’été « puisqu’il fut créé en juillet 2017 », juillet, c’est l’été, rien à redire. Ce nonobstant, il y a de l’oxymoron dans l’air puisque « madrigal » originait (pourquoi pas ?) l’a capella. Curieusement le ou la soliste violoncelleiste n’a droit à aucune mention spécifique, si nous avons bien lu. C’est d’autant plus navrant que le résultat est tout à fait charmant, et l’on éprouve curieusement la nécessité de préciser que cette remarque n’a rien de péjoratif, avec ce qu’il faut de dissonance sporadique assumée (plage 5, 4’42 – oui, ce sont de vraies références, pas des trucs au pif), démontrant un sérieux savoir-faire. Les fade-off qui nous semblent un peu maladroits (7’35, mais il y en a moult) sont anodins : voilà de la belle musique jouée avec probité, si trop de vibrato pour notre goût sans doute fasciste, mais qui peine à nous bouleverser en dépit de notre bonne volonté, donc à convaincre qu’elle surperforme celle d’autres excellents compositeurs français moins produits – pensons au tout aussi tonal Serge Ollive.
Le disque s’achève curieusement, mais cette curiosité est une joie, sur un Salve Regina qu’interprète a capella, pardonnez du peu, le Madrigal de Paris dirigé par Pierre Calmelet. L’occasion d’admirer le métier du compositeur : le musicien sait comment en demander trop mais pas trop à ses exécutants, comment valoriser une dissonance (1’58, 2’38…) grâce aux basses en grande forme quand les pupitres aigus semblent parfois avoir du mal à remettre le moteur en route (« O clemens » et 10’07, cruel), comment détacher une mélodie – accord plein en bas et ligne supérieure flottante, comment relancer le discours (4’40), assurant toujours un respect du texte fondamental et ce que Yes aurait appelé une « magnification », etc.
En conclusion, trois points. Un, saluons le courage d’un label soucieux de poursuivre la publication symphonique d’un compositeur français – certes sans préciser les conditions de rémunération des musiciens bulgares, que l’on imagine hélas désastreuses. Deux, dénonçons le livret encore une fois tellement perfectible (malgré l’arnaque, appuyée par cette ordure de Pharaon Ier de la Pensée complexe, de « l’entreprise individuelle », le correcteur devait être payé aux conditions françaises : est-ce la raison de cette faille ?). Le compositeur est évoqué après la notice sur le madrigal… et avant la notice sur le Salve Regina, ce qui n’a aucun sens ; les fautes orthotypo pullulent (le numéro des siècles doit être inscrit en petites capitales, le « e » en exposant, pas à la va-comme-je-te-pousse comme p. 6), etc. Quel dommage ! Trois, applaudissons le savoir-composer de Philippe Chamouard (qui a droit, sur le livret, à aussi peu de place que Pierre Calmelet, alors que son importance dans le présent enregistrement méritait davantage). Donc, quoi que le résultat ne réussisse pas à nous submerger d’émotion, insensible que nous sommes, incitons les lecteurs à la découverte, si une musique pimpante, bien écrite et vaillamment exécutée, les attire. Passionnés de pouët, de jdiboujdiboujboïng et de boulèzeries électroacousmatologisticiennes, passez votre chemin, de grâce !