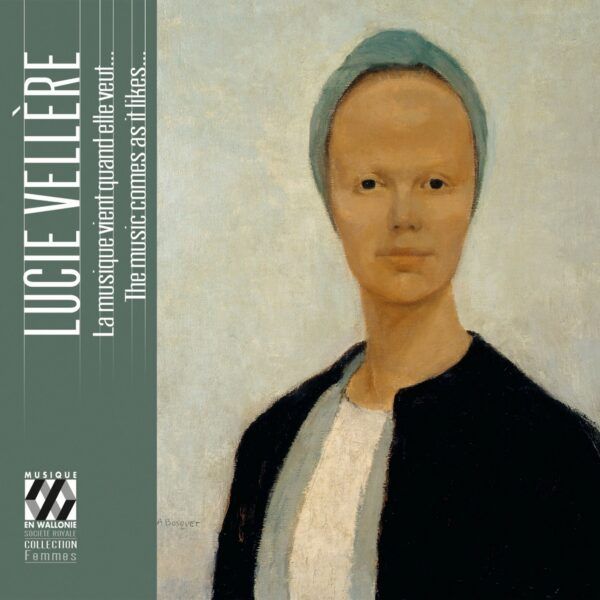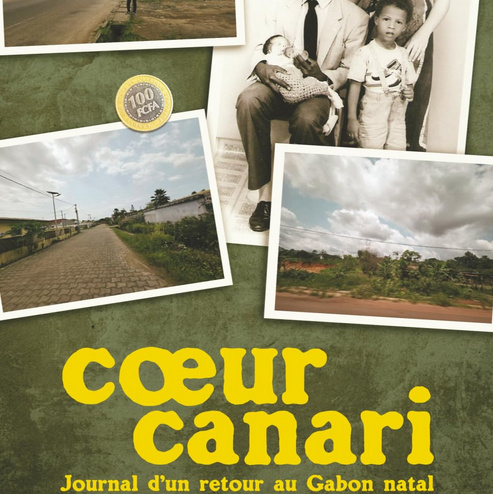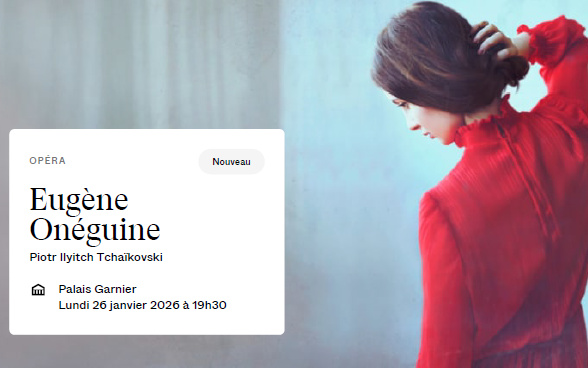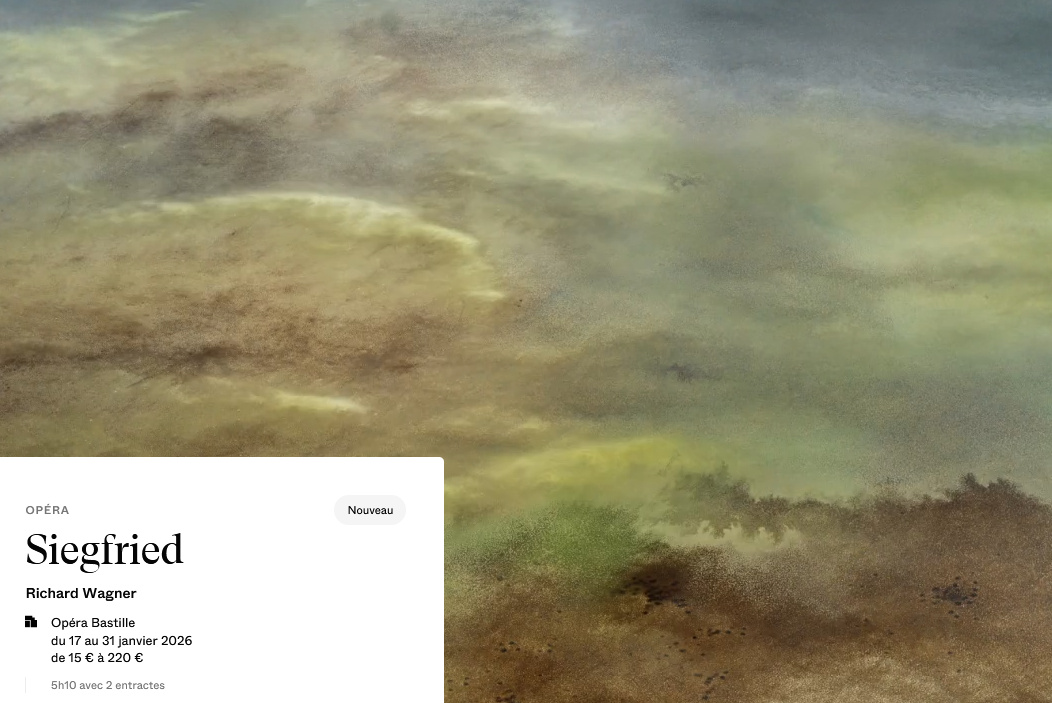Moyen chapitre premier
Où le pseudocritique assume sa crainte
d’ouïr un disque qui crache
C’est avec précaution que l’on part à la découverte de ce disque, initialement enregistré pour le deux-centième anniversaire de la naissance du zozo, donc pour publication en 2011 – et, ma foi, quelle joie de constater que des attachés de presse ne considèrent pas que la vie d’un disque s’arrête dans les deux mois suivant sa sortie ! Dès lors, pourquoi tant de prudence à décellophaniser la rondelle, si j’puis dire ? C’est que l’on a déjà dit et redit du bien d’Yves Henry. Aussi la crainte de nous répéter nous taraude-t-elle, presque comme Alexandre – ça dit un peu le niveau de l’humour à redouter dans les lignes qui suivent. Il n’empêche, sans vanter outre mesure notre vista légendaire, à tout le moins, reconnaissons d’emblée notre propre talent, ce qui évitera aux autres de s’y abaisser : nos pires craintes se confirment par trois fois.
Premier indice, le livret bilingue signé par l’interprète est un modèle de clarté, pédagogique sans être donneur de leçon, musicologique sans être pédant, intelligent sans être prétentieux – une parfaite introduction pour les mélomanes un peu avertis, qui en valent donc un peu deux, comme pour les curieux par la pyrotechnie alléchés. En substance, le musicien a choisi des œuvres situées dans la période médiane des créations de Franz, celle qu’Yves Henry juge la plus aboutie.
Second indice alimentant notre inquiétude, la construction du programme est parfaite. Trois beaux mammouths d’environ 15’ sont sandwichés, ce sera ma tentative de néologisme pour aujourd’hui, par les trois sonnets « del Petrarca », pesant seulement 7’ chacun. On retrouve ainsi le goût du musicien-passeur et la marque de l’interprète soucieux de délivrer une prestation aussi belle que digeste, aussi impressionnante que stimulante, aussi wow que popopo.
Un troisième indice – oui, j’aime bien les plans en trois parties, mais, là, c’est pas que de ma faute –, le disque a été enregistré par Joël Perrot, patron de la maison Soupir et souvent admirable dans son rôle de capteur, et à l’église Saint-Marcel, peut-être le studio préféré de tant de musiciens classiques à Paris. Soyons stipulatoire, ça commence à fleurer le disque pomme-pet-deupe. En somme, l’objet, en apparence, nous oblige à fourbir nos compliments, au cas où, hélas, il nous faudrait les frotter de nouveau à l’art du sieur Henry si les notes ouïes nous paraissent au niveau de notre préjugé. Passons donc au, souvent, meilleur moment de la chose : l’écoutationnement.
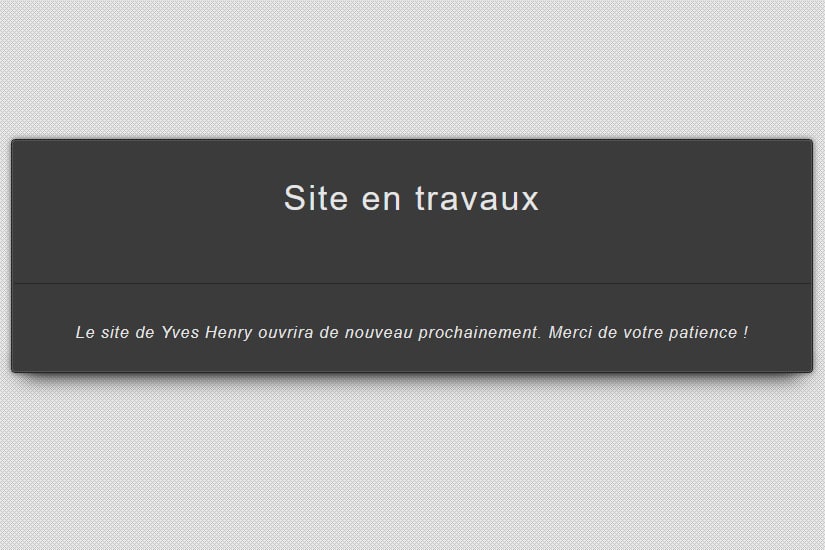
Long chapitre deuxième
Où le pseudocritique se réjouit d’avoir craint à raison, mais doit justifier la pertinence de sa prémonition
Le disque s’ouvre sur Après une lecture de Dante. Fantasia quasi sonata. D’emblée séduit cette capacité de la prise de son à restituer le p’tit plus Henry : en sus de jouer les notes et de rendre les brusques changements d’atmosphère, l’interprète sait transformer son instrument en jouant sur la résonance et le toucher, toujours fougueusement soignés. Car c’est bien cela qui saisit l’oreille : cet art de se servir du piano – et du silence – comme d’un orchestre ou comme d’une banda spécialisée dans les batucadas, comme d’un rideau de tulle ou comme d’un maillet cherchant à reforger Notung (j’avais écrit « comme d’un maillet dans ta tête de pioche », c’était moins culturel). Dans la partition infernale où l’intranquillité serpente dans le calme, où la tempête se fracasse sur l’éphémère du prompt or somethin’, et où le ternaire, farouche, défie le binaire tandis que les sept accidents renversent une armature naïvement vierge, l’aisance digitale, superlative chez Yves Henry, ne suffit pas à retenir l’attention un quart d’heure. Il faut cette capacité à raconter, à tout moment, une histoire – pardon : à maintenir la directivité de l’agogique, ouf ; et mazette, comme cette partition technique sonne narrative et captivante sous les doigts du monsieur à la blanche crinière ! On l’entend d’autant mieux dans les passages moins show-off (y en a quelques-uns) où l’art de la respiration pertinente, la nuance qui fait sens, le toucher qui happe l’oreille achèvent d’éblouir voire d’émouvoir l’auditeur. Si vous cherchez une version associant légèreté, brio et profondeur, vous avez votre homme. Enfin, votre disque, c’est déjà bien.
Le premier intermède est le Sonetto 47 del Petrarca où le poète « s’encourage lui-même à ne se point lasser de louer les yeux [les yeux, bien entendu] de Laure » car « ils allument toujours en mon cœur des étincelles » (« sempre nel cor colle faville accesse »). Parti sur un faux la mineur à quatre temps, le prélude débaroule sur un vrai Ré bémol à six temps « sempre mosso con intimo sentimento », avec « il canto espressivo e un poco marcato » tandis que « l’accompagnamento » restera « sempre dolce ». La réalisation paisible trahit la maîtrise du pianiste qui n’a pas besoin d’en rajouter dans l’hyperromantisme : un accent lui suffit à ébouriffer l’auditeur, en Ré bémol comme en Sol ou, changement d’ambiance, en Mi, avec deux portées comme avec quatre. Intermède ? Sans doute par la capacité de l’artiste à rendre ce sentiment intermédiaire qu’est l’amour-dans-la-durée, aka l’amour après le wow. Et avec quelle élégance, maou !

Deuxième partie, deuxième gros morceau, la Vallée d’Obermann, incluse dans le premier volume des Années de Pèlerinage, juste après la redoutable « Tempête », présent un homme prêt à se « consumer en désirs indomptables » pour s’abreuver « de la séduction d’un monde fantastique », afin de « rester atterré de sa volutuptueuse erreur » avant de constater qu’il a « fait un pas sinistre vers l’âge d’affaiblissement » par l’usage trop grand, trop soudain, des passions. Pourtant, ad initio (?), tout est paisible, dans la vallée. Pis : tout est lisible. Avec une mélodie distincte et un accompagnement discret. Que demande l’opium du peuple ? Oh, Yves Henry réussit bien à habiter tout cela, même dans le bruit étouffé de la vi(ll)e (piste 3, 1’53 à 1’55, du danger du silence…). L’excellent réglage du Bechstein D 282 par Jean-Michel Daudon permet de goûter tant les graves que les aigus, explorés posément par le début de la pièce. Une fois de plus, l’art formidable du récit selon Yves Henry joue tant des nuances que du toucher, du jeu de pédale que des silences. Ce qui vaut dans le midtempo vaut dans le Presto, dans l’agitato que dans le Lento, dans le tremolando que dans le rinforzando. Cette capacité à susciter du beau whatever the beat ou le niveau technique requis enveloppe l’interprétation d’une aura susceptible de captiver l’auditeur, fût-il inquiet à l’idée d’un disque 100 % Liszt (« quand Yves Henry joue, toi prendre »).
Deuxième intermède, le Sonetto 104 del Petrarca annonce que « les pleurs de Laure font envie au Soleil [et pourquoi pas] et étonnent les éléments », bref… « si bien que, à me les rappeler, je me réjouis et je souffre ». Comme en réponse, la piste choisie semble commencer dans l’écho des cloches de Saint-Marcel. Le pianiste souligne la dimension cosmologique du propos en jouant franc du collier, sans sentimentalisme. L’arrivée du thème surligne cette volonté de suivre la partition pour exprimer l’émotion, en évitant la surcharge d’émotivité pseudo-convenue. Franz Liszt avait tout prévu… pour ceux qui sauraient jouer aussi bien que lui. Yves Henry se délecte des différentes inflexions passionnées que contient cette pièce. Libéré des considérations techniques propres au bon pianiste qui se hausse du col, il peut se permettre de donner du sens à une partition secondaire, soit, mais redoutable et superbe quand elle est aussi merveilleusement jouée – c’est dit.
Ouvrant la troisième partie, l’épouvantable (pour les farceurs qui, se croyant pianistes d’un niveau correct, prétendent la jouer) Deuxième ballade, avec ses accords aux intervalles d’emblée franckistes, alterne grondements graves – passant du Ré au Ré bémol pour s’enfoncer un peu plus – et élévations vers l’aigu sans arriver provisoirement à trouver une issue autre que l’exacerbation virtuose. Cette alternance entre calme et pure explosion de digitalité anime une pièce aussi frustrante qu’impressionnante, où la logique aristotélicienne du récit se dissout dans un gloubigoulba de possibles, de déceptions et de vertiges tous provisoires – reflets, sans doute, de la condition de la plupart des humains… lesquels seront toutefois bien en peine de comprendre comment l’on peut jouer une pièce aussi difficile, et d’un, et faire sonner ces difficultés comme s’il s’agissait de tremplins vers la musicalité, et de deux.

Troisième intermède servant de postlude, le Sonetto 123 del Petrarca conclut le disque. Alors que le compositeur est censé décrire une passion difficile avec la fameuse Marie, le poète profite de cette séquence pour évoquer le « pauvre fou » qui traverse « l’horrible solitude des forêts ombreuses » sans faire bravo des fesses car il pense à sa choupinette et regrette juste de ne lui point conter fleurette cependant qu’il baguenaude. D’où le balancement lento placido choisi pour commencer par Franz. La fragmentation du discours souligne néanmoins le passage du sous-bois à la forêt censée flipper quiconque ne serait point suramoureux. La finesse incroyable du si bémol qui conclut le prélude (piste 6, 1’12) pointe la délicatesse de l’interprète. Le texte l’empêchant, il n’y aura point ici d’emportement apocalyptique ; mais Yves Henry fera feu de tout bois pour rendre l’émotion intérieure du promeneur enthousiaste au sens étymologique. Des doigts quand il faut ? Certes. Mais de la simplicité, de la rectitude, de l’honnêteté quand cela fait sens ; et avec maîtrise ou maestria, comme cela vous sied – écoutez l’évacuation de la pédale à 4’30 : cela ne paraît rien, et néanmoins combien de virtuoses vedettes auraient négligé cette sortie en nous crachant quelque dissonance métallique ? Sur cette pièce « mineure » comme sur tout le disque, la délicatesse est reine ; et c’est pourquoi nous n’avons nulle vergogne à rédiger deux fois plus de lignes sur une pièce deux fois plus courte que la spectaculaire ballade précédente, na.
Fort bref chapitre conclusif
Résumons : quand vous en êtes à dire : « En revanche, pour les photos, prendre un pro, ce serait pas du luxe » ou « Côté esthétique de mise en page du livret, peut mieux faire », c’est que, globalement, vous avez été soufflé par le disque et que vous en conseillez l’écoute voire l’acquisition non pas pour avoir davantage de services de presse, quoi que, mais nos contacts savent que, hélas, c’est jamais l’objectif, juste parce que, bigre, bougre et saperlipopette, il est fort, ce mec (ça se dit, culturellement, ça ? En tout cas, en pensant à celles et ceux qui estiment que mes pseudocritiques sont souvent diluées dans des digressions perturbantes, ce qui n’est point toujours opinion excessive, la preuve, j’espère et je subodore dans un mouvement benoît que cette synthèse compulsive aura fait frétiller du croupion).