
Selon les générations et les snobismes, on appellera ça une compil, un best of ou un florilège. C’est en tout cas une sélection personnelle de chansons semées çà ou là qu’a concoctée pour nous le chanteur Jann Halexander en personne. Originellement prévu pour 2021, retardé par le Covid, désormais habillé d’une pochette qui cache à peine l’influence d’un disque présentant des miscellanées d’Anne Sylvestre avec visage au premier plan et Notre-Dame fondue-enchaînée derrière, ce parcours est disponible ici. Voilà une bonne occasion pour les curieux de picorer quelques titres de celui qui se définit parfois comme « le mouton noir de la chanson française » ; mais voilà aussi une bonne occasion pour les habitués de découvrir un autoportrait singulier, l’artiste ayant
- choisi quelques piliers de son répertoire,
- sélectionné des chansons moins souvent présentes dans ses tours de chant, et
- laissé de côté quelques-unes de ses fredonneries qui électrisent son public (« Le poisson dans mon assiette », pourtant créé en 2016, n’est pas de la partie, par exemple, peut-être parce qu’elle est devenue davantage une chanson de scène que de disque… en attendant peut-être une compil’ live ?).
Le voyage commence en 2003 avec « Pont Verdun ». Au fil de la longue intro, le piano ressasse une série de motifs que la batterie ponctue bientôt. La voix, ensuquée dans une apparente mélancolie, poursuit la chanson danger et d’Angers en prenant à contre-pied ceux qui réduisent Jann Halexander à un chanteur à texte façon rive gauche, et ceux qui aiment à voir en lui un chanteur de cabaret survolté. Dès lors, ce titre liminaire résonne comme une déclaration d’insoumission. Il revendique à la fois son côté pop façon moins Bashung qu’entre Daho et Christophe, avec
- parophonies vintage,
- ton traînant, comme défait, et
- envolées mystiques que l’écriture irrégulière semble, dans un geste oxymorique, vouloir rendre autant claquantes qu’hypnotiques.
Jouant d’un timbre grave, le chanteur évoque, à travers le paysage angevin, la minuscule insaisissabilité des sentiments grandioses. Il raconte l’ambiguïté de la pulsion d’Eros qui peine à masquer, dans « le jour noir », la présence irradiante de Thanatos. Sous l’apparence d’épuisement qu’il arbore parfois comme pour dresser un voile (ou une voile, selon les moments) entre sa barque et le fleuve du monde, il lance son disque sur ce que les habitués pourraient à tort prendre pour une fausse piste. Si l’on est loin de « Papa, Mum », on est dans le dark side of the Halexander’s trip, où le chanteur paraît prendre plaisir à
- désirer et maudire,
- idéaliser et agonir de quolibets,
- piédestaliser (et hop) et clouer au pilori
trois pôles qui le hantent :
- la lumière,
- l’amour et
- la vie.
Pour l’artiste, il y a un plaisir presque ironique à
- se morfondre,
- constater la vanité des choses et
- tâcher de se convaincre qu’il ne faut pas rêver plus haut que le cul – en attendant néanmoins avec impatience le prochain songe.
« L’Inconnue dans ma maison » ne prétend pas contraster avec cette amertume heureuse par une luminosité plus réjouie. Une double intro – spécialité halexanderienne s’il en est – installe un rythme résolument sixties sur lequel l’ACI pose un thème central dans son œuvre : l’identité. Retors, il ne pose pas a priori la question de son identité mais celui d’une « belle inconnue » au sexe changeant, qui semble être à la fois impalpable et assez charnelle pour qu’elle lui « redonne de l’envie ». En laissant une grande part
- à l’imprécis,
- aux pointillés et
- à l’estompe,
l’estampe produite par Jann Halexander place dans le puzzle de son portrait son art de la suggestion et, par-delà les seuls mots, son goût pour la musique dont témoignent les plages instrumentales agrémentant le paysage de cette chanson. En témoigne la coda inquiétante qui reflète la première partie de l’introduction et boucle l’inconnaissance sur elle-même. C’est alors que, respectant le jeu de la compil’, le chanteur dégaine deux titres récurrents dans ses tours de chant, chacun avec un statut particulier. Premier titre iconique, voici « Le mulâtre », une chanson qui prolonge la question de l’identité
- trouble,
- floue et
- profuse.
Avec la collaboration des chants d’oiseaux peu messiaeniques – heureusement – et trop mignons pour être honnêtes (la suite confirmera cette intuition), l’intro richement harmonisée contraste avec l’accompagnement pianistique sciemment étique qui soutient le chant d’humain. Jann Halexander excelle dans l’art de l’autobiographie biaisée, mais son introspection se dérobe à l’égocentrisme. Il l’assume : quand il sourit de lui, il nous invite à sourire de nous. Le mulâtrisme, et hop, n’est pas réservé aux gens « vaguement blancs, vaguement noirs » car nous sommes tous
- des contradictions,
- des mélanges,
- des singularités plurielles
sur pattounettes.
- Bourgeois et précaires,
- honnêtes hommes et filous fieffés,
- gens reconnus des leurs et des voisins – donc inconnus :
l’ambiguïté identitaire se nourrit de nos contradictions. Loin d’une phraséologie woke, le Français d’origine gabonaise métaphorise sa condition. Contre lui, tout contre, on irait jusqu’à dire qu’il la sublime ou qu’il la transcende, au sens où il la dépose aux oreilles du public en la chansonnant, c’est-à-dire en nous permettant de nous l’approprier. Nés à Libreville, « Paris, Bordeaux, Lille, Brest(e) », nous avons à gagner à apprécier la complexité de nos identités. Elle n’est pas forcément
- richesse,
- éblouissement ou
- orgasme intellectuel.
Croire à cette équivalence serait la définition même du fascisme. Non, ce que semble suggérer le chanteur dans cette proposition habilement habillée dans un piano-voix puissamment dénudé, c’est que
- la dissonance (lui qui aime tant l’harmonie des secondes et des neuvièmes…),
- la contradiction (lui qui cherche à longueur de textes son identité tout en refusant d’y être assigné), et
- l’interpolation (lui qui, perdu devant les entrelacs qui constituent l’humain, en est ailleurs réduit à espérer une réponse des statues de l’île de Pâques, elles-mêmes inexpliquées)
sont potentiellement fécondes, mais il nous appartient de leur donner du sens, ce qui n’est point chose aisée. Planent sur ce questionnement ontologique
- le constat de nos limites humaines,
- l’anticipation de notre finitude, et la promesse de la mort, cette flamme qui brûle nos vies, nous fait « valser avec le malheur » et à l’aune de laquelle nous n’aurons jamais vraiment la lucidité de jauger nos « villages natals »,
- réels,
- reconstruits ou simplement
- imaginaires.
Le second titre iconique du zozo s’appelle « À table ». C’est un moment-clef de ses concerts, ici rappelé dans sa VO. Les fans redécouvriront un titre présenté en piano-voix, avec l’artiste au piano (alors qu’il délègue souvent cette fonction, sur ce titre, quand il est sur scène). Les autres goûteront la logique narrative de l’album digital car, après avoir fait péter l’idée d’une identité fixe, qu’elle soit sexuelle
- (l’hétéro,
- l’homo,
- le bi)
ou géographique
- (l’Angevin du Gabon,
- le Différent qui se fond dans la foule,
- le Métissé qui se revendique tel tout en affirmant n’être que lui, comme un ornithorynque),
Jann Halexander propose d’expliciter le malaise de l’ambiguïté en affirmant que, malgré qu’on en ait, « il va falloir se dire tout ça à table ». Dans un arrangement sans flonflons superfétatoires, la chanson propose de « bouffer la vérité » au lieu du saumon dégueu et du crumble froid – peine perdue. Le fredonneur évoque
- les non-dits,
- les implicites,
- les connexions imaginaires
qui ravinent les familles – celles du sang ou celles que l’on se choisit. Même en s’appuyant sur les autres, rien ne permet de solidifier son identité ni d’en faire un espace de sérénité.
- La famille d’où nous venons est un lieu de haine recuite,
- l’amour ne sert qu’à se sauver au sens de la fuite, sans doute, plus que dans une acception rédemptrice, et
- la réunion entre proches ou amis est
- un gouffre,
- une vacuité,
- un faux-semblant,
tonne l’artiste, mordant. Moins dandysme que lucidité, cette posture désenchantée du chanteur farmerophile se prolonge dans « J’aimerais, j’aimerais », long récit – toujours en piano-voix – de la révolte d’une « pédale » plouc de vingt ans face à son amant « député et bon catholique ». La confrontation entre le fils de péquenot et le politique au-dessus de tout soupçon n’est qu’une facette d’un double malentendu que narre ici le troubadour franco-gabonais. Nous ne spoilerons pas la suite du drame, qui confirme la conviction de l’artiste : seul le sexe dit vrai, tout le reste est bullshit et personne ne nous comprendra jamais. En dépit de son emphase définitive, une telle affirmation serait rassurante si l’humain n’avait pas tendance à déborder le support, donc à vouloir, en dépit du bon sens,
- s’attacher,
- se projeter,
- espérer.
Dans cette première moitié de compilation, un Jann Halexander très sombre nous le déconseille fermement. Nous vérifierons fort bientôt s’il persiste et signe dans la seconde moitié de son florilège. À suivre !
Pour écouter ou acheter le disque virtuel, c’est ici.



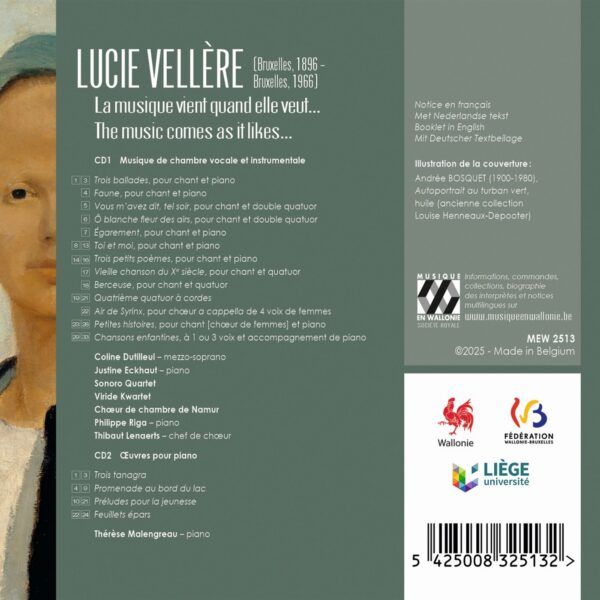

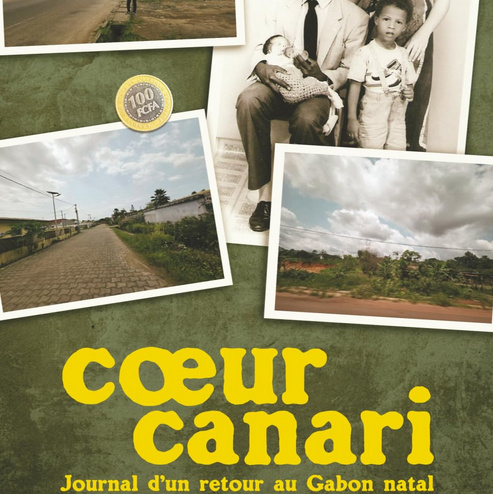


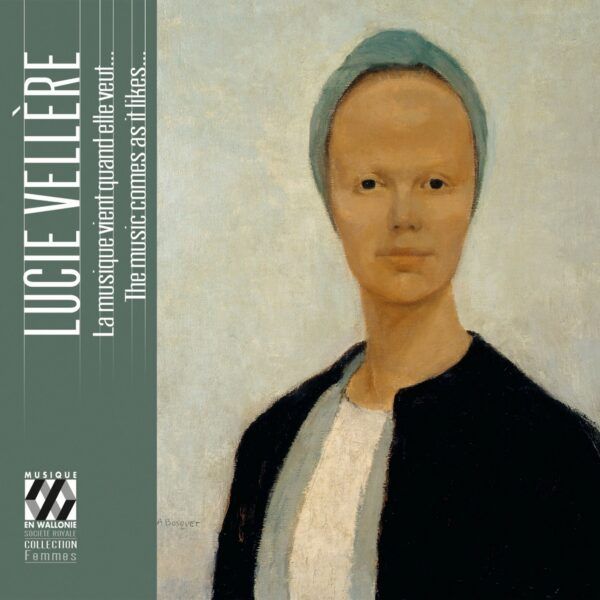
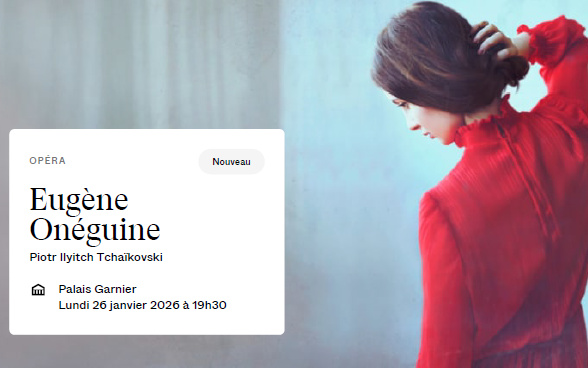
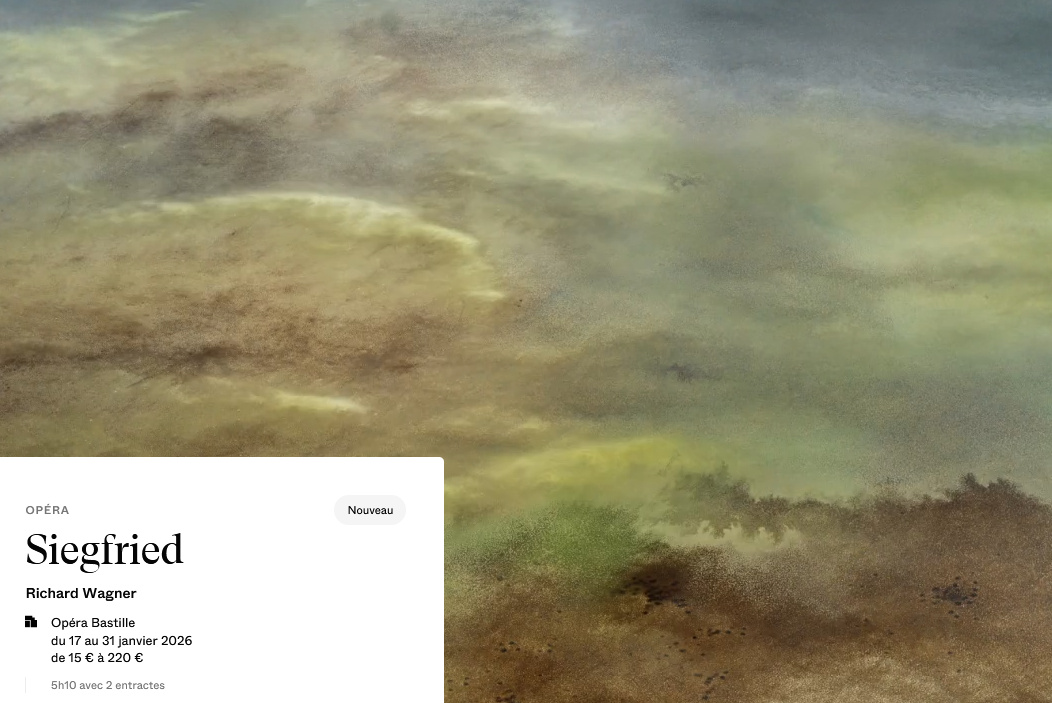

















































![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)




