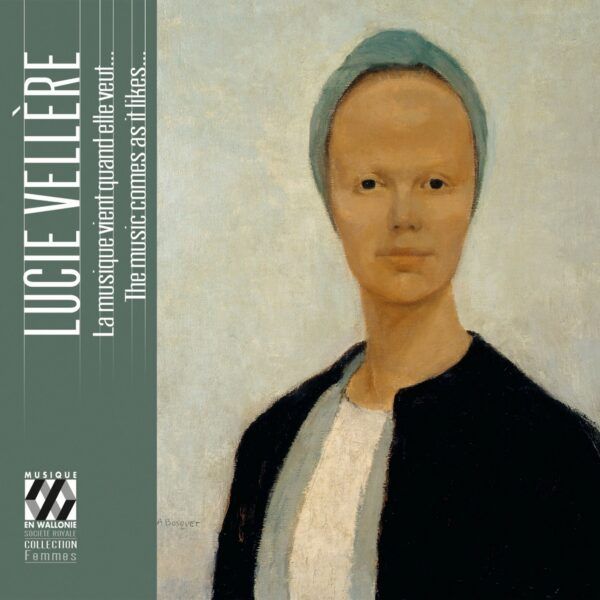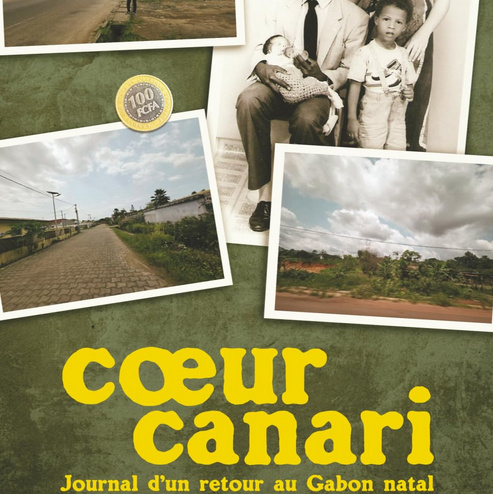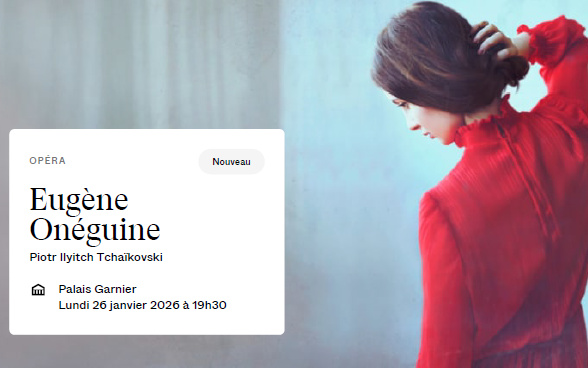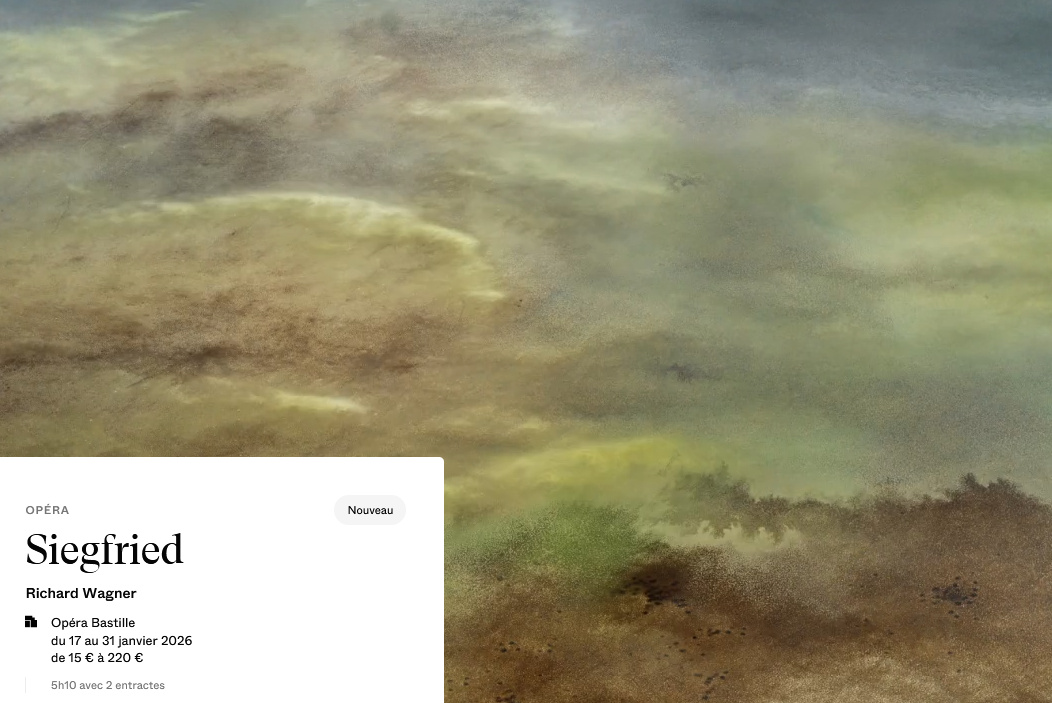Le concept : l’opéra de Paris créait ce mois-ci sa commande, une composition de Luca Francesconi inspirée par Honoré de Balzac. Nous allâmes applaudir la dernière, dans cet oxymoron de Garnier – décor grandiose, espace minimal entre les rangées, ce qui rend toute représentation moins agréable, même quand on n’est pas gigantesque.
L’histoire : Lucien de Rubempré (Cyrille Dubois) veut se suicider, et pourquoi pas ? Parce que l’abbé Carlos Herrera (Laurent Naouri) l’en empêche, soucieux de posséder une créature. Le saint homme au visage difforme promet de faire du chougneur cet homme aux mille réussites que le zozo désespérait d’être. Lucien va donc se lancer dans deux aventures parallèles : draguer les nobles moches ou vieilles mais pleines aux as (Béatrice Uria-Monzon, Chiara Skerath), et s’adonner au stupre amoureux avec son Esther chérie (Julie Fuchs), une pute – peut-être le mot le plus utilisé dans l’opéra – que l’abbé refourgue au marquis de Nuncingen (Marc Labonnette) grâce à l’entremise d’Asie (Ildikó Komlósi). Lucien sera donc attaqué des trois côtés à la fois : pour avoir voulu avoir du succès alors qu’il se sait louseur depuis le départ ; pour avoir berné les richasses qui lui écrivirent mille cochoncetés ; et pour avoir accepté qu’Esther « battît monnaie sur le traversin » afin de lui refourguer le million dont il a besoin. Les révélations fomentées par un trio de potineurs (Laurent Alvaro admiré jadis, François Piolino, Rodolphe Briand) bousculent tout ce monde. L’abbé, reconnaissant qu’il est un faux abbé, exige un pacte. Aussitôt après, Lucien est accusé de meurtre, interrogé et exécuté à vingt-sept ans. Le juge accepte de céder au chantage du faux abbé, Jacques Collin de son état, bagnard en fuite et surnommé Trompe-la-mort, qui s’est automutilé la face pour n’être plus reconnu. Bientôt, son statut d’ordure sournoise et maligne lui vaudra, logiquement, d’être désigné chef de la police dans un monde où les femmes sont des salopes, les puissants des corrompus vicieux et les pauvres des arrivistes dégoûtants. Miam, mi-démon.

L’œuvre : sur un livret et une musique de Luca Francesconi, cette poly-exploitation de Balzac propose une partition riche, portée notamment par une orchestration foisonnante et variée. Alors que le compositeur sous-utilise l’excellent chœur local (les chuchotis et le hors scène sont privilégiés), il manie avec gourmandise toutes les richesses d’un orchestre incluant, en sus de l’instrumentarium habituel, force claviers nobles, un accordéon hélas pour l’approche finale, et de multiples percussions dont certaines se sont réfugiées dans les loges. L’usage de la récurrence et de l’ellipse réjouissent et stimulent le spectateur (en tout cas, moi, ça m’a stimulé, na), surtout pour une création dont le site de l’Opéra ne daigne pas préciser le synopsis – je serais tellement heureux de discuter avec les responsables du site pour leur essspliquer pourquoi leur créature me semble en-dessous de tout. En revanche, la dramaturgie convainc moins, quand bien même on admettrait que des à-plats narratifs, des points d’orgue monologués, des longueurs se prenant pour des langueurs font potentiellement sens. Coupes ou retouches scénaristiques auraient peut-être valorisé la tension sans détriment pour l’équilibre ou, plutôt, le déséquilibre général. De même, sans tenir compte des supposées donc bien compréhensibles erreurs de live telles que mauvaises liaisons ou oublis d’hispaniser des « u », on n’est pas certain que l’irrégularité de la prosodie, avec coupures de mots incongrues (surtout au premier acte), répétitions parfois bizarres et appui sur des finales muettes soient plus dues à une volonté artistique qu’à une maîtrise perfectible de la langue française. Ces quelques scories subjectivement pointées, reconnaissons ici une association qui nous plaît : ambition de la musique, originalité du traitement de la trame narrative, souci de rester à peu près intelligible – voire un peu trop à notre goût lors de la confrontation finale.

Le spectacle : avant de profiter de l’œuvre (2 h 10 sans entracte, curieusement), pour cette dernière représentation, les spectateurs qui ont la politesse d’arriver à l’heure bénéficient d’un bon quart d’heure de cacophonie générée sans honte par les musiciens de l’orchestre. C’est à la fois désagréable et inconvenant, un peu comme si la maîtresse de maison qui vous a invité – moyennant, en l’espèce, une coquette petite somme – lavait la vaisselle devant vous pendant que monsieur déféquait bruyamment, porte grand ouverte. Quel que soit le niveau de ces musiciens, on ne peut que s’étonner de leur incorrection – et de l’absence de réaction de l’institution contre ces pénibles habitudes. Faute de mieux, il faut donc se farcir ces crottes de nez envoyées par des sans-gêne, tout br(u)illants soient-ils, pour accéder, enfin, à Trompe-la-mort.

Le dispositif scénique (Guy Cassiers et Tim Van Steenbergen, également costumier) qui attend le spectateur est à la fois basique et sophistiqué. Basique parce que moderne : pas de décor fixe, des praticables qui montent et descendent. Sophistiqué car, sur des lamelles mouvantes, sont projetées des vidéos. Théâtre dans le théâtre, mise en abyme mise en abyme, les vidéos (Frederik Jassogne) représentent essentiellement les ors de l’opéra Garnier, voire l’opéra vu de Googlemaps, et il faut attendre les scènes finales pour trouver un semblant d’esthétique dans les clairs-obscurs traversés par des éclairs autoroutiers dégoulinant des cintres. La fragmentation de l’espace est donc à la fois horizontale (plusieurs « étages » se répondent en hauteur, des praticables montent puis descendent sous scène, un rideau semi-transparent sert d’écran géant), verticale (des panneaux-écrans strient sporadiquement la scène, des ampoules investissent le vide) et transversale (un tapis roulant se déclenche de cour à jardin comme de jardin à cour). Prétendre que l’on a gobé la substantifique moelle de ce dispositif ou des lumières de Caty Olive sous-éclairant systématiquement Lucien et l’abbé serait mensonger. L’impression de déjà-vu et de passe-partout l’emporte sur tout effort d’exégèse. La spécificité des enjeux francesconiens ne paraît pas avoir été prise en compte, avec un avantage : cette proposition scénique pourrait s’appliquer à n’importe quel opéra monté par une scène fortunée mais intellectuellement paresseuse.

Les interprètes : heureusement, en fosse, l’intransigeante et formidable Susanna Mälkki mène orchestre et chanteurs d’une battue précise qui inspire synchronisation, rythme et respiration aux acteurs sonores. Le plateau, pour une fois très français, a recruté du haut de gamme. Laurent Naouri, méconnaissable sous son masque, a la tessiture et la présence hébétée qu’il faut. Cyrille Dubois rend la complexité (pas que technique, mais quand même) de son rôle avec un désarroi joliment incarné. Julie Fuchs ne manque ni d’abattage ni de résistance – son redoutable dernier air est enlevé comme à la parade, et avec sensibilité s’il vous plaît ! Marc Labonnette séduit en vieux pigeon plein de faconde, scéniquement et vocalement, tandis qu’Ildikó Komlósi, au contraire, en fait trop pour donner sincérité et force à son personnage d’entremetteuse dénuée de morale. Philippe Talbot, vu et ouï jadis en Zizi, si si, est inaudible : ce soir-là, au moins, sa voix n’a pas la puissance requise pour passer outre l’orchestre. À l’opposé, Béatrice Uria-Monzon a toujours une voix puissante, mais elle sacrifie les consonnes sur l’autel de la force : on peut sans risque défier tout monzonophile de décrypter une miette de son texte – c’est gênant, et pour suivre l’intrigue sans les sous-ttres et pour le malaise que cette incapacité à prononcer suscite chez l’auditeur à force de forcer. Heureusement, le trio bouffe constitué par Laurent Alvaro, François Piolino et Rodolphe Briand (cinq rôles solistes à l’ONP en deux saisons pour cet artissse), joue ses deux grandes scènes, entre chant et texte parlé, avec brio et précision. L’orchestre, lui, s’approprie cette partition variée en caractérisant avec soin les climats convoqués par l’artiste, et emporte le spectateur dans la découverte.
 En conclusion, le tout donne un spectacle qui aurait peut-être gagné à être densifié çà et là (dialogues pas toujours utiles au rythme narratif, explicitation morale finale fort regrettable), et où l’on aurait aimé que fût revigorée une mise en scène qui manque de trouvailles, de singularité et de puissance dramaturgique (Guy Cassiers et Erwin Jans), oui ; mais aussi un spectacle qui capte l’attention et se révèle peu à peu au spectateur, dans son ambition gourmande et son mystère intelligible. Le triomphe fait par un opéra Garnier plein en témoigne avec justesse.
En conclusion, le tout donne un spectacle qui aurait peut-être gagné à être densifié çà et là (dialogues pas toujours utiles au rythme narratif, explicitation morale finale fort regrettable), et où l’on aurait aimé que fût revigorée une mise en scène qui manque de trouvailles, de singularité et de puissance dramaturgique (Guy Cassiers et Erwin Jans), oui ; mais aussi un spectacle qui capte l’attention et se révèle peu à peu au spectateur, dans son ambition gourmande et son mystère intelligible. Le triomphe fait par un opéra Garnier plein en témoigne avec justesse.