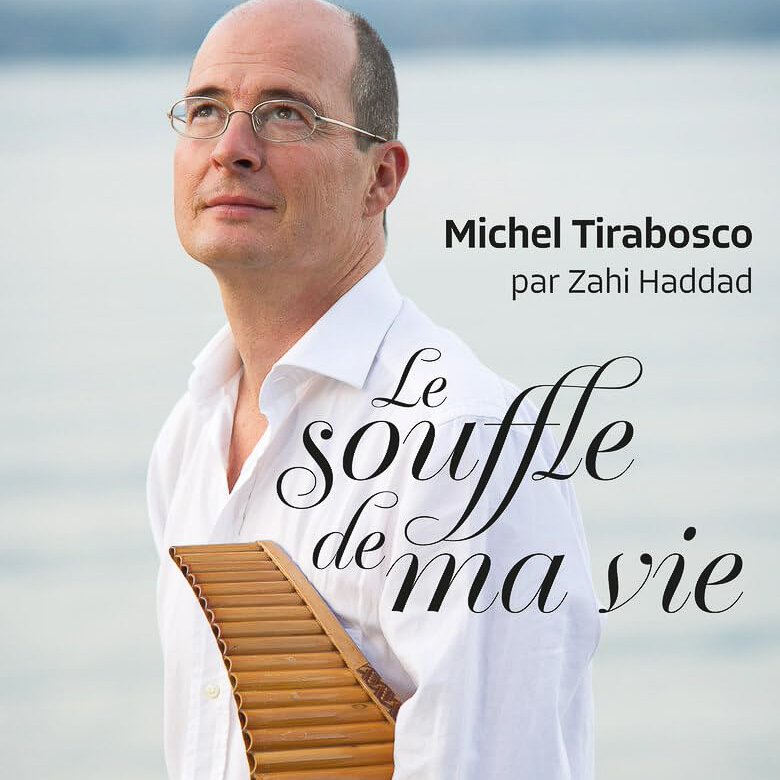Travailler la mort, travailler avec la mort, dans l’optique de Charles Guyard, c’est avant tout travailler les morts pour développer une économie du care après le care, même si l’aspect économique est l’un des quasi tabous de l’ouvrage. En se focalisant sur une vingtaine d’événements dramatiques – attentats, accidents, meurtres en tout genre – pour lesquels il a retrouvé des témoins ayant participé à la prise en charge des cadavres, l’auteur pose une question intéressante : derrière l’événement exceptionnel en nombre de cadavres ou en horreur, comment les process funéraires permettent-ils de rétablir la fausse banalité de la mort (la plupart d’entre nous ne la côtoyons pas tous les jours, mais nous savons malgré nous qu’elle finira par tous nous choper) ? En d’autres termes, comment normalise-t-on le hors-norme ?
L’accident de passerelle, lors de l’inauguration du Queen Mary 2 (16 morts), en 2003, permet d’aborder à nouveaux frais cette problématique. Le témoin raconte précisément le retournement de situation : aux chiffres traduisant la monstruosité du navire (« hauteur, longueur de pont, capacité, nombre de cabines, de piscines, de salles de restauration ») se substituent
- les chiffres des victimes, mortes ou blessées,
- ceux qui permettent de prendre conscience de la chute qu’elles ont subie (« l’équivalent de cinq à six étages, au moins »), et
- ceux qui donnent une idée des derniers instants des malheureux (« pendant quelques secondes, [ils] ont forcément pu prendre conscience de leur sort tragique »).
Ainsi le témoin reconstitue-t-il une sorte de retour dans le temps par la numération approximative. Apprivoiser la mort semble ici passer par
- la quantification
- (conditions du décès,
- nombre de cercueils à prévoir,
- temps de trajet entre le lieu du drame et la morgue improvisée…),
- le physique (entrée en jeu des thanatopracteurs pour la reconnaissance par les familles) et
- la métonymie (quand les crânes ont éclaté, les croque-morts ferment le cercueil et posent dessus les bijoux : ce sont ces substituts que les familles seront invitées à reconnaître).
Cela passe aussi par la gestion de l’après :
- le « petit coup » bu en rentrant,
- le débrief psy,
- l’invitation au restaurant par le patron de la boîte, et
- un reste de colère contre ceux qui avaient à gérer le public et ont fait n’importe quoi.
Il ressort du récit que la mort est banale parce que nous sommes des animaux drogués à l’habitude. Beaucoup d’inacceptable devient acceptable dès lors qu’il peut être inscrit dans une routine. Le travail de résilience commence donc par la capacité à retrouver de l’habituel dans l’inhabituel. Dans le cas de la tempête Xynthia qui, en 2010, « a tué vingt-neuf personnes en quelques heures » (teasing : les lecteurs du livre apprécieront la jolie chute de ce chapitre), l’habituel, c’est le repas annuel du club de foot de la commune où vit le témoin. L’inhabituel, c’est
- l’interruption de la fête pour cause de trop nombreuses ruptures de courant ;
- l’énormité des dégâts commis par le vent ;
- l’arrivée de la presse et des cons qui regardent, alléchés par le nombre de cadavres.
Le témoin décrit bien le phénomène de flux et de reflux psychique :
- incompréhension car réflexe de vouloir saisir l’inhabituel par le prisme de l’habituel ;
- prise de conscience de l’inhabituel et changement de focale ;
- gestion de l’inhabituel pour le remettre sur les rails de l’habituel
- (reconstitution des stocks,
- tailles des cercueils,
- gestes commerciaux pour éviter le bas de gamme,
- trucage des actes de décès pour que les familles puissent voir le défunt avant les obsèques…).
Le signe que l’opération est réussie, c’est que, une fois l’inhabituel redevenu habituel, on peut apprécier à nouveau des phénomènes inhabituels qui, à petite dose, pimpent l’habituel
- (venue d’un ministre,
- sélection de trois cercueils « pour représenter toutes les victimes »,
- conseils de shopping aux familles devant habiller les défunts…).
Dans cette narration comme dans l’ensemble des témoignages recueillis par Charles Guyard, il appert à ce stade que le plus intéressant est une triple ambiguïté.
- Ambiguïté structurelle : les témoins travaillant autour des cadavres, ils ont conscience que leur posture, quoique collective, est singulière, mais ils le vivent comme une habitude.
- Ambiguïté circonstancielle : les témoins étant confrontés à des catastrophes d’ampleur, ils ont conscience que la situation est exceptionnelle mais doivent le gérer avec les outils de l’habitude.
- Ambiguïté posturale : en témoignant, par définition, les témoins ont conscience qu’ils attisent autant qu’ils désamorcent le voyeurisme ou la curiosité des lecteurs-auditeurs, mais ne manquent pas de s’emporter, ainsi que nous le pointions dans la précédente chronique, contre le voyeurisme ou la curiosité des journalistes dont ils ne maîtriseront pas le narratif… tout en regrettant d’être toujours « la dernière roue du carrosse, les grands oubliés ».
La noyade dans le Drac, au cours de laquelle six élèves de CE1 et une accompagnatrice meurent après un lâcher d’eau d’un barrage EDF, est l’occasion d’observer cette ambiguïté à l’œuvre. Le témoin est un professionnel : il sait
- que les véhicules de secours ne peuvent transporter de cadavres (sauf si le préfet dit le contraire) ;
- comment gérer la reconnaissance par des parents (sauf si les forces de l’ordre se contredisent) ;
- ce qu’il a l’interdiction de faire même pour présenter plus joliment un cadavre (sauf si le parquet l’autorise à le faire).
Pour autant, ce cadre
- légal,
- réglementaire et
- professionnel
ne le protège pas irrévocablement de l’émotion quand
- il découvre les cadavres d’enfants qui « semblent simplement endormis » ;
- il partage « l’ascenseur émotionnel » des parents qui découvrent que leur enfant n’est pas le cadavre qu’on leur présente… mais qui déchantent quand on leur en présente un autre ;
- il reconnaît que la carapace qui lui permet d’exercer son boulot ne l’empêche pas de « transférer [sa] peine immense sur [sa] propre vie » de parent, y compris dans la gestion des rideaux (les lecteurs du livre comprendront pourquoi à la fin du chapitre concerné).
C’est bien le rapport aux corps morts et non le rapport à la mort qui
- interroge,
- construit et
- défie
les témoins. Le chapitre sur le « four crématoire géant » qu’est devenu le tunnel du Mont-Blanc, le 24 mars 1999, le confirme. Le témoin dépeint son rapport aux corps, c’est-à-dire
- à son propre corps (qu’évoque le besoin de manger en attendant l’autorisation d’intervenir),
- aux corps morts (« inutile de prendre des cercueils et des housses mortuaires »), et
- au traitement des cadavres, ici métonymisés par des cartons contenant « des mâchoires, des dents, des crânes » lesquels seront intégrés à des cercueils standards pour sauver les apparences, comme on l’a vu dans une chronique précédente.
Le témoin qui va récupérer à Villacoublay le corps d’un soldat mort en opex pour le ramener au funérarium des Batignolles parle, lui aussi, du rapport au corps
- en bombardant les thanatopracteurs au rang « orfèvres de la mort »,
- en racontant la dépossession de la famille, un temps privée du cadavre pour que l’armée et la nation jouent leur comédie des hommages,
- en effleurant la part spéculaire de ces corps qui nous renvoient à notre « conception de la vie », c’est-à-dire à notre manière de donner du sens à ce qui n’en a pas – en l’espèce, la mort.
On regrette que Charles Guyard ne saisisse pas les perches qui auraient permis à certains témoignages d’aller plus loin. Typiquement, ici, le témoin explique que, à force de fréquenter des familles de soldats défunts, « on n’a plus la même conception de la vie » : c’était un boulevard pour creuser cette question avec lui et passer d’une formule vague ou creuse à une réflexion plus poussée. Peut-être l’auteur a-t-il préféré éviter de dépareiller ses entretiens… hypothèse qui ne fait qu’accentuer notre regret ! Sans doute faut-il accepter son choix d’entretiens peu directifs, laissant la place à la spontanéité, fût-elle frustrante.
Néanmoins, ce n’est pas la spontanéité qui frappe dans le dernier chapitre, où « le patron d’un réseau national » de pompes funèbres « raconte l’enfer de la pandémie vu depuis les chambres mortuaires ». Pas parce que le chapitre est gauche mais parce qu’il s’ouvre sur un courriel secret, annonçant le premier mort (chinois) du virus en France alors que, « à cet instant, l’Hexagone est officiellement épargné ». Entre
- ignorance,
- silences et
- mensonges,
les informations manquent sur ce que des franchisés appellent « Bagdad » tant pleuvent les cadavres. Les bras viennent à manquer. Les patrons de pompes tremblent à l’idée qu’on leur colle un procès si un employé meurt du Covid après avoir manipulé un malade décédé, d’autant que les équipements de protection manquent. Les pompes funèbres apprennent à
- hiérarchiser leurs interlocuteurs pour gérer les manques (le maire l’emporte alors sur le préfet),
- jongler avec des normes
- improbables,
- éphémères et
- souvent contradictoires, ainsi qu’à
- accepter l’invisibilisation de leur travail, notamment en comparaison avec celui des soignants.
Gérer les cadavres est un métier. On ne le connaît pas vraiment mieux à l’issue de cette myriade de récits, mais tel n’était pas le propos. Celui-ci semblait consister
- à interroger plutôt qu’à définir,
- à laisser résonner plutôt qu’à délimiter,
- à évoquer des fragments de réel plutôt qu’à se perdre en
- philosophie,
- métaphysique et
- autres manières plus ou moins spirituelles d’appréhender notre mort prochaine et celle de nos plus ou moins proches.
Pour aller plus loin sur l’autre versant du sujet, on pourra feuilleter ceci.

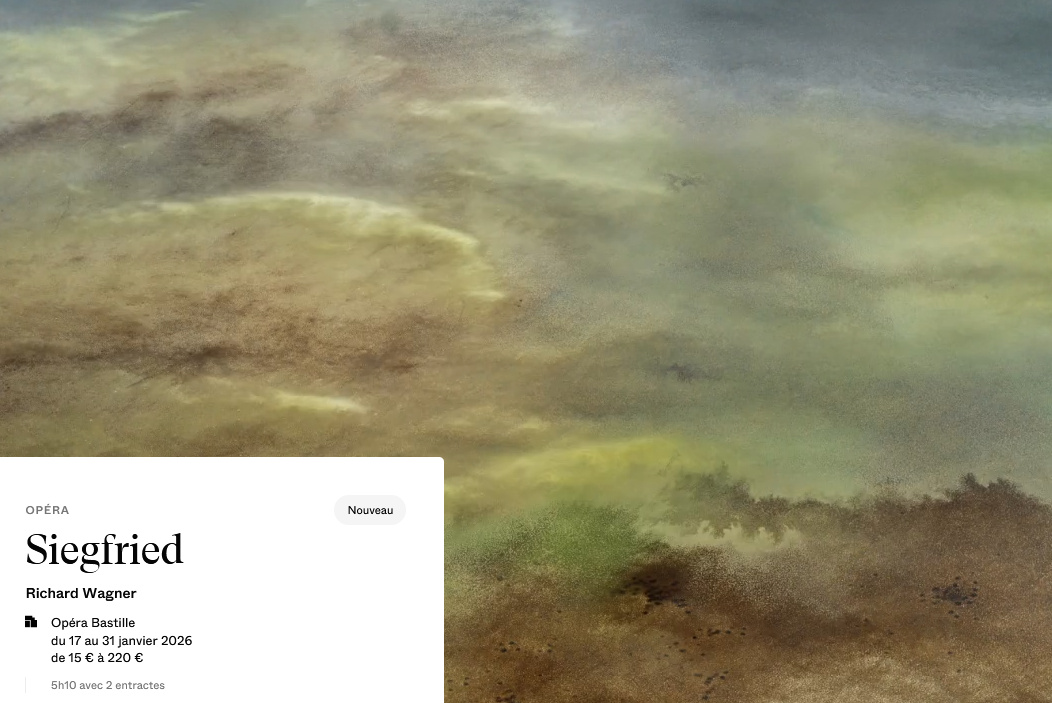


















































![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)