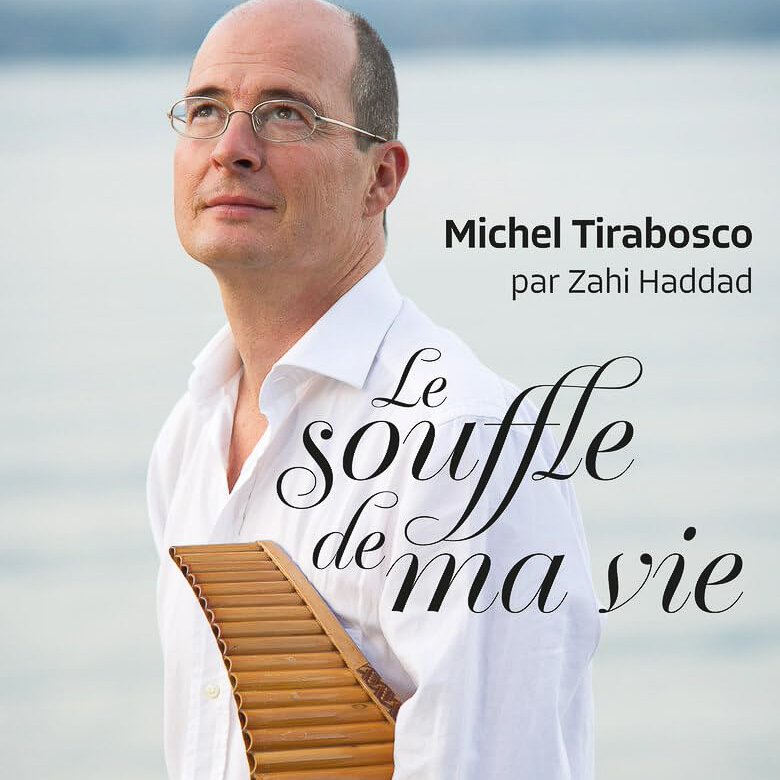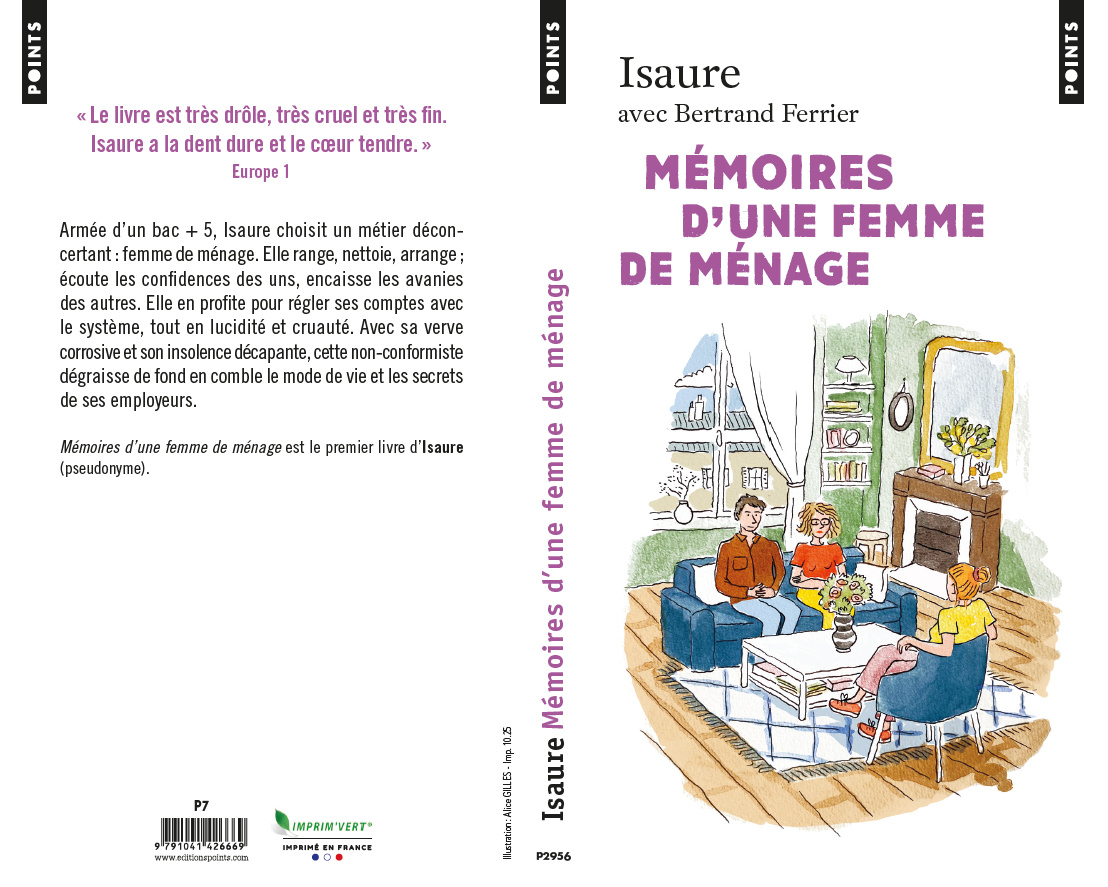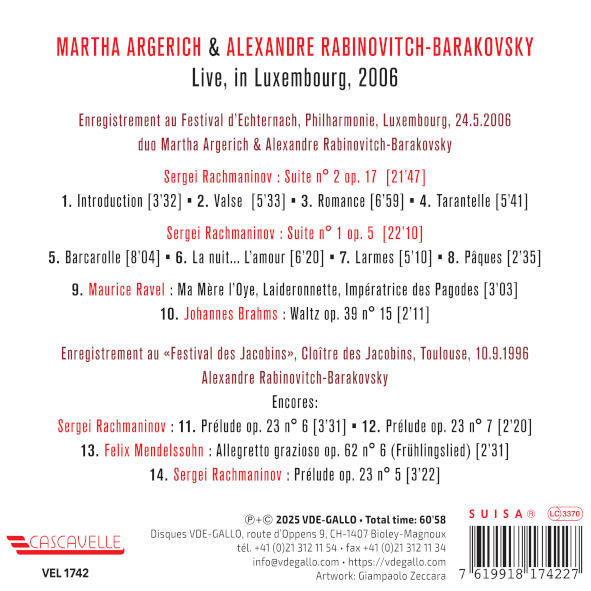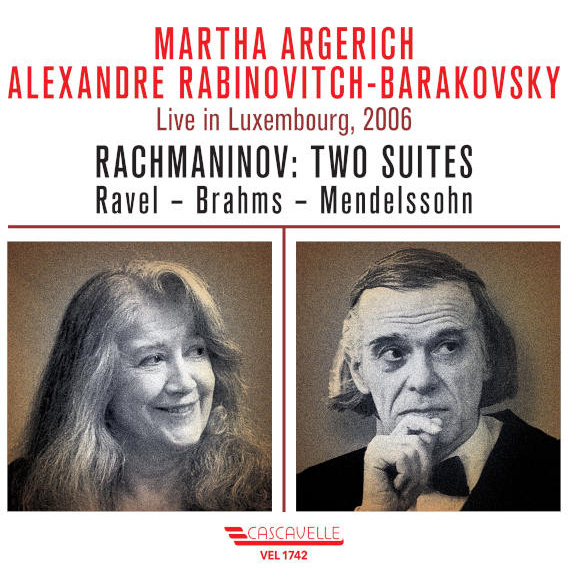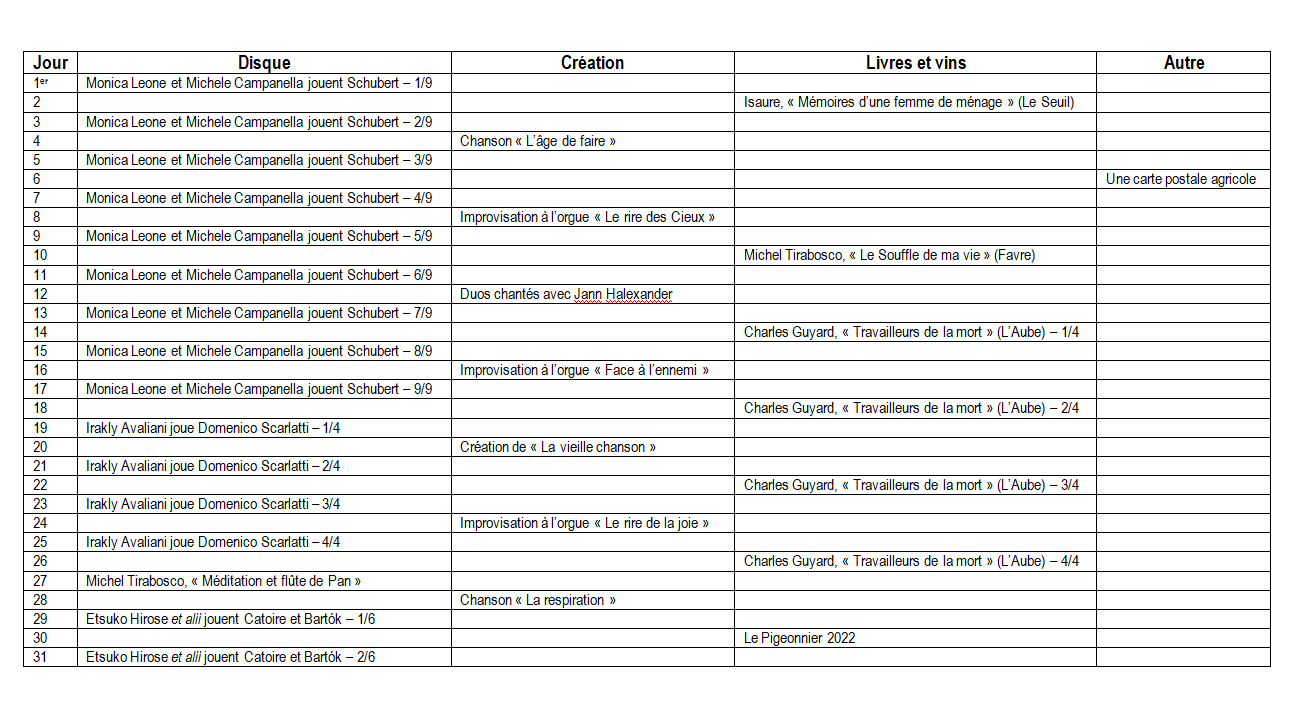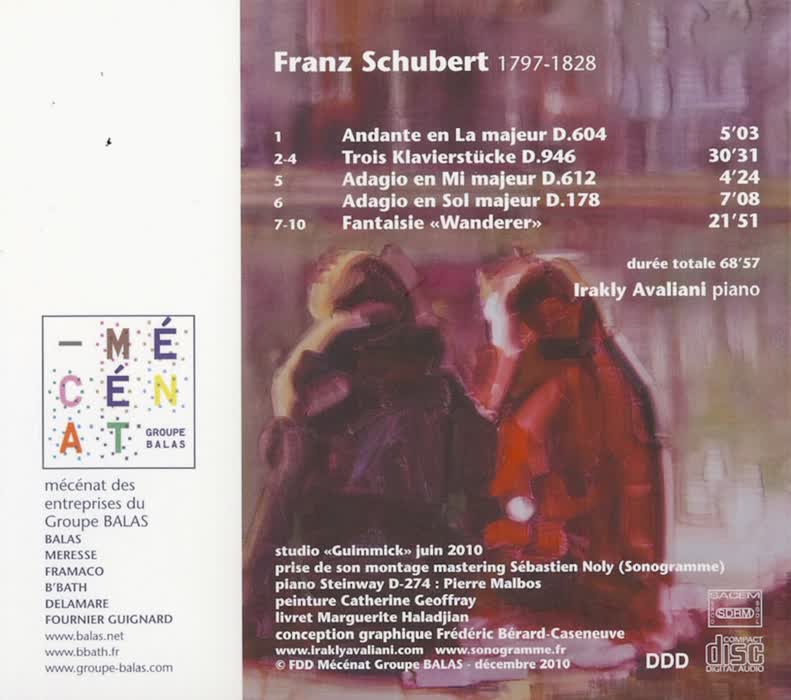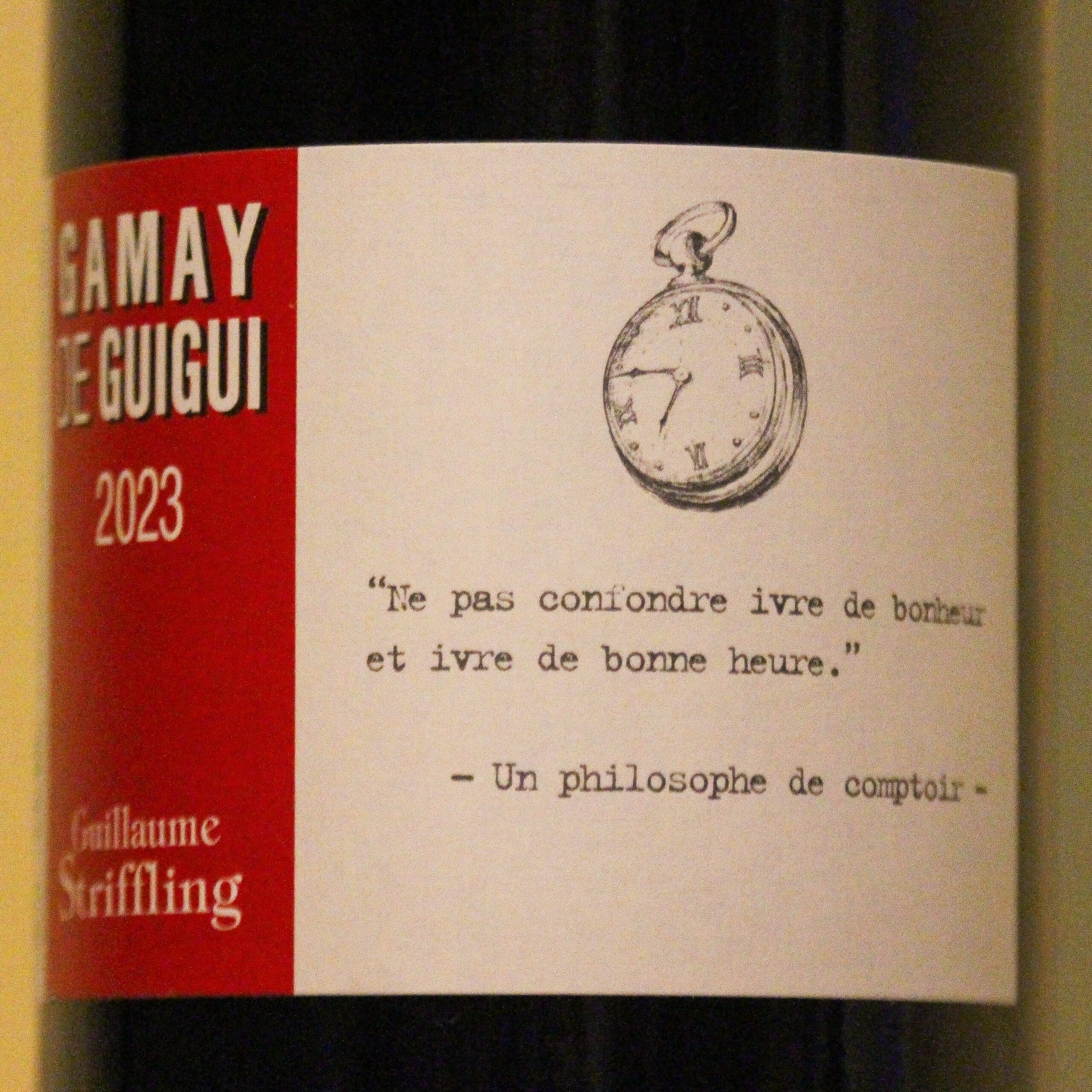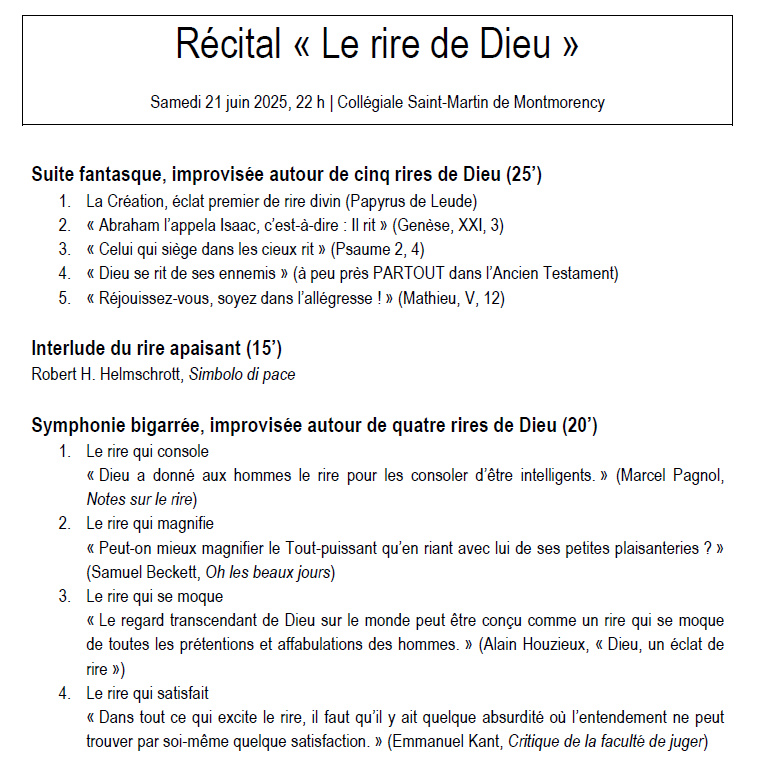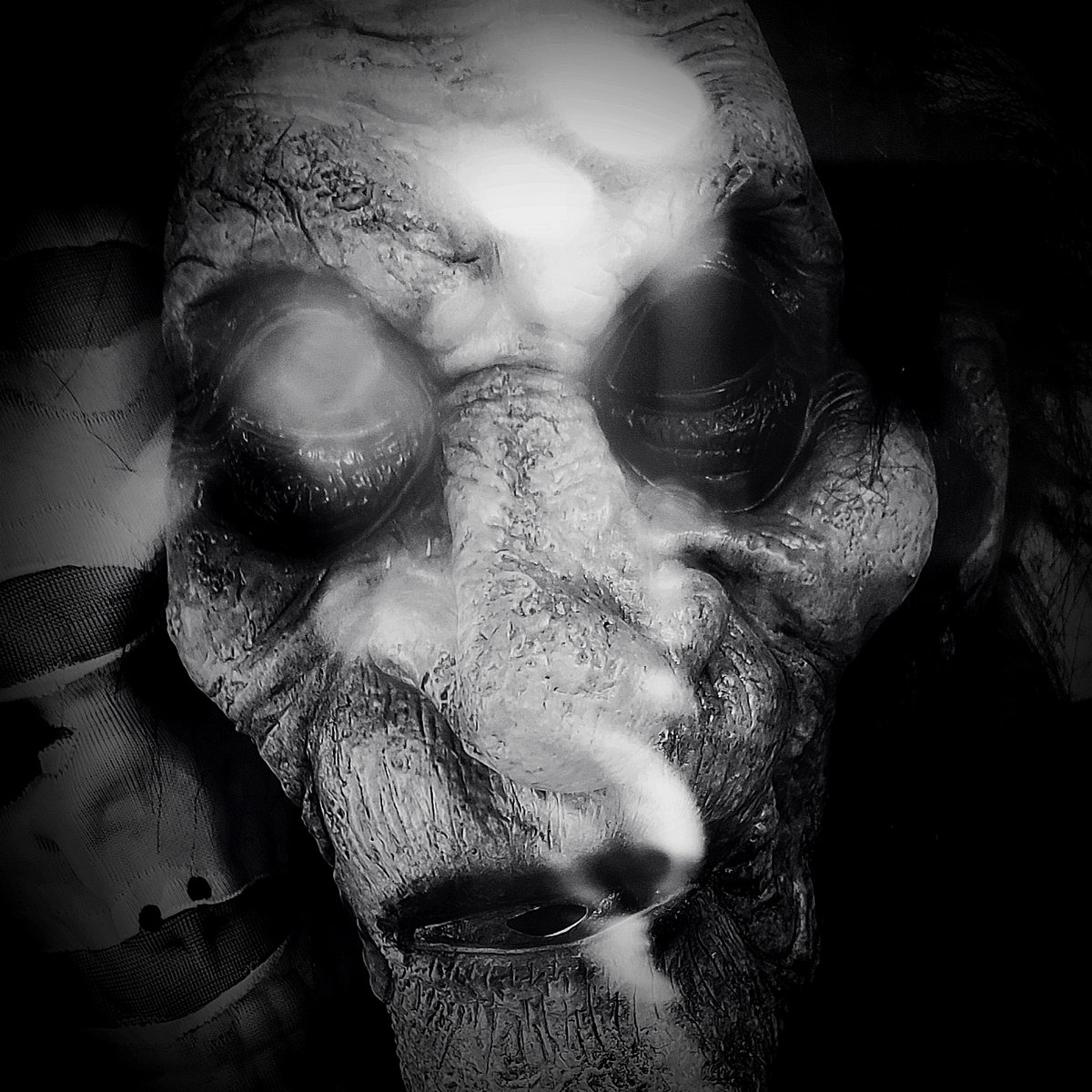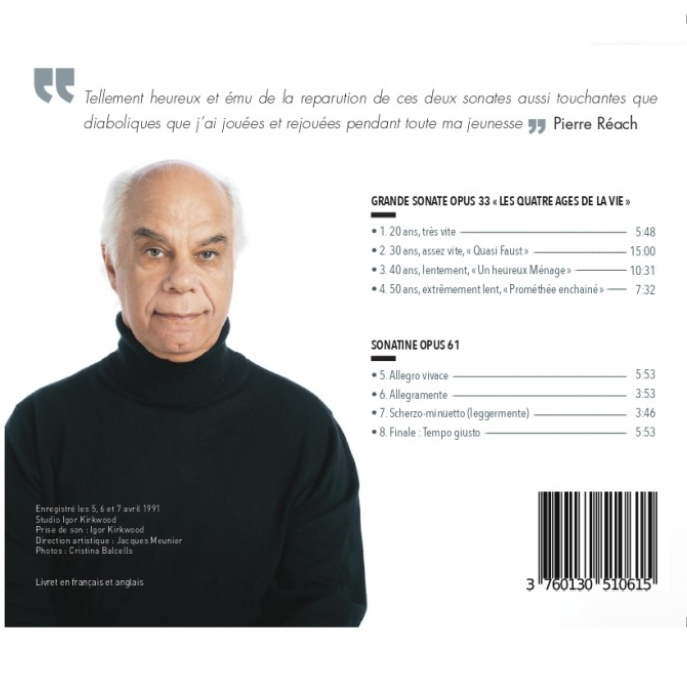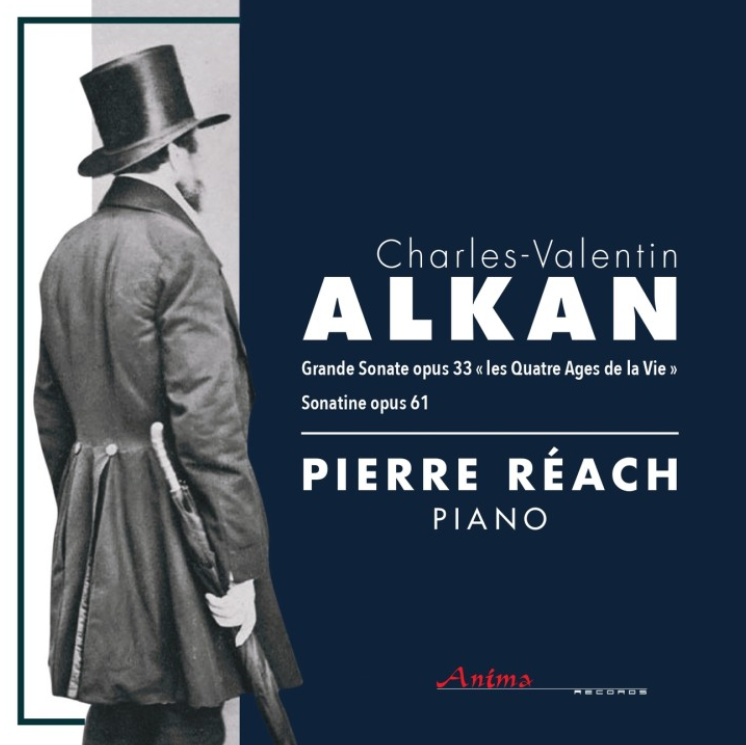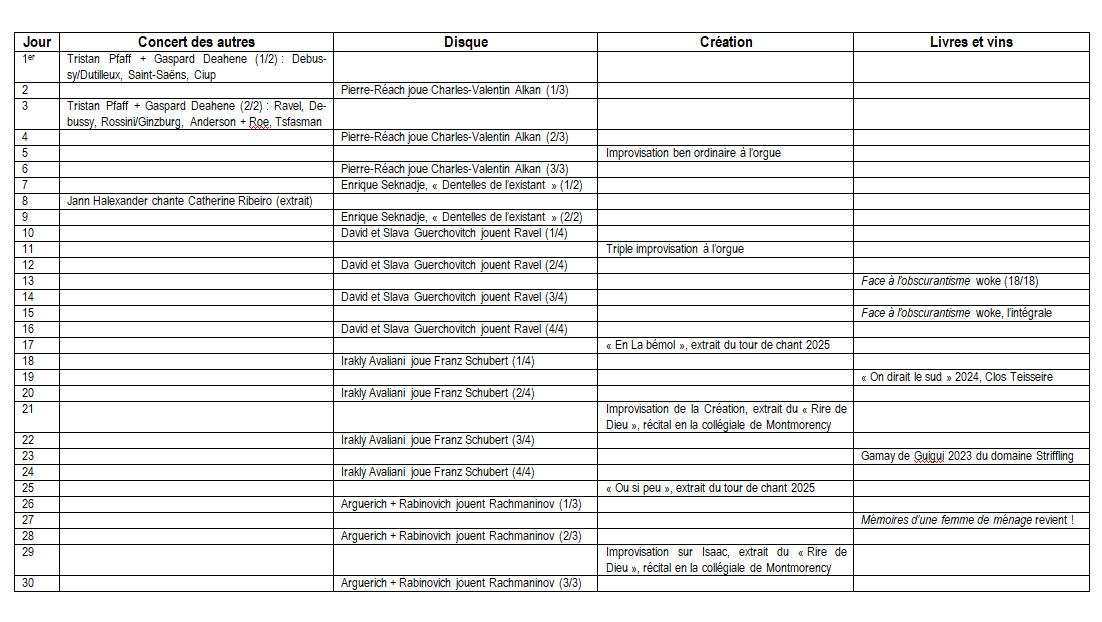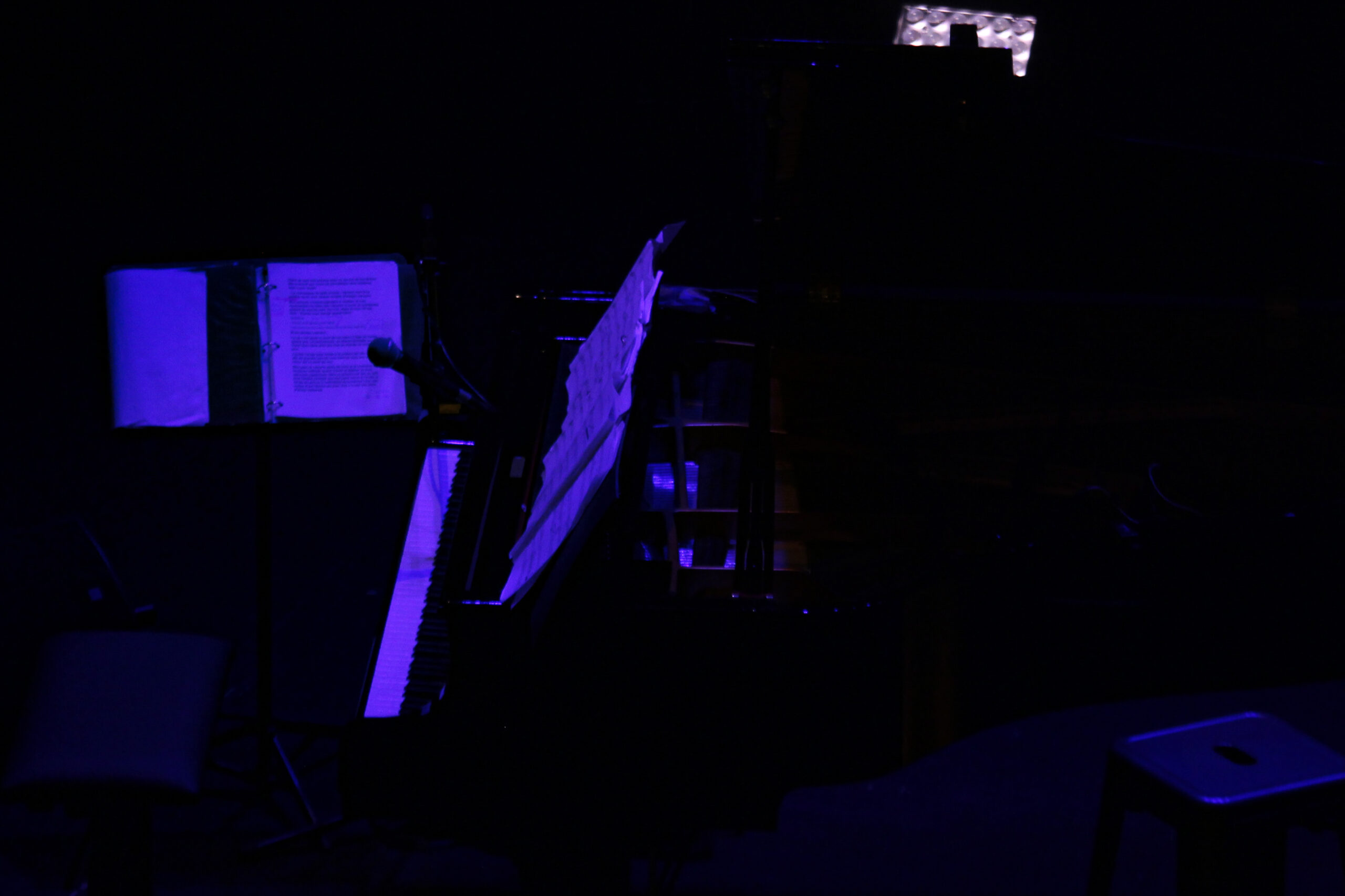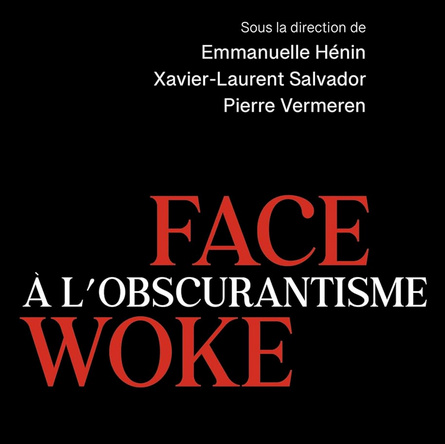
Le wokisme n’est pas qu’un prisme sociopolitique, c’est aussi une hiérarchie culturelle qui détermine l’intérêt d’un objet – artistique mais pas que – en fonction de sa wokocompatibilité. L’illustre, à titre d’exemple, la dernière page du Monde des livres du 20 juin 2025, consacrée au Pain des Français de Xavier Le Clerc, né Hamid Aït-Taleb – quelques pages plus tôt, on avait pu se déconstruire notamment grâce à l’évocation d’une Histoire (dé)coloniale de la philosophie française, parue aux PUF comme pour expier Face à l’obscurantisme woke, l’ouvrage collectif publié sous la direction d’Emmanuelle Hénin et alii.
Si l’utilisation d’un pseudonyme n’a rien de woke en soi, elle s’inscrit ici dans une logique de transidentité dont la suite de l’histoire va révéler les tenants et les aboutissants. Première thématique chère au wokisme : l’identité n’existe pas, dans la mesure où elle est centrée sur l’image du Blanc cisgenre, étalon qu’il est urgent de déconstruire. Le Pain des Français s’intéresse aux « plaies laissées par la colonisation ». Deuxième connexion avec la wokocompatibilité : la dénonciation des travers de la colonisation. L’auteur explique que, pour lui, la langue est une « manière de renverser le jeu de la domination ». Troisième item wokocompatible : la revendication d’une auto-victimisation, fondée ou non, considérant que j’appartiens à une communauté dominée par un système post-colonial, raciste ou mysogine ou transphobe ou tout cela à la fois. L’auteur explique son succès dans les ressources humaines du luxe par son changement de nom : en devenant Xavier Le Clerc, Hamid Aït-Taïeb a pu « mettre un terme à la soumission et au rejet auxquels mes origines [l]’assignaient ». Quatrième posture wokocompatible : la désignation des bourreaux, les Blancs, ces racistes systémiques, selon l’idiolecte woke.
Xavier-Hamid a aussi souffert d’un « coming-out douloureux » quand il est sorti « du placard » en affichant son homosexualité. Cinquième point wokocompatible : le problème est le mâle blanc hétérosexuel, homophobe par définition. L’auteur raconte avoir été rabroué par un boulanger qui « refuse de servir le pain des Français aux bougnoules ». Sixième point wokocompatible : pour un wokoconvaincu, il existe une part de racisme inconscient dont le racisme explicite est la partie émergée. Enfin, Xavier-Hamid est « de nationalité algérienne, française et britannique », ce qui est un septième point wokocompatible : il n’y a pas d’identité nationale, le récit mondialiste doit remplacer le narratif centré sur un pays en posant que chacun est, par essence, citoyen du monde. Avec de tels atouts, Xavier Le Clerc ne peut être qu’une égérie des critiques wokosensibles puisque « chaque étape de sa vie est une démarche d’émancipation (…) de toutes les injonctions identitaires et de toutes les discriminations », explique Virginie François.
Or, le wokisme suppose l’effacement des identités individuelle et collective au profit d’une identité communautaire. Dès lors, son examen doit passer par l’étude d’identités communautaires. Aussi Tarik Yidiz se propose-t-il d’enquêter sur les liens entre « identité, délinquance et radicalisme islamiste » en partant d’un double principe : l’islamisme radical
- prospère sur le « vide idéologique et identitaire », et
- se développe dans « une forme de continuum avec la petite délinquance ».
Depuis les années 1960, observe le sociologue, la fatalité de la tradition familiale est devenue relative : « Le fils du cordonnier n’est plus forcément celui qui deviendra lui-même cordonnier. » En conséquence, « ma place n’étant plus établie, je dois me construire ». Le projet peut être éreintant, voire susciter un « épuisement à devenir soi-même » susceptible de « trouver une réponse avec le fait religieux ».
Face à ce problème, le takfirisme peut être une solution puisque, comme la scientologie, ce courant de l’islam se veut « totalisant », avec « une réponse à chaque question pouvant se poser dans la vie quotidienne ». Face au désenchantement du monde webérien se profilerait ainsi une restructuration de soi par l’ultrareligiosité comme antidote au « vide idéologique et à la liberté individuelle ». Dans les faits,
la manière de vivre sa religion constitue une modalité d’action qui se structure dans le rapport à une société en constante évolution.
L’islam confirme le rôle de la religion comme « régulateur social ». Aux ex-petits délinquants, sa version rigoriste, exclusiviste voire, à l’extrémité de l’extrême, djihadiste, donne parfois l’illusion de constituer une structure solide pour construire une « contre-société, plus pure, loin des déviances mécréantes ». La voie peut paraître « valorisante pour des individus sans repères ». Certes, « tous les individus se réclamant » d’une telle obédience « ne basculent pas dans le terrorisme », mais « l’inverse se vérifie quasiment systématiquement ».
Au final, l’article de Tarik Yidiz ne parle absolument pas du wokisme, à moins que l’on ne considère l’évocation sommaire du rôle de l’islam (pourquoi juste l’islam ?) dans notre société comme un exemple communautariste – et encore, il est ici peu question de communauté. Sans doute ce papier peut-il être perçu comme un nouvel exemple du manque de cohérence dont pâtit la direction de cet ouvrage collectif. L’ouvrage chapeauté par Emmanuelle Hénin et alii semble se perdre loin du sujet qu’il est censé traiter. Dans une prochaine notule, nous vérifierons si nos craintes sont fondées avec l’article de Florence Bergeaud-Blackler sur « le voilement ». À suivre !



















![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)