
Après une sonate de Mozart, Herbert du Plessis se lance à l’assaut d’une montagne d’épouvante : les douze études op. 25 de Frédéric Chopin. Redoutable concentré de divers défis virtuoses, le cycle est auréolé du trend Google à son sujet : la question la plus récurrente à son sujet est de savoir quelle est, parmi les douze, la plus difficile. La favorite est la sixième, bien qu’elle dispute son classement avec la première de l’opus 10, qui fichait les chocottes à Vladimir Horowitz. Entre « Harpe éolienne » et « Petit berger », selon les étiqueteurs, l’étude en La bémol, première du second cahier, se signale par des rythmes fouillés et un allant aguicheur. Elle est ici marquée par
- la ductilité du propos,
- la souplesse des petites saucisses, et
- la capacité à faire sonner l’aigu sans gommer le bouillonnement quasi magmatique :
puissant ! La deuxième étude, en fa mineur, a droit à ses deux étiquettes contradictoires, « Les abeilles » ou « Le baume », aussi apocryphes l’une que l’autre. Le résultat de ce qui est censé être « doux comme la chanson d’un enfant endormi » ne manque pas d’attrait, ce soir-là :
- les doigts courent,
- la mélodie sonne grâce à une pédalisation savante, et
- le rythme tournoie avec swing.
La troisième étude, en Fa, dite « Le cavalier », ne lui cède en rien : comme si ce galop était chose simple,
- ça saute,
- ça file,
- ça cabriole,
- ça rebondit.
Semblant presque insouciant de la technicité de la chose, Herbert du Plessis installe une électricité qui transforme la pyrotechnie en musique si bien que, plus encore que la maîtrise des difficultés, c’est bien la capacité à chercher l’essence artistique de chaque proposition qui aiguise l’admiration et l’appétit de l’auditeur. Ça ne s’arrange pas avec la quatrième étude, transformée en triple éloge
- de la tonicité,
- de la nuance et
- de l’art du toucher
- (attaque,
- phrasé,
- différenciations).
La cinquième étude, dite de « La fausse note », dans sa forme majestueuse en ABA, persiste à vouloir transformer
- la performance en geste artistique,
- l’unité en multiplicité,
- l’évident en surprenant – tierce picarde finale incluse.
Sorte de tierce en taille avec la mélodie à la senestre, la flippante sixième étude dite « En tierces » se révèle
- aérienne dans les aigus,
- souple dans les modulations,
- vigoureuse par sa gestion de l’agogique et
- intraitable dans son beat incroyablement inarrêtable.
Plus méditative, la septième étude, en ut dièse mineur, dite « Au violoncelle » par ceux qui l’appellent ainsi, déploie un langage plus
- méditatif,
- polyphonique,
- lyrique
qu’alimente une main gauche
- solide,
- polychrome et
- tentée, l’affriolante coquine, par la poésie.
La huitième étude substitue des sixtes aux tierces de la sixième. Loin de survoler la partition en vieux routard de Chopin, Herbert du Plessis s’y donne sans mignarder, entre
- cavalcade et saccade,
- travail de rythme et d’intensités (vertigineux crescendi–decrescendi),
- exploration des couleurs des différents registres – même si l’instrument du soir paraît parfois moins éblouissant qu’on l’eût rêvé – et obsession du thème.
La neuvième étude, dite « Le papillon », est le tube du recueil. Le musicien en fait cliqueter
- la légèreté,
- l’énergie et, osons le terme,
- la pétillance voire le pétillisme (et allez donc, c’est pas mon père !).
La dixième étude en si mineur, dite « Aux octaves », développe les joies sauvages
- du grondement,
- de la percussion,
- des fortissimi mais aussi
- de la suspension exigée par la forme ABA.
C’en est trop pour le public qui bat des mains à tout rompre. Avec métier, Herbert du Plessis en prend acte avant d’attaquer la onzième étude en la mineur, dite « Le vent d’hiver » où il offre une leçon
- d’agilité
- (doigts,
- poignets,
- pédalisation),
- de narration par la nuance ainsi que
- d’un mélange
- de gourmandise,
- de maîtrise et
- d’abandon devant l’abondance de notes.
Dans la douzième étude en ut mineur dite « L’océan », le clavier
- ondule,
- tempête,
- déborde et
- parvient néanmoins à ciseler une mélodie grave qui résonne avec une beauté singulière.
Ces études sonnent moins comme une interprétation louable que comme les confidences (sportives) d’un long compagnonnage entre un musicien d’exception et un répertoire foufou. Herbert du Plessis parvient à distiller de l’intime dans l’extraversion, du subtil dans le mécanique, de la distance dans l’immédiateté impossible de la partition. De quoi préparer dignement l’écouter des deux nocturnes de Gabriel Fauré qui feront l’objet de la prochaine recension du même concert !


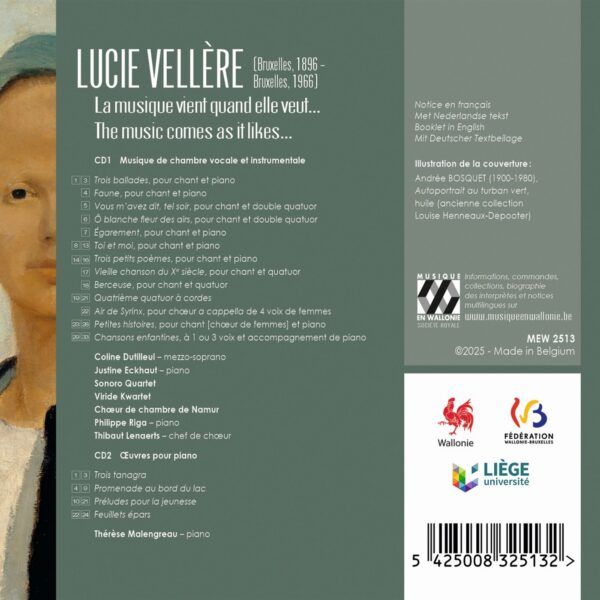

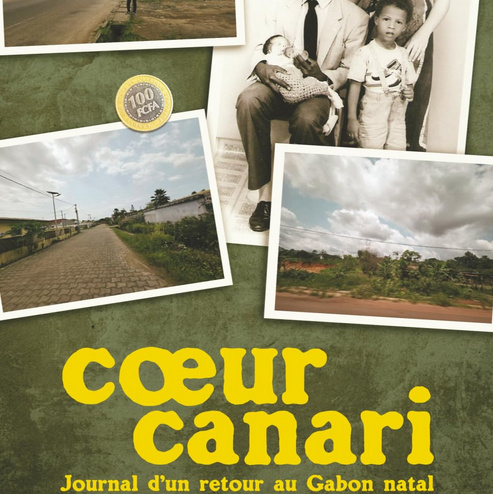


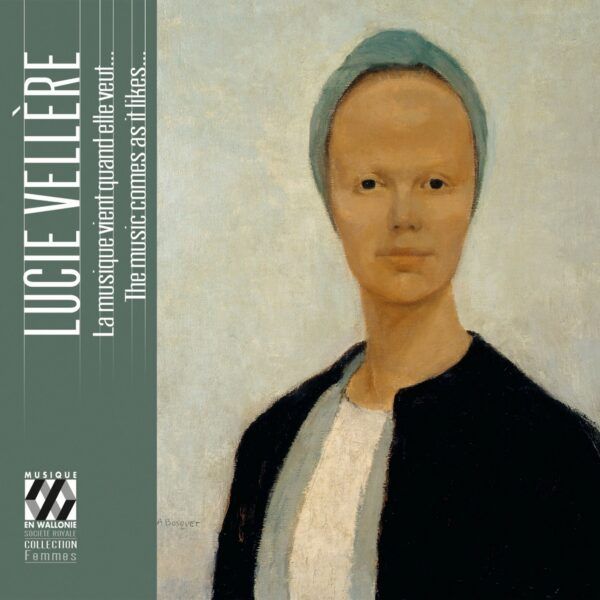
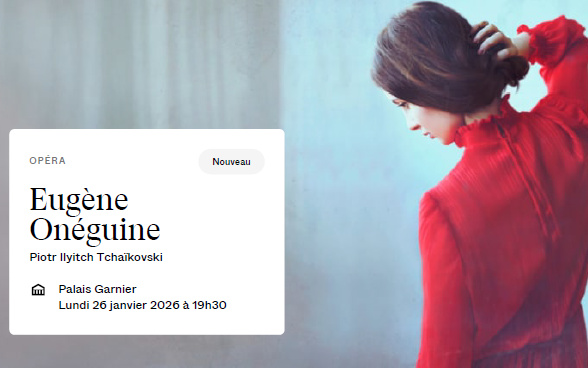
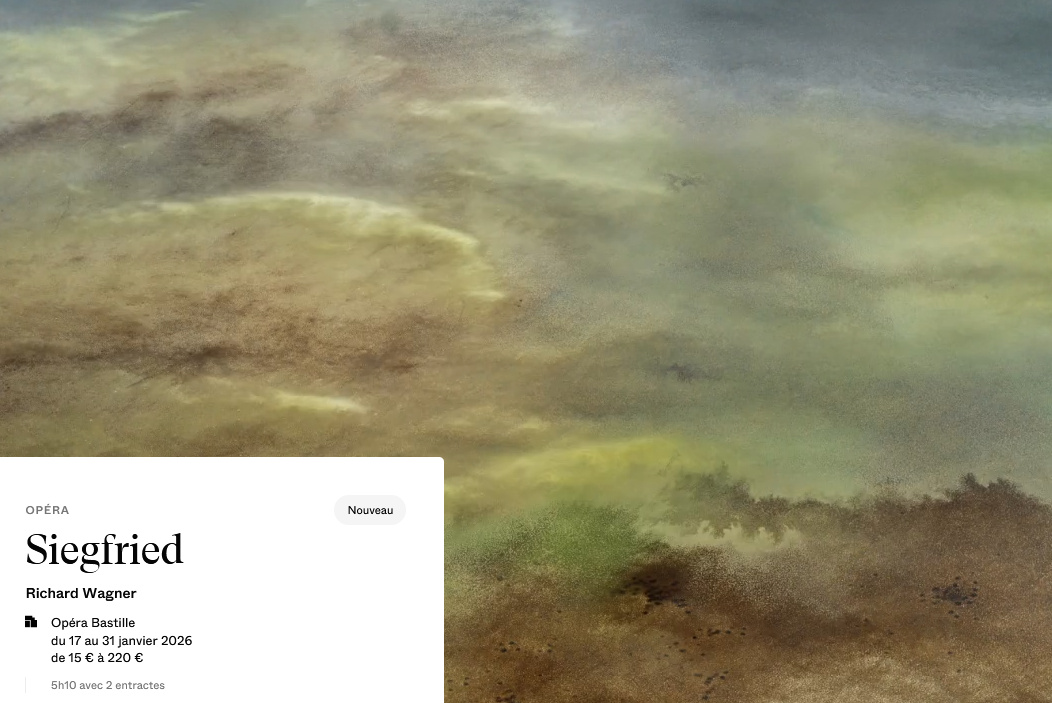


















































![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)




