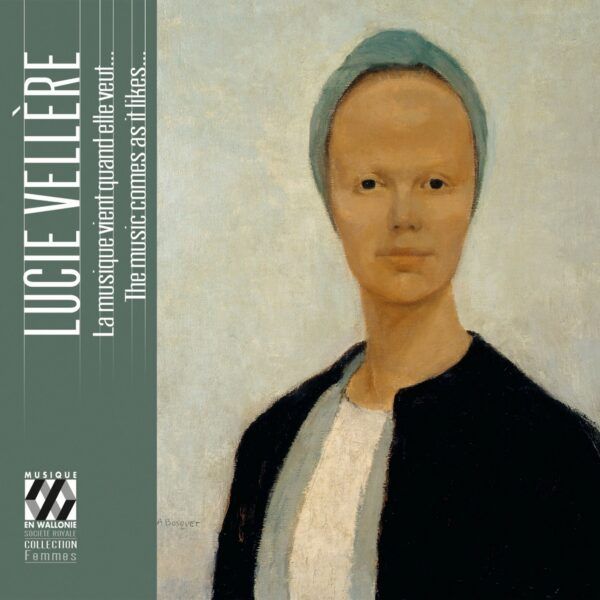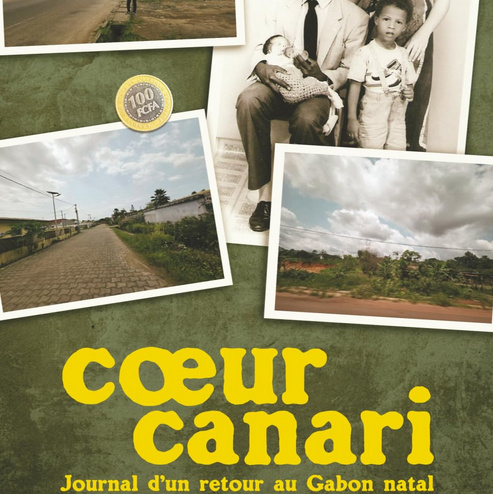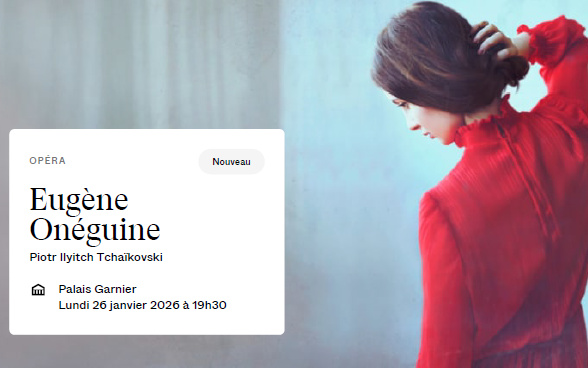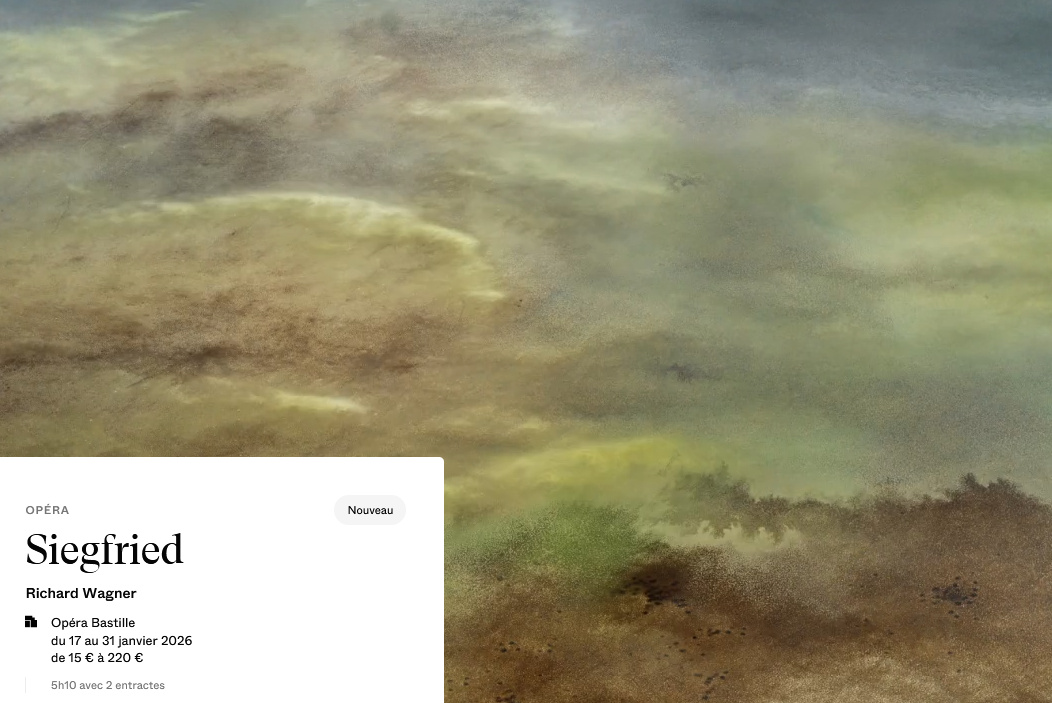Après sa phase gling-gling (pas bling-bling : gling-gling) et glang-glang, avec ou sans « accompagneurs » comme il les nommait mais ponctuée d’albums aussi rares que captivants et de prestations piquantes, Jean Dubois a entamé une phase ploum-ploum et zinzin, rythmée par des concerts où l’évidence de la chanson percutante se métisse d’une profonde recherche artistique. Même s’il revendique « ne plus avoir envie de chanter », il
- travaille,
- malaxe et
- sculpte
avec une obstination féconde la tension entre fredonnerie façon Rive gauche et moments instrumentaux. C’est d’ailleurs par un mélange des deux qu’il s’élance, costume cravate, dans un remix de « Rendez-vous à Izmir », chanson dont il a gommé de longue date les paroles initiales en imaginant, un jour donc sans doute jamais, en écrire d’autres qui lui conviendraient mieux (on trouve trace de la première version ici). Piano en pogne et harmonica en gueule, il claque ensuite la première mazurka de la soirée, articulant de façon classique et cependant très duboisienne les modes majeur et mineur.
Conscient qu’au PIC, on attend malgré tout d’un chanteur qu’il chante, l’artiste prend la parole en murmurant : « Bon, puisqu’il semblerait que je doiv’ m’exprimer… / Hum hum, est-c’ que ça passe dans le microphone ? » Derrière la boutade propulsant la première chanson complète du spectacle, se niche voire se love une triple interrogation sincère et perpétuelle que chérit Jean Dubois :
- qu’est-ce que je parviens à dire aux autres
- en chantant,
- en jouant ou, simplement,
- en échangeant avec eux ?
- qu’est-ce que j’ai envie
- de dire,
- de sous-entendre,
- de taire ? et
- qu’est-ce que l’autre peut entendre de mon galimatias polymorphe,
- évident pour moi,
- potentiellement plus nébuleux pour l’autre voire, pire qu’incompréhensible,
- source, au sens propre, de graves malentendus ?
Voilà l’une des forces du parolier : ménager
- de la profondeur sous l’apparente superficialité,
- de l’intime dans l’humoristique,
- du grave dans la légèreté.
En associant
- texte,
- mélodie,
- harmonie et
- interprétation,
l’homme veut croire que, « si tout n’est pas parlé, y a des gestes qui disent » d’où, peut-être, son goût pour les danses, au premier rang desquelles la mazurka, inclination autobiographique mais aussi source d’inspiration artistique, à supposer que les deux soient toujours aisées à distinguer. Au fond, interroge le saltimbanque,
- que donne-t-on vraiment quand on « se donne » en spectacle ?
- qui regarde qui ?
- qui amuse qui ?
- qu’est-ce qui se joue dans cet échange pas si silencieux que ça – surtout dans manière de cabaret – entre scène et salle ?
Prise dans ce questionnement, la chanson de Jean Dubois implique souvent un interlocuteur dans sa ronde,
- qu’il écrive une lettre à une mystérieuse anonyme ou à des correspondants familiers inquiets de n’avoir plus de ses nouvelles épistolaires,
- qu’il s’adresse aux spectateurs ou à un cercle d’amis en les incitant à se monétiser encore davantage, ou
- qu’il espère à la brune, comme dans la chanson suivante, particulièrement poignante, « que tout le monde va bien ».
Le guitariste est alors absorbé par le pianiste, mieux : par le musicien. Sur le quart de queue de la maison, il crée un accompagnement
- atmosphérique d’abord,
- impressionniste ensuite pour évoquer ce « couple occupé à compter les feuilles » (où les aficionados voient le prolongement des fiancés qui, dans « Les rues sont à tout l’monde », comptent « les cadeaux qu’on va leur offrir »),
- dynamique enfin.
Ce n’est pas seulement maîtrisé : mieux, c’est senti et malin. Toujours à la recherche de la bonne voie – qui ne doit pas être unique – pour dire et se dire, Jean Dubois propulse sa carcasse au centre de la scène pour y dire « un poème de saison ». En l’espèce, le locavore a déniché « Automne malade », extrait d’Alcools et récit d’une double désolation : comme nous, l’automne va mourir ; et c’est beau. Point d’amollissement nunuche pour autant ! Aussitôt après avoir constaté que, feuilles qu’on foule, train qui roule, « la vie s’écoule », le clown ténébreux, armé de son harmonica, décide de nous initier à la mazurka. Nous en retenons la leçon suivante : « Pour danser, l’important, c’est quand ça ne touche pas terre. » Peut-être pour la vie aussi ? L’artiste le suggère en chantant « La mazurka », un éloge ternaire
- à la drague dansante,
- à l’ironie chorégraphiée, et
- à la prise de conscience légère de ce qu’est la vie : être, avec l’autre, sur un même plancher.
Celui qui se revendique « plutôt pianeux que pianiste » et annonce vouloir jouer « du piano diatonique mais, comme ça n’existe pas, je vais jouer du piano dans l’esprit diatonique » claque « Dupe d’une jupe » où il remet
- les pendules à l’heure,
- l’église au milieu du village et
- les choses au clair :
le textile n’est pas sa passion. Non, lui, quand il se passionne pour un vêtement, c’est qu’il y a quelqu’un dedans. Comme quoi, même dans son monde, l’artiste est des nôtres, et peut-être réciproquement. (Non, ça ne veut rien dire mais, sur le moment, j’avais l’impression que si, alors je tente.) À suivre !