
Derrière le nom bien français de Georges Catoire se cache en réalité Georgi Lvovitch Catoire, wagnérophile de la première heure et mathématicien devenu professeur de composition au conservatoire de Moscou. Plus chanceux que Béla Bartók sur ce disque, puisque le label Continuo n’a pas eu l’inélégance de souiller son patronyme (le quatuor Élysée devient itou le quatuor Elysée, dans un étonnant laisser-aller éditorial, comme si apposer un accent coûtait trop cher…), il ne bénéficie cependant pas d’une gloire posthume à la mesure du compositeur avec lequel il partage la set-list de ce disque où le quatuor Élysée convie Estuko Hirose pour coupler deux imposants quintettes pour piano et cordes. Comme il a été dit : « Il avait un défaut, celui de ne pas savoir se mettre en avant. » Et pourtant…
C’est en 1921 que Georges Catoire a terminé son quintette op. 28 en sol mineur, lequel s’ouvre par un allegro moderato en 3/4 officiellement, mais plutôt en 9/8 puisqu’au ternaire de la mesure s’ajoute celui de la main droite qui égrène trois croches par temps. D’emblée, le compositeur crée une tension entre l’énoncé à trois triolets par mesure et un accompagnement binaire privilégiant le contretemps.
Abstrait, ce galimatias ? Au contraire, très concret car c’est de ces frictions que jaillissent les escarbilles animant cet incipit jusqu’à un grand crescendo qui se résorbe peu à peu, passant du plein souffle des cinq instruments à un dialogue entre le violoncelle d’Igor Kiritchenko (croisé tantôt avec Jasmina Kulaglich) et le piano d’Etsuko Hirose.
- Des harmonies changeantes,
- des rôles qui s’interpolent, et
- des changements de mesure
caractérisent une musique où l’élégance n’est jamais éloignée du mystère. Georges Catoire joue avec les miroitements de son quintette.
- Différenciation des pupitres,
- éviction du piano,
- piano solo,
point de doute : d’emblée, Georges Catoire marque sa maîtrise de l’instrumentarium. L’écriture est assez habile pour faire du piano d’Etsuko Hirose le pivot de la narration. Sa rythmique
- sensible,
- labile et
- rigoureuse
galvanise le propos.
Des effets
- d’écho,
- de contamination et
- de contraste
entre pupitres font circuler le propos autour d’un motif familier que le piano semble expliciter en le rapprochant du « Dies irae » (4’15). Les cinq compères excellent à faire gonfler puis dégonfler les bulles d’émotion. Grâce à leur aisance technique
- (confondants suraigus de Vadim Tchijik,
- précision rythmique de Pablo Schatzman,
- ampleur et chaleur de l’alto d’Andrei Malakhov,
- vigueur et caractérisation des registres du violoncelle d’Igor Kiritchenko,
- capacité à être lead et à accompagner avec la même rigueur imaginative d’Etsuko Hirose sur son Steinway D)
et leur évident désir de jouer avec expression et dans une belle cohérence de son et d’intentions,
- les emportements emportent,
- les decrescendi sont subtilement agencés,
- les fortissimi savent sonner sans jamais confondre puissance et bruit.
Ainsi les interprètes offrent-ils une vision très animée de la partition tout en donnant une sensation d’intensité et de cohérence libre, sinon de logique, dans l’agencement des humeurs.
- La richesse rythmique sait s’abstraire de la confusion ;
- la richesse harmonique sait aguicher sans virer au clinquant ;
- la richesse des nuances (superbe finale pianissimo) sait capter l’attention sans verser dans l’histrionisme.
Bref, on se régale et l’on s’ébaubit. À suivre !
Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.
Pour l’écouter gracieusement en intégrale, c’est là.
Pour retrouver Etsuko Hirose en entretien, c’est ici.
Pour retrouver la chronique de Schéhérazade by Etsuko Hirose, c’est ici, re-ici et là.

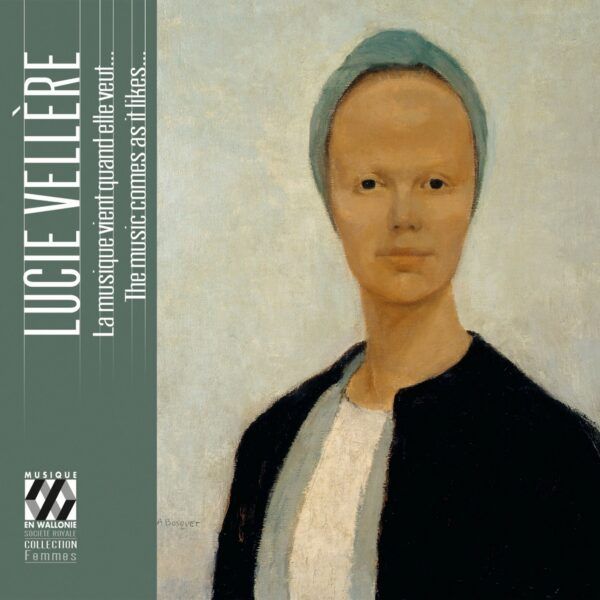

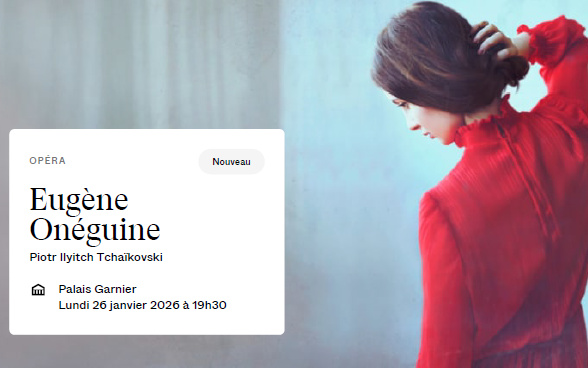
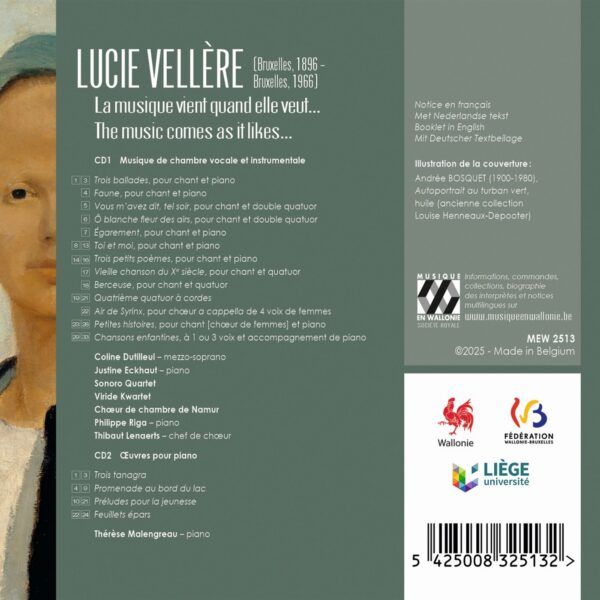
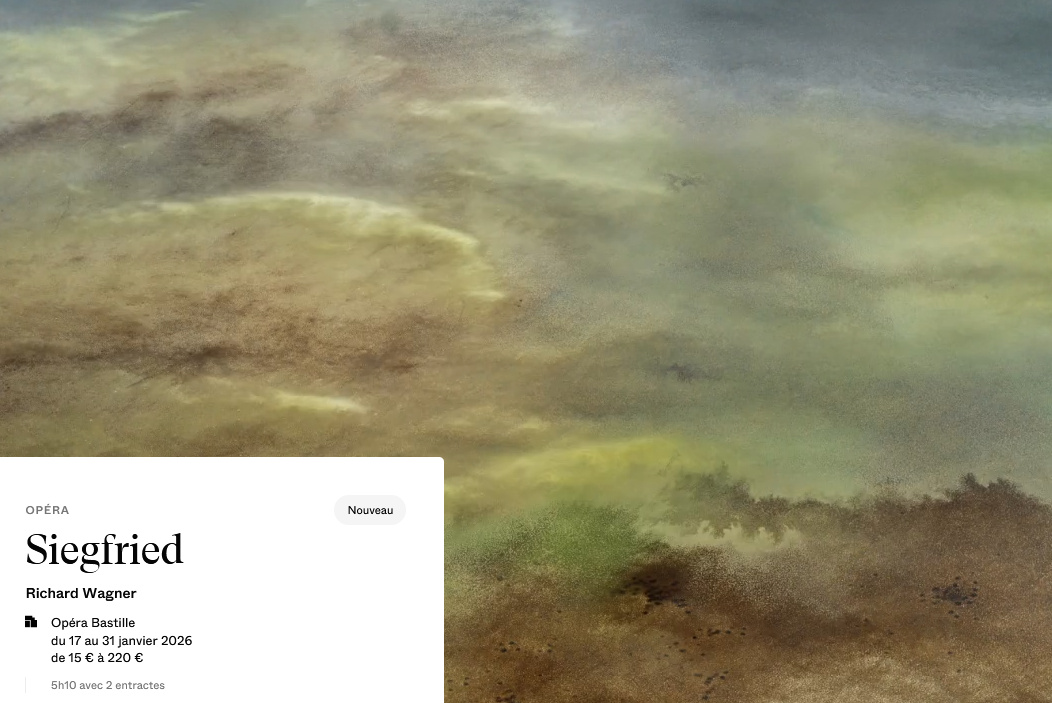

















































![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)







