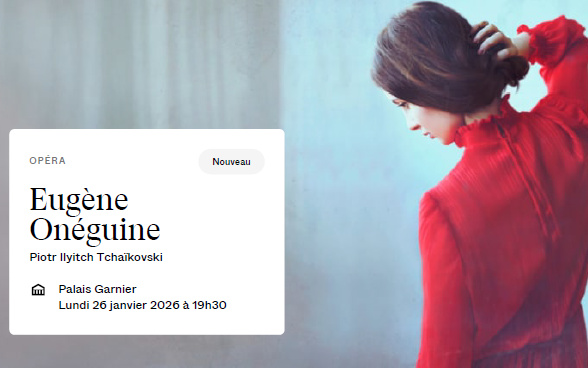
Les temps changent. En 2017, Eugène Onéguine se déroulait à Bastille et s’assumait en deux temps, coupant l’acte II en deux. En 2026, l’opéra se téléporte à Garnier pour une série de représentations à guichets fermés, avec des têtes d’affiche rutilantes :
- après avoir repris les éléments de langage antipoutiniens et viré son ténor de mec, Anna Netrebko est venue assister à l’avant-première pour proposer des bouches en cul-de-poule sur IG, quelques jours avant sa première du Bal masqué ;
- Semyon Bychkov, le nouveau patron artistique de l’Opéra, est à la baguette (ou à la main, selon les moments) ;
- Ralph Fiennes, comédien superstar, met en scène.
L’histoire, elle, n’a pas changé. Olga va se marier avec Lenski. Venant la visiter, celui-ci amène avec lui son pote Eugène Onéguine. Le mec séduit Tatiana, la sœur d’Olga. Tatiana lui mande une épistole pour lui dire qu’elle a flashé sur lui. Il revient lui mettre un râteau (acte I, 1 h 15, entracte de 25′). Pour la sainte-Tatiana, c’est la fête. Las, Lenski trouve qu’Onéguine danse trop avec Olga. Beaucoup trop. Il le défie en duel et meurt (acte II, 40′, entracte de 25′, faut bien remplir les bars). Quatre ou cinq ans plus tard, Onéguine recroise Tatiana. Elle
- est mariée à un barbon,
- n’a pas oublié son crush mais
- lui dit que, en fait, ce sera un non négatif, désolée, bisou (acte III, 35′).
Le spectacle revendique trois éléments :
- fidélité au texte,
- absence de transposition moderniste (« mais pourquoi vous avez pas fait envoyer un texto à Tatiana quand elle écrit une lettre ? » s’irritait en substance un crétin de journaliste du Monde),
- concentration sur
- des éléments de décor reconnaissables (signés Michael Levine),
- des mouvements compréhensibles et
- des situations identifiables.
En conséquence,
- pas d’énergumène en costume-cravate (les costumes sont signés Annemarie Woods),
- pas de déplacement dans une station spatiale ou un champ de cannabis,
- pas de personnage cul nu ou en train de s’infliger un fix,
- pas d’extraterrestre accouchant sur scène,
- pas de double dansant le texte d’Eugène Onéguine dans une boîte en carton.
Ça peut paraître un brin passéiste aux jacklangomanes, mais c’est pas forcément désagréable pour le spectateur surtout quand, au fond d’une baignoire, il ne peut bénéficier des sous-titres. Le son perçu ne permet pas non plus de jouir de toute la puissance d’un orchestre et d’un chœur – sous la baguette virtuelle de la jamais rigolarde Ching-Lien Wu – dont les membres semblent en ébullition, comme émoustillés par des danseurs – dirigés par Sophie Laplane et Kim Bandstrup – parfois à gueule de loup. Évidemment, hormis Sophie Laplane, aucun artiste français n’est engagé dans cette production.
- Pas un techos,
- pas un soliste (même M. Triquet, rôle de Français s’il en est, est confié à Peter Bronder, Anglais de son état),
- pas davantage le chef.
Nous renouvelons donc notre double suggestion : que l’État français cesse de subventionner cette institution qui ne donne pas leur chance aux artistes nationaux ; et/ou qu’il cesse de subventionner les conservatoires où sont censés être formés les meilleurs musiciens et chanteurs parmi nos concitoyens. Si on ne veut pas des artistes français donc si l’on doit payer exclusivement des artistes étrangers, pourquoi diantre parler d’opéra « national » et l’arroser d’autant de pognon, lui, national ? Cette remarque escagassée ne signifie point que les solistes du jour déçoivent, plutôt qu’on est déçu de
- ne pas entendre des compatriotes,
- voir éclore des talents ou
- s’épanouir sur une scène prestigieuse des artistes hexagonaux reconnus.
Pour autant, les engagés ne déméritent pas. Boris Pinkasovich est un Eugène Onéguine droit dans ses bottes. Son absence de charisme sied à son personnage de snob qui finit par se mordre les doigts, mais trop tard.
- Sa capacité d’incarnation,
- sa raideur qui se fendille au troisième acte et
- sa puissante solidité vocale au long des trois actes
ne séduisent pas mais font la job, incontestablement. Ruzan Mantashian, elle, est une Tatiana sensible qui évite la sensiblerie. Elle sait
- chanter à différentes intensités,
- raconter des sentiments variés et
- jouer sans chanter, qualité appréciable.
Bogdan Volkov est le Lenski attendu :
- déchiré plus que déchirant,
- sensible plus que sensuel, et
- capable de claquer son air du II sans peur des piani,
ce qui lui vaut un triomphe mérité. Marvic Monreal a visiblement plaisir à être Olga,
- Olga la jubilante,
- Olga la provocatrice, mais aussi
- Olga qui disparaît du récit dès qu’Eugène Onéguine n’a plus besoin d’elle.
Susan Graham, croisée il y a douze ans à la Cité de la musique, joue les utilités en Mme Larina, assistée d’une valeureuse Elena Zaremba en Filipievna. Tout est propre et bien fait. Il manque juste le grain de folie ou l’inventivité qui susciterait
- un enthousiasme autre que technique,
- un plaisir supérieur au « joli ! » comme quand on voit la neige succéder aux feuilles mortes, ou
- une déflagration qui associerait vision respectueuse de l’opéra et ingéniosité artistique.
Même si, où nous sommes, le son nous parvient tamisé, l’orchestre, qui finira par saluer sur scène, ne démérite jamais :
- les instrumentaux sont nuancés,
- la coordination avec les chanteurs est soignée,
- les soli et contrechants (cors et clarinettes au premier chef) sont ciselés.
Le chœur, par
- sa justesse,
- sa capacité à jouer et
- son plaisir à danser,
fait son possible pour nous contenter. Ce n’est pas exactement suffisant pour nous faire frissonner. Un soupçon de planplan flotte parfois devant ce spectacle plus sage que spectaculaire. Toutefois, comme les papys chics venus soutenir Ralph Fiennes et kiffer l’air de Lenski, l’on pourra saluer un travail de bonne facture respectant,
- l’esprit,
- le texte et
- la musique de l’œuvre.
À l’Opéra national de Paris, ça se savoure !


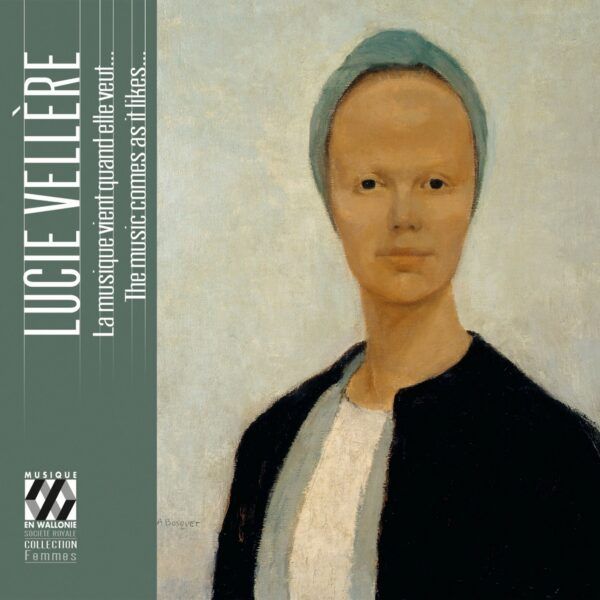
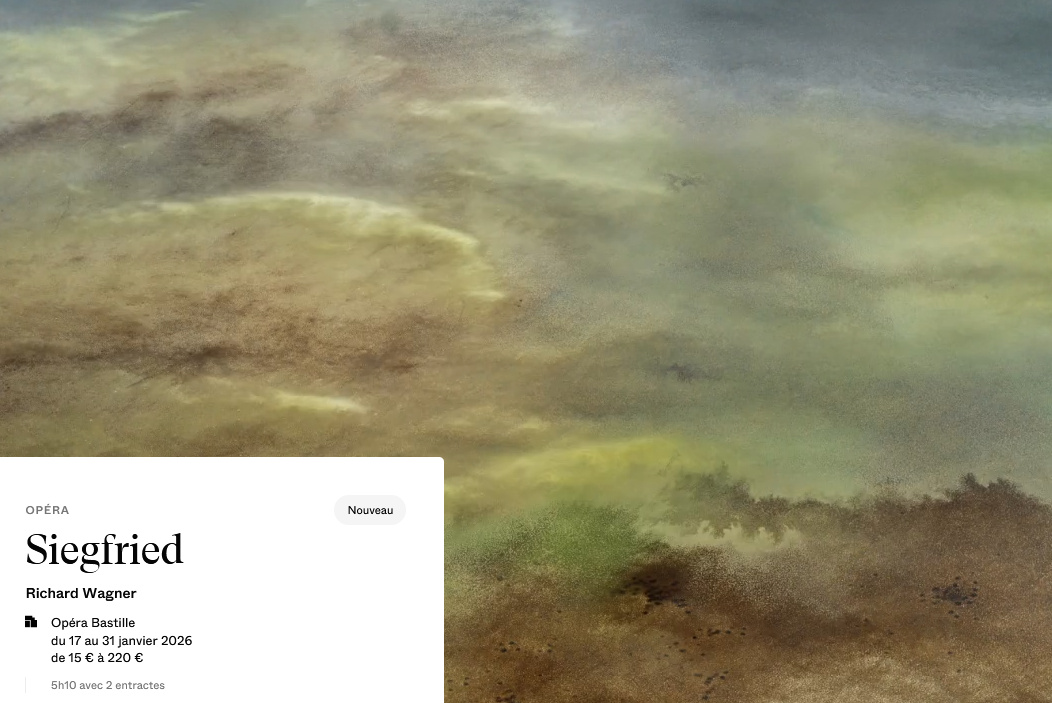














































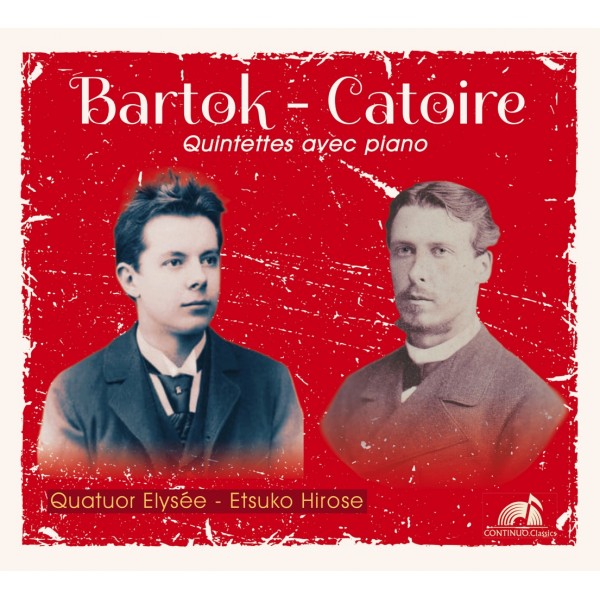

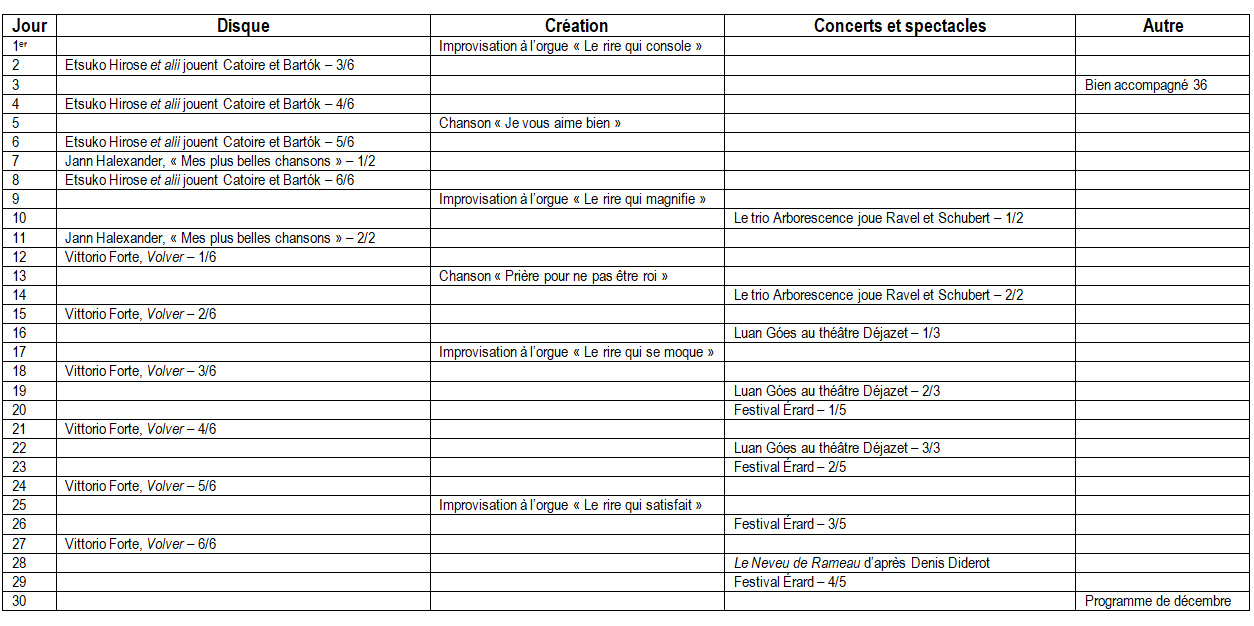

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)








