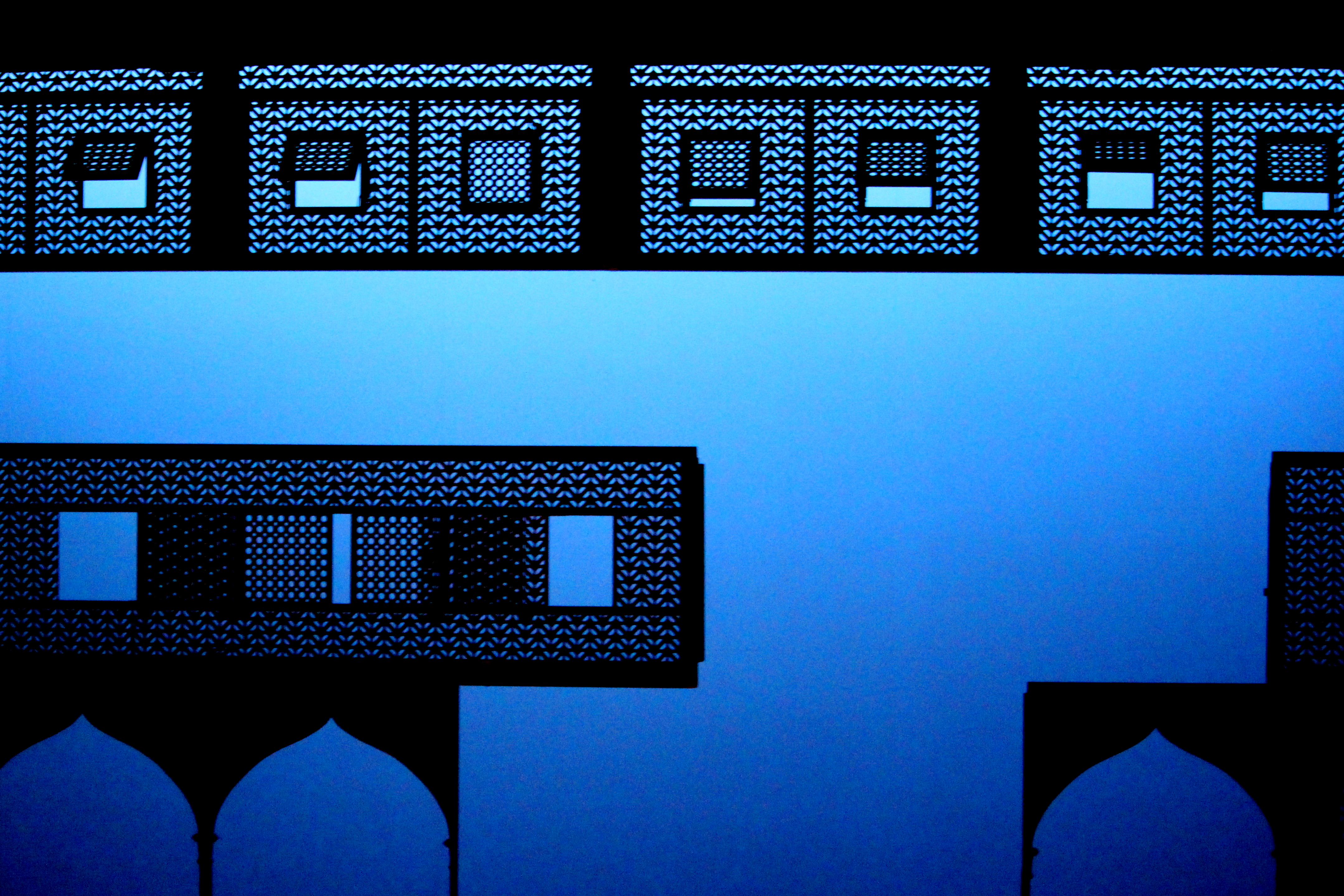Craquons une allumette
– Photographier, c’est empaqueter une scène dans la bouteille vide d’un appareil, et craquer une allumette pour la remplir de lumière.
– Docteur ? Oui, c’est ça, bonjour, ça va, bon dimanche, tout ça, on s’en fout. Je crois que l’on vous a déniché un bon client.
En attendant Julien Bret et Hervé Désarbre…
… c’est François-Xavier dit « Fix » Grandjean qui était aux manettes, ce 8 avril. Le titulaire de la plus importante paroisse de Wallonie, Sainte-Julienne de Namur, fracassait sa grande carcasse contre les récifs parisiens de Saint-André de l’Europe, à l’occasion d’un récital vespéral associant notamment Bédard à Franck et Decerf à Bach en passant par exemple par les variations de Dandrieu sur le thème pascal.
Bien sûr, les fans du bûcheron des Ardennes préfèrent la photo ci-dessous. Et nous, même si on est plus intéressé par son talent que par son collier poilu de mec qui fricote avec les sangliers, on est fier d’apprendre aux admirateurs de tout sexe que l’homme sera derechef des nôtres en octobre pour un programme fièrement propulsé sous le titre « Florilège des plus grands succès de l’orgue » ou environ. Vues la dextérité et la musicalité du zozo, vivement que et youpi.
Édith Butler et Robert Charlebois, Théâtre de Poissy, 11 avril 2018
N’est-il bon bec que de Québec, comme s’en agaçait Anne Sylvestre en interpelant Pauline Julien ? Ce serait oublier qu’il en plut aussi d’Acadie, dont la représentante qui, ici, plut le plus (en partie grâce à Marie-Paule Belle, ainsi qu’elle le rappelle), demeure Édith Butler. Ce 11 avril, elle était réunie avec Robert Charlebois au théâtre de Poissy.
En présence de complices de l’artiste comme Catherine Lara et Lise Aubut (pourtant annoncée enterrée au détour d’un lapsus), le concert s’ouvre donc par une première partie d’une heure assurée par Édith Butler, plus connue pour son énergie débordante, appuyée sur sa passion pour le folklore, que pour l’ensemble de son répertoire chansonnier. Ce jour-là, elle est annoncée en formation trio, avec Javier Asencio, un pianiste argentin, et la violoniste Andrée-Anne Tremblay dont le nom, contrairement à ceux de maints fouteboleurs français, ne nécessite pas de précision quant à la provenance. Cette formule resserrée est hélas trahie par une bande-son remplaçant la section rythmique. Reconnaissons-le, ici comme pour Michèle Bernard, jadis, au Forum Saint-Germain : quelque admirateur de la chanteuse que nous soyons, payer pour entendre de la musique partiellement en conserve nous hérisse – autant comme musicien syndicaliste que comme spectateur. On nous dira : manque de moyens. Je répondrai : avec un piano, un violon et une chanteuse pouvant guitariser, y avait de quoi réarranger quelques tunes, même sans beaucoup de thune, non ? D’autant que chaque utilisation de ce stratagème, rendant superflu et inaudible le piano, suscite ce soir-là de tristes décalages entre le mp3 et le chant. Les trois tubes remixés par Catherine Lara, « Marie Caissie », « À la claire fontaine » et « Dans les prisons de Nantes » en souffriront ; le bis indispensable, « Paquetville », sera de justesse sauvé par les indications orales d’Andrée-Anne Tremblay alors que l’on se dirigeait de nouveau vers la cata.
Pour autant, fut-ce un mauvais concert ? Certes non, et pour trois raisons, en sus de notre fanitude.
Première raison, le répertoire est choisi pour plaire puisque, hormis une chanson d’amour, le reste ressortit du folklore énergisé qui fit le succès, mérité, de l’« ethnologue et interprète », ainsi qu’elle se définissait sur Madame Butterfly (Kappa, 2003). Deuxième raison, la violoniste, rock mais précise à souhait, apporte un geyser de pétillements qui colle parfaitement au concept de party, à la fois chéri et honni par la chanteuse pour avoir, parfois, étouffé ses autres facettes. Troisième raison, l’artiste continue d’irradier comme un voyageur immobile. Vêtue avec soin, elle a du souffle, de la voix, du métier, de l’aisance scénique (poupée comprise) et cette distance légèrement ironique qui lui va comme une chapka.
Ainsi, à soixante-seize ans, deux cancers au compteur et un téton en moins, la squaw Édith Butler continue d’être une exceptionnelle passeuse de chansons antiques et une formidable distributrice d’énergie souriante, que l’on a hâte de réentendre… débarrassée de ces béquilles consternantes que sont des arrangements lourdauds et l’utilisation d’une bande-son. Pour preuve, si besoin était, « Le grain de mil » en solo était à tomber. Avouons-le, c’est cette simplicité, cette pulsation, cette profondeur qui nous émeuvent encore et toujours, quand le talent, la singularité de la démarche et le savoir-faire s’extraient donc nous extraient de la contingence.
Après demi-heure d’entracte, s’avançait Robert Charlebois, un jeunot au moins au regard de la légende précédente (soixante-quatorze ans, lui, mais quarante et un ans de mariage, ce qui ne se voit guère). Comme à chaque fois que nous l’avons vu, le Montréalais propose un récital de haute volée, appuyé sur une batterie, un contrebassiste-bassiste, un claviériste-pianiste et, curieusement, deux guitaristes – le musicien à jardin semble, pardon pour lui, superflu. L’ouverture, plate, sur « La complainte du phoque en Alaska » pourrait décevoir si l’artiste omettait de s’en expliquer, ce qui la rend formidable : à force que des dames bien mises regrettent qu’il ne chante pas cette chanson (celle qu’elles préfèrent, « et de très, très loin », parmi les trois cents qu’il a écrites), il a décidé de faire tomber de la ouate de phoque dans leurs oreilles… comme s’il avait écrit le tube de Michel Rivard. La suite sera de ce tonneau : qualité de l’interprétation, variété du répertoire, énergie du rockeur et, pour pimenter le tout, entre les chansons, minisketchs toujours percutants et bienvenus.
Bien sûr, comme pour Édith Butler, on a mauvaise conscience d’aller à la fois applaudir un chanteur et rendre visite à un monument, fût-il fort bien conservé. Vient-on saluer un excellent compositeur-interprète, vivant et potentiellement créatif, ou, comme ces consternants gogos payant des centaines d’euros pour s’ennuyer devant la momie aznavourienne, profiter de ses chansons tant-qu’il-est-vivant ? Oui, nous venons entendre l’artiste en espérant découvrir de nouvelles idées stimulantes ; mais pourquoi le nier, niais ? Il y a, assurément, un fort relent muséal devant l’alignement d’autant de tubes formidables : les émouvants « Ordinaire » et « J’veux d’l’amour », l’obligé « Je reviendrai à Montréal », son pendant à huit temps « Québec », l’ironique « Conception », le psychédélique « Lindberg » qui échoïse, et pourquoi pô, l’higelinien « Paris – New York », le basiquement hyperpêchu « J’t’aime comme un fou » repris avec une fougue communicative hier soir, etc. Dès lors, dans une set-list hyper efficace, rares sont les raretés. Pour autant, elles existent ! Citons « Les ondes », extrait de Doux sauvage (2003, La Tribu / Universal), le joyeusement archaïsant « Les talons hauts », l’inattendue mise en musique de la scie dite de saint Augustin « le Berbère » (« Je ne suis pas loin, juste passé de l’autre côté », pfff) et l’inédit « Des livres et moi », collant des titres de romans pour en faire de la musique (« évidemment, pour ceux qui ne savent pas lire, ça va paraître long », stipule astucieusement le cultivé cultivateur).
Sûr de son fait, porté par un répertoire en béton rose fort soyeux, et poussé par une énergie à décorner Anne Sinclair, célèbre reine des cocus, l’entertainer fait la job (oui, la job car, « chez nous, pour les anglicismes, le féminin l’emporte sur le masculin ; de toute façon, l’égalité des sexes marchera jamais, y en a pas deux de la même longueur »). Malgré des soli un brin systématiques du guitariste au chapeau, on apprécie le savoir-faire du Robert à l’abondante chevelure frisottée, sa vitalité, la qualité de son contrebassiste, la variété du spectacle et la subtilité des sorties de scène inversées (d’abord accompagnateurs puis vedette, et inverse après le bis : c’est du détail, et c’est d’autant plus efficace). Bref, une fois de plus, même si l’artiste avoue tourner pour le pognon « depuis quinze ans » (sortie de son dernier disque d’inédits), fans et nombreux vieux spectateurs venus pour la première fois le plodir sortent bluffés par une performance ébouriffante. Quant à nous, en prime, nous ajoutons, snob, un conseil pour nos lecteurs : ne pas aller voir de concerts de chansons rock dans le théâtre de Poissy. En effet, du milieu du balcon, on subit une sonorisation gravement inadaptée, donnant l’impression à la fois que ça envoie du gros son mais que les baffles sont immensément loin – regret technique qui n’altère qu’à la marge le plaisir procuré par cette soirée inattendue et joliment troussée. C’est dire si les artistes furent bons !
La réponse d’Édith Butler
Cher Bertrand !
Un gros merci pour les commentaires sur le spectacle d’hier, très constructifs et instructifs. J’en prends grandes notes, car je suis d’accord(s) avec tout! Il me manquait 3 musiciens (question de budget ), pas subventionnée. Je le serais si j’étais parmi les ÉMERGENTS! Hélas il y a longtemps que j’ai passé par là! Merci d’avoir pris le temps de venir nous écouter avec autant d’attention. J’apprécie.
Toute mon amitié,
Édith.
Jean Muller, « Les variations Goldberg », Institut Goethe, 10 avril 2018
Plus de 300 demandes pour environ 200 places : c’est peu de dire que le succès des concerts « Classique en suites » ne se dément pas. D’autant que, ce mardi 10 avril, le programme, impressionnant, est à la fois cohérent (quoi de plus classique que les Variations dites Goldberg de Johann Sebastian Bach ? selon des experts, l’artiste a publié le 582ème enregistrement de l’œuvre…) et oxymorique (l’intégrale n’est pas si souvent donnée en concert, même si quelques témoignages discographiques comme celui de Tatiana Nikolayeva, en 1986, édité en 2007, témoigne de l’intérêt de l’exercice). Né en 1979, le semi-sosie du prince Albert en concert ce soir-là nous vient du Luxembourg, sosie fiscal de la principauté détestable, où le pianiste sévit comme directeur artistique de l’Orchestre de chambre du grand-duché. Le monument bien tempéré et la présence de l’ambassadrice en France du haut-lieu bancaire sont-ils de nature à faire trébucher le colosse ? Après un concert aussi prometteur que décevant (c’est sans doute le danger de susciter une belle attente), peut-être certains habitués ont-ils des craintes.
À tort.
Déjà, un petit Steinway a remplacé l’imposant mais redoutable piano à queue local. La belle idée ! Car, pour cette heure de musique jouée avec partition, la délicatesse, l’énergie et la précision exigées par Johann Sebastian Bach ne paraissaient pas compatibles avec l’instrument habituel. Le quart Steinway a sans doute moins de personnalité, mais il s’adapte parfaitement au propos de Jean Muller, dont, détail qui n’a pas son importance, les photos officielles semblent dater d’avant son relooking radical. Pour ces trente-deux pièces (aria au début et à la fin, plus trente variations), l’artiste a décidé de privilégier la clarté du discours, l’expressivité intérieure – s’exprimât-elle par des gestes extérieurs qui vivent le son et le feeling – ainsi que la lisibilité des contrastes. Le résultat est plus que séduisant.

Fête à l’Institut. Enfin un organisateur qui a compris que l’on fait ou que l’on écoute tous de la musique pour l’after ! C’est aussi pour ça que l’on va aux enterrements des autres. Pour le sien, c’est différent, mais, bon, c’est pas le sujet. Photo : Bertrand Ferrier.
Souvent, Jean Muller nous emporte dans le vertige de la polyphonie en réussissant à faire entendre, avec un art exceptionnel, les voix qui dialoguent, n’en déplaise aux tenants d’une musicologie chichiteuse qui considérerait qu’une pièce pour clavecin à deux claviers doit être jouée scluzivman sur un clavecin à deux claviers (nous sommes heureux de les inviter le samedi 2 février 2019 à 20 h en l’église Saint-André de l’Europe où Pascal Vigneron interprètera la même intégrale sur pire qu’un orgue : un orgue de concert). D’autres fois, Jean Muller nous précipite dans le vertige du contraste entre apaisement soudain et virtuosité ébouriffante, fût-elle pimentée par quelques rares scories montrant que c’est du live, bordel. Tout est précis, palpitant, simplissime, maîtrisé, élégant sans jamais de chichis, perlé sans cul-de-poule, énergique sans forcer, jusque dans le choix des rares reprises, rendant intelligible et accessible l’œuvre sans la trahir aucunement.
Que cette interprétation remarquable s’achève sur une « Cathédrale engloutie » de Debussy (« pour unir France et Allemagne, Paris et Goethe-Institut, Jean et Muller ») suggestive à souhait enchante en dévoilant un autre profil de ce musicien autant musicien qu’expressif – je sais, mais « cet expressif autant expressif que musicien », c’était encore moins clair ; et l’initiative de l’Institut ajoute une coda fort bienvenue à cette grande joie, en proposant aux spectateurs de partager un verre (et de goûtus cornichons) à la fin de la performance. Autant dire qu’il ne faut pas tarder à réserver au 01 44 43 92 30 pour le concert de Mitsuko Saruwatari le mardi 22 mai, à 20 h, à guetter sur le calendrier de l’Institut. En vue, un récital présentant les sonates pour clavier de Wilhelm Berger (1861-1911, comme chacun sait), avec des places cotées 5 à 10 €. Le cadre (auditorium confortable), l’accueil avenant et les récitals passés mettent le cornichon à la bouche. Autrement dit : les places seront vite rares ce qui, en un sens, est fort joyeux.
François-Xavier Grandjean est dans la place
 François-Xavier Grandjean, figure de l’orgue wallon, est dans la place. Rendez-vous ce dimanche à 17 h pétantes pour un concert spectaculaire qu’annonçaient les répétitions…
François-Xavier Grandjean, figure de l’orgue wallon, est dans la place. Rendez-vous ce dimanche à 17 h pétantes pour un concert spectaculaire qu’annonçaient les répétitions…
… et que confirme un programme spectaculaire. Grand écran, cadreuse lailleve et entrée libre devraient faire le reste.
- KB2 – Programme 15 – 1
- KB2 – Programme 15 – 2
« Le Cid », Manufacture des Œillets, 5 avril 2018
Ce 5 avril, pas question d’aller voir, vulgairement, Le Cid, mais Le Cid dans « la version de 1637 ». Comme disent les ziciens, nuance. Côté théâtre, il s’agit d’une production à succès « parce qu’il y a de vrais costumes », nous souffle-t-on, quoi que certaines jupes se dégrafent en cours de route, glissent de jeunes spécialistes. Même si, à une époque où foutre des intermittents à poil sur scène rend cette idée de « costume » éminemment ringarde, nous acceptâmes de nous faufiler à la Manufacture des Œillets pour juger du spectacle. (De rien, voyons, nous devons bien cela à nos lecteurs passionnés.)
L’histoire
Rodrigue aime Chimène, air connu. Don Gomes, papa de Chimène, chicote par jalousie de lèche-bottes don Diègue, le papa de Rodrigue, qui demande au fiston de rosser son agresseur (acte I). Le godelureau s’exécute et l’exécute. Chimène réclame vengeance (II). Chimène avoue qu’elle aime Rodrigue malgré tout. Rodrigue apparaît. Chimène ne nie pas qu’elle ne le hait point mais promet vouloir sa mort. Rodrigue, tout à son amor, part se battre contre les Maures pour y trouver la mort (III). Hélas, Rodrigue gagne et devient le Cid. Chimène exige quand même que le nouveau Sidi se batte en duel contre un freluquet encore plus freluquet que lui. Elle épousera le vainqueur (IV). Rodrigue propose encore de mourir sous les coups de Chimène. Elle refuse de le buter. Il part donc au duel, rosse le freluquet sans le tuer. Chimène demande qu’on lui accorde un an de deuil. Le roi, ravi, envoie Rodrigue combattre les Maures chez eux. À son retour, inch’Allah, il épousera sa nana (V).
Le spectacle
Sur un texte qui doit sans doute sa survie, à l’ère hypocrite des sensitivity readers, à l’emploi du mot « Maure » au lieu d’Arabe, Yves Beaunesne propose un spectacle stagnant et évolutif à la fois. Sur un décor unique pour le moins basique (pardon : sur une scénographie de Damien Caille-Perret) incluant un parterre partiel en parquet et un double fond de scène amovible façon moucharabieh, avec aérations mobiles, les deux premiers actes jouent la parcimonie. On croit un instant que cette platitude est regrettable. Pourtant, elle n’est rien au regard de ce qui reste à venir.
En effet, petit à petit, comme pour s’excuser du sérieux – jugé, suppute-t-on, désuet – des enjeux, Yves Beaunesne tire son travail vers la comédie grotesque façon Michel Fau. Le roi (Julien Roy, ha-ha) joue une sorte de Michel Bouquet en collants roses, le puissant étant bien sûr en chaise roulante afin de pointer son ridicule. À cette crise fatigante d’homo pseudo comicus (qu’il s’agisse d’une tragi-comédie signifie simplement que la tragédie se finit bien pour ceux qui ne sont pas morts, pas que l’on doit faire en sorte que le public s’esclaffe à tort et à travers), s’ajoute un deuxième défaut : le stabylobossismus, pathologie consistant à en rajouter dans tous les genres – mélo, émotion, drame, suspense, allégresse, etc. Troisième stratégie pour pousser le baroque à fuir l’univocité supposée du tragique : le collage. Aux scènes gnangnan succèdent des scènes érotiques manuellement surjouées ou des scènes grotesques d’une épouvantable lourdeur (Julien Roy agitant ses petits petons pour se mouvoir sur scène), etc.
Est-ce pour désamorcer la hauteur de vue d’un drame dont les mots-dièses, tels que #honneur, #fidélité, #obéissance, #famille et #amour, sont censés dépasser notre époque ? Sans doute. Et ce ricanement à contresens nous agace car le tragique, cœur de la pièce, ce n’est pas que la mort sature cette pièce ; ce n’est pas que le drame se passe dans une unité de temps et de lieu – celle-ci simplifiant le cadre prévu par l’auteur ; bien davantage, ici, c’est un révélateur implacable des idées hautes qui sclérosent les hommes. Désamorcer le tragique en s’en gaussant, galvauder la happy end en montrant sur scène des personnages lassés par l’obstination hypocrite de Chimène, cela revient à désamorcer le cœur du texte ; donc, disons-le, à moins désarçonner le spectateur qu’à le décevoir. En effet, ce tragique céleste, obsédant, quasi saturant, en contradiction avec nos terrestres pulsions sexuelles, structure le personnage de Chimène. Libérée de cette gravité oxymorique, elle devient juste une greluche répétitive et casse-bonbon.
De la sorte, bien que la salle soit relativement petite et à moitié pleine (quasi exclusivement de scolaires), on ne capte pas tout ce que disent les acteurs, notamment Zoé Schellenberg, pour des questions de volume, d’articulation et de mise en scène (voir le couinement des parties mobiles du décor au V) ; les grandes tirades de Thomas Condemine, cassées, sans charisme, parfois propulsées dans un costume grossier, tombent à plat puisque la mise en scène tire plus vers la gaudriole que vers le poignant – comme s’il s’agissait à la fois de jouer Le Cid et de se moquer de cet archaïsme. Devant l’effort mnémonique et physique, notamment de l’omniprésente Chimène, quel dommage ! Dans ce contexte, la diction yoyotante de Jean-Claude Drouot, pas souvent intelligible au-delà du marmonnement, n’est plus qu’un détail ; disons qu’elle relève autant du détail dissonant que le retour idiot de don Gomes, ressuscitant d’entre les morts pour rappeler, au dernier tableau, que l’on n’efface pas un crime en le faisant justifier par l’État, ce que l’effacement annuel de Chimène signifiait assez nettement.
En conséquence, on est partagé entre la performance, fût-elle entachée de quelques minimes balbutiements rappelant que le théâtre est d’autant plus impressionnant qu’il est vivant, et une certaine consternation ; entre l’intuition d’une recherche et le constat d’un inaboutissement sonnant comme une démission moqueuse devant un monument ; entre, d’un côté, le plaisir d’entendre, avec un sain souci des alexandrins (ce qui ne signifie pas une métrique sclérosée), un texte puissant et suri, et, de l’autre côté, un agacement certain de voir un metteur en scène tenter d’injecter du Dany Boon dans manière de sublime, au point de souiller un texte pourtant parcouru de répliques cultes pour ceux qui, jadis, fricassèrent leurs humanités (genre : « Ô rage ! Ô désespoir ! », « Rodrigue, as-tu du cœur ? », « Va, cours, vole et nous venge », « La valeur n’attend point le nombre des années », « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », « Va, je ne te hais point », « Nous partîmes cinq cents, mais par un prompt renfort… », « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles », « Et le combat cessa faute de combattants » qui n’est pas qu’un remix de « La tribu de Dana »). On devine la gêne, toute profitable qu’elle lui ait été, qu’a dû éprouver le metteur en scène à dealer, une fois de sus, avec du Klassique. Cela s’exprime par exemple par le choix, a priori joyeux, de jeunes acteurs, dûment financé par un fonds spécialisé : las, si l’on apprécie que les gamins aient l’âge de leur personnage, l’on constate aussi que, tout mignons qu’ils puissent être, leurs personnalités et leur technique ne semblent pas toujours assez affirmées pour emporter l’émotion du public, tandis que les plus anciens de la troupe sont soit inaudibles soit hors sujet. Oui, c’est prétentieux de l’écrire noir sur blanc, et le pire est que j’en suis conscient ; mais ce n’est pas insultant. Serait insultant d’écrire que Zoé Schellenberg est charmante (même si elle l’est plus en vrai), que Thomas Condemine est « dans l’énergie », ou qu’Antoine Laudet est choupinet dans son rôle de minet. Les acteurs principaux font leur possible ; la mise en scène ne leur rend pas justice.
La conclusion
On l’aura subodoré, cette mise en scène qui profite d’un classique, spécialité du grand régisseur, pour s’en gausser nous met mal à l’aise. Ce peut être une qualité. Pourtant, cette hypothèse qualitative nous paraît inadaptée ici : nous admettrions d’être colère devant une régie modernisante, ou ennuyé par un plat défilé historicisant. En l’état, la volonté de mutation vers le grotesque nous déçoit ; les applaudissements que mériteraient les parties chantées en chœur, notamment par les convaincants Marine Sylf et Maximin Marchand, seraient justifiés si la musique en général et le chant en particulier avait du sens dans une œuvre aussi compacte ; en revanche, cet endroit sympathique, réussi et pertinent qu’est la Manufacture des Œillets vaut tous nos brava pour oser une programmation sinon toujours émouvante, du moins toujours qualitative et méritant débat.