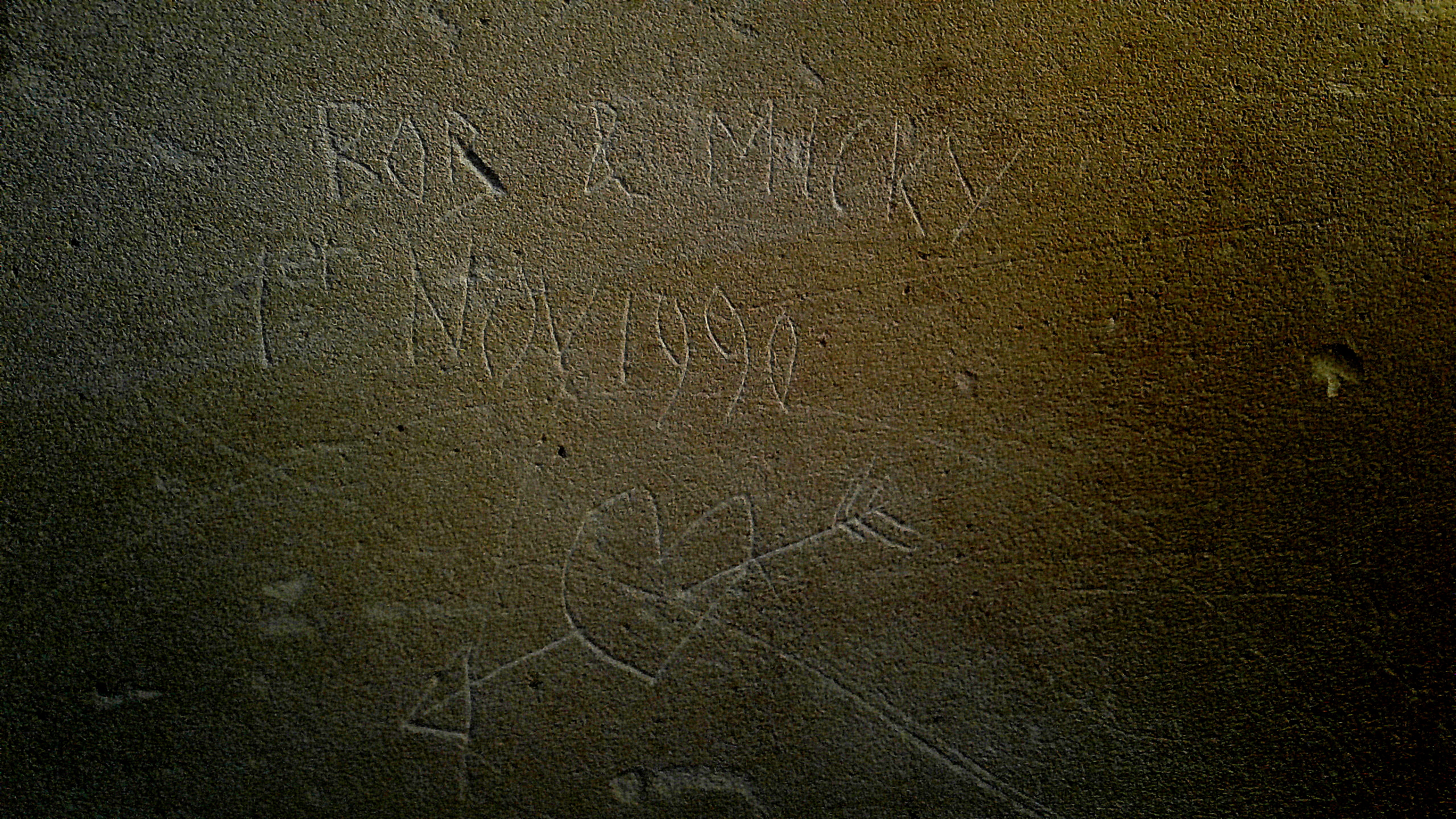Corinne Kloska, « Sous le signe de Bach », 13 février 2018, Institut Goethe
Le pitch (Intro 1)
Enfin une critique difficile à rédiger, pour la deuxième partie de notre série sur les transcriptions, rouverte autour du disque de Cyprien Katsaris après quelques épisodes au piano (Yves Henry) et à l’orgue (Vincent Genvrin) !
La problématisation (Intro 2)
Critique difficile d’abord parce que le projet est passionnant (Bach au piano, transcrit de l’orgue de surcroît, et augmenté d’un César Franck laissant résonner autrement l’art de l’olibrius) ; donc les attentes sont hautes. Difficile ensuite parce que nous sommes invité, ce soir-là, et qu’il est toujours délicat de garder son franc-parler dans ces joyeuses conditions (poli, on pourrait s’enthousiasmer a priori pour remercier, ou du moins ne rien critiquer par respect pour l’artiste et reconnaissance envers la production). Difficile enfin parce que… ben parce que, tautologie, il n’est tout simplement pas simple de rendre raison, à leur aune, et des qualités (vu le programme ou très virtuose, ou très délicat, feat. trois chorals redoutablement transcrits par Ferrucio Busoni, un grand triptyque de Franck et le BWV 543 remixé par Franz Liszt en sus du tube « Bist du bei mir » dans la version inédite d’Éliane Richepin, on se doute que Corinne Kloska a des doigts à revendre), et des difficultés, patentes, rencontrées par l’artiste ce 13 février.
Le plan (Intro 3)
Cela étant posé, tant mieux. Ben oui, c’est un p’tit peu plus stimulant à rédiger, une critique difficile. Et puis, avec quelques heures de vol, on apprend à développer des stratégies pour pallier cette complexité – trois stratégies, forcément ; en Lettres, quand on était jeune, c’était la norme, alors bon, restons jeunes afin d’essayer, posément, d’écrire du récital ce qui nous semble juste sinon bon.
Le développement en trois mouvements
Première option : nous pourrions, simplement, aborder le concert par une feinte objectivité. Dès lors, nous admettrions avec un désarroi certain que nous avons entendu beaucoup de pains et que nous avons vu, à plusieurs reprises, l’artiste perdue car sa main gauche sonnait faux et refusait de se rattraper. Cependant, cette objectivité reste relative : devant la quantité de notes exigée, les différences de types de musique présentés, les prises de risque et la spécificité du live par opposition au disque studio qu’il accompagne, doit-on préférer un jeu lisse et sans accrochage à un jeu engagé avec son lot de scories, il est vrai plus dangereusement en évidence dans la musique de Bach que dans une sonate de Pierre Boulez ou une mazurka de Jambon Frèz ?
Deuxième option : nous pourrions avouer notre déception devant le choix de l’artiste d’abuser de la pédale de sustain, soit pour créer une résonnance d’église assez caricaturale, soit pour essayer, en vain, d’estomper les errements cités supra. Cependant, ce constat, quasi objectif lui aussi, tendrait à gommer la particularité et de la salle, à l’acoustique sèche, et du Blüthner de l’institut Goethe, dont la sonorité parfois dure et inégale exige des trésors de finesse, de la part des artistes, afin d’assurer la continuité des lignes mélodiques et de donner à goûter les beautés harmoniques. Gageons que ce flou, au rendu pas toujours artistique, naît d’une volonté vaine quoique généreuse – celle de recréer une résonance dans une salle de concert qui n’en a guère. Cela n’ôte pas toute notre déception, mais contraste avec les extraits du disque que nous avions pu entendre en avant-première, extraits où la clarté et la précision digitale nous avaient davantage séduit que ce soir.
Troisième option : nous pourrions regretter, surtout au vu d’un programme aussi varié, ce que nous avons perçu comme une étrange tendance à la monochromie, privilégiant l’usage du mezzo forte voire du forte lors des accords en octave, au détriment d’une palette de nuances plus large. Cependant, cette voie critique, peut-être liée à la spécificité de l’instrument, conduirait à gommer la capacité de l’artiste à jouer de façon très pédagogique, sans que le terme ait, pour une fois, une connotation péjorative : sur une même intonation, portée par des poignets d’une grande souplesse permettant un toucher et des legato diversifiés, Corinne Kloska parvient à faire entendre chaque voix et à créer des échos entre ces lignes plus subtilement que si elle s’astreignait à un contraste scolaire, façon coup de Stabylo, la voix entrante en forte et les voix précédentes en pianissimo. À ce titre, l’entrée de la fugue du « Prélude, choral et fugue » de César Franck (que seul le titre relie au projet autour des transcriptions de Bach, mais le titre du disque est « Sous le signe de Bach »), est un modèle du genre ; et les brèves œuvres de Szymanowsky et Scriabine concluant, en bis, le concert, montrent que cette clarté polyphonique n’est pas contradictoire avec une énergie de très bel aloi.
La conclusion
Alors, plutôt que de s’attarder maintenant sur l’énormité incluse dans l’intéressante note de programme (« au dix-neuvième siècle, presque tous les foyers possédaient un piano, voire deux » : mazette, paysans, prolos et pauvres ne font donc pas partie de la société ou avaient des pianos cachés dans taudis ou masures ?), suspendons un temps notre estimation mais pas notre estime.
Certes, le concert a privilégié l’ambition à la sécurité, quitte à décontenancer parfois la pianiste et l’auditeur.
Certes, les incertitudes de doigts et la perplexité de la pianiste devant les frottements ont pu être dérangeants tant, par compassion, le spectateur avait le réflexe de s’inquiéter par anticipation.
Certes, à plusieurs reprises, on a admiré le professionnalisme de la dame pour deux motifs : d’une part, ce qu’elle sait faire de ses quatre ou cinq mains est inaccessible au béotien qui l’applaudit ; d’autre part, elle a su rester constante et sérieuse à tout moment, alors qu’un être humain normalement constitué aurait parfois claqué le clavier en s’avouant vaincu.
En somme, les scories, propres au direct, humanisent l’exceptionnel et n’effacent pas la cohérence ni l’intérêt du projet ; elles ne gomment pas l’audace de cette heure un quart de musique à découvert ; et elles ne voilent pas irrémédiablement la musicalité indispensable pour faire miroiter Bach à l’aune de ses adaptateurs, quand tant de snobs drogués à la musicologie historiquement informée excluent le zozo du champ d’action des pianistes – le fait qu’il s’agisse, ici, de transcriptions, apaisera le vert courroux de ces idiots.
L’ouverture
Comme on a un peu d’chance (pas souvent, souvent, mais parfois, parfois, comme un notaire, faut l’avouer – même en relisant cette facétie, j’ai pas compris du premier coup et pourtant, a posteriori, c’est presque clerc, ha-ha), on aura le plaisir, prochainement, d’écouter le disque à l’origine de ce concert, publié chez Soupir éditions, et d’examiner de la sorte une autre version, par une même artiste, d’un même projet. Peut-être commencera-t-on en chougnant que c’est une critique difficile à rédiger vu que l’on a déjà parlé du sujet, façon captatio benevolentiae quêtant l’empathie sous forme de piètre running gag. Ou alors, avec le ton mielleux d’un présentateur de radio publique, nous citerons Jacques Roubaud en minaudant : « C’est un autre roman encore, peut-être le même » puis en sourçant la citation, par honnêteté et fatuité (Quelque chose noir, III, « Roman, II », Gallimard [1986], rééd. « Poésie / Gallimard », 2001, p. 53) Qui sait ?
En attendant, dire que la curiosité d’entendre la version studio nous titille sera, on l’aura pressenti, manière de litote.
En attendant Bruno Beaufils de Guérigny
Chaque concert Komm, Bach! est une joie pour l’organisateur quand il constate l’investissement des artistes et de leurs assistants dans le projet complètement con qui consiste à donner, pour peanuts, des récitals d’orgue. Tellement ringard et élitiste. Tellement pas rentable et tellement anti-macroniste. Tellement archaïque et chiant. Rock’n’roll, en somme.
Or, le terme correspond bien à Valérie Capliez, organiste virtuose comme il sied, artiste comme il est bon et musicienne comme il convient aux dames de qualité. Son programme du 10 février s’articulait autour de deux pôles : musique allemande qui envoie (Bach, Böhm, Buxtehude, Mendelssohn), et musique française qui zouke en festonnant autour de sa mélodie (Corrette, Lefébure-Wély).
Alors, en attendant la venue de Bruno Beaufils de Guérigny, le samedi 10 mars à 20 h, dans un programme « orgue mystique » tout sauf ennuyeux (Bach, Satie, Françaix et le plus beau tube de César Franck), les curieux et mélomanes du « trente-neuvième concert depuis l’inauguration de l’orgue » ont pu profiter du sens de l’interprétation et de la registration de cette fofolle de Valérie, malgré (ou grâce à ?) une set-list hérissée de difficultés ici transformées en émotions, en partie grâce à Aude, la courageuse assistante en service à la console. À cette connaisseuse et passionnée de courses hippiques qu’est maîtresse Capliez, adressons nos remerciements et hommages en un mot : chapeau !
Lettre ouverte à certaines gens qui prennent les autres pour de la merde (et leur envoient quand même leurs amitiés)
Cher, pour ainsi dire, Raoul,
À votre échelle, bien sûr, ce n’est rien. Ou alors, une paille, un copeau, une plume de moineau, à la rigueur. Pourtant, à mon aune, ça mérite, pour une fois de plus, que je fasse des vagues sylvestres.
Vous m’avez contacté après avoir lu ma notule sur le concert d’Anne Sylvestre au Treizième art. Vous m’avez proposé que cet aperçu soit intégré (gracieusement) au journal que vous dirigez, Je chante. La proposition était flatteuse et joyeuse. Dans cette perspective, nous y avons travaillé en bonne intelligence, et je m’en réjouis.
M’en réjouissais jusqu’à ce samedi, en fait.
Car vous m’avez aussi demandé l’autorisation de reproduire (gracieusement) une photographie spécialement prise par une, ben oui, photographe pour l’article internet. C’était pas un package, hein, vous pouviez prendre l’article sans la photo, mais vous avez aussi demandé la photo. Alors, naïvement confiant (chuicon, hein ?), j’ai sollicité l’artiste, qui vous a naïvement accordé son autorisation (ellécon, hein ?), et c’est avec son cliché que le bon à tirer me fut envoyé. En conséquence, quand vous vous êtes enquis de mon adresse pour me mander votre nouvelle réalisation à laquelle nous avions contribué, je vous ai demandé, dans la mesure du possible, deux exemplaires gratuits, afin que le rédacteur comme la photographe puissent disposer chacun d’un exemplaire.
En ouvrant l’exemplaire unique que vous m’envoyez, je découvre que la photographie sollicitée a été remplacée par une autre, déjà connue, d’un autre photographe. Ceci est le centre du motif de mon ire : vous n’avez pris la peine de m’avertir de votre girouettisme, alors que vous aviez mon adresse, mon courriel et mon téléphone, heureux fripon (taisez-vous, coquines, cette révélation est professionnelle). C’est ballot, Raoul, c’est même sale, parce que ça aurait permis que les choses se passent souplement. Par exemple, cela aurait permis que moi d’abord, puis la photographe, ne découvrions pas en direct que cette artiste a été sollicitée pour rien – alors que, eussiez-vous été correct, vous eussiez pu profiter de ma demande de double exemplaire pour m’annoncer, dira-t-on : m’avouer ? votre choix éditorial.
Cette substitution n’est pas qu’un détail de l’histoire qui me met en mauvaise posture vis-à-vis de la photographe, même si cela est déjà cossu. Ce n’est pas non plus qu’un fait incident susceptible de me donner, pauvre petite âme sensible que je suis, l’impression d’une petite mais vilaine trahison. Soyons clair : vous êtes maître en votre journal, ce n’est donc pas, en soi, votre libre choix que je déplore, même si je garderai par devers moi ce que j’en pense. En revanche, me déçoit, déroute, dégoûte votre attitude, grossière envers la photographe et étrangement pleutre à mon encontre.
J’ai conscience d’être un brin suranné voire moralo-chiant – las, je m’en balèc. De fait, lorsque l’on sollicite la collaboration d’autrui, même sans contrepartie pécuniaire ou surtout sans contrepartie, il me semble que, a minima, un tout p’tit peu de correction et d’honnêteté devrait régir les relations entre les interlocuteurs. Votre couardise en a décidé autrement. Nos échanges préalables, courtois et professionnels, me laissent supputer que vous pouvez être une personne fiable, un interlocuteur sérieux, un professionnel respectable – et non ad vitam æternam ce faquin que vous vous abaissez à être parfois. Toutefois, ce dernier épisode prouve aussi, au mieux, votre mépris des collaborateurs, quantités négligeables, au pis et sans exclusivité, votre lâcheté.
Au moment où je dois informer la photographe que son travail, pourtant sollicité et intégré dans la mise en page a, visiblement, été considéré in fine comme merdique, permettez que je déplore ici votre attitude avec une colère froide et déçue, et ce, publiquement. Ben quoi ? C’est logique pour un goujat qui n’ose pas assumer ses décisions et laisse ses aides-de-camp ponctuels dans un malaise frisottant le désarroi.
Je reste relativement à votre disposition si vous souhaitez m’expliquer face à face les raisons de votre mésaction et ce, tranquillement, soit, mais certes pas cordialement comme c’est plutôt la coutume ici.
Le concert qui va faire fondre Paris

Trente-neuf concerts après la réinauguration de l’orgue, la Grosse Bête s’apprête à pétiller sous les vingt doigts de Valérie Capliez, genre trois médailles d’or de CNR et un p’tit prix de perfectionnement pour ceriser le gâteau. La dame s’apprête à nous jeter en pâture un succulent menu, préparé spécialement pour les curieux présents ce soir. Musique allemande de haute voltige (Bach, Böhm, Buxtehude) et musique française (Corrette, Boëllmann, Lefébure-Wély) mélodique en diable.
Église un brin chauffée, entrée libre, écran géant, programme papier offert aux cinquante premiers spectateurs : pour le moment, on ne change pas une équipe qui, du mieux qu’elle peut, tâche d’inviter les passionnés, les curieux et les autres à passer 1 h 10 de musique variée et belle juste à côté de la place de Clichy. Ça ne réduira pas la souffrance de ceux qui dorment dehors ni ne ressuscitera les suicidés, mais ça sèmera quelques jolis moments dans nos petites ou grandes vies ; et je crois que c’est déjà pas si mal, comme projet à partager. D’où le programme d’ores et déjà dispo ci-d’sous !
- KB2 – Programme 11 – 1
- KB2 – Programme 11 – 2
Ne comptez pas sur moi pour vous montrer la voix

Invité à sévir comme chantre à un convoi, je suis finalement promu organiste, faute de concurrent au poste. Sous le regard du sosie Photomaton de François-Xavier Demaison, j’y étais accompagnateur au quatrième degré, remplaçant (1) le substitut (2) envoyé par l’adjoint habituel (3) du prestigieux titulaire (4).

Ben, même si j’ai regretté de n’avoir point pris quelque appareil photo un peu digne, c’était une chouette surprise, comme aurait dit l’écrivain Audrey Raveglia, peut-être la seule femme de moins de cent ans à utiliser encore l’épithète ornithologique. (Et je précise que le périmètre de ma mission fut rééquilibré avant même que je commençasse à chanter. Médisants.)
Gérard Morel, « Affûtiaux cafouilleux », Café de la danse, 5 février 2018
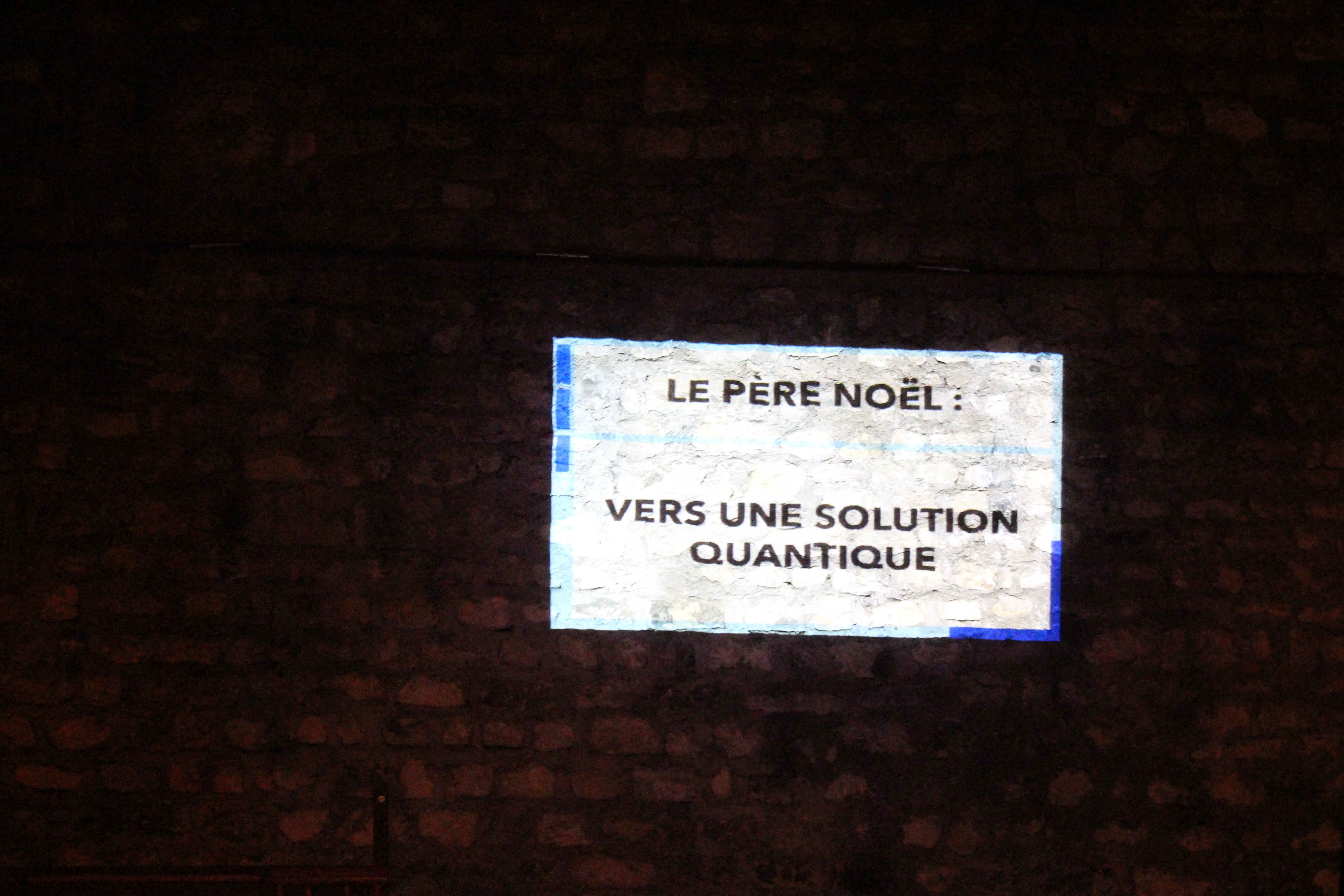 L’affiche est alléchante, car elle rassemble deux artistes, produits par Vocal 26 (l’ex-producteur de Romain Didier et le toujours producteur de Michèle Bernard), dont nous sommes client enthousiaste dès que l’occasion s’en présente. Pour preuve, nous réservâmes notre place de février dès le 28 octobre 2017. Foufou, donc.
L’affiche est alléchante, car elle rassemble deux artistes, produits par Vocal 26 (l’ex-producteur de Romain Didier et le toujours producteur de Michèle Bernard), dont nous sommes client enthousiaste dès que l’occasion s’en présente. Pour preuve, nous réservâmes notre place de février dès le 28 octobre 2017. Foufou, donc.
En première partie sévit Luc Charreyron, grand maître de la pifologie, autrement dit la science du pifomètre. L’expert en conférences pas si absurdes, aux accents sporadiquement françois-rolliniens et souvent poétiques, propose un florilège de son spectacle en « Surchauffe ». Le best of est constitué de trois extraits ouvertement scotchés ensemble pour l’occasion. Le texte part sur des bases comiques proposant une physique, quantique (avec un « qu ») ou non, du Père Noël, façon Alexandre Astier dressant un « bilan mitigé » à coups de PowerPoint ce soir partiellement interactifs. Puis il s’enrichit par la création du personnage de savant expulsé mais pas dupe, et s’achève sur une note poétique (et quantique) autour d’une petite fille que l’on aide à vélocipéder seule, dans la veine onirico-logique d’un Gauthier Fourcade. Hurluberlu avenant, Luc Charreyron impose très vite son personnage, y compris devant une salle venue entendre de la chanson. Sans doute cette rhapsodie de moments choisis semble-t-elle ajourée ou rapiécée çà ou là, par souci de ravauder des bribes qui ne matchent pas toujours au poil de fesse. L’exercice, ingrat, l’exige ; mais la singularité de l’artiste séduit une salle largement novice en charreyronades, et laisse présager d’heureuses découvertes, tant quant(ique) au spectacle intégrale que pour la seconde et grande partie.
Car les gens, surtout des vieux (on aperçoit même une chanteuse à rouge crinière, mais quel âge ça lui fait donc ?), se sont déplacés en masse pour applaudir Gérard Morel, un chanteur qui renouvelle son répertoire en presque intégralité à chaque nouveau spectacle – ce coup-ci, surnageront quelques rares antiquités plébiscitées par le public, comme le très annesylvestrique « Claire et Clément » ou le navire amiral du capitaine Morel, « Les goûts d’Olga ». Là encore, la peinture semble un peu fraîche : « On rode notre spectacle à Paris avant de le tourner en province », affirme l’artiste, même si le spectacle a déjà tourné en province fin 2017. De fait, on note le travail effectué : travail de mémoire car Gérard Morel écrit de longs textes souvent parophoniques et peu narratifs, sans doute peu aisés à retenir et pourtant bien embouchés dans l’ensemble ; travail de problématisation car un fil rouge (« l’amour, hétéro ou lesbien, le seul engagement qui vaille une chanson »), qui rappelle le Ricet Barrier du double live québécois Tel quel chantant « le couple », chapeaute d’autres sujets tout aussi essentiels et tout aussi consubstantiels au zozo, venant se faufiler sans qu’ils ne tournent dos, au premier chef la gastronomie ; travail d’originalité, puisque, cette fois, Gérard Morel s’entoure de quatre mains qui l’accompagnent, en l’espèce Françoise Chaffois à l’accordéon et Stéphane Méjean aux saxophones, au « vase » percussif, à la flûte typique, aux castagnettes et à la cornemuse ardéchoise. Devant tant de labeur, accompagné d’un décor de cabaret et de nouvelles chansons qualitatives, comment expliquer que nous ne nous laissions prendre que difficilement au jeu de cet Achille Talon musicien ?
La première raison est évidente : la sonorisation est une honte. Le micro du chanteur fait cracher certaines consonnes assourdissantes tout au long du récital, et ce n’est pas la faute de la salle (nous y avions apprécié des chanteurs deux jours plus tôt, avec des voix supérieurement retransmises) ; et la guitare de Gérard Morel ne sera jamais amplifiée, mais les techniciens placés à la régie feront bien chier les rangs avoisinants en devisant à très haute voix – de leur incompétence, suppute-t-on. Devant la pléthore d’excellents régisseurs sons, on déplore bien sûr l’inefficacité, la mauvaise oreille et la grossièreté de l’équipe du soir.
La seconde raison est pour partie subjective : sans que l’on le souhaite, au contraire, quasi tous les choix esthétiques relevant de Stéphane Méjean, compositeur et arrangeur bien implanté localement et qui, sur scène, inspire la sympathie, nous hérissent. Pas tant le côté « on est fiers du terroir d’où c’est qu’on vient » (même quand on n’aime pas souvent les imbéciles heureux qui sont logés quelque part, cette veine souriante est un classique du genre : Wally, dans un genre pas très éloigné mais un physique désormais si, le revendique aussi – soulignant la stupidité de ces conventions qui trouvent le nationalisme répugnant, par opposition au régionalisme, tellement trognon). Plutôt le côté kitsch de l’habillage général, matérialisé par les costumes (même pas c’est une blague), dont la stérilité artistique est patente. Et aussi l’usage cliché de cet accordéon que l’on abhorre dès lors qu’il se cantonne à accompagner plus ou moins façon guinguette – oui, même quand il est, comme ce soir, bien manipulé. Et aussi le recours à des genres musicaux sciemment et systématiquement hors de nos goûts, entre java des familles et faux latino, et avec citations coupant les chansons, trop évidentes et stéréotypées pour être mieux que fat. Et aussi, enfin, la copie du personnage « cucul » de Nathalie Miravette, attribué à Françoise Chaffois qui le maîtrise beaucoup moins bien : pourquoi diable ?
Ces incompatibilités artistiques, personnelles mais pas que, nous feraient presque oublier, sottement, le souci de mise en espace, qui pourrait certes être approfondi mais n’est pas si souvent aussi poussé dans les spectacles de chansons. Elles nous feraient presque oublier aussi une fin de spectacle en crescendo, très réussie. Et une palanquée de textes à la dégaine parfois similaire, mais toujours fouillés avec gourmandise (et avec, un peu pesant à la longue, un dictionnaire de rimes). Et elles nous feraient presque oublier, comble de leur malséance, Gérard Morel, un personnage de la chanson française truculente, variée, qui en a dans l’genou – un zozo que l’on se réjouirait de réentendre à Paris seul avec sa guitare qui l’accompagne.
Comme l’aurait proposé Ricet Barrier : tel quel.