Concert qui pète au Connétable
Agrandir le plan
Hé, les gens ! Aujourd’hui, c’est concert au Connétable, au 55 rue des Archives (75003, plan supra). Ce sera le premier spectacle depuis le lancement du site. Raison de sus pour souhaiter vous y croiser… Au programme : inédits, chansons récentes, chansons du répertoire et blagounettes. Entrée libre, ce qui veut dire que vous pouvez écouter sans bourse délier, et sortir en donnant quelques sesterces ou rien. Concert à 20 h pétantes. Durée : entre une heure et une heure un quart.
Pour les passéistes, petit cadeau en honneur de saint Thé, ou en odeur de sainteté, je sais jamais. Bref, voici un souvenir poétique de l’avant-dernier concert, bien qu’il évoque un sujet qui ne nous concerne absolument pas.
Lire à la vanille, selon Sophie Chérer
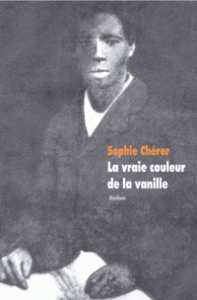 Arrêtons de déconner. Au moins cinq minutes. Bon, disons deux ou trois. Une, d’accord.
Arrêtons de déconner. Au moins cinq minutes. Bon, disons deux ou trois. Une, d’accord.
Sérieusement, les gens, on n’écrit pas pour le plaisir de caresser son clavier ou de contempler sa génialité profonde. Surtout pour la jeunesse. Non, la vérité, c’est qu’on publie des livres pour la jeunesse afin d’être invités, si possible, plutôt à Nice et Marseille fin septembre qu’à Besançon en plein hiver. Quoi que. Au moins, c’est typique, j’ai testé, et en fait c’était sympa. Sauf la remontée de la gare le soir dans la glacialité de l’immensité déserte, j’avoue. Mais bon, vous voyez l’idée.
En 1997, Sophie Chérer, elle, était invitée – et là, attention, on tape dans le top moumoute -, par des bibliothécaires de La Réunion. Sur place, elle découvre l’embryon d’une histoire captivante, et décide de faire partager sa révolte : pourquoi un enfant noir ne pourrait-il être considéré comme un grand savant, s’il a réussi ce qu’aucun grrrand biologiste ne savait faire ? Quinze ans plus tard paraît La Vraie Couleur de la vanille (l’école des loisirs, “médium”, 210 p., 9 €), tout fraîchement arrivé en librairie.
L’histoire : Ferréol est gentil. Il lit des livres. Beaucoup. Il recueille Edmond, le fils nouveau-né d’une esclave noire qu’il n’a pas engrossée. Mais Ferréol est juste, il défend les Noirs, n’a pas peur de l’abolition de l’esclavage, n’aime pas les racistes, et a une vision moderniste de l’éducation (première partie). Il enseigne la biologie au fils de feue l’esclave, lors de longs développements sur l’acquis et Linné – on comprend mieux, à ces occasions, son goût pour les plantes fondé sur leur mutisme -, prétexte à une dénonciation des “mariages arrangés de la haute société de Bourbon” opposés aux “mariages d’amour” qui unissent les plantes. On apprend aussi, grâce à lui, c’est dire si on se passionne, l’origine de fuschia, qui se devrait dire fouxia (wouah ! ça trépide !) ; et on s’extasie avec ce guide sur l’intelligence d’Edmond, qu’il a pourtant formé avec l’aide des écrits pédagogiques de Jean-Jacques (deuxième partie).
Puis soudain, c’est le drame : inspiré par un viol, Edmond féconde la vanille, ce qui est un exploit. Ferréol refuse de le croire, se fâche, s’en veut, finit par se réconcilier avec lui et comprendre qu’Edmond a vraiment réussi cette merveille (troisième partie). Humain en dépit de sa bonté liminaire, Ferréol profite de la découverte d’Edmond, tente de s’accaparer cette avancée foudroyante sans en faire bénéficier l’inventeur – il aurait pu, pourtant, le récompenser en l’associant à sa publication, ou en l’affranchissant et en le rémunérant. Heureusement, auprès de lui, on veille pour montrer que ce n’est pas bien. Et l’abolition arrivant, Edmond devient Edmond Albius car, par sa découverte, il aurait mérité d’être blanc – albius en latin. Mais cela le sauvera-t-il, poil au pistil (quatrième partie) ? Soudain, la chronologie s’emballe. Tous les personnages lèchent les fesses du plus puissant dignitaire de l’île. Même Ferréol s’y met. Edmond “prend femme”, puis devient veuf au paragraphe suivant. Des chiffres de production montrent qu’il s’est fait méchamment enfler puisqu’il vit misérablement alors que les quantités de vanille explosent, boum. Néanmoins, quand Edmond meurt en rêvant de sa mère, il sait qu’il a sauvé l’île grâce à son coup de génie, donc que la vraie couleur de la vanille est noire comme sa gousse… et comme le héros (cinquième partie). Une brève annexe, écrite dans un petit corps – ça fait sérieux -, clôt le livre en offrant une manière de making of.
Le bilan : livre à message, La Vraie Couleur de la vanille peut agacer pour plusieurs raisons.
La première est sans doute le principe du livre à message consensuel : les colons sont tous des salopards sauf un, l’esclavage c’est pas beau, il faut respecter l’enfant dans l’unicité et la spécificité de son développement, et la lecture c’est super mais connaître la nature c’est bien aussi. Sans doute un message plus corrosif aurait-il davantage captivé que cette propagande en faveur d’une posture désormais seule à être admise.
La deuxième raison d’agacement est liée à la première : elle accompagne le développement d’un jugement rétrospectif. La distribution a posteriori de bons points historiques, compréhensible mais d’une facilité intellectuelle que l’on peut aussi juger guère digne, incite l’auteur à multiplier les archétypes à la fois favorables à sa démonstration et défavorables la dynamique romanesque (adieu surprise, émotion, attachements inattendus, etc.). Une telle façon de raconter l’Histoire en jaugeant le passé à l’aune de notre opinion contemporaine met mal à l’aise, tant elle stimule peu la réflexion. L’utilisation de formules figées (“si vous pensez à lui, Edmond ne sera pas mort en vain” – c’est quoi, pas mourir en vain, surtout pour le mec qui est mort ?) et de lourds signes de ponctuation d’insistance (récurrents “!?”) surlignent, entre autres stratégies, la leçon de choses qui nous est infligée. Cette “histoire vraie” (dit la quatrième, insiste la postface) se transforme en une pesante leçon qui vise à édifier les jeunes lecteurs, ce qui n’est pas mon premier critère de valeur littéraire, séduire les prescripteurs voire, pourquoi pas, susciter une nouvelle invitation. Pas de quoi faire vibrer le lecteur, quel que soit son âge.
La troisième raison d’agacement est donc liée à la deuxième : Sophie Chérer, qui sait être une styliste efficace et rusée, semble ici réduire sa plume à un marteau lourdingue cloutant les planches d’un cercueil de la pensée. Point d’ivresse de la nature, point d’émotions : ici, tout paraît cadenassé par la volonté de transmettre Le Message – de sorte que l’on ne ferme pas le livre avec la conviction que cette stratégie pataude est la plus convaincante. Pour une belle scène onirique (la dernière du livre), combien de pensums didactiques ? Combien de passages visant à apprendre des choses au lecteur (donc à guigner lourdement vers le prescripteur) sans se soucier de capter son attention par le charme d’un roman ? Combien de chapitres guindés, empesés, convenus, dont on pourrait croire que le sérieux pédagogique vise à excuser les habiles sautes de style potentiellement littéraires (changement de focalisation, modification du temps et du rythme du récit…), comme si elles risquaient de détourner le lecteur du Message ? Non, j’vous rassure, j’ai pas compté “combien”, mais je dirais, en gros : beaucoup.
Le résultat des courses : l’intérêt de La Vraie Couleur de la vanille, pour quiconque ne souhaite pas être réduit à la “dame du CDI” à moustache, est sans doute de découvrir ce que peut être un type très particulier et non moins répandu de livre pour la jeunesse : un produit pour prescripteurs scolaires, à stricte vocation morale et didactique. Dans cette catégorie, le nouveau texte de Sophie Chérer n’est certes pas le plus mal fichu, comme en témoigne le soin apporté à la construction d’un chapitrage cohérent, et le souci, fort louable, de distiller quelques bizarreries littéraires dans le sage flot d’un propos très cadré. Néanmoins, les lecteurs en quête d’une littérature pour la jeunesse qui soit dérangeante, émouvante ou délirante – au sens étymologique, tant chéri par Ferréol -, feront mieux de passer leur chemin.
Contre la sécheresse, on veut à boire !
Amis de la chanson intellectuelle, soyez les bienvenus. En souvenir du 26 septembre 2012 au Connétable, cette chanson est pour vous exclusivement… et aussi pour les autres, histoire de fêter les plus de 10 000 vidéos de moi-même-je vues sur Youtube. Merci aux curieux, big up aux fanatiques, et buvons un coup pour fêter ça, (c)hips !
Le Nouveau Monde était à Paris
C’est bien de prétendre avoir, dans son répertoire, des “tubes” – pardon, des “classiques” (voir rubrique dédiée). Mais aller écouter les vrais “tubes” classiques, c’est pas mal non plus.
Donc, ce jeudi 4, je suis allé ouïr l’Orchestre de Paris, dirigé par Tomas Netopil – je vous passe les accents sur le a et le s, vous les rajouterez à la louche si ça vous dit. En première partie, pour un peu d’originalité, Taras Bulba de Janacek – même chose pour les accents, hein. C’est tendu, y a de beaux contrastes même si plus de forte que de piano : on chipote, ça commence pas mal ! Les Quatre derniers lieder de Strauss, ensuite, envoient du lourd. C’est Anja Harteros qui chante : superbe voix, d’emblée, avec une large tessiture impeccablement maîtrisée. Il y a de la prise de risques (superbes pianos), donc des imperfections sans importance pour une prestation de cette tenue : voix riche, grande présence (la dame n’est pas là pour rigoler, elle chante droit dans une robe noire, elle ne bouge pas quand elle se tait, c’est digne et fort)… L’orchestre n’est pas parfaitement en place, mais Anja Harteros séduit par ses choix d’interprétation.
En seconde mi-temps, la Symphonie dite du “Nouveau Monde” d’un certain Dvorak – maintenant, pour les accents, vous êtes au point, gravez-les directosse sur l’écran, ça ira plus vite. Malgré une jolie présence des solistes, la partition est parfois un peu savonnée, et, à l’écoute, l’intensité semble inégale. Certains moments semblent routiniers – oui, c’est un tube, mais y a quand même de quoi faire pour émouvoir… Le finale néanmoins réussi (beaux cuivres) emporte une salle Pleyel pleine et à l’écoute. L’ensemble est sympathique, mais on attend plus de l’orchestre, pourtant ou car d’un très bon niveau individuel. Problème de chef ou programme trop banal donc pas assez pris au sérieux ? Vivement le prochain test pour avoir un élément de réponse !
Sofédis, à nous deux !
Hier, dans un Paris de carte postale, départ puis Grand Oral pour convaincre les commerciaux de la SOFÉDIS de mettre en place, partout et en masse, le nouveau projet collectif que je tente de mener à bon port (avec un “t”), pour parution en janvier 2013. La bataille ne fait que continuer…
Vivre à guichets fermés, projet
Vie pleine, un jour, peut-être. Nouvelle chanson dispo. Hope u like it.
Jean-François Chabas a tué l’océan
 On le sait, mais, parfois, faut l’assumer : c’est pas vrai que, quand on vous donne un livre, vous crevez toujours d’envie de le lire. Même quand c’est un peu votre métier. Exemple : j’avais pas trop envie d’ouvrir le nouveau Jean-François Chabas. Ben oui, quand l’école des loisirs m’envoie des SP, je suis toujours un peu gêné de pas en dire du bien, et comme j’avais pas du tout aimé le précédent livre de l’auteur, boum, j’étais méfiant rapport à la politesse, tout ça. Mais comme j’aime pas non plus ranger les services de presse dans ma bibliothèque sans les avoir lus – ce qui souligne que c’est compliqué voire paradoxal, la politesse, alors que péter, hypermoins -, j’ai quand même testé J’ai tué l’océan (l’école des loisirs, “Neuf”, 92 p., 8,7 €). Voilà l’résultat.
On le sait, mais, parfois, faut l’assumer : c’est pas vrai que, quand on vous donne un livre, vous crevez toujours d’envie de le lire. Même quand c’est un peu votre métier. Exemple : j’avais pas trop envie d’ouvrir le nouveau Jean-François Chabas. Ben oui, quand l’école des loisirs m’envoie des SP, je suis toujours un peu gêné de pas en dire du bien, et comme j’avais pas du tout aimé le précédent livre de l’auteur, boum, j’étais méfiant rapport à la politesse, tout ça. Mais comme j’aime pas non plus ranger les services de presse dans ma bibliothèque sans les avoir lus – ce qui souligne que c’est compliqué voire paradoxal, la politesse, alors que péter, hypermoins -, j’ai quand même testé J’ai tué l’océan (l’école des loisirs, “Neuf”, 92 p., 8,7 €). Voilà l’résultat.
L’histoire : Pridi, dix ans comme le lecteur-cible, est possédé par le “démon de la farce”, la bonne excuse. Cela lui vaut des ennuis, mais il n’y peut rien : il ne maîtrise pas son corps quand les esprits exigent de lui un nouveau sacrifice sur l’autel du gag. Jusqu’au jour où il tente un gros coup en allant fourrer des crustacés pourris sous le plancher du gros richard du coin. Paniqué, en un mot, dès qu’il imagine les conséquences de son inconséquence (c’est nul, mais j’ai pas mieux pour l’instant), il fuit à l’autre bout de l’île. Il devrait pourtant savoir que, pire que la rage d’un magnat, il y a l’ire d’un cobra royal, la colère aveugle d’un vieillard veuf qui aspire à tuer l’océan et ses enfants en harponnant sans cesse les flots, et la fureur d’un requin mako luttant pour sa survie… Marqué par la fréquentation de ces dangers, Pridi se repentira-t-il, poil au nombril, de son penchant pour la blague limite, poil à la mite ?
Le bilan : passé la dédicace pas très excitante, j’ai bien aimé. Si.
Bien aimé la construction du récit : ce petit livre pour jeunes lecteurs a l’air d’un conte (c’est bref, ça s’passe en Afrique, ça part sur des airs moralisants) vaguement mis en roman (y a des chapitres). En fait, c’est plutôt une nouvelle, bien construite avec ses rondeurs et ses vides, ses précisions et ses flous, et en prime bien ficelée par une fin ouverte.
J’ai bien aimé aussi que l’on rende hommage à un farceur. Même si on suppute à la lecture que l’auteur n’est pas du tout un familier de la blague (les gags, attendus, ne sont ni drôles ni fouillés), et c’est un euphémisme, ça fait quand même zizir d’avoir un tel projet dans un livre pour la jeunesse, même si on est loin des excès rapides et excellents de Dan Gutman (dont les traductions françaises sont dispo ici).
J’ai bien aimé aussi l’écriture, qui assume de bout en bout un registre élevé, ce qui n’exclut pas un irritant aspect “rédaction sage” par moments, avec “mots de vocabulaire” intégrés, mais ce qui cadre le propos et installe une convention qui est honnêtement tenue de bout en bout.
Enfin, bien sûr, j’ai apprécié que le repentir moral se prenne un doigt d’honneur dans sa face de Carême, même si je me serais réjoui d’apprendre les projets de déconnade envisagés par Pridi pour la suite.
Le résultat des courses : J’ai tué l’océan offre une lecture plaisante, où la blagounette ne se taille pas la part du cobra royal, mais où le propos de l’auteur cadre avec le genre du “livre pour lecteurs de dix ans” sans être inintéressant dans sa forme ou gnagnagnesque dans son propos. Pouce levé, donc !
Nouveau brunch au Connétable
Nouvelle enquête sur les gens qui brunchent et ceux qui les regardent, en direct du concert du 26 septembre…






