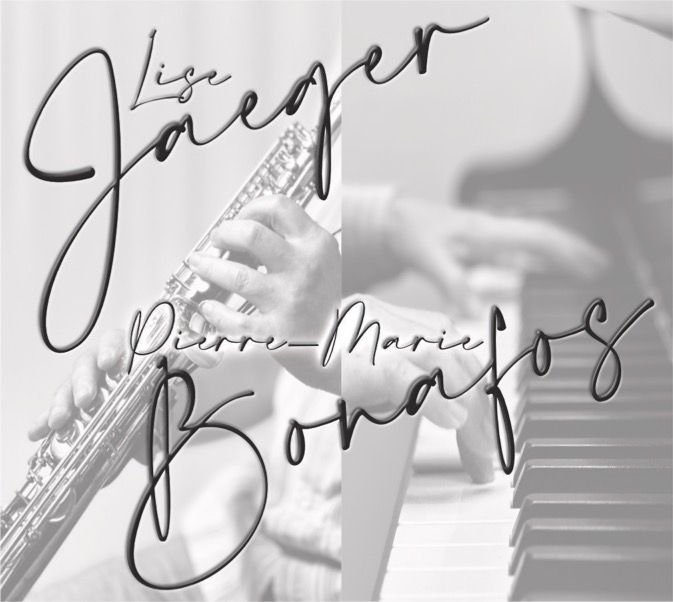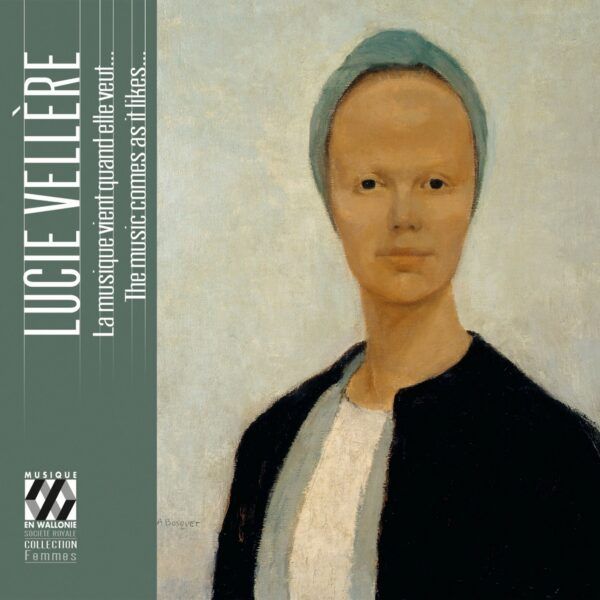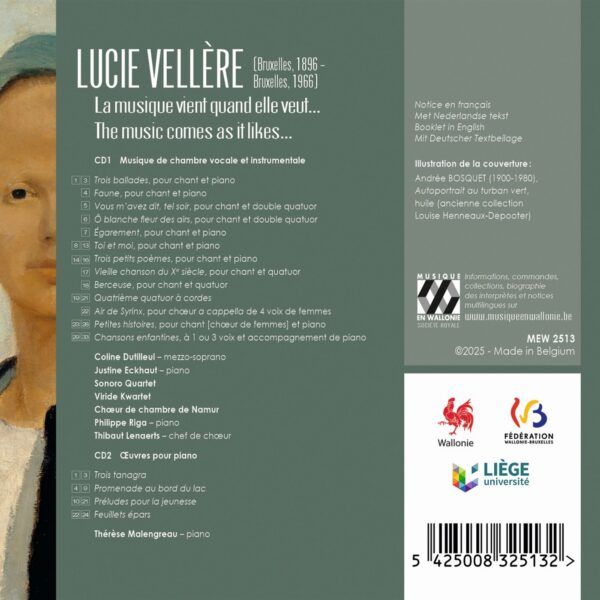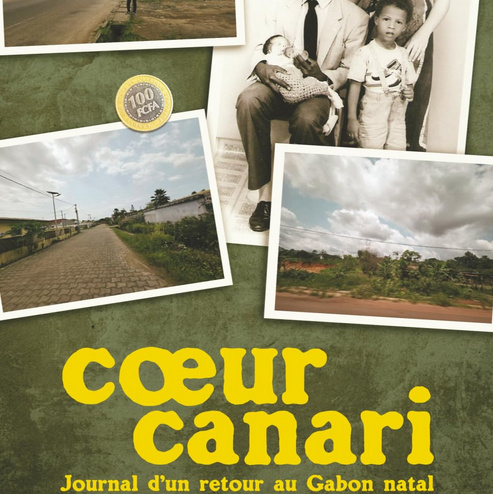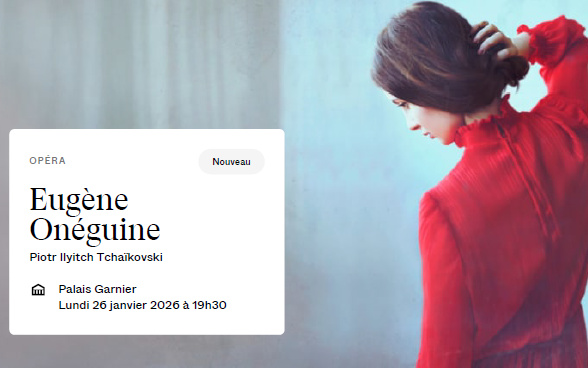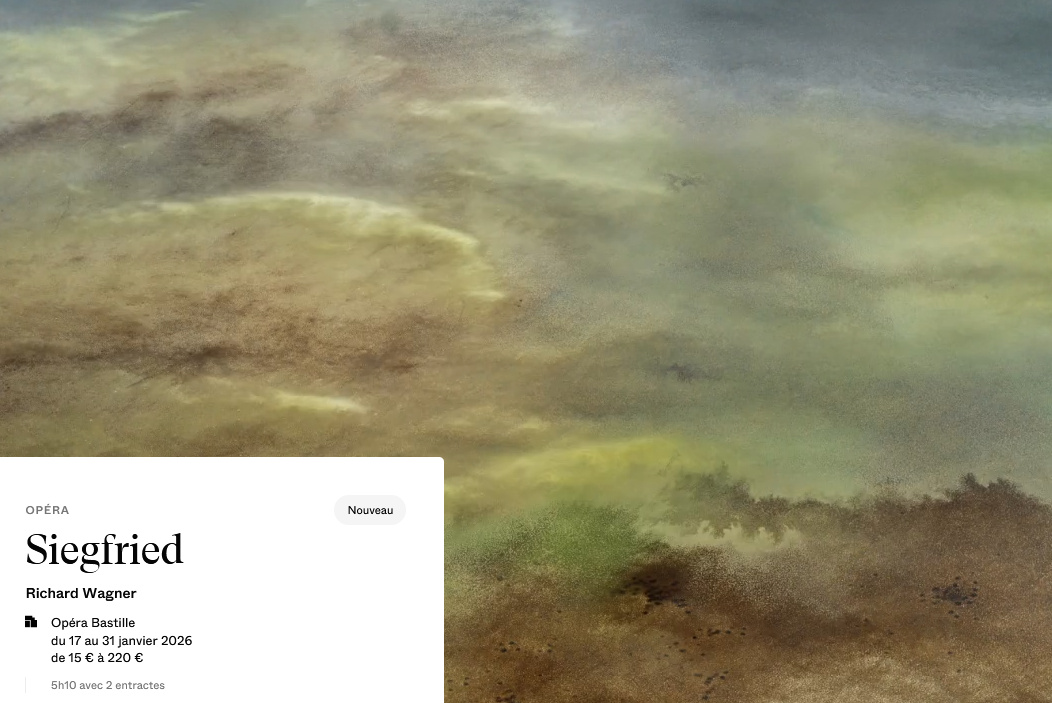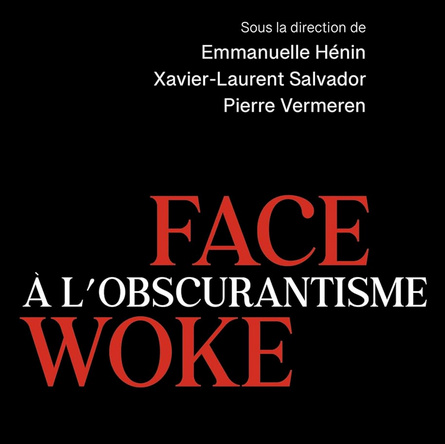
Dernière étape de notre promenade à bord du paquebot (en un mot ou en trois) Le Wokisme avec, en chef d’équipage, Emmanuelle Hénin et sa team qui ont concocté la croisière polémique intitulée Face à l’obscurantisme woke (PUF). Le 13 mai 2025, il y a pile quatre mois, nous avions entamé le voyage avec l’idée que le wokisme était une idéologie agaçante par ses excès – d’autant qu’elle cible en priorité une tête de Turc : le mâle blanc dit cisgenre, espèce à laquelle j’appartiens – mais soucieuse de porter la voix de personnes mal considérées ou carrément victimes de discriminations infondées, ce qui est plutôt noble et me convient. En effet, je milite au Syndicat des musiciens affilié à la CGT parce que je crois que défendre les collègues en butte à des injustices professionnelles (ou profiter d’un soutien concret si des conflits se profilent) est plus qu’important ; ce n’est pas pour autant que toutes les foucades et l’intégralité du sous-jacent cégétique me transportent. À vrai dire, je trouve ça stimulant. La consonance, c’est mignon, mais la dissonance harmonieuse, énergisante, surprenante, stimulante, ça, c’est chouette !
Baste, tenons le cap et revenons à notre aventure en mêlant à la critique des derniers articles du livre quelques coupures de presse relevées durant sa lecture. À ce stade de notre périple, force est de reconnaître que la nature même du wokisme ne nous apparaît plus inclusive mais confusive – tentons le terme – et exclusive. Confusive : en prétendant supprimer des barrières structurelles voire biologiques, le wokisme tente par nature d’être dans la confusion des luttes comme dans la confusion des genres. Ainsi, dans le numéro 48 de Livres Hebdo datant de décembre 2024, ébaubi par Carnes, le premier roman d’Esther Teillard paru chez Pauvert, Sean Rose éructait de joie en accompagnant l’héroïne pour qui
le genre déborde la grammaire, libérons-nous du carcan qu’impose la langue, dépassée, sclérosée, fasciste ! Le genre est fluide ! (…) [À Paris] règne la confusion des prénoms et des pronoms : « il » devient « elle » et inversement ou, de manière indéterminée, en faisant sa transition en « iel' ».
Dans cette confusion des genres se glisse le délire d’intentionnalité : la langue serait « fasciste » par elle-même, elle aurait été développée pour cela. En la floutant, on brouillerait sa nocivité, qui consiste à reproduire des schémas de domination, plus ou moins fantasmés (en général, plus, ça mobilise mieux) qu’il ne s’agit guère de combattre, plutôt de dénoncer. Ainsi, comme membre des « acteurs.ices du mouvements folk », le « quatuor féminin » La Mal coiffée associe la « cause féministe » et la « conscience des ravages que la colonisation a pu exercer » en chantant en occitan (Le Monde, 5 août 2025, p. 15), ce qui lui permet de cocher trois cases woke :
- un discours féministe,
- un discours anticolonialiste et
- un discours intersectionnel.
Leur musique devient secondaire. Prime le storytelling wokocompatible, donc médiatisable. Ce n’est pas un hasard si, deux pages plus loin, dans le même numéro du même journal, était proposé un portrait de la galeriste Mariane Ibrahim, qui mène « un groupe de femmes au nom des afrodescendants », soit les mêmes ingrédients, peu ou prou, que La Mal Coiffée. Voilà pourquoi la nature de wokisme est exclusive. Pour ses adeptes, il s’agit de décerner bons et mauvais points selon la conformité de la gueule du client, de son discours ou de sa production avec les diktats de l’idéologie.
Il n’y aurait là rien de très saugrenu si cette machine à fabriquer des discriminations plus qu’à les combattre ne s’affichait comme le seul projet capable de refonder la société sur des bases consensuelles. Or, le wokisme, ses représentants les plus distingués ainsi qu’une large partie des médias désignent ce qui vaut d’être salué et ce qui doit être exclu selon des mots-clés récurrents dont les objets culturels sur lesquels la presse daigne se pencher sont le plus souvent affublés. Quelques exemples ?
- #leracismecestpasbien : on appréciera le spectacle d’Ysanis Padanou (« elle est noire », précise la journaliste) parce que « le racisme décomplexé, elle le traverse et le surmonte ».
- #lafemmeestunevictime : Annette Baussart est formidable car « elle a toujours eu du mal avec le rôle qu’on a longtemps assigné aux petites filles, aux femmes, aux mères » (en deux mots), comme l’écrit Le Monde du 19 juillet 2025, p. 18 pour Annette et Ysanis.
- #legenrenexistepas : Sorry, baby d’Eva Victor est à louer car le film « développe une identité queer« . Son héroïne « critique une Europe néocoloniale ». Elle est fascinée par Gui, « un Brésilien queer, corps d’athlète sous la robe à bretelles » qui rêve de « retrouver ses racines africaines ». Le protagoniste central est néanmoins un Européen « conscient des enjeux postcoloniaux » dans un pays où « ce sont les femmes qui mènent la danse, au lit ou ailleurs » (en l’espèce la domination de ce genre-ci ne pose pas de problème à ceux qui vilipendent la domination de l’autre genre), comme l’écrit Le Monde du 9 juillet 2025, p. 19.
Le cinéma semble d’ailleurs inondé de hashtags woke, à en croire les autres sorties du jeudi 24 juillet 2025, date à laquelle nous écrivons ces lignes.
- The Things you kill d’Alireza Khatami permet de sensibiliser le spectateur aux « thématiques sociétales autour de la domination masculine » pour secouer « le cauchemar de la violence masculine » ;
- Aux jours qui ne viennent pas de Nathalie Najem est « un récit tout en tension de la violence conjugale » ;
- Frantz Fanon d’Abdenour Zahzah rend hommage à « une grande figure de l’anticolonialisme » ; et
- Pooja, Sir joue le cumul en évoquant
- la « communauté madhesi, l’une des plus discriminées » du Népal,
- le « statut peu enviable des femmes » dans ce pays, et
- le sort de Pooja, forcément « lesbienne » (Le Monde, 23 juillet 2025, p. 18).
L’industrie musicale paraît, elle aussi, souvent conditionnée à la répétition d’une doxa devenue dictatoriale : sans elle, pas d’existence ! Même Dee Dee Bridgewater, s’y est mise. Elle a conçu un « spectacle militant et féminin » (elle n’est entourée que de musiciennes) en le précédant d’un sous-texte pour les médias : « Nous, les femmes dans le jazz devons batailler pour exister sur scène, pour être respectées dans ce milieu patriarcal. (…) Et puis, il y a tout ce qui est remis en cause pour les Noirs, aujourd’hui » (in : Le Monde, 5 août 2025, p. 13).
- Défense des femmes,
- dénonciation du patriarcat,
- émotion devant le racisme anti-Noirs :
bingo « intersectionnel » s’il en est ! Ainsi, la part obscurantiste du wokisme est liée à l’obsession sclérosante, presque monomaniaque, qui
- caractérise,
- sature, et, généralement,
- hystérise
la sensibilité woke, l’enfermant dans une conception binaire du monde où l’évaluation de l’autre se construit à l’aune des mots-clés que nous avons cités et induit une attitude radicale.
Le « spectacle historique » permet ainsi d’opposer,
- d’un côté, les productions compatibles avec les idées du « milliardaire catholique » Pierre-Édouard Stérin (je n’ai aucune sympathie ou antipathie pour ce gars, mais imaginons le syntagme « milliardaire juif » pour bien comprendre l’incitation à la haine woke sous-jacente), accusé de « tentative d’hégémonie culturelle » par le metteur en scène Mohamed El-Khatib ;
- de l’autre, les productions gentilles, comme le projet mené au château de Chambord par ledit « metteur en scène » dans une perspective « ni militariste, ni nationaliste ».
D’un côté, donc, le Puy-du-Fou, de l’autre la cérémonie queer réduisant l’Histoire de la non-nation à un interminable défilé de drag queens – nous avions eu l’occasion de réfléchir sur une version antérieure d’une telle dichotomie ici et là. Deux extrêmes représentant chacun « un espace de projection de fantasmes avec des représentations très stéréotypées », l’un devant être dénoncé comme promouvant « le mythe d’une France éternelle qui n’existe pas », selon les mots de la médiéviste Fanny Madeline, l’autre devant être défendu et promu car wokocompatible, tant il est vrai que la France où
- Jeanne d’Arc est « racisée »,
- Drag Race reflète la société dans son ensemble, et
- Marie-Antoinette danse avec sa tête sous le bras,
elle, a toujours existé, chacun le sait (in : Le Monde, 17-18 août 2025, p. 8). La haine du catholicisme est d’ailleurs consubstantielle au wokisme, avant même les conneries rapportant des affaires de sanctification pour des histoires de T-shirt ou d’Internet : dans ce même numéro, à la une et en dernière page, Le Monde mettait en avant trois attaques contre cette religion, la deuxième étant un énième épisode contestant la sainteté de Marthe Robin, la troisième dénonçait la haine institutionnelle de l’Église contre « les minorités sexuelles et de genre » via un entretien avec la sociologue Céline Béraud.
Cette détestation du non-woke en général et du catholique en particulier n’est pas une opinion culturelle, laquelle serait aussi banale que le « j’aime pas » n’empêchant pas de prendre langue avec autrui (« tu me convaincras pas, moi, j’aime pas la musique contemporaine, mais j’t’en offre un autre pour la route », « la sauce biggy, pourquoi pas, mais pas sur ce truc de merde que t’appelles kebab, c’est pas sérieux ! »). Bien que ses porte-voix refusent de l’admettre, alors qu’une posture assumée donnerait au propos une assise intellectuelle plus vivifiante, une telle détestation est idéologique, au sens où la phobie épidermique empêche toute
- tempérance,
- réflexion,
- distance et
- place pour l’acceptation d’une dissonance.
Loin d’être un appel à la compréhension ou à tolérance mutuelle, le wokisme est un fascisme qui vise à
- purifier l’espace,
- unifier la pensée,
- dénoncer en éructant – pas déconstruire : dénoncer en éructant.
Dans cette perspective, la discussion avec l’autre serait une compromission mortelle. L’idée même de nuancer ressortit de l’hérésie. L’un des meilleurs outils pour piocher des exemples de binarité mentale chaque semaine est M le magazine du Monde. Son numéro du 19 juillet 2025 enquillait deux reportages résolument binaires.
Le premier reportage évoque la vie très sexuelle et l’invisibilisation de James Baldwin à Istanbul, où un colloque sur « les questions LGBTQIA+, les minorités et le racisme » autour de cette figure a été annulé. Pourtant, jadis, à Istanbul, James Baldwin « n’avait pas à craindre de ne pas être servi dans un restaurant ou d’être agressé par des policiers dans un quartier huppé en raison de sa couleur de peau ».
En Turquie, l’écrivain était à la fois noir de peau et « pas noir » car, explique Yachar Kemal, « nous n’avons pas connu la traite des esclaves, nous n’avons pas cette catégorie, il n’y a que des personnes à la peau plus foncée », ce qui vaudra à un chanteur turc fredonnant du blues des actes de violence de l’écrivain l’accusant de « massacrer [s]a culture noire ». Donc pas Noir, mais noir quand même. Aux États-Unis, il était noir mais pas gay car « des voix du mouvement noir rejetaient son homosexualité ». À Istanbul, « aucun Turc ne le considérait comme un écrivain gay. Les gens le savaient mais s’en moquaient. » La réalité étant têtue, James Baldwin finira par se faire rosser par des saltimbanques furieux contre ce « nègre pédé ». On note ici l’essentialisation caractéristique de la vision woke : tu es ce que tu es, par exemple ta couleur de peau ou ton orientation sexuelle. L’idéologie qui revendique de lutter contre les assignations est l’une des plus réductrices qui soit, considérant l’individu à travers ce qui est censé être sa communauté.
Le second reportage oppose l’image très positive de l’homosexuel noir à celle de Lucy Connolly, « la nounou d’enfer de l’extrême-droite britannique », une dame qui a écopé de trente et un mois de prison ferme pour un post furibond où elle appelait à « cramer des hôtels à migrants » après qu’un « citoyen britannique de 17 ans, né à Cardiff de parents rwandais » a planté trois gamines lors de leur cours de danse. L’enchaînement des reportages illustre la vision binaire typique du wokisme : il y a d’un côté les bons (les Noirs, les homosexuels…) donc, de l’autre, les méchants (forcément Blancs comme les fauteurs de troubles dans les piscines allemandes). On devrait s’étonner qu’un prisme aussi étriqué et grotesque connaisse un tel succès et étouffe à ce point la pensée politique, sociologique et culturel. Ce serait oublier que la complexité intellectuelle est rarement populaire. Ce qui marche, le plus souvent, c’est
- le simple,
- le simplifié et
- le simplifiant.
Cyrille Godonou ne dit presque pas autre chose en dénonçant « les biais militants dans le traitement des inégalités entre hommes et femmes ». Le statisticien dénonce l’art de truquer voire d’inventer des chiffres qui permet aux wokomaniaques d’étayer leurs convictions sur le sable ou la poudre de perlimpinpin. Ainsi, il affirme que le temps partiel, qui est réputé frapper majoritairement des femmes est montré comme subi « alors qu’il est pour l’essentiel choisi comme le montrent des études internationales portant sur plusieurs pays » (on regrette néanmoins qu’il cite à l’appui de sa déclaration un article de… 2010 !). Le biais victimisant les femmes serait lié au fait « qu’un article (…) sera nettement moins cité s’il établit un biais à l’encontre des hommes », de sorte que, pour être cité, ce qui vaut des points dans la carrière d’un universitaire, choisis ton camp, camarade ! Sur le même mode, l’auteur conteste que,
- pour des raisons fiscales qui nous dépassent plus qu’un peu, le quotient familial désavantage les mères séparées ;
- le marketing genré n’induit pas que les produits pour femmes soient plus chers ;
- la discrimination salariale dont pâtiraient les femmes n’est certainement pas de 25 % et pourrait de surcroît s’expliquer par le temps de travail effectif, donc par l’appétence des mâles pour les heures supplémentaires, etc.
Les méthodes pour arriver à ces fins sont connues et incluent par exemple
- l’invention de fausses citations,
- la citation de fausses citations,
- le recours à des angles subjectifs donc à des perspectives trompeuses,
- l’utilisation frauduleuse du conditionnel permettant de balancer n’importe quoi derrière, etc.
Le biais est une constante de l’esprit humain en général et de l’esprit woke en particulier. Ainsi, après avoir loué le deuxième saison de Platonic dans Le Monde, 21 août 2025, p. 14), Audrey Fournier en souligne « ses limites » : hélas, hélas, trois fois hélas, si j’ai bien compté, la série est « très blanche, très hétéro »… alors qu’il ne viendrait pas à l’idée de Stéphanie Binet, qui signe l’article suivant, de dénoncer les limites de Theodora, « la nouvelle patronne de la pop en France » en pointant le fait qu’elle est très noire, très bisexuelle… voire très débile (si, j’insiste à cause de l’incipit de son tube « Kongolese sous BBL » tel qu’il est transcrit sous son clip :
Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh
J’ai volé ton boo-ouh-ouh-ouh-ouh-ouh
Trop sexy
Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh
J’ai volé ton boo-ouh-ouh-ouh-ouh-ouh,
19 millions de vues au moment où ces lignes sont écrites). En ce second sens, le wokisme confirme qu’il est un fascisme, dans la mesure où il écrase les gens sous des identités qui valent – ou non – médaille culturelle. Ainsi, Rebeka Warrior, dont on apprend qu’elle « a été faite chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres », est louée pour la qualité de ses chansons, citation à l’appui :
Le sex appeal de la policière
me fait mouiller devant derrière.
Elle a aussi écrit un livre dont on ne sait à peu près rien, au terme de l’article de Clémentine Godszal in : M le magazine du Monde, 15-16 août 2025, pp. 14-15, sinon qu’il « est queer parce que je suis queer », dit la romancière. Osons le constat : c’est sa queeritude, et hop, qui ne permet pas mais oblige le wokiste à tomber en pâmoison devant un objet moins culturel que communautaire. De même Catherine Nabokov est louée pour être l’agente de « plumes indociles », entendez : wokocompatibles. Parmi les indocilités lucratives listées par Wassila Blehacine dans M le magazine du Monde, le 30 août 2025, p. 19,
- Gaël Faye, originaire du Rwanda, qui a fait du génocide rwandais une vache à lait éditoriale ;
- Clara Ysé, qui se revendique bisexuelle et « souhaite que les questions du masculin et du féminin dans la société soient dépassées » ;
- Dominique Celis, Belgo-rwandaise née au Burundi, qui « incarne cette liberté grâce, notamment à l’utilisation régulière de mots rwandais » ; et
- Séphora Pondi, d’origine camerounaise, que la même Clémentine Goldszal, pour M le magazine du Monde du 23 août 2025 définit, p. 14, à travers son roman, comme une personne « noire, jeune et grasse » et une actrice « issue de la diversité »,
autant d’éléments qui, dans la logique woke, invalident toute évaluation de l’œuvre puisque celle-ci, par automatisme, ne peut être qu’admirative, dithyrambique et ébaubie, sous peine de désigner le sceptique comme un raciste et/ou un homophobe appelant à la haine de la différence au nom du patriarcat et/ou de son décolonialisme non déconstruit – penser à bien accorder l’invective avec le délit. De la sorte, grâce à des médias flattés de leur propre tolérance, et grâce à des journalistes n’ayant plus à faire l’effort de lire, d’écouter ou de critériser un acte artistique, se constitue une sorte de communauté fonctionnant sur des logiques de stimuli-réflexes où l’intelligence est désamorcée.
Il y a pourtant dans cette posture une inquiétante tendance à l’infantilisation de l’autre, au sens où l’on devrait s’extasier devant des productions de « minorités » parce qu’elles sont des minorités, dans la polysémie du mot, comme on s’extasie du gribouillage hideux d’un enfant parce qu’il est un enfant. Le signe de la communautarisation wokiste est que l’affaire tourne en rond. Par exemple, dans M le magazine du Monde du 23 août 2025, p. 24, Aureliano Tonet s’extasie devant la chanteuse Lorde notamment parce qu’elle se revendique « androgyne » comme sa mère et qu’elle déclare :
J’ai décidé que, quitte à être une femme, j’allais être exactement celle que je voulais être – ce qui passe parfois par être un homme.
Clara Ysé est évidemment sollicitée pour louer sa consœur, tant le micorcosme semble fonctionner dans une validation en circuit fermé où
- l’identité de l’artiste est censée déterminer
- l’identité de ce qu’il est parfois présomptueux d’appeler son art, et donc
- l’identité de ceux qui sont appelés à le valider.
Face à ce type de dérives qui fracturent notre vision pour la réduire à une série de prismes préfabriqués, réduisant l’humain et son travail à ses caractéristiques physiques ou à ses orientations sexuelles, Pierre-André Taguieff propose un épilogue en forme de « Plaidoyer pour l’universalisme », lequel serait une arme contre « la déconstruction (…) de toute tradition réduite à un ensemble d’illusions, de préjugés, de prénotions et de croyances fausses ». Le combat est d’autant plus rude, estime-t-il, que l’idée de déconstruction n’est pas neuve. Marx et Engels estimaient que « les particularités naturelles de l’espèce humaine (…) peuvent et doivent être éliminées. »
Cette conviction irrigue la fougue des « inquisiteurs et délateurs institutionnels » que sont les « universitaires wokistes », parfois rattrapés à leur propre jeu de moralisation des pratiques, leurs pratiques personnelles n’étant pas toujours guidées par leur moraline inquisitrice. Face à ces pulsions de destruction, l’universalisme proposerait « une exigence d’universalité au regard de laquelle la différence et le particulier sont dotés d’une valeur secondaire », les deux éléments étant importants : prime l’universalité, mais il n’est pas nié que la singularité ait une valeur.
Le wokisme est anti-universel. Il conçoit la société comme une multitude de communautés victimes d’un ordre qu’il s’agit de renverser. Aussi se revendique-t-il parfois commun « pluriversalisme décolonial » désignant avec pompe le rêve d’un « monde fait d’une multitude de mondes ». Ce qui empêche cet éclatement, c’est « l’homme blanc hétérosexuel, supposé raciste, sexiste, prédateur et exploiteur ». Pauline Harmange a ainsi écrit que « détester les hommes et tout ce qu’ils représentent est notre droit le plus strict ». Beatriz Preciado, « gouine trans » devenue depuis « Paul B. Preciado, philosophe et activiste trans », proposait de refonder l’universalisme autour de l’anus et du gode car, résume Pierre-André Taguieff, « tout humain peut accéder au statut de travailleur de l’anus ». Humour déplacé ? Alors que penser de punchlines preciadiques comme : « En philosophie, il est temps de tirer la leçon du gode » ?
Ce que révèle le wokisme est assurément la pullulation de « pseudo-philosophes », ces « charlatans » parfois renommés « communicants » ou « consultants » qui ressassent les mêmes formules magiques telle celle-ci, signée par l’inénarrable Judith Butler : « On ne peut aborder l’idée du genre comme si elle était séparée de son legs colonial. » Plus largement que le genre, l’art lui-même ne semble plus devoir être apprécié qu’à l’aune woke, justifiant l’extase d’un Philippe Dagen davant les billevesées de Mickalene Thomas parce qu’elle
- « déjoue les codes qui ont déterminé longtemps – et continuent à déterminer si souvent – les imageries de la femme noire »,
- critique « les représentations de la femme noire dans l’histoire de l’art occidentale »,
- explique que le collage cubiste « vient de la culture africaine » et
- « a pour héroïne la femme noire lesbienne »
(in : Le Monde, 23 août 2025, p. 14), résumant ainsi une intersectionnalité parfaitement woke puisque associant
- anticolonialisme,
- antiracisme,
- féminisme et
- éloge de l’homosexualité :
le grand chelem ! En écrasant
- l’individu sous le collectif,
- le subjectif sous la posture,
- la personnalité sous des stigmates survalorisés,
le wokisme fait résonner cette mise en garde de Theodor Adorno contre « la fausse émancipation », qui donne l’illusion d’une libération alors qu’elle laisse intacts « les stigmates de l’esclavage ». D’où l’appel de l’essayiste à un universalisme « dont on retient trop souvent (…) la seule colonisation réduite à une forme de racisme et d’exploitation capitaliste brutale », à l’instar du Conseil international des musées, « qui représente 20 000 musées dans 141 pays » et promouvait les établissements « inclusifs et polyphoniques, consacrés au dialogue critique sur les passés et les futurs », les invitant à « travailler en collaboration active avec et pour diverses communautés ». Ces bons musées s’opposent aux musées traditionnels, lesquels seraient des « lieux de domination de l’artiste mâle blanc qu’il faut décolonialiser ». Cette formule synthétique de Michel Guerrin lui a aussitôt inspiré le commentaire suivant : « C’est possible » (in : Le Monde, 6 septembre 2025, p. 34).
Au contraire, l’universalisme prôné par l’auteur assumerait « l’importance du croisement des cultures et de leur reconnaissance », non pour cliver les individus en groupes étanches se soutenant dans une lutte absurde, raciste et abêtissante, mais pour les associer à un projet sans doute fouyouyou pour un wokiste – celui de faire société plutôt que faire la fortune et/ou la gloriole warohlienne d’opportunistes vendeurs d’illusions
- malsaines,
- dangereuses et
- potentiellement abrutissantes.
De la sorte, notre longue croisière peut s’achever sur la vision d’une communauté de destins qui serait une « spécificité civilisationnelle aussi forte que positive ». Mirage ou port d’attache ? L’avenir nous le dira peut-être !