
Il fait partie de ces solistes exceptionnels – et de ces accompagnateurs recherchés – dont les récitals émeuvent les foules, les enthousiasment… et débouchent inévitablement sur la question : « Pourquoi vous n’êtes pas plus connu ? » Loin d’être le secret le mieux gardé du piano français, Jean-Nicolas Diatkine garde des années où la musique n’était pas muselée un track record impressionnant, incluant des concerts à l’opéra Bastille et la tradition du concert annuel à Gaveau en passant par un passage au Rode Pomp, à Gand, où le public l’élit « meilleure révélation pianistique depuis dix ans ».
Formé par des pointures, frotté aux grandes salles de concert, habitué des micros, l’homme se revendique comme « humaniste » avant de se définir comme pianiste. Après ses confrères tels Cyprien Katsaris, Orlando Bass et Philippe Entremont, prenant prétexte de son nouveau disque 100 % Beethoven, nous avons obtenu de lui un « grand entretien » qui porte bien son nom. Jean-Nicolas Diaktine nous y ouvre une fenêtre sur son art, son travail, sa construction et ses projets sans omettre de répondre aux questions saugrenues qui pointent çà et là le bout de leur museau. À bâtons rompus, sans filet et avec une générosité qui n’exclut pas l’intelligence et la mesure, cet artiste d’une rare culture se déploie en révélant ses six défis d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Oserez-vous les relever avec lui ? Ils sont ici publiés à la file, mais vous pouvez les retrouver individuellement grâce aux hyperliens ci-dessous.
- Se comprendre et comprendre une œuvre
- Se construire et construire un programme
- Se déployer et déployer une interprétation
- Se découvrir et découvrir de nouveaux horizons
- Se trouver et trouver les autres
- S’envoler et envoler le public
Défi 1.
Se comprendre et comprendre une œuvre
Commençons in medias res : comment choisit-on un piano pour jouer Beethoven aujourd’hui ?
Pour être honnête, j’ai essayé des pianos à Paris. Ils étaient magnifiques. Trop. Je ne trouvais pas le velouté et la gradation que je cherchais. Les instruments avaient beau être somptueux, ils ne correspondaient pas aux trois sonates de Beethoven que je voulais enregistrer.
Être « trop magnifique », est-ce le pire compliment que l’on puisse faire à un instrument ?
Peut-être pour Beethoven. Beethoven, c’est pas « beau ».
« Beethoven, c’est comme la peau »
Pardon ?
Non, Beethoven, c’est pas « beau ». C’est pas lisse. C’est plein d’aspérités. C’est rugueux. C’est comme la peau. C’est vivant. Donc, comme d’habitude, j’étais désespéré de rencontrer des pianos parfaits mais qui ne correspondaient pas à mon projet. Jusqu’à ce que je dise à mon éditeur allemand que je me morfondais. Comme il travaillait avec l’Orchestre symphonique de Vienne, il m’a répondu qu’il avait des contacts en Autriche, et ces contacts pourraient avoir des pistes pour enregistrer du Beethoven.
Que fait un artiste de votre trempe dans cette circonstance ?
Presque rien. Juste une prière.
Pour quel résultat ?
Alors que cette piste semblait avoir fait long feu, mon éditeur me souffle : « J’ai peut-être trouvé un endroit et un gars. » Quand je découvre le piano, je n’en reviens pas : c’est un Steinway accordé par Karl Brandl, un spécialiste des Bösendorfer. C’était fantastique. Exactement ce que je cherchais.
Avez-vous échangé avec l’accordeur ?
Oui, de façon muette. Je lui écrivais des messages que je laissais sur le clavier pour lui expliquer ce que je voulais ou les problèmes que je rencontrais.
Pourquoi en mode muet ? Votre accordeur était sourd ?
Non, évidemment. En revanche, il venait au studio trop tôt pour moi ! D’autant que, la nuit précédant la dernière séance d’enregistrement, je n’ai pas fermé l’œil. J’étais épuisé, et j’avais l’opus 101 à mettre en boîte. Comme, en prime, j’étais d’une humeur massacrante pour des tas de raisons, impossible d’imaginer pires conditions ! Quoique… Pour jouer du Beethoven, ça peut servir. Quand on est un ronchon électrique, on comprend mieux certaines choses qu’il a écrites. Or, le matin du dernier jour, je tombe sur l’accordeur qui avait achevé son travail plus tard qu’à l’accoutumée. Je me mets au piano, teste quelques passages et vois ce monsieur se précipiter vers moi. Il me dit qu’il adore les couleurs que je tire de l’instrument, m’assure qu’un tel son est extrêmement rare, bref, me couvre de compliments qui me touchent et me prouvent que la communication avait fonctionné. Il avait saisi ce que je cherchais, et nous avions œuvré dans la même direction. Cette rencontre et la joie qui en a résulté m’ont mis dans un tel état d’euphorie que j’ai oublié ma nuit quasi blanche. Rasséréné et gonflé à bloc, je me suis lancé dans une première prise. À la fin, je lance à l’ingénieur du son : « Alors ? » Il me dit : « C’est parfait ! » Bien sûr, on a fait d’autres prises, par sécurité, mais je sentais que je ne jouerais pas mieux. Une telle conjonction de belles vibrations, c’est tellement rare !

La version de la vingt-huitième sonate choisie pour le disque est donc la première prise ?
En partie. Vous savez, c’est le mystère de l’enregistrement : quand on réécoute les bandes trois mois plus tard, on n’est plus du tout dans le même état d’euphorie, et on se demande si c’est bien la bonne bande que l’on écoute ! J’ai beau être prévenu, j’ai beau le savoir, à chaque fois, la réécoute du travail en studio me surprend.
« Cette tragédie nourrit ma réflexion »
Comme si, à chaque projet discographique, vous découvriez les affres du métier…
Peut-être cela s’explique-t-il en partie parce que j’ai gardé en moi des réflexes d’amateur.
Amateur ? En quel sens ?
J’ai eu une vie avant le piano professionnel ! J’ai passé un bac C. Mes parents se méfiaient du milieu musical. Ils ne le connaissaient pas du tout ; et, en bons enfants de juifs russes réfugiés (mes grands-parents ont émigré en 1905 et 1912 pour fuir les pogroms), ils avaient toujours l’impression d’être en état de survie. Cela reste un non-dit, mais c’est toujours présent. Par exemple, ils m’ont appelé Jean-Nicolas pour ne pas me donner un prénom juif. Au cas où.
C’est un détail qui n’en est pas un, mais vos parents vous ont eu tardivement…
Oui, ils auraient pu être mes grands-parents ! Mon père est né en 1918. À dire vrai, j’ai des frères qui auraient pu être mes propres pères. Ça crée, surtout à cette époque, une distance considérable, et ça laisse le temps à mes parents de se forger une idée de ce qu’il conviendrait que je devienne. Du moins, j’imagine, car ça m’étonnerait qu’ils m’aient laissé une page totalement vierge !
Vous le revendiquez assez pour que l’on puisse le signaler sans sombrer dans le people : vous n’êtes pas nés dans une famille ordinaire…
Ordinaire, non : je dirais plutôt que j’ai eu la chance de naître dans une famille humaniste. Mon père m’a beaucoup parlé de sa rencontre avec les hôpitaux psychiatriques. C’était sous l’Occupation. Il était réfugié sous un nom un peu falsifié et voulait faire carrière en chirurgie, mais on lui a trouvé une place d’infirmier dans un HP. Là, il a découvert avec horreur comment étaient traités les patients. Ça l’a choqué profondément. Il a pensé aux Allemands qui nous déportaient, et a constaté que les médecins français ne traitaient pas beaucoup mieux les malades mentaux. Partant, il s’est beaucoup intéressé aux tentatives pour réformer l’attitude des médecins, que régissent certains codes associés à une position de pouvoir, telle que l’expérimentent aussi les hommes de loi ou les acteurs politiques. Mon père a réfléchi aux modifications à apporter pour développer une médecine plus respectueuse.
Il vous a nourri de ses expériences…
Plus que ça : à force de me raconter des histoires, il m’a inoculé le virus du respect de l’autre. Il pointait souvent les conséquences de l’irrespect sur les malades. Il évoquait ainsi le cas d’une de ses patientes qui avait été plongée dans la schizophrénie par un médecin qui avait placé la main sur son épaule en déclarant : « On va s’en occuper, de cette petite ! » La cage s’est refermée sur la malade. Désormais, une vitre Securit la séparait des autres. Elle avait dix-huit ans. Aujourd’hui encore, cette tragédie nourrit ma réflexion.
[embedyt] https://youtu.be/iaQQo2KkBIE[/embedyt]
Dans ce contexte, vous étiez programmé pour être plutôt médecin que pianiste.
Peut-être, mais mon prof de piano était vent debout contre cette perspective. Il m’affirmait que j’étais fait pour la musique. Je chantais quand même Don Giovanni par cœur quand j’avais six ans. Gamin, je jouais aux petites voitures en écoutant les symphonies de Beethoven. Ça me paraissait normal, et je suis sûr que beaucoup d’autres enfants font de même.
Vous êtes sûr ?
En tout cas, à un moment, il faut trancher. J’avais des affinités avec la musique, sans doute, mais, comme dit Daniel Barenboim, « un enfant prodige, c’est un enfant doué avec des parents ambitieux ». Or, mes parents étaient ambitieux sur le plan humain, pas sur le plan carriériste. Ils n’étaient pas chauds à l’idée de me couper de leur projet humaniste en me laissant travailler dans un élevage de jeunes virtuoses. Aussi ai-je toujours conservé deux carrières, même si le mot peut sembler maladroit ou prétentieux – disons plutôt deux perspectives de développement : celle de ma vie de pianiste et celle de l’être humain que je suis. Pas l’une sans l’autre. Et, dans les deux cas, une évidence : il ne faut pas s’louper !
« L’homme est un arbre comme les autres »
Au long des ans, vous avez dû côtoyer des pianistes qui, eux, avaient oublié de développer leur humanisme, ou qui l’avaient banni de leurs perspectives en pensant ainsi mieux « réussir », à défaut de s’accomplir…
Parfois, je m’étonne de la dissociation entre les personnes et la musique qu’elles produisent. Les deux me paraissent si éloignées que je me demande : « Qu’est-ce qui est vrai ? » Ça peut sembler naïf, mais je préfère penser que c’est plutôt enfantin.
En quel sens ?
Les enfants ont couramment un désir de pureté qu’ils sont capables de garder très longtemps. J’ai fait partie de ces enfants ! Mon père a écrit un article intitulé : « L’enfant dans l’adulte ou l’éternelle capacité de rêverie ». Je suis sûr qu’il pensait à moi, et j’étais assez d’accord avec ce qu’il disait. Enfin, j’étais surtout d’accord avec le titre puisque, après, je n’entendais goutte à sa prose ! Le titre était clair ; le reste ressortissait de la psychanalyse, donc c’était très technique. Néanmoins, j’en retiens l’idée qu’il est bon de rester l’enfant que l’on a été. L’homme devrait être un arbre comme les autres : le cœur des troncs reste toujours le même.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UKZONIiF99U[/embedyt]
Dès lors, aviez-vous peur de perdre vos valeurs humanistes en devenant musicien ?
Je formulerais cela différemment. Je dirais que je me suis d’emblée demandé comment devenir un artiste et un humain de qualité. Et il se trouve que le maître de mon maître, Argentin, avait pour modèle, forcément, Claudio Arrau, le héros de l’Amérique latine. Or, Arrau raconte que, dans son enfance, il était assez chouchouté puisque, jusqu’à ses dix-huit ans, sa mère lui nouait ses lacets ! J’imagine que, roi en sa demeure, enfant prodige adulé dès ses six ans, il ne devait pas être d’un naturel très modeste. Si bien que, un jour, quand il avait onze ans, son maître, Martin Krause, lui dit : « Pour la semaine prochaine, tu vas m’apprendre quatre des Douze études d’exécution transcendante. » Évidemment, c’était impossible. Une semaine plus tard, Arrau n’était pas prêt. J’imagine que l’objectif était de faufiler une once d’humilité dans la tête du petit Chilien. La leçon a dû porter car, dans ses écrits, Arrau parle beaucoup de l’orgueil comme d’un énorme frein de développement. Lire cela a été très important pour moi, car je me suis méfié d’une tendance de certains pianistes à transformer la musique en show. La spectacularisation du concert, ça ne m’intéresse pas du tout, d’autant que, au lieu de masquer le vide, le cabotinage le révèle.
Ce n’est peut-être pas du cabotinage, mais quand Liszt écrit ses Paraphrases…
Pour des raisons historiques, Liszt s’est servi du côté théâtral de la virtuosité avec beaucoup d’habileté. Toutefois, aujourd’hui, cette débauche d’effets ne se justifie peut-être plus musicalement.
Vous pensez que Franz est puni par où il a pêché, sa musique « plus virtuose que musicale » n’ayant plus de charme ?
Je l’ai pensé un temps. Ce nonobstant, comme j’aime les paradoxes, j’ai rebroussé chemin, et je me suis dit : « Qui sait s’il n’y a pas quelque chose de beau à en tirer ? »
Il est vrai que l’idée que le compositeur a toujours raison est l’une de vos marottes !
Incontestablement. Quand je n’aime pas une œuvre, je postule que j’ai tort. En revanche, quand je découvre le sens de ce que je n’aimais pas, donc que je me mets à aimer ce que je n’aimais pas, je conclus que j’ai raison. J’adore cette impression d’illumination.
… qui n’est pas sans évoquer le « bodhi », l’éveil spirituel cher aux bouddhistes dont vous êtes !
En effet, je suis bouddhiste, un peu à cause d’Arrau qui évoque le zen à travers le tir à l’arc… et un peu aussi à cause d’un de mes professeurs qui m’a parlé de la pratique bouddhique comme étant susceptible de m’aider à être plus concentré.
« Je suis amoureux de la curiosité en elle-même »
Le bouddhisme est donc quelque chose de structurant dans votre pratique artistique.
Oui, car il m’a permis de retrouver les valeurs humanistes qui me tiennent à cœur. Avec cette spiritualité, j’ai appris à fusionner un dédale qui, auparavant, me paraissait constitué de couloirs cloisonnés. Ainsi, j’ai compris que je pouvais être moi-même partout et, de la sorte, me débarrasser de l’impression de devoir jouer des personnages différents, ce qui m’amenait à être incomplet à chaque fois.
Là encore, votre expérience d’incomplétude n’est pas l’expression d’un malaise anodin. Elle est constitutive de votre métier de pianiste.
Disons que, lors de mon adolescence, je faisais une psychanalyse ; j’avais un père qui était un poids lourd dans ce domaine ; j’avais une sœur et des frères qui étaient des sommités dans leurs domaines respectifs (psychanalyse, économie, ophtalmologie) ; j’avais un maître de musique ; et tout cela constituait des mondes complètement séparés, donc compliqués à gérer ! Pour m’aider, on me disait : « Choisis ! » Moi, je ne voulais pas choisir, mais je ne voulais pas non plus être une personnalité éclatée. Heureusement, j’ai trouvé dans le bouddhisme des outils pour travailler à l’abolition du dualisme, cette intarissable source de conflits. Les Japonais ont un geste très simple pour expliquer ça. Ils vous montrent une main dont ils cachent la partie inférieure, et ils disent : « Vous voyez des doigts séparés. » Puis ils montrent la main en entier, et ils disent : « Vous voyez, ces doigts font partie d’une même main. » Cette perspective, quand j’ai pris conscience de ses implications, a changé à la fois ma vie et ma perception de la musique. Lorsque je ne perçais pas le mystère d’une partition, je savais que la partition n’était peut-être pas en cause : peut-être était-ce moi qui ne savais pas la lire. Une telle hypothèse a une grande vertu, car elle attise ma curiosité.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=CqoK0MDeTyg[/embedyt]
La curiosité est donc un joli défaut ?
J’aime la curiosité. Mieux : je suis amoureux de la curiosité en elle-même. Je trouve que ça tient éveillé. Comprendre quelque chose, c’est un plaisir immense mais extrêmement passager. Si on s’arrête à cette sensation, on s’arrête tout court très vite. Vous connaissez la blague de Toto : pendant dix ans, il fait des gammes. Un jour, il s’arrête. La voisine s’étonne et toque à la porte pour comprendre. Toto explique : « C’est bon, je peux m’arrêter, maintenant, je sais. » Au début, je trouvais que cette blague était drôle. Dorénavant, je la trouve vraie. Avec Beethoven, ça marche bien !
Beethoven vous a aidé à comprendre une blague de Toto ?
C’est plutôt une blague de Toto qui m’a aidé à comprendre Beethoven ! Quand j’entends une œuvre que j’aime beaucoup jouée par un confrère et que je me dis : « Hum, non, c’est pas ça », je peux commencer mon enquête. Je veux comprendre pourquoi « c’est pas ça ». Je veux saisir ce qui fait que « c’est pas ça ».
« Quand vous êtes de mauvaise humeur, ça marche quand même »
Faute de police scientifique, vous n’avez pas beaucoup de munitions pour résoudre l’énigme…
Joli euphémisme ! En réalité, je n’ai qu’une intuition, celle qui alimente un malaise profond. Avant, cette situation me poussait presque à la dépression car j’estimais que j’étais dans l’erreur parce que je n’aimais pas. Si je n’aimais pas, c’est que je n’allais pas bien. Donc je n’allais pas bien puisque je n’aimais pas. Je mettais ma faute de goût sur le compte de mon humeur ou de je ne sais quoi. Dans tous les cas, la faute m’incombait.
Avez-vous réussi à vous extraire de ce sentiment de culpabilité ?
Heureusement ! Quelque temps plus tard, j’ai pensé que mon malaise venait de ce que, si le sens de l’œuvre m’échappait, c’est qu’une construction ou une idée m’échappait. Ce n’était ni ma faute, ni pas ma faute : il me fallait juste travailler pour comprendre ce que je n’avais pas saisi. Par conséquent, quand j’ai travaillé avec le compositeur Narcis Bonet, je ne le laissais pas prendre le lead – joli jeu de mot avec l’allemand, sans doute ! –, je venais avec une batterie de questions.
Comme ?
Eh bien, « pourquoi Bach a écrit ce truc-là, je comprends pas ». De la sorte, ce n’était plus ma faute, c’était celle de Bach. Et le travail de mon maître était de m’expliquer que, de faute, il n’y avait pas. En revanche, il y avait une raison à la bizarrerie que j’avais cru repérer et qui me chiffonnait tant.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5pbDLK40vU4[/embedyt]
Ça ressemble à quoi, pour un compositeur, une bonne raison de commettre une « faute » ?
Par exemple : « À tel endroit, il a écrit sa phrase d’une certaine façon ; donc, à tel autre endroit, il ne pouvait l’écrire autrement. » Quand mon maître me dévoilait ce genre de mécanisme, ma question se transformait en découverte, et je comprenais, dans l’exemple que je vous ai donné, la puissance d’association entre les diverses parties. Pareil, dans le deuxième Kreisleriana de Robert Schumann : j’avais beau répéter dans tous les sens le thème liminaire (sib do ré fa sol fa ré sib fa), la mise en place n’était jamais parfaite. C’était pas ça. J’ai cherché la solution chez des collègues, et leur proposition ne me convenait pas davantage. N’y voyez aucunement la prétention de l’artiste qui, selon lui, ne peut pas jouer moins bien que ses confrères, je veux ici parler de mon désarroi devant mon incapacité à comprendre le problème de partition, donc d’interprétation, que mon intuition me désigne.
Les disques ayant échoué, il vous restait la solution Narcis Bonet.
Exactement ! Je vais donc le voir et lui annonce platement que je n’arrive pas à jouer ce segment. Et lui m’explique : « Enfin, vous voyez bien que, dans cette arabesque, seules trois notes sont importantes ! Le reste ne constitue qu’un passage. » Et, comme Nadia Boulanger affirmant qu’« il suffit d’éclairer la sensible (son grand dada !) par son oreille », il m’expliquait qu’en soulignant de l’intérieur trois notes et non l’ensemble du motif, d’un seul coup, tout change.
Pardonnez la question de l’ignare et du mécréant : « souligner de l’intérieur », ne serait-ce pas un faux-fuyant ?
Pas le moins du monde quand celui qui vous a asséné cela se met au clavier pour vous montrer la différence. Certaines évidences élèvent et ne peuvent s’énoncer simplement. Donc Narcis m’a montré les notes qui étaient moins importantes. Alors, évidemment, il est impératif de jouer toutes ces octaves legato. C’est difficile à faire, il faut insister… sauf dans la musique. Il ne faut pas insister, il faut les laisser couler et insister sur les trois premières, sib – do – ré. Quand on pousse sur ces notes-là, l’évidence apparaît : c’est ça. D’autant que, quand on tourne la page, on voit que Schumann l’a indiqué à la reprise. Alors ça, j’adore. Ce qui était hermétique devient signifiant. Ce qui était brouhaha devient langage articulé. Et le magnifique, avec cette révélation, c’est que, quand vous saisissez le principe, même quand vous êtes de mauvaise humeur, ça marche quand même. C’est ça qui est fou. Le compositeur vous emmène vers ce qu’il souhaitait vous montrer, fût-ce malgré vous. La structure de l’œuvre est plus forte que l’état d’esprit dans lequel on se trouve. Voilà le genre de moment dont je raffole : quand je suis capturé par la partition. J’aime la laisser me capturer plutôt que la capturer.

Défi 2.
Se construire et construire un programme
Si vous le voulez bien, Jean-Nicolas Diatkine, recommençons in medias res : à l’occasion de la parution de votre nouveau disque, vous affirmez que Beethoven est « la base et le sommet » de votre vie musicale. Une telle profession de foi ne vise-t-elle pas à faire taire les chafouins qui soupireront en pensant : « Encorrrre un enregistrement des sonates de Beethoven ! »
Vous me demandez ce qui justifie un nouvel enregistrement de Beethoven ? Laissez-moi vous dire que je me suis posé la question. Pas que pour Beethoven : à chaque enregistrement ! Peut-être parce que je n’ai pas toujours été destiné à être pianiste, mon premier mouvement est toujours de me juger illégitime. Du coup, la question que vous soulevez s’adapte quel que soit le compositeur que je mets sur mon pupitre. On ne peut pas, hélas, la balayer d’un revers de main en prétextant la beauté des pièces, l’importance des œuvres et l’espérance qu’il reste quelques merveilles à dévoiler dans des morceaux que l’on croit connaître. On ne peut pas davantage négliger la question qui accompagne ce doute : dans un monde où beaucoup souffrent et pleurent, à quoi bon jouer Chopin ou, sans jeu de mots, Mahler ? A-t-on besoin de s’escrimer pour faire pleurer encore plus les gens, fût-ce d’émotion esthétique ?
« Beethoven a cette force d’ouvrir nos vies »
J’imagine que vous avez trouvé une bonne réponse, puisque le disque est là… et que vous êtes toujours pianiste !
Je ne sais pas si j’ai la bonne réponse, mais j’ai trouvé ma réponse à la question : est-ce que ce que je joue sert à quelque chose ? Qu’est-ce que ça apporte aux autres ? Si on ne réfléchit pas à ces questions, comment peut-on aspirer à faire de la musique ?
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LF52pD1pkPI[/embedyt]
Ce questionnement vous permet-il de rester un humaniste, alors qu’un artiste égocentré aurait rétorqué : « Mon Dieu, mais ils n’ont rien compris ! Moi, je vais leur expliquer comment jouer telle ou telle œuvre… » ?
Pour être honnête, il m’arrive d’avoir ce genre de bouffées mais, hélas, la bouffée contraire apparaît immédiatement. Ça ne tient pas la route deux minutes. Ça ne marche pas. Donc, comme toujours, il faut revenir à la partition pour se demander : dans les sonates que je veux graver, vais-je trouver une forme d’encouragement chez Beethoven ? Romain Rolland l’appelle « le consolateur ». Cela fait écho à une autre époque, certes. Il n’empêche ! Beethoven a ceci de très particulier : il a traversé des difficultés personnelles très importantes et, pourtant, il a persisté dans l’idée d’encourager les autres. Il n’est jamais tombé dans un égocentrisme tourmenté, que l’on retrouve davantage chez certains artistes de la fin du dix-neuvième siècle. Je pense que cela peut venir du fait qu’il s’est occupé de ses frères à la place de son père.
Il semble que Beethoven senior n’était pas un zozo très recommandable…
En effet, il était alcoolique au dernier degré et battait son fils bien que celui-ci prît soin des siens. Je suis convaincu que cette attitude forge un caractère. Soutenir les autres est resté gravé chez Beethoven. Ce n’est pas de l’ordre du sentiment ou de l’humeur : c’est structurel, chez lui. Il a ça. Or, quand on saisit cet altruisme dans sa musique, ça ouvre la vie. Quand on trouve sa vie trop petite, l’ouverture est une nécessité. C’est ce que dit le Sûtra du lotus de la loi merveilleuse. La traduction japonaise du chinois ancien l’appelle Myōhō-Renge-Kyō (妙法蓮華経). « Myōhō », c’est la loi merveilleuse ; « renge », le lotus ; et « kyō », l’enseignement. Entre autres, « Myō » signifie « ouvrir ». Au treizième siècle, le moine Nichiren y a ajouté le mot « nam », qui signifie « je me consacre à », pour formuler son mantra que je récite chaque jour : « Nam Myōhō Renge kyō », que l’on peut traduire par : « Je me consacre à la Loi merveilleuse du sûtra du lotus. » Il s’agit d’ouvrir en nous quelque chose ; et il y a cette énergie chez Beethoven.
Vous voulez dire que Beethoven était bouddhiste ?
Ce n’est pas du tout ce que je dis, enfin ! En revanche, quand on écoute Beethoven, on découvre des pistes qui nous ouvrent des espaces. Plus on le réécoute, plus on sent que des mondes s’ouvrent à nous. Et c’est ça, ce que je vous dis, Beethoven a cette force d’ouvrir nos vies.
« Quand j’imagine un programme, je cherche les haubans »
C’est cette conviction qui a justifié et fondé votre décision d’enregistrer trois sonates de Beethoven ?
Évidemment ! Interpréter un Beethoven libérateur, ça a du sens, de nos jours, et ça me passionne d’autant plus que j’ai pensé que je travaillais dans le même sens que le compositeur. Je me suis dit que sa musique était une forme d’encouragement ; donc, qu’en l’interprétant, j’encouragerais mes auditeurs ; et, vous le savez, quand on encourage les autres, on s’encourage soi-même.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=W1HQqLVtaf4[/embedyt]
À l’aune de votre discographie, ce disque paraît singulier voire radical. Ce n’est pas la première fois que vous enregistrez « du » Beethoven. En revanche, c’est la première fois que vous gravez une galette 100 % Beethoven. D’ailleurs, vous aggravez votre cas en choisissant trois sonates (en excluant d’autres formes beethovéniennes). De la sorte, souhaitiez-vous faire un éloge de la diversité qui se cache derrière l’apparente unicité terminologique (« sonate ») ?
Peut-être y a-t-il de ça, mais je ne l’aurais pas formulé ainsi. Au fond, le problème est le même dans toute forme de programme, et la solution définitive se fait toujours attendre : comment choisir puis agencer les pièces pour qu’elles se parlent ? En l’espèce, j’ai pensé que rien ne peut mieux mettre en valeur une sonate de Beethoven qu’une autre sonate de Beethoven. L’expérience du « Carnaval » de Robert Schumann m’a beaucoup marqué. Je l’ai enregistré avec la sonate Waldstein de Beethoven. La réception du disque a divisé les auditeurs en deux. C’en devenait drôle ! Très peu de gens m’ont dit qu’ils aimaient les deux. A posteriori, je vois que cette dichotomie n’a rien d’illogique : chaque humeur trouve agréable ce qui lui correspond. J’ai donc eu des compliments pour les deux parties du disque, mais quasi jamais en même temps.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=B-PQGZe_IGY[/embedyt]
J’imagine que, après un concert, il vous arrive d’affronter ce genre de réaction.
Oui, et ce n’est pas toujours agréable. Par exemple, je me souviens d’avoir joué un prélude de Rachmaninoff en bis, après un récital Schubert ; après, les gens ne me parlaient que du prélude de Rachmaninoff. Sur le moment, j’étais secrètement vexé. Puis j’ai compris que le prélude prenait toute la place. Il est tellement expansif et extraverti pianistiquement qu’il occulte le reste !
Surtout après une heure de Schubert…
Disons qu’il exige beaucoup moins de l’auditoire. Les 45’ de la sonate D 960 de Schubert, c’est dur pour le pianiste mais aussi pour ceux qui l’écoutent. Si, au-dessus de ce gâteau, on met de la chantilly, il est possible que les gens s’exclament : « Hum, délicieuse, cette crème ! » et ne parlent pas du tout du gâteau. Même topo pour Beethoven : quand il a présenté le sublime quatuor opus 130 à Mathias Artaria, son éditeur, celui-ci a retoqué le quatrième mouvement, une fugue monumentale, qu’il jugeait, en substance, injouable et invendable – c’est devenu la grande fugue opus 133 ; et il a exigé du compositeur un autre quatrième mouvement, beaucoup plus simple. Quand le compositeur a appris par son neveu que, lors de sa création par Ignaz Schuppanzigh et ses confrères, seuls les mouvements les plus courts de son quatuor (dans sa version avec la fugue) avaient eu du succès, il était furieux contre les auditeurs, ces « ânes » qui n’aiment que « les friandises » ! Beethoven a donc écrit un mouvement court et simple à souhait où, visiblement, il se fiche de son éditeur et de son auditoire.
Ainsi, même Beethoven avait été questionné par la mise en valeur des morceaux les uns par rapport aux autres !
C’est fort de son histoire et de mon expérience que j’essaye toujours de penser l’agencement des programmes. D’autant que, quand j’ai envie de jouer une sonate, je ne réponds pas à une nécessité sociale. Je suis beaucoup plus égoïste et ne réponds qu’à mon timing personnel. Sinon, j’en serais incapable. Après, si ça coïncide avec une demande du public, tant mieux… ou tant pis, car de si nombreux disques sont parus ou ont été réédités à l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven ! Une fois que j’ai cerné mon envie du moment, je l’imagine comme un navire et je cherche les haubans qui tireront chacun dans un sens mais tous dans la même direction. Je suis donc parti de la vingt-troisième sonate, l’Appassionata, et j’ai pensé qu’il fallait lui donner une raison de vivre.
« Il est très important que le spectateur s’ennuie un peu »
Elle n’est pas une raison suffisante ?
Il faut se rendre à l’évidence : on ne balance pas l’Appassionata comme ça. En tout cas, cela ne me correspondrait pas. Pour que je joue cette sonate, il me faut une raison, une profondeur et une résonance. Avant, j’associais l’Appassionata avec les « Thème et variations » de Haendel (ce même thème qui a inspiré à Brahms ses variations), car Beethoven adorait Haendel bien qu’il en bousculât les codes. Cela me permettait de commencer par une musique à la fois policée, savante, équilibrée et vivante… mais limitée par l’instrument dont Haendel disposait. Puis je jouais l’Appassionata, une œuvre où Beethoven casse la porte et renverse la table. Le contraste produisait son p’tit effet ! Si j’avais lancé d’emblée l’Appassionata, il n’y aurait eu ni porte à casser, ni table à renverser. Pour ce disque, j’ai pensé à la Septième sonate en Ré majeur, qui permet de préparer (justement parce qu’elle ne la prépare pas), l’irruption de la vingt-troisième, cet abyme de fureur qui sent la fumée !
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=A7fKm5MTsMM[/embedyt]
Après quoi, vous qui aimez tant l’équilibre, vous ne pouviez pas laisser l’auditeur sur un tel bouillonnement…
J’ai choisi de passer sur un mode totalement méditatif avec la Vingt-huitième ; et, là, j’ai eu un petit sentiment de satisfaction. J’avais l’impression que chaque sonate valorisait l’autre. Pour moi, il ne saurait être question de jouer une petite sonate et une grosse à côté, même si je comprends bien la logique. C’est David Lean qui disait : « Il est très important que le spectateur s’ennuie un peu. » Il commentait ainsi la séquence du puits, dans Lawrence d’Arabie, vous savez, quand, dans le désert, deux personnages puisent de l’eau et voient, au loin, au très loin, même, un cavalier qui arrive vers eux. Pour la première fois, au cinéma, on ne montrait rien. Pendant soixante secondes, pas d’action ! Le commentaire du metteur en scène m’a marqué. Comme lui, à ma façon, lorsque je construis un programme, je garde en tête cette nécessité de travailler sur l’attention de l’auditeur.
Vous voulez dire que trop de chantilly, c’est écœurant et ça ne rassasie pas ; mais trop de gâteau, c’est bourratif ?
En quelque sorte, mais en moins pâtissier !
Cette manière de construire un programme traduit musicalement vos convictions humanistes et votre refus de vous en tenir aux conventions les plus archétypales.
Je n’aime ni les cases, ni les étiquettes. Depuis tout petit ! C’est un peu à cause de Jean Gillibert, un ami de la famille qui était à la fois psychiatre, psychanalyste, poète, traducteur, dramaturge, acteur (il avait fait le Conservatoire de Paris !) et metteur en scène. Il a présenté mon professeur de piano à mes parents, quand j’avais six ans. Si quelqu’un n’était pas dans une case, c’était bien lui. Il jouait les grandes tragédies grecques, Claudel, Racine, Shakespeare ; il a joué dans le Procès de Jeanne d’Arc de Robert Bresson, entre autres ; et je crois qu’il a mis en scène La Flûte enchantée au festival de Saint-Céré. Il avait donc le problème d’être pris pour un metteur en scène chez les psychanalystes, et pour un psy chez les metteurs en scène ! Je trouvais triste cette situation, ayant moi-même interrogé – et interrogeant toujours ! – ma légitimité, jusqu’au moment où j’ai découvert qu’Arturo Toscanini avait dit de Wilhem Furtwängler qu’il était un amateur de génie. Mon sang n’a fait qu’un tour, et j’ai conclu : « Si c’est ça un amateur, je veux être un amateur ! » Comme quoi, l’effet de l’insulte (ou du compliment !) dépend de la personne qui vous l’adresse… Un sage japonais n’explique-t-il pas que « la plus grande honte, c’est d’être loué par des insensés » ?
« La musique, c’est ce qui agrandit nos espaces intérieurs »
Ce positionnement se ressent dans votre interprétation qui, tout en explorant un large spectre expressif de Beethoven, veut valoriser la capacité de simplification du compositeur – dans le livret de votre disque, vous insistez sur les palimpsestes beethovéniens, partant d’une profusion pour s’alléger à mesure du retravail. Une telle volonté de clarification guide-t-elle l’ensemble de vos interprétations, ou s’agit-il d’une spécificité que vous réservez à Beethoven ?
Non, c’est quelque chose que je redécouvre et pratique à chaque fois que je prépare un programme. En effet, la virtuosité n’est rien d’autre qu’une science de la complexité. Quand je multiplie les voix, quand je joue vite et beaucoup de notes, je peux éblouir l’auditoire jusqu’à ce qu’il ne sache plus où il est et perde pied. Par exemple, en écoutant une fugue à cinq voix de Bach, l’auditeur moyen – et même parfois, soyons honnêtes, l’auditeur supérieur – aura grand peine à vous chanter chaque voix séparément ; mais cela ne l’empêche pas le moins du monde de se sentir face à quelque chose qui le dépasse. Selon moi, c’est ce sentiment d’être dépassé qui agrandit nos espaces intérieurs. Nous parlions d’ouverture plus tôt, nous y revenons : pourquoi écouter de la musique sinon pour agrandir son espace intérieur ?
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_-EXnE0W-mE[/embedyt]
Oui, pourquoi ?
Parce qu’il y a un risque. Un seul, mais il est conséquent. Poussé à l’extrême, ce procédé ne fonctionne plus. Je me souviens d’une réflexion de Narcis Bonet commentant les deux premières pages de la sonate en si mineur de Franz Liszt. Il admirait la façon dont le compositeur maintenait la tension sans conclure aucune cadence avant la trente-deuxième mesure… ce qui est très long ! Il me disait : « Si on laisse les gens trop longtemps debout, ils en ont assez. Si on les fait rasseoir sans cesse, ils en ont assez aussi. Alors, qu’est-ce qu’on fait ? » La cadence parfaite en si mineur est d’autant plus savoureuse qu’on l’attend avec une impatience croissante depuis le début ! Le travail du concertiste est de retenir l’attention du public pour qu’il ait envie d’écouter la suite. L’abus de complexité, passé le moment où l’on en a mis plein la vue, peut susciter une lassitude. Être ébloui en permanence, ce n’est ni agréable, ni tenable !
Selon vous, Beethoven en avait pleinement conscience quand il composait ?
Oui, on voit bien comment, dans un premier temps, en excellent improvisateur qu’il était, il imprimait son émotion immédiate ; puis il se relisait et se raturait. L’exemple typique reste les trois ouvertures de Léonore, processus d’écriture étonnant s’il en est ! Ce constat vaut aussi pour les sonates. Quand on lit la conclusion de certains passages, on peut penser que c’est simple ; sauf que, lui, il lui a fallu une semaine ou deux mois de travail pour obtenir ce résultat. C’est un peu comme le théorème de Fermat : si on commence par la fin, il est évident ; n’empêche, depuis trois siècles, les mathématiciens se demandent comment Fermat a réussi ce tour de force ! Dans certaines sonates, on a le même sentiment : derrière l’évidence, on devine les repentirs. Cela vaut la peine de penser le trajet que le musicien a fait pour aboutir à ce que l’on a sous les yeux, car l’interprétation s’en ressent. Il faut éviter l’impression que l’on peut avoir, sur l’autoroute, quand on se dit : « Tiens, c’est la cathédrale de Chartres », et puis on passe à autre chose. En musique, il est important que l’on s’arrête et que l’on prenne conscience qu’il s’est passé quelque chose d’important à cet endroit-là.
Cette apparence de simplicité vaut aussi pour votre travail. Quand on vous entend jouer Beethoven, on est frappé par l’évidence et la fluidité du discours ; en revanche, quand on vous lit, on comprend le travail qui sous-tend l’évidence, et qui n’est pas que technique…
Beethoven est un compositeur qu’il faut particulièrement travailler. Ce n’est pas un compositeur émotionnel – enfin, si, mais au quinzième degré, derrière une construction musicale d’une rigueur et d’une ingéniosité démoniaques ! Donc, l’interprète doit fusionner ce qu’il est, lui, et ce qu’est Beethoven.
« Une règle doit être une porte qui ouvre sur des possibles »
Vous voulez dire que, quand vous jouez Beethoven, vous devenez Beethoven ?
Je ne le fais pas exprès ! C’est simplement parce que je vois des correspondances avec ce que je suis ; et le problème, c’est que ce n’est pas définitif. Par exemple, le disque dont nous parlons, je l’ai enregistré comme ça le jour où je l’ai enregistré. Aujourd’hui, je l’enregistrerais différemment. Demain, encore différemment. Il faut l’accepter !
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ErW7lmdG8fQ[/embedyt]
Vous rejoignez Igor Stravinsky interpelant Philippe Entremont lors d’une séance d’enregistrement pour lui lancer : « Tu sais ce qu’on fait, là, Philippe ? On n’enregistre pas une œuvre. On prend juste la photo d’un instant. »
On évolue. Aujourd’hui, quand je me réécoute, je me dis : « Non, c’est pas ça. C’est pas tout à fait ça. » Je ne veux pas corriger ce que j’ai gravé ; simplement, ça ne correspond plus à ce que je suis. Si je rejoue le mouvement d’une sonate, là, devant vous, je jouerai sûrement à un tempo différent que celui du disque, parce que je ne m’impose pas ce genre de carcan. Pour moi, une règle doit être une porte qui ouvre sur des possibles. Une porte, hein, pas la pièce elle-même.
Cette conviction vous a-t-elle animé depuis le début de votre pratique pianistique intensive, ou vous l’êtes-vous forgée au fil du temps ?
Au départ, quand je travaillais avec Narcis Bonet, j’étais convaincu qu’il existait une vérité de la partition, surtout chez les très grands compositeurs où c’est tellement organisé, et qu’il suffisait donc de jouer la partition telle qu’elle était pour que le résultat soit vivant. Je me suis rendu compte que ce fantasme n’était qu’un fantasme, et qu’il était vain. Pis : croire à la vérité d’une partition, c’est exactement comme si on essayait d’habiter le plan d’un architecte plutôt que la maison. Le plan est parfait, mais la construction est plus complexe. Y a des trous, des fenêtres qui ne ferment pas… C’est vivant !
Qu’est-ce qui vous a poussé à virer votre cuti ?
Je me suis rendu compte que je m’ennuyais. J’avais lu un entretien où Lorin Maazel estimait qu’un morceau de musique est comme un jardin dont le musicien doit connaître chaque pierre. J’ai longtemps admiré cette comparaison. Pour moi, la musique était plutôt une jungle qu’un jardin dont je connais chaque pierre ! Sauf que, une fois qu’on a analysé la partition et que ses moindres graviers nous sont connus, la contemplation peut vite sombrer dans l’ennui… J’en ai déduit que quelque chose me manquait, sans savoir ce que pouvait être ce « quelque chose ». J’étais désorienté par cette intuition trop vague. Comme souvent, c’est une catastrophe – au sens mathématique – qui m’a dessillé les yeux. Je traversais une crise personnelle quand j’ai eu envie d’aller écouter à l’Olympia Herbie Hancock et Wayne Shorter, deux jazzmen qui sont aussi bouddhistes – cela a-t-il contribué à me motiver ? Je n’en sais rien ! Toujours est-il que, quand je m’asseois à ma place, boulevard des Capucines, j’étais dans un état où… Disons que j’étais dans un état où je ne m’attendais à rien. C’est peut-être le meilleur état pour écouter de la musique. Je ne savais pas si j’avais envie d’être surpris ou non. J’étais là, point. Et, quand le concert a commencé, j’ai eu un sentiment très spécial : j’ai compris que les musiciens étaient dans l’instant présent. Pas dans le « je viens de là, je vais faire ça ». Ils étaient libres. Cette sensation était d’autant plus saisissante qu’ils jouaient une musique très complexe qui, pourtant, paraissait naître de rien sous nos yeux.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=njs0FsvFVY0[/embedyt]
Cette expérience vous a-t-elle inspiré ?
Elle a fait beaucoup plus que ça : elle a changé ma vie artistique. Je suis sorti de la salle en pensant que, si j’arrivais à cette liberté en classique, ce serait génial. C’était ça qui me manquait : laisser jaillir la musique dans l’instant. Malgré la partition et les milliards de contraintes qui l’accompagnent. En revenant au jaillissement vital qui ne peut se produire que dans l’instant vers le futur. Sans jaillissement, il n’y a plus de vie, il n’y a que des destins. Mon ambition a donc été, dans les contraintes architecturales indispensables, de restaurer le vivant. Le problème, c’est que ce défi est permanent. En enregistrant mon dernier disque, j’ai tâché de m’y tenir, en pensant : « Je suis comme ça aujourd’hui, donc je vais jouer comme ça et si, demain, j’aime pas, je trouve que c’est trop vite ou trop lent, tant pis ! Ce qui compte c’est que, aujourd’hui, je le sens comme ça. » Je ne voulais pas édulcorer, aseptiser me retrouver devant le plus grand commun diviseur de la musique. Autrement dit, une réduction du rien qui passe partout, peut plaire à chacun… mais n’émouvra jamais vraiment. Un Beethoven passe-partout : voilà exactement ce que je ne voulais et ne veux pas faire ; et c’est aussi pour cette raison que, comme vous le signaliez, Beethoven est la base et le sommet de ma vie musicale.

Défi 3.
Se déployer et déployer une interprétation
Re-recommençons in medias res, si vous l’acceptez à nouveau : vous associez une réflexion très poussée sur la partition à une volonté de suivre votre intuition, ce qui paraît paradoxal. Votre approche d’une œuvre suit-elle une chronologie – par ex. la tétralogie : travail, intuition qu’il manque quelque chose, révélation et peaufinage ?
Non, ce n’est pas aussi formaté ! En réalité, je suis très désordonné. En général, tout ce qui arrive musicalement est accidentel. J’ai parfois l’impression que mon travail est de laisser arriver l’accident. Quand j’ai trop de volonté, j’empêche la solution d’advenir.
« La solution fait partie de vous »
Vous devez vivre des moments assez délicats !
« Assez » délicats ? Décidément, vous avez le sens de l’euphémisme ! Aujourd’hui, oui, je peux répéter un grand nombre de fois le même passage, et je n’ai plus peur du moment où je pense que ça ne veut rien dire. Ça n’a pas toujours été le cas. Si chronologie il y a, disons qu’elle passe par un moment où vous croyez que tel passage doit être joué de telle sorte ; puis, au long des répétitions, vous vous apercevez que cette manière de jouer n’a aucun sens. Au début, je pensais que c’est parce que j’en avais assez, ce qui n’aurait pas été illogique. Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris que non : en fait, je découvrais que le sens que je donnais à la partition était erroné.
Votre désir de donner du sens butait contre le texte ?
Pire que ça ! Le problème est que, quand on s’est habitué à une erreur, elle semble bizarre, certes, mais naturelle, en quelque sorte. Tout se passe comme si j’avais mis des chaussures trop petites à mon interprétation.
En quel sens ?
Le premier kilomètre, ça gêne mais ça passe ; en revanche, après quarante kilomètres, ce n’est plus la même douleur !
Vous comprenez alors que vous devez changer de pointure ?
De pointure ou de modèle, je ne sais plus. J’entre alors dans une troisième phase, durant laquelle je m’interroge. Et ne croyez pas que la réponse arrive instantanément ! Au contraire, il me faut accepter que je ne sais pas résoudre l’énigme. Sans cela, je plaquerais une autre interprétation tout aussi claudicante que la précédente. Donc je dois supporter une musique que l’on croyait comprendre et que l’on ne comprend plus. Ça n’a rien de facile. Je passe par des jours assez austères…
« La solution arrive toujours par hasard »
Comment la solution vous arrive-t-elle ?
Par hasard. Comme dans Pinocchio. Un matin, Gepetto se lève, et le pantin de bois est devenu vivant. Nul ne sait comment. C’est quelque chose qui s’est débloqué dans mon inconscient. Claudio Arrau parle beaucoup du sommeil, qui le fascine par sa capacité de réorganisation. J’y crois beaucoup. Le problème, c’est que la solution ne peut être qu’involontaire. Peut-être le travail a-t-il mûri. Je l’ignore. Je ne peux que constater que, à un moment, vous rrrrrrejouez le passage, et vous vous dites : ça y est, c’est ça ! Mais vous ne saurez jamais pourquoi vous ne compreniez pas. Vous vous contentez d’oublier tous les efforts que vous avez consentis pour arriver à cette libération. Vous vivez un instant merveilleux ; et c’est d’autant plus génial que vous n’avez pas besoin d’y penser. Ça fait partie de vous.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=DDkhi9dt0TU[/embedyt]
Vous postulez que, ce qui compte, c’est le résultat que vous offrez au public, en concert ou au disque.
Oui, même si la présence du public ou du micro modifie le résultat.
D’après votre expérience, dans l’idéal, faut-il ignorer ces éléments perturbateurs ?
Non, heureusement, il ne faut pas lutter contre ! Il faut les accepter, et ce ne sont clairement pas des « éléments perturbateurs ». Comment vous expliquer ? Tout se passe comme quand vous expliquez quelque chose à quelqu’un et que, chemin faisant, vous découvrez un autre sens. Si on ne se laisse pas impacter par une présence, on demeure dans la reproduction mémorielle d’un texte figé. C’est ainsi que naît le trac : de l’envie de reproduire tel quel, en concert ou en studio, ce que l’on a répété.
N’est-ce pas l’objectif de tout interprète consciencieux ?
Surtout pas !
« Beethoven encourage les gens à se sentir en sécurité »
Pourquoi ?
La vie, c’est pas ça. Elle ne fonctionne pas comme ça. L’autre jour, mon kiné me disait : « Vous êtes dans un carcan ! » Au début, je croyais à une boutade consécutive à l’observation de l’état de mon dos, mais je me suis rendu compte que le carcan était aussi dans ma tête. L’idée qu’il faut figer les choses pour pouvoir les transporter et les montrer aux publics, c’est une contre-indication. À l’inverse, il faut arriver à avoir le plus de liberté possible pour adapter son discours à qui on le propose. Je ne vous cache pas que c’est plus facile à dire qu’à faire…
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=CxjrTeHreTo[/embedyt]
Ce doit être d’autant moins facile que le livret de votre nouveau disque témoigne de l’exigence qui vous anime. À plusieurs reprises, on croit lire un thriller où, à la place de la traque d’un meurtrier…
Vous me rassurez !
… on chasse, en lisant et relisant la partition avec vous, le tempo juste – par ex., c’est quel rythme, un allegro ma non troppo ? – ou les trilles qui vont bien. Devant ce témoignage passionnant, je pensais à Blandine Rannou qui, en substance, expliquait qu’elle pouvait passer une journée à savoir si elle allait attaquer le mordant par-dessus ou par-dessous, tout en ayant conscience que, pour l’auditeur fatigué par sa vie quotidienne, cette problématique avait, en soi, peu de chance de le captiver. Est-ce qu’il vous arrive de penser que toutes vos recherches, vos réflexions, vos remises en question, tous vos coups de déprime aussi, faute de trouver des « solutions » convaincantes, sont, sinon superfétatoires, du moins peu perceptibles ?
C’est une question très intéressante. Pour bien jouer du piano, il faut être un spécialiste, donc se poser effectivement les questions très précises et fondamentales dont j’aborde quelques exemples dans le livret. Or, à quoi bon être un spécialiste si l’objectif est de jouer pour tout le monde ? Vaudrait-il mieux pas proposer des choses simples, sans se faire trop de nœuds au cerveau, afin de communiquer de cœur à cœur avec son auditoire, et ainsi encourager les gens qui ont une vie difficile et éprouvent le besoin d’être délassés ? Longtemps, j’ai cru que les deux pôles étaient opposés. Aujourd’hui, je sais que ce sont les mêmes. Comme le démontre Beethoven en personne, plus on travaille à être cohérent, plus l’auditeur se sent en sécurité. Quand on a effectué ce travail de fond indispensable, la musique devient sécurisante. Parce qu’elle est logique. Parce qu’elle s’appuie sur un background, sur des racines. Alors, vous avez raison, les gens ne le savent pas mais, et c’est beaucoup plus important, ils le sentent.
Beethoven, que vous présentez comme très carré, très organisé, se prête donc particulièrement à ce « travail de cohérence »…
Oui, et pour une raison simple : il s’est posé ce genre de question. Il s’est demandé comment il allait écrire ce qu’il voulait écrire. Il était prêt à réécrire mille fois un passage jusqu’à ce que cela tînt. Par conséquent, essayer de comprendre le mécanisme très construit de ses sonates, par exemple, et d’en tirer des conséquences sur la manière de les interpréter, c’est essentiel pour l’auditeur qui, peut-être, vit dans un monde qu’il ne trouve pas très cohérent.
« Beethoven, c’est un espace qui ne dépend ni de l’instant, ni de l’humeur »
Pour faire une analogie synesthétique, vous posez que l’on n’a pas besoin de savoir tous les détails d’une cuisson pour sentir la différence entre un mets raffiné et un plat industriel, fade et peu nourrissant.
Je crois surtout que la musique peut apporter une impression de sécurité à son auditeur… si elle est cohérente.
Pourquoi ?
Le sentiment d’injustice n’est rien d’autre qu’un constat d’incohérence. Quand on a l’impression que tel gouvernement ne fait pas son boulot, que tel patron n’a pas une attitude saine, bref, que quelque chose est déréglé, ça crée un sentiment d’injustice. Sentiments d’injustice et d’insécurité vont de pair. On constate que, à tel moment, un décideur fait une déclaration qu’il contredit quelques jours ou quelques semaines plus tard. Ce ballotage est très anxiogène. Des gens haut placés en profitent. Nous avons la solution pour désamorcer leur projet en retrouvant notre cohérence intérieure par nous-mêmes.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Hads55-1-JM[/embedyt]
La solution s’appelle Beethoven ?
Beethoven nous tend une perche pour y parvenir. Il est très fort pour dénouer l’anxiété de l’incohérence. Son monde est tellement construit que, quand les gens se glissent à l’intérieur, ils se disent : « Ah ben voilà ! » Furtwängler parlait de la loi qui régit l’art de Beethoven. Elle crée un espace qui ne dépend ni de l’instant, ni de l’humeur. Elle s’adapte à toute forme de situation personnelle. C’est pourquoi il n’y a pas d’opposition entre se creuser la tête pour interpréter le mieux possible Beethoven et s’adresser à tous. Au contraire.
Cette absence d’opposition fonctionne-t-elle sur l’ensemble de votre répertoire, qui s’étend de Haydn à Chostakovitch ?
Avec certains compositeurs, j’ai parfois eu du mal à dialoguer. Nous avons vécu des éclipses ! À l’inverse, je comprends très bien quand Martha Argerich dit : « Schumann m’aime bien. » Je comprends que l’on dise ça car, à force de fréquenter leurs œuvres au quotidien, on s’approche très, très près, des émotions profondes des compositeurs. Et, parfois, ça n’est pas agréable. On ignore pourquoi. Est-ce moi qui n’aime plus le compositeur ou lui qui ne m’aime plus ?
« Comment Chopin faisait-il pour savoir ce que j’éprouverais ? »
Vous avez connu ce phénomène avec des compositeurs en particulier ?
Oui, j’ai connu ça avec Chopin. Je crois que j’ai énormément aimé Chopin pendant mon adolescence. J’avais l’impression que c’est lui qui me comprenait. Quand j’étais dans un certain état d’esprit, je mettais les Préludes par Claudio Arrau et, d’un seul coup, une question me traverse l’esprit : « Mais comment il le sait ? » J’avais l’impression qu’un ami me comprenait. Donc j’ai voulu devenir moi-même cet ami qui me comprend. C’est mieux ! Mais le résultat n’a pas été concluant. Plus exactement : c’était fuyant. À chaque fois que j’essayais d’attraper Frédéric, il me donnait l’impression de se défiler. C’était d’autant plus bizarre que je n’avais ce sentiment ni avec Schubert, ni avec Schumann, ni avec Brahms, ni… Non, Chopin était le seul. J’étais d’autant plus frustré que je déployais beaucoup d’efforts pour le jouer comme je souhaitais le jouer.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=hVPjkKh_NVs[/embedyt]
Quelle solution avez-vous inventé, cette fois ?
Une solution radicale : j’ai arrêté.
Pour quelqu’un de pondéré comme vous semblez l’être, n’était-ce pas excessif ?
Au contraire ! Si je n’y arrive pas, à quoi bon s’obstiner ?
Dépit amoureux, sans doute…
Le fait est que, quand j’entendais certaines autres interprétations, j’avais l’impression que ce n’était pas ça. Je dois le préciser, une fois de plus : ce que je viens d’exprimer n’est pas un jugement que je porte sur mes collègues – non, rien à voir. C’était un sentiment plus personnel, plus intérieur. Celui de ne pas entendre une version qui me corresponde ou s’approche de ce que je cherche. J’étais déçu. D’autant que j’ai travaillé les Études en long et en large, avec l’idée qu’il s’agissait d’œuvres artistiques aussi importantes que les Préludes, et non de simples – pas si simples ! – exercices pédagogiques qu’il est séant de pouvoir jouer trois fois de suite pour montrer à quel point on maîtrise son affaire. Une fois de plus, j’avais l’intuition qu’il y avait quelque chose que je n’arrivais pas à trouver.
Donc vous arrêtez de jouer Chopin.
Oui.
Jean-Nicolas Diatkine, justifiez-vous.
Oh, sous le coup de l’irritation, je me suis forgé les prétextes les plus divers.
Marchez.
Chopin est Polonais, je suis d’origine Russe.
La belle affaire !
Il avait certains côtés vaguement antisémites.
« Vaguement », c’est déjà pas si mal, à son époque.
Il apparaît sur des photos avec des poses qui me déplaisaient…
C’est-à-dire ?
Il avait l’air prétentieux.
« Beethoven n’était pas forcément sympa »
Bon, on peut être sérieux deux secondes ?
Je suis sérieux ! De tous les éléments mentionnés, j’essayais de déduire que ce n’étaient pas les œuvres qui m’échappaient : c’est juste le bonhomme que je n’aimais pas.
Donc vous en avez rajouté…
Ça s’est aggravé – malgré moi – quand j’ai lu comment ses élèves le voyaient. Le personnage, avec son apparence distante et froide, me déplaisait de plus en plus. Bien sûr, je savais que Beethoven n’était pas forcément sympa. Bien sûr, je savais que, dans mon jugement anti-Chopin, palpitaient mes projections personnelles.
Son cas semblait scellé.
Heureusement, mon ami Arnaud Dumond, compositeur et guitariste de renom, s’est étonné de cette antipathie anti-Chopin qui me privait d’une grande partie du répertoire pianistique. Il m’a très chaleureusement encouragé à la surmonter. Hélas, sa gentillesse n’a pas suffi à me faire changer d’avis. Au contraire, le livre qu’Arnaud m’a offert à l’époque pour me réconcilier avec Chopin a renforcé mon impression.
Un coup pour rien, alors ?
Non, pas pour rien ! La bienveillance d’Arnaud m’a finalement amené à m’interroger sérieusement sur moi-même, et je suis très reconnaissant à mon ami pour cela.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Ou6BKySCbQg[/embedyt]
Pour autant, Chopin n’était toujours pas votre tasse de thé !
En effet, malgré tous mes efforts, plus des gens comme Gide me racontaient le Chopin qu’ils percevaient, plus j’avais confirmation que ce n’était pas mon Chopin dont ils parlaient. Heureusement, j’ai fini par dénicher les annales d’un colloque sur Chopin. C’était un Bottin énorme rassemblant les articles de spécialistes tout azimut, dont des acousticiens et des musicologues ultra pointus. Partant, j’ai parcouru des analyses incroyables jusqu’à tomber sur une petite biographie des parents de Chopin qui a tout changé.
Diable, pourquoi ?
Les parents du petit Frédéric étaient des pédagogues très modernes, pour qui il était plus important de développer la personnalité que la performance des élèves… afin que les élèves soient heureux. Ils ont donc élevé leur fils dans cette mentalité. Pour l’époque, c’est très particulier. Et moi, ça, ça me parlait car je suis investi dans le bouddhisme sōka, qui a été fondé par deux éducateurs. Et la Sōka Gakkai, le mouvement dont je fais partie, ça veut dire « Société pour la création de valeurs ». Dans cette mouvance, il est beaucoup question de ce genre de pédagogie. Autant dire que je suis assez sensibilisé sur le sujet !
Entre la pédagogie et l’interprétation, il y a un pas, non ?
Non. Découvrir comment Chopin a été éduqué m’a enthousiasmé. J’y voyais une explication à l’incapacité de beaucoup à ne pas saisir ce qui m’intéressait chez lui : il ne correspond à aucun archétype. Il n’est pas du tout formaté. Chacun le perçoit cadré alors qu’il ne l’est pas. J’en ai conclu que c’était ça qui me dérangeait. Donc j’ai tiré ce fil pour m’imaginer qui il était vraiment ; et, là, ça s’est reconnecté mais d’une façon complètement différente.
« Jouer Chopin, c’est jouer dans le moment »
Résultat, vous avez joué les préludes à la salle Gaveau, il y a deux ans…
… et d’autres projets se profilent, car j’ai la conviction que j’ai trouvé une clef. Ma clef. En l’espèce : une des raisons pour lesquelles je n’arrivais pas à jouer Chopin, c’est que, contrairement à beaucoup d’œuvres qui sont construites, par exemple autour d’un modèle de danses polonaises, mazurkas, valses, etc., les Préludes, ce sont essentiellement des improvisations. Aussi a-t-il eu énormément de mal à les finir puisque, à chaque fois qu’il les retravaillait, il les changeait. Et je me suis dit que c’est ça ce que je sens : ces œuvres sont instables. Il n’y a qu’une solution : les créer dans l’instant. Je me retrouve avec les convictions acquises lors de l’écoute de Herbie Hancock et Wayne Shorter. Je comprends que, ce que je dois trouver, c’est l’art de jouer là, dans le moment.
Qu’est-ce que ça veut dire, pour le niaiseux, « jouer dans le moment » ?
Retrouver le jaillissement. Pas calculer « je vais faire mon crescendo là », « je vais prendre cette progression comme ça ».
Pourquoi ? C’est pas la base du travail ?
Avec Chopin, ça-ne-mar-che-pas. Or, quand j’ai pris conscience de ça, j’ai senti le vent me pousser.
Chopin a commencé à vous aimer ?
C’est ça. Enfin ! Franchement, il était temps !

Défi 4.
Se découvrir et découvrir de nouveaux horizons
Après les trois premiers défis qui permettent de mieux saisir votre travail devant une partition, passons au concret, si vous le voulez bien. En effet, vous ne vous contentez pas de décrypter et de travailler Beethoven, Chopin et les autres : vous les enregistrez aussi – quel scoop ! Comment abordez-vous la phase de captation, moment crucial que certains artistes jugent ingrat ? Et comment décririez-vous l’énergie particulière et spécifique qui vous parcourt quand vous vous retrouvez face aux micros ?
Je vis mal de me retrouver face aux micros, bien que j’aie attendu ce moment avec impatience, et bien que j’aie créé les conditions pour qu’il advienne.
Alors pourquoi ?
Parce que l’enregistrement, c’est très cruel. Pour moi, ce n’est pas un moment ingrat comme vous le soupçonnez : c’est un moment de cruauté. C’est un peu comme se regarder dans la glace en se demandant si on est beau. En studio, il n’y a qu’une piste à suivre pour désamorcer ces difficultés : il faut trouver une astuce pour sortir des contraintes qui nous paralysent.
« Lorsque l’on est concentré sur la musique, on oublie tout »
Ainsi réapparaît votre confiance en l’équilibre que vous avez évoquée précédemment : un problème n’est effrayant que si l’on ne présuppose pas qu’il n’y a pas de problème sans solution. Or, dans votre démarche artistique, ce qui est le plus problématique, ce n’est pas de voir le problème, c’est de ne pas voir le problème. Pour vous, une fois qu’il est défini, fût-ce intuitivement, le problème n’est pas un problème, c’est le début de la solution !
En tout cas, j’essaye de partir du problème pour retrouver la pulsion de vie essentielle du morceau que je dois jouer. L’objectif est d’éviter se centrer sur le narcissisme, consubstantiel au fait de s’enregistrer.
La difficulté de l’exercice est que, j’imagine, toutes les expériences ne se ressemblent pas. Plus on retourne en studio, plus on découvre que l’on n’a pas résolu le problème : le problème est multiple, il change tout le temps…
Il est vrai que j’ai vécu systématiquement des expériences différentes pour chacun de mes disques. Le problème a toujours su inventer des variants au virus de base ! Pour plaisanter mais pas que, je dirais que j’ai parfois l’impression que l’univers s’est donné le mot pour me surprendre et me dire : « Hé non, ça ne sera pas comme avant. Ton vécu ne te sera d’aucun secours. » Ma première expérience était centrée sur la Sonate en si mineur de Franz Liszt, à Sion, avec des techniciens très gentils, beaucoup de réverbération et un sublime décor de montagne. J’avais choisi de commencer les séances par les Kreisleriana de Robert Schumann. Quelle sottise ! On ne peut pas enregistrer cette pièce de but en blanc, alors que, émotionnellement, on est froid. En même temps, il faut toujours commencer par quelque chose… Donc j’ai dû revenir à Schumann à la fin des séances et, là, ça s’est ouvert alors que ça s’était refusé jusqu’ici. Pour jouer cette musique, il faut être chaud et fou. Il ne faut pas être dans le calcul et la prise de risque très timorée. Le plus gros danger, c’est de trop maîtriser parce que l’on est intimidé par les micros.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9D6B5B39ERI[/embedyt]
Pourquoi est-ce dangereux ?
Parce que l’on n’est pas soi-même. On est trop contraint. Heureusement, il y a l’œuvre.
D’autant que vous avez une préférence pour les gros morceaux – ce que le pianiste normalement constitué appelle, dans sa musicologie personnelle, les « trucs injouables » !
En effet, on me demande parfois pourquoi je me coltine des bêtes de cet acabit.
Fanfaronnade ?
Paradoxe.
Bon, d’accord, vous avez gagné. Expliquez-vous, avant que l’on entame une partie de Kamoulox.
Les chefs-d’œuvre d’une grande complexité m’aident dans l’épreuve de l’enregistrement. Ce sont des œuvres d’une force incroyable. Plus il y a de force dans l’œuvre, plus on s’oublie. Or, en studio, le risque est toujours de ne pas s’oublier. Je pense beaucoup à Sharon Stone à qui une apprentie actrice issue d’un milieu très religieux demandait comment elle avait pu tourner la scène la plus osée de Basic Instinct ; et elle a répondu cette chose extraordinaire : « Si vous tournez une scène de nu en pensant que vous êtes nue, c’est que vous n’êtes pas concentrée. » Cette phrase m’a beaucoup aidé car, à la réflexion, il est certain que, lorsque l’on est concentré sur la musique, on oublie tout. Le piano. Là où on est. Les micros. Mieux : on s’oublie soi. À l’inverse, quand on est en train d’essayer tout maîtriser, on n’est plus dedans. On n’est plus dans la musique.
« Cette fois, une seule personne avait raison : moi »
Vous laissez entendre que, si l’on veut analyser ce que l’on joue, on est fatalement à l’extérieur de la musique… laquelle exige, au contraire, d’être jouée de l’intérieur ! Peut-être voit-on ici la logique de votre démarche analytique : s’il faut réfléchir à l’interprétation, tempi et intentions compris, c’est avant, pas au studio. Votre deuxième expérience discographique a-t-elle confirmé cette cartographie diachronique (si, si) de l’art d’enregistrer ?
Pour mon deuxième disque, j’ai pris mes quartiers à la salle Colonne. Les conditions étaient presque complètement différentes de celles que j’avais connues à Sion. Le piano était toujours magnifique ; l’équipe était toujours très sympa ; en revanche, la réverbération était nettement moindre… et les deux parties de mon programme ne me facilitaient pas la tâche tant elles étaient différentes. D’un côté, il y avait Beethoven, un compositeur qui vous « fait devenir », comme dit Wilhelm Furtwängler, c’est-à-dire un compositeur qui vous installe puis vous développe ; de l’autre, j’avais choisi Schumann, qui est toujours dans un état post-hallucinatoire, d’où une musique fantasque, imprévue, surprenante. Bref, il s’agissait de deux mondes résolument distincts ; et il me fallait néanmoins passer de l’un à l’autre. C’est comme Peter Sellars dans Docteur Folamour de Stanley Kubrick, où il joue trois rôles. Il était même prévu qu’il en interprétât un quatrième – il l’a refusé en expliquant que c’était trop lourd. Ce pari audacieux résonnait avec ce que je ressentais en enregistrant Beethoven et Schumann dans la foulée. Nouveau disque, donc nouveaux apprentissages !
Comment s’est passée la captation du disque Schubert à Berlin ?
Très différemment, à cause du compositeur. Pour jouer du Schubert, il ne faut pas s’interrompre. Du coup, on ne sait pas si on joue beau ou bien. Toute la concentration est mobilisée par l’œuvre. C’est comme le rêve, quand on se réveille et que l’on veut refaire ou poursuivre l’histoire. Si vous vous risquez à ça, vous ne rêvez plus, c’est fini. Donc, pour cet enregistrement, j’ai souhaité rester dans le jeu. Je ne voulais pas m’écouter. Si je m’étais écouté, j’aurais crevé la bulle schubertienne où je souhaitais me lover.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4SjAAimmRlI[/embedyt]
Il vous fallait néanmoins un contrôle…
J’avais mis mon sort entre les mains d’un directeur artistique – pas le pire : j’avais choisi Martin Sauer, de Teldec, une pointure qui sait ce qu’il veut. Ce choix acté, je me suis laissé complètement manipuler par lui. Ne lui avais-je pas accordé ma confiance ? À moi les doigts, à lui les oreilles. Le résultat a été assez surprenant.
Si bien que vous avez choisi un nouveau mode de fonctionnement pour votre dernier disque.
Oui, et c’était encore pire puisque j’ai décidé qu’une seule personne aurait raison : moi. Donc je n’avais pas besoin d’aller vérifier ou de réécouter. Je savais ce que j’avais joué de correct et ce qui serait moins utilisable.
Le paradoxe, quand on a toujours raison, n’est-il pas que l’on peut se tromper ?
Évidemment, je me suis peut-être trompé ! Mais mon aplomb s’entend, me semble-t-il, comme on peut parfois entendre le manque d’assurance de certains collègues. Pour ce disque, j’ai décidé de dire plutôt une chose fausse avec aplomb qu’une chose juste en n’en étant pas certain.
« Je veille à ne pas virer maniaque »
Êtes-vous méticuleux jusqu’à intervenir dans les détails techniques de la captation, ou laissez-vous plutôt libres l’ingénieur du son et les hommes de l’art ?
Pour moi, l’important, c’est le point de départ. Je dois expliquer la couleur que je souhaite, et nous devons obtenir ce qui s’en approche le plus. Quand j’entends le son, je sais immédiatement si c’est ça ou pas. Je n’ai aucun doute. Je sais trop ce que j’espère entendre. Une fois que nous nous sommes mis d’accord sur le son, je ne remets plus en question les réglages.
Pour les amateurs d’horoscope, sera-ce votre côté taureau ?
Oui. J’assume la responsabilité. C’est logique, non ? Je choisis le piano, la réverbération, la couleur ; après, je fonce et laisse l’ingénieur naviguer dans son espace. Je ne change jamais de son en cours de route. La seule chose que l’on a faite, pour le premier disque, consistait à modifier légèrement la couleur du piano entre Schumann et Liszt. J’aurais préféré changer d’instrument, mais c’était inenvisageable. On a refait ça aussi entre Schubert et Brahms, car je voulais un rendu plus rond pour le second. Mais je veille à ne pas virer maniaque ! Dans ce domaine, le meilleur conseil m’a été donné par un ami metteur en ondes à Radio-France, quand il m’a dit : « Si tu réécoutes ton disque, prends un whisky et pense à autre chose. »
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8bLX3sQHR9Y[/embedyt]
À défaut d’être maniaque, vous êtes le producteur de votre disque après avoir esquissé un label appelé JND. Cette position fait sens. Jadis, l’autoproduction n’était qu’un faute-de-mieux : personne ne veut de moi, je vais m’en occuper seul. Aujourd’hui, elle est devenue monnaie courante (peut-être parce que la monnaie n’est pas si courante, justement) et, souvent, signe un engagement personnel et une revendication de liberté propre à l’artiste. Travailler avec une production extérieure doit être plus confortable mais exiger des compromis parfois douloureux ; à l’inverse, se produire, fût-ce au creux d’un label installé comme Solo musica, doit offrir à la fois plus d’indépendance et plus d’inquiétudes non-musicales. Comment le musicien que vous êtes dialogue-t-il avec le producteur que vous êtes aussi ?
Pour le disque Schubert-Brahms, une production extérieure était à l’étude. L’équipe qui la portait souhaitait idéalement entendre les huit Impromptus de Schubert. Comme nous avions travaillé ensemble sur un autre projet, j’étais plutôt enclin à céder à leur demande. Cependant, après réflexion, j’ai estimé que c’était impossible. Huit impromptus de Schubert à la file, je trouve ça indigeste. Je suis donc reparti dans mes questionnements sur l’équilibre d’un programme, et j’ai décidé de jouer, d’une part, les quatre Impromptus op. 142 que je n’avais jamais joués, ce qui représentait un gros défi ; et, d’autre part, j’ai décidé de mettre exactement le contraire. Comme n’aurait pas dit Verdi, c’est ça la force du destin : quand un musicien se retrouve producteur, la nécessité musicale est devenue primordiale.
« On est loin de la course automobile »
Vous n’avez jamais été tenté par le côté rassurant et plus visible d’un disque produit par une major ?
Je n’ai pas de position tranchée sur la question. À un moment, la porte s’est entrouverte, mais l’affaire ne s’est pas concrétisée.
Vos interlocuteurs ont été gagnés par une certaine frilosité ?
Il faut admettre que, financièrement parlant, le classique, ça ne rapporte rien. Même chez les majors. Pensez ! Certains organisateurs de concerts gagnent de l’argent en gérant des courses de voitures ou des événements liés au football… et viennent le dépenser en investissant énormément sur les têtes d’affiche de la musique classique. Ils ne gagnent pas d’argent grâce aux concerts ou aux festivals ; ils vivent grâce à d’autres domaines.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=s1qlMYRcPII[/embedyt]
Bon, puisque c’est la solution, soyez honnête : organisez-vous des courses de voitures ?
Non. Quand je dois produire un disque, c’est parce que je ressens plus qu’une nécessité musicale : un impératif. On est loin de la course automobile ! Ce n’en est pas moins bizarre… De temps en temps, je me demande si ce que je fais est bien raisonnable. Puis j’en conclus que, si je choisis d’enregistrer un nouvel album, c’est que j’ai trouvé une singularité. Sinon, ce n’est pas la peine car, je vous l’accorde, j’enregistre des pièces qui ont été enregistrées plus de mille fois. Il n’y a qu’une manière de justifier la folie de les graver à mon tour : cela m’est nécessaire. À moi. C’est totalement égoïste, mais cela me paraît faire totalement sens.
Peut-être ce que vous appelez « égoïsme » doit-il lutter contre votre modestie. En effet, vous produisez votre disque, ce qui laisse imaginer que vous allez vous échiner pour le rendre incroyablement visible. Or, non, vous n’êtes pas un artiste 2.0. Votre production n’est pas assise sur un crowdfunding. Votre site est désactivé. La dernière vidéo sur votre chaîne YouTube date d’il y a quatre ans… et elle ne parle pas de vous. Je ne sache pas qu’Instagram ou TikTok vous tente particulièrement. Est-ce, par exemple, par désintérêt, volonté de se concentrer sur la musique, désamour prudent devant le jeu parfois délétère des réseaux sociaux, ou manque de conviction sur ce que la cyberautopromotion, fût-elle déguisée, peut apporter à un artiste ?
C’est un peu un mélange de ces hypothèses. Je dirais déjà que je suis conscient de ne pas être un pratiquant frénétique de l’autopromotion, activité qui est assez incompatible avec ma nature. Mais, attention, je me soigne ! Pour ce disque, je travaille, côté promotion, avec Laurent Worms ; un producteur devrait se charger de mon prochain concert salle Gaveau ; bref, je préfère déléguer la promotion aux gens dont elle est le métier. D’autant que je n’ai jamais été très bon dans l’exercice. Vous expliquer pourquoi, j’en serais incapable.
À cause du temps ?
Bien sûr, il en faut beaucoup, pour s’occuper correctement ce genre de joyeusetés ! Peut-être aussi parce que la substance du message qu’il faut penser et faire passer est : « Achetez-moi parce que je suis meilleur que les autres. » Et on est obligés d’en être convaincus, sinon on ne peut pas se vendre !
« Facebook n’a aucun impact sur le remplissage des salles de concert. Aucun, aucun, aucun »
Avez-vous réussi à élaborer des pistes pour vous visibiliser néanmoins ?
Je sais que je pourrais réactiver mon site, mais je ne suis pas tout à fait convaincu de l’intérêt d’une telle tâche. J’essaye plutôt de créer un cercle vertueux alternatif. Des rencontres. Des projets. Des voies de traverse. Parfois, ça a « bien marché ». Par exemple, quand j’ai accompagné des chanteurs, j’ai enchaîné les dates… grâce à eux, car ils avaient déjà leur système. Aujourd’hui, la question serait : à qui je veux m’adresser et comment ? Je pense à cela aussi à l’autre bout de la chaîne, par rapport à la critique. Quand le temps passe et que vous relisez les articles qui ont été écrits sur vous, vous ne pouvez pas être insensible si vous pensez que des gens vous ont écoutés avec cœur et raison, et ont émis un avis motivé voire juste sur votre travail. De là à aller chercher les spectateurs un à un…
Malgré votre mea culpa sur votre frilosité 2.0, reconnaissons que vous avez quand même une page Facebook…
Une page et un mur, s’il-vous-plaît. J’essaye de les nourrir tous les deux, et je ne crois pas à avoir à rougir sur ce plan ; mais je préfère penser que ce que je fais de mieux pour l’autopromotion, c’est le disque.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GgNoFGEBSfc[/embedyt]
Justement, pour le vendre, vous pourriez vous montrer devant votre piano, ou muni d’un café au bord du prochain train que vous allez prendre, ou vous pourriez demander à vos fans de prendre en photo leur exemplaire dans une situation pittoresque… À l’évidence, vous ne souhaitez pas user de ce type de communication ou faire rêver le pékin avec votre vie d’artiste !
Je n’ai aucune idée de ce que je devrais faire. Ne croyez pas que peu me chaut, j’ai travaillé avec des communicants. L’une d’elles m’a poussé à beaucoup communiquer sur Facebook. Ça n’a eu aucun impact sur le remplissage des salles de concert. Aucun. Et, quand je dis « aucun », ce que je veux dire, c’est « aucun, aucun, aucun ». C’est impressionnant. Deux mondes parallèles semblent s’approcher sans jamais qu’une once de porosité n’apparaisse et ne m’encourage à poursuivre dans cette voie. J’avais l’impression d’être un avatar qui parlait à d’autres avatars. Donc je me suis posé la question de savoir si on existait « pour de vrai » sur Facebook, ou si ce n’était que fumée. Les résultats que j’ai obtenus m’ont amené à privilégier la seconde hypothèse, bien que je me pose encore des questions.
« J’ai eu énormément de chance »
Tout pousse à penser que vous préférez le concret, ce qui n’est certes pas une insulte. Jusqu’en 2020 exclu (alors que la Vingt-huitième sonate de Beethoven, que vous vous apprêtiez à enregistrer, était au programme), vous avez créé la tradition du concert diatkinien à la salle Gaveau. En dehors de sa nécessité musicale, votre nouveau disque (l’anagramme s’impose : encore plus concret qu’un concert !), est-il aussi une manière de garder le lien que vous avez su tisser avec votre public, en dépit de l’incompréhensible interdiction persistante des concerts ? Ou est-ce davantage une astuce pour conserver votre exigence artistique alors que, sans concert et sans disque, un virtuose pourrait s’acoquiner avec celui que Georges Bernanos, dans Les Grands Cimetières sous la Lune, appelait « le démon de [s]on cœur », le seigneur « À-quoi-Bon » ?
Je vous dois un aveu. J’ai eu une chance merveilleuse de porter ce projet à ce moment. Comme le programme Beethoven était inscrit dans mon timing artistique, Laurent Worms m’a suggéré d’enregistrer. J’ai accepté parce que j’ai confiance en lui. Nous sommes tous deux dans une démarche qui n’est pas utilitaire, mais artistique, avec des questions sous-jacentes comme : est-ce que le projet paraît signifiant et mûr ? J’ai pris conscience que je n’aurais plus d’autres occasions d’être aussi habité par un programme que j’avais dans les doigts et qui, au moment où l’idée affleure, était bouillant.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=RHoiz6dnsHk[/embedyt]
Vous dites parfois que vous avez le sens du moment.
Je le crois, même si le confinement a retardé le projet ! Malgré cela, j’ai eu la chance de traverser la frontière pour aller à Vienne et à Munich. Je suis aussi tombé malade – très légèrement, par chance encore ou parce que j’ai quelques défenses, aussi. Et, pourtant, le disque s’est fait. Quand je revois l’année 2020, je me rends compte que j’ai été, sur ce plan, un peu veinard… Non, tant pis pour la répétition, je dois l’admettre : j’ai eu énormément de chance, qui plus est pour travailler dans des conditions optimales d’enregistrement. En bouddhisme, il existe une parabole mettant en scène une tortue borgne qui vit dans l’eau. La tortue remonte du fond des mers une fois tous les trois mille ans et qui, pour se réchauffer le dos et se refroidir le ventre, doit trouver un morceau de bois de santal exactement à sa taille. Quelle est la probabilité pour qu’une telle tortue trouve un tel bois de santal tous les trois mille ans ?
Vous avez été la tortue la plus chanceuse de l’histoire de la tortuité ?
Peut-être. Avoir trouvé cet endroit, à Raiding, près de Vienne, était une bénédiction. Avoir pu concrétiser le projet malgré le confinement, une autre. Du coup, je n’attends rien. Je suis déjà infiniment reconnaissant de la chance que j’ai déjà eue. Vu le contexte général et celui de ma propre vie, a posteriori, je trouve que l’existence du disque est joyeusement incroyable.
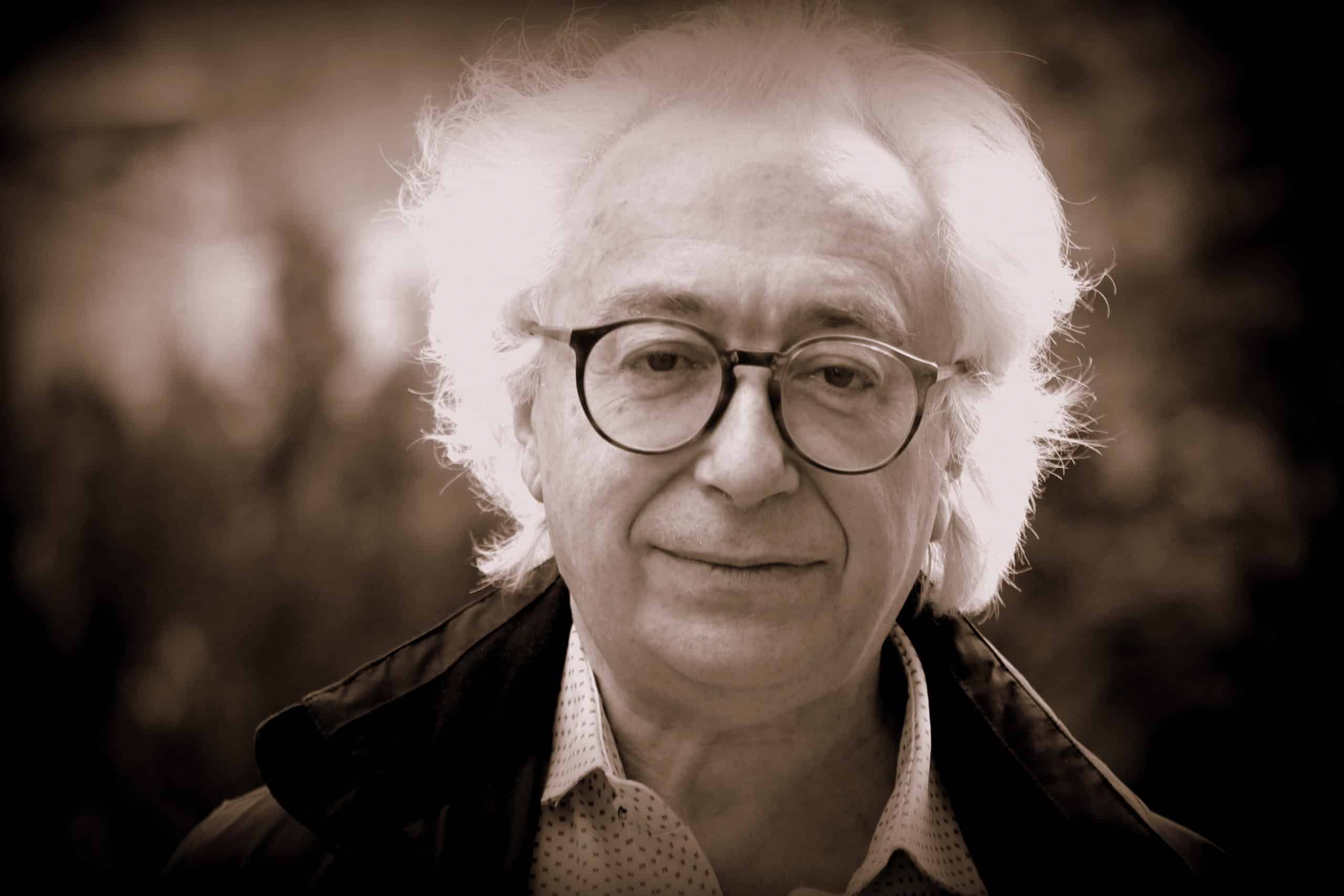
Défi 5.
Se trouver et trouver les autres
Nous avons jusqu’ici abordé votre carrière de soliste. Toutefois, même un soliste peut – voire même a intérêt à – ne pas être « qu’un » soliste. Ainsi, Philippe Entremont, pianiste et chef, explique que son maître conseillait aux pianistes d’aller passer une journée dans la vie d’autres instrumentistes pour mieux comprendre les couleurs de l’orchestre dont le piano pourra se nourrir. Vous avez vécu une expérience similaire puisque, sur les conseils de Frédéric Chopin en personne, vous avez fricoté avec le chant et les chanteurs. Notons que c’est rare, chez les virtuoses, si vite effrayés à l’idée de froisser leur habit de soliste (je me souviens d’une artiste qui avait été vexée que je la présentasse comme « chambriste et soliste » et non l’inverse…). Or, vous avez accompagné deux chanteurs lyriques et travaillé comme coach dans l’école de chant qu’Yva Barthélémy a fondée en 1975. L’heure du bilan a sonné : Chopin a-t-il raison de conseiller aux pianistes de travailler avec les chanteurs ?
Il a mille fois raisons, c’est sûr et certain. D’accord, ma conviction est peut-être aussi ferme parce que j’ai eu la chance de rencontrer un grand professeur de chant et, par la suite, des artistes de très grande qualité ; mais elle ne souffre pas contestation pour autant.
« Il n’est écrit nulle part comment bien interpréter Rossini »
Que vous a apporté la découverte des chanteurs ?
La première expérience que j’en ai tirée, c’est que – cela paraît à peine croyable – l’on peut être chanteur et ne pas savoir respirer. Je m’attendais à ce que, physiquement parlant, le fait d’accompagner un chanteur lyrique m’aiderait à apprendre à respirer, par empathie ou synergie ; or, ç’a été l’inverse. Je me suis rendu compte que la respiration est dans la partition. Donc, souvent, il me revenait d’aider le chanteur à respirer.
Qui vous a appris votre travail de répétiteur DeLuxe ?
Chaque personne avec qui j’ai travaillé m’a appris mon travail ; toutefois, l’essentiel, je l’ai appris par accident, comme d’habitude. Vous savez bien que, selon moi, tout arrive par accident ! Un jour, Alicia Nafé m’a appelé en me disant : « J’ai un concert à préparer pour le Grand auditorium de Madrid. Je répète avec le chef italien d’un chœur important. Il a été l’élève d’un assistant d’Arturo Toscanini. Il est ultra compétent musicalement mais, sur le plan digital, il a de grandes difficultés, surtout dans les redoutables tierces de la « Regata veneziana » de Rossini. Je sens qu’il ne s’en sortira pas. Il accepte que tu le remplaces ; et toi tu es partant ? » Plus que partant, je suis parti illico ! [Sur la vidéo infra, un conseil : filez directement à 1’38 !]
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BXfF1LaQqnk[/embedyt]
Avec quel bénéfice pour votre pratique pianistique, cette fois ?
Ce n’était pas que pianistique : c’était plus généralement artistique. Cette expérience m’a donné la chance à la fois d’accompagner Alicia pour un concert très important, et d’être moi-même coaché par quelqu’un qui connaissait mieux que personne tout ce que l’on devrait savoir pour interpréter Rossini.
Quoi, par exemple ?
Les secrets de l’interprétation de Rossini sont préservés par des traditions orales qui ne se transmettent que de maître à élève, de bouche de druide à oreille de druide, si vous préférez. Ce maître-là m’en a transmises quelques-unes.
Vous qui analysez en profondeur les partitions, que vous manquait-il, cette fois ?
Ce n’est pas tant qu’il me manquait quelque chose, c’est que j’en avais trop.
Trop de quoi ?
Dans la « Regata », tout est hypercarré, de sorte que, si l’on déroule le texte musical tel quel, quatre mesures par quatre mesures, ni la musique ni le chanteur ne peuvent respirer. L’accompagnateur que j’ai remplacé m’a expliqué comment procéder plus subtilement. Cela consistait à permettre à Alicia, en silence, de contrôler le tempo, c’est-à-dire de contrôler sa respiration.
Vous n’en aviez pas l’intuition ?
Impossible, ce sont des choses qui s’apprennent ; et ce que m’a appris ce chef de chant était une révélation. En effet, dans la partition, vous ne trouverez jamais spécifié la dilatation ou la rétractation du tempo pour s’adapter à la respiration du chanteur. Or, c’est particulièrement facile à faire quand, comme chez Rossini, l’écriture est très carrée, car on sait très bien où on en est, de quel côté du carré on se trouve.
« En musique, les contraintes servent à respirer »
Cela vous a permis d’être un meilleur accompagnateur ; mais cela vous a-t-il aidé à progresser encore dans l’art pianistique ?
Vous avez raison, ce qui s’est passé était plus qu’une révélation sur l’art d’accompagner, et même plus qu’une exégèse pratique du belcanto italien. Dans un troisième temps, cette déflagration a aussi influé ma compréhension de Chopin.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=HLdK3eWNzzg[/embedyt]
Pour vous, Chopin est résolument un compositeur belcantiste ?
Spécifiquement dans les Nocturnes, où j’avais l’impression qu’il voulait imiter de très près les chanteurs. Dès lors, je me demandais : que se passerait-il si un chanteur chantait vraiment la mélodie ? Comment l’accompagnerais-je ? Je vous garantis qu’accompagner un chanteur change en profondeur l’appréhension des nocturnes de Chopin et éclaire son conseil d’aller écouter les chanteurs.
En jouant Rossini, vous avez donc trouvé votre solution chopinologique…
Oui et non, car cette solution contenait un nouveau problème : pressentir la proximité ouvrait un chemin, mais ce n’était qu’un chemin. Il me restait à l’explorer. En musique, il faut se méfier des « voilà la vérité », et se souvenir qu’emprunter soi-même un chemin occasionne davantage de découvertes que de voyager les yeux bandés dans une voiture conduite par un autre. Demeure une évidence qui me nourrit encore aujourd’hui : le voyage que j’ai fait vers et avec les chanteurs m’a permis de retourner, changé, vers mes partitions.
Est-ce ce qui vous a poussé à coacher des chanteurs ?
Oui.
Alors, parlons français et concret : que recoupe ce terme de « coach » ?
Ce n’est pas l’exact équivalent chef de chant, car je n’ai pas la formation ad hoc. En revanche, il s’agit pour moi d’aider le chanteur à lire la partition. Ma tâche consiste à lui montrer l’ensemble des informations qu’il peut tirer de ce qui est écrit.
Vous voulez dire que les chanteurs sont nazes en…
Je veux dire que les chanteurs sont très concentrés sur leur instrument. Heureusement ! Il est si délicat ! La contrepartie est que beaucoup d’entre eux n’explorent que superficiellement la partition. Ce n’était pas le cas, par exemple, de Maria Callas. Elle jouait du piano, ce qui l’aidait à intégrer une connaissance extraordinaire de la partition… ce qui, en suite, la poussait sans doute à exécuter le texte d’une manière aussi extraordinaire. Elle n’avait aucune complaisance à son endroit, ne se permettait aucun passe-droit, et ne dérogeait jamais aux exigences de la partition, si impressionnantes fussent-elles. La partition était son moyen d’expression. Contrairement à ce que l’on s’imagine parfois, la partition n’est pas une austère cellule monacale dans laquelle chaque musicien contrit ne s’autoriserait pas même à respirer. Au contraire, je persiste et signe : en musique, il faut se servir des contraintes pour respirer.
« Je ne pratique pas le sport qui consiste à transposer à la dernière minute »
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=R-Wuqu9IKgI[/embedyt]
Fort bien, filons votre métaphore. Vous, le soliste, n’étiez-vous pas à l’étroit dans votre cellule d’accompagnateur ?
Ah, si ! Accompagner est dur pour l’ego. Posons que cela rend d’autant plus savoureuses les bonnes surprises.
Comme ?
Oh, rien d’extraordinaire, en général. Mais quand, déjà, un critique remarquait que j’étais là, quelle fierté ! Alors, si, en plus, il laissait entendre que je ne jouais pas si mal et que j’aidais plutôt bien la cantatrice…
À propos, quelles relations avez-vous noué avec les artistes que vous avez accompagnés ?
Je vois où vous voulez en venir. Certes, par rapport à l’image qu’il se fait de lui-même, l’accompagnateur peut souffrir ; mais il peut souffrir encore plus quand la relation avec les chanteurs est compliquée. Par chance, Alicia Nafé et Zeger Vandersteene…
… ténor avec qui vous avez enregistré deux disques de mélodies, l’un de Duparc, l’autre de Bizet…
… oui, Zeger comme Alicia sont des artistes extrêmement humains. Ils fonctionnent plutôt sur le registre de la complicité que sur celui de la domination. Tous les grands chanteurs ne peuvent en dire autant. Certains pianistes très connus ont fait des dépressions nerveuses après de mauvaises expériences quand ils ont accepté, comme une fatalité, d’être mal traités.
Mal traités comment ?
Bah, par exemple quand, au moment d’entrer sur scène, on vous demande de baisser la partition d’un demi-ton et que vous devez accompagner plutôt « Erwartung » d’Arnold Schoenberg qu’« Au clair de la lune », même un champion de la transcription à vue peut rêver d’une attaque cardiaque dès la onzième mesure…
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=nSs8sOtunpE[/embedyt]
Vous qui n’avez pas l’air d’un va-t-en-guerre, comment avez-vous réglé ce problème ?
J’ai prévenu que je ne pratiquais pas ce genre de sport. C’était l’avantage de ne pas être membre du sérail des accompagnateurs de métier : je n’ai eu aucun complexe à poser d’emblée que les chanteurs devaient s’adapter à la partition comme je m’y pliais. Pour autant, j’ai évidemment conscience qu’un accompagnateur est partie prenante du récital. Il est coresponsable de ce que va produire la cantatrice laquelle, néanmoins, sera tenue pour seule responsable en cas d’exécution moyennement satisfaisante. Donc, même si les excès comportements de certaines vedettes peuvent paraître extrêmes à tête reposée, il faut les comprendre dans une certaine mesure – et dans une certaine mesure seulement – parce que, à exigences extrêmes, tension extrême. À un certain niveau, tous les chanteurs ne savent pas gérer cette tension sans provoquer des dégâts collatéraux dont les accompagnateurs peuvent souffrir.
« Tout est dans l’intention »
En réalité, en acceptant d’être accompagnateur et coach vocal alors que vous développez essentiellement une carrière de soliste, ne contribuiez-vous pas à creuser votre singularité ?
Comment cela ?
Vous étiez singulier parmi les accompagnateurs – vous l’avez dit vous-même, vous n’êtes pas du sérail. Mais vous êtes aussi singulier parmi les pianistes.
Comme beaucoup de pianistes, non ?
Non, et j’en donne mieux qu’un exemple, presque une preuve. Dans la partie biographique du livret qui accompagne votre disque, il y a quelque chose d’extrêmement rare parmi vos pairs. La plupart des solistes instrumentaux abordent cet exercice du CV à la troisième personne en dégainant leurs diplômes de conservatoire et leurs prix internationaux. Plutôt que de plastronner, vous préférez parler de ce qui vous constitue et justifie, notamment, votre activité pianistique : votre attachement viscéral aux « valeurs humanistes ». Comment donner de cette perspective une idée concrète, si un tel oxymoron a un sens ?
Nous pourrions définir la « pratique de l’humanisme » comme un projet de vie visant à abattre les murs que l’orgueil dresse entre les gens, entre les pauvres et les riches, les bien-portants et les malades, les jeunes et les vieux, les vivants et les morts, afin de les englober dans un tout grâce à un dialogue volontaire et déterminé.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xFl9zxKM0xQ[/embedyt]
Dont acte pour l’intention générale : voyons à présent, en musique, ce que cela donne. En quoi êtes-vous un humaniste quand vous enregistrez, montez et proposez aux acheteurs de disques votre version des sonates de Beethoven ?
C’est une question essentielle, parce qu’elle remet l’intention au cœur du geste musical. Pour moi qui crois et essaye de pratiquer sans relâche les valeurs humanistes que vous évoquez, tout est dans l’intention, donc dans la question : pourquoi fais-je ce que je fais ? Notez que la question n’est pas réservée aux artistes. Chacun peut se poser la même.
Et vous, quelle est votre réponse ?
Moi, quand j’enregistre trois sonates de Beethoven, ce n’est pas pour m’exhiber. Bien sûr, j’existe en tant que musicien et, par conséquent, je dois montrer que j’existe. Pour partie, le disque a sa raison d’être dans cette évidence. Néanmoins, ce qui me motive est quelque chose d’essentiel dans le bouddhisme, à savoir la conviction que chaque personne a une capacité d’illumination. Attention, je ne viens pas de vous énoncer une théorie ! Il s’agit d’une pratique qu’il n’est pas toujours facile d’appliquer, comme beaucoup de pratiques !
Alors envisageons un cas concret : si un critique vient dire que votre disque est nul, vous croyez toujours à sa capacité d’illumination ?
Si cela advient, je constate que la négativité existe partout. Je le sais, ça ne me réjouit évidemment pas, mais c’est comme ça, je ne vais pas feindre d’être surpris. Le bouddhisme nous apprend à penser que, malgré leur négativité, les personnes négatives restent capables de bonté et d’illumination. Voilà d’où vient ma motivation. Parce que je crois en cela, je dois créer un vecteur d’illumination ; et la musique est un vecteur parmi d’autres. Puisque j’essaye de parler le langage musical, j’ai pensé que ça valait la peine de se battre pour que ma musique fasse écho ou réveille la capacité d’illumination de chacun. Mon maître bouddhique disait : « Chacun a de la capacité d’illumination à l’intérieur. Donc, en proposant de la musique, on permet à chacun de se jouer sa propre musique intérieurement, et de s’illuminer en conséquence. Ce n’est pas nous qui les illuminons ; ils s’illuminent eux-mêmes parce que ce que nous leur avons proposé a résonné avec ce qu’ils ont en eux. »
« La perfection, ce n’est pas mon but »
Cette idée de donner à chacun de quoi être illuminé, même si la personne met le boisseau sur votre lampe, ça vous plaît.
Oui… même s’il y a un inconvénient à cette conviction.
Lequel ?
Elle procède d’une ambition illimitée. Vous imaginez le travail qu’il y a pour donner à chacun la possibilité de s’illuminer ? Le projet n’a aucune limite ! Il est à la fois très structurant et très stimulant. Il ne s’agit plus seulement de plaire ou de ne pas plaire dans la mesure où, même quand on déplaît, on peut toucher quelque chose chez celui que l’on a mécontenté. Toutefois, grâce à cette vision, j’ai moins peur de ne pas rentrer dans les clous. Grâce à ma conviction, je suis persuadé que mon intention de toucher le « moi illuminé » de mes auditeurs passe partout. Les murs – physiques ou propres à chacun – ne peuvent pas l’arrêter.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=urTaxfQ3L3c[/embedyt]
Ce nonobstant, vous savez aussi que jouer de la musique, c’est – ô découverte ! – se confronter à la critique. La critique des « vrais gens ». La critique institutionnelle. La critique du gars qui vous entendra un jour en concert si etc.. La critique du pseudo critique comme moi qui exprime son ressenti ou son ressentiment sur Internet. La non-critique, c’est-à-dire le silence assourdissant que l’on entend parfois autour de ses projets. Quelle relation entretenez-vous avec cette idée protéiforme de critique ?
Je suis assez apaisé sur le sujet car, selon moi, la critique révèle davantage le critique que l’objet de sa critique. La manière dont on reçoit quelque chose révèle ce que l’on est. En 1275, le moine Nichiren a écrit :
« Les esprits affamés perçoivent le Gange comme du feu, les êtres humains le perçoivent comme de l’eau, et les êtres célestes comme de l’amrita [la boisson des dieux]. Bien qu’il s’agisse toujours de la même réalité, elle apparaît différemment selon les rétributions karmiques du passé de chacun. »
En gros, chacun voit minuit (ou midi) à sa porte ?
Tout ce que je fais est critiquable. Je ne prétends pas à la perfection, quand bien même la notion de « perfection » en musique aurait eu un sens. La perfection n’est pas mon but. Mon but, c’est que mon travail musical en général et mon disque en particulier aient du sens.
Sur le principe, soit ; mais, concrètement, comment vivez-vous la confrontation avec des critiques ?
Bah, je serai toujours plus dur critique envers moi-même que le plus dur des critiques. J’ai eu du mal à me produire en public à cause de cette propension. Bref, je lutte déjà assez contre ma propre négativité pour ne pas me préoccuper outre mesure de celle des autres !
Donc, quoique vous ayez du mal à le reconnaître, vous n’êtes pas insensible aux critiques négatives, vous me rassurez !
Bien sûr, quand on me juge de façon désagréable, j’éprouve un sentiment désagréable ; néanmoins, l’intensité et la durée de ce sentiment dépendent de l’intention avec laquelle le jugement désagréable a été prononcé. Par exemple, si un ami me dit d’une sonate : « Ce mouvement, j’ai trouvé que tu l’enlevais trop vite ; et, tant qu’on y est, pourquoi tu as joué ce passage trop fort ? », je vais l’écouter. À l’inverse, certaines recensions de mes disques ou de mes concerts peuvent juste démontrer que la personne qui méprise mon travail était de très mauvaise humeur ou manifestait une envie maligne de me rabaisser pour x raisons. Ça, c’est dommage mais, passée la déception d’avoir déçu, sans gravité. Quelqu’un avait l’envie et le pouvoir de me rabaisser, c’est son problème. Mon disque ou mon concert n’est qu’un prétexte qui actualise sa volonté.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UumA3llvj_M[/embedyt]
« Je ne déteste pas que l’on m’aime »
C’est ainsi que vous avez construit manière de carapace autour de vous…
Je vous l’ai dit, comme dans l’art – comme dans tout, d’ailleurs –, l’intention est primordiale. Je me souviens d’une de mes premières critiques qui était le fait d’un commentateur de théâtre. En 1990, je jouais « le pianiste » dans La Mort de Socrate de Jean Gillibert, dont nous avons parlé tantôt. C’était au Théâtre de la vieille grille, un minuscule endroit du Quartier latin. J’accompagnais Jean et un autre comédien, Claude Aufaure, et je jouais quelques œuvres en solo. C’était donc du cabaret. Les acteurs entraient par la cave et traversaient la salle minuscule tandis que je devais jouer très fort « Let’s call the whole thing off » de George et Ira Gershwin…
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=r2i77syzG30[/embedyt]
… et non de Cole Porter, comme le critique l’a écrit…
… afin que ma musique passe à travers le rideau et le brouhaha du public. Hélas, le journaliste était assis au premier rang, tout près du piano. Il a donc écrit que Jean et Claude entraient dans la salle « sur une musique piétinée au piano droit par Jean-Nicolas Diatkine ». À l’évidence, le journaliste (qui a adoré le spectacle ou, au moins, a écrit combien il l’avait adoré) avait de l’humour, donc ça ne m’a pas atteint. Sauf que, à un moment, Socrate me demande de jouer quelque chose pour aider à comprendre la mort. Je joue donc une étude de Scriabine…
… et non un prélude, comme il l’a écrit…
… et, comme le spectacle est une sorte de psychanalyse de Socrate et que Jean Gillibert était psychanalyste et que René Diatkine, ça lui disait quelque chose, il me désigne comme un « rejeton de psy ». Alors, ça, pour moi, ce n’était plus une critique, ce n’était plus de l’humour, c’était une insulte ! J’étais furieux.
Aujourd’hui, l’anecdote vous fait beaucoup rire.
Oui, car je ne vois plus trop ce qui m’avait irrité à ce point ! Parfois, avec le recul, nos réactions nous paraissent curieuses… Peut-être que, au regard de ma famille, il y a trente ans, la formule avait une portée qu’elle n’a plus à présent.
Désormais, vous êtes plus posé devant les critiques.
Hum, peut-être aussi parce que je n’ai jamais été vilipendé dans les grandes largeurs. On verra quand ça m’arrivera. Je ne suis pas pressé ! Cela dit, récemment, j’ai lu une monumentale biographie de Victor Hugo par Jean-Marc Hovasse, où j’ai appris qu’un tombereau d’injures avait accompagné la sortie des Misérables. Le succès populaire que tout le monde connaît ne doit pas effacer l’exécution critique du livre. Ça m’a fait réfléchir. J’ai pensé : « Et maintenant, qui se souvient de ces injures ignominieuses ? »
Le livre cherchait aussi à choquer le bourgeois ; et l’insulte critique peut être une bonne publicité…
Certes, le bourgeois fut choqué, mais quand même… Alors, en y repensant, je me suis dit : « Si je me fais ignorer ou descendre par la critique, serai-je malgré tout fier de moi ? » Heureusement, la réponse est oui. Donc je peux défendre ce que j’ai fait, et prendre sereinement les compliments comme les vitupérations. D’autant que je comprends très bien que l’on me déteste. J’en ai détesté aussi. Mais, précisons-le, je ne déteste pas qu’on m’aime.

Défi 6.
S’envoler et envoler le public
Pour conclure cette rencontre, j’ai préparé sept questions variées, peut-être même sturapides, c’est-à-dire stupides et rapides à la fois – Nora Lakheal a été la première à subir cette torture.
Prometteur…
Première question : à propos de la sonate Appassionata de Beethoven, que vous interprétez dans votre dernier disque, vous dites que cette œuvre « recèle une joie profonde, celle que l’on éprouve lorsque l’on triomphe de soi-même ».
Je confirme.
« Beethoven, c’est moi »
D’où ma question : que combat Jean-Nicolas contre Diatkine afin de triompher de lui-même ?
La colère.
La vôtre ou celle de Beethoven ?
C’est la même… ou, plutôt, je me reconnais dans celle que Beethoven exprime dans le troisième mouvement de sa Vingt-troisième sonate.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6DQV_o8Ljog[/embedyt]
Après l’avoir incarnée dans votre dernier disque, pouvez-vous nous raconter la colère diatkino-beethovénienne ?
Elle est introduite par une magnifique septième diminuée, puis elle monte jusqu’à devenir gigantesque. Elle traverse le compositeur très brutalement, alors que (et parce que) l’on sort d’un moment de très grande tendresse. On sent que le gaillard est allé puiser dans un domaine qu’il ne fréquente pas souvent dans sa vie quotidienne. C’est ce qui rend encore plus fascinant cet élan de douceur quasi extatique.
Est-ce une exception dans l’œuvre pour piano de Beethoven ?
Le seul élément symétrique, dans le domaine de la tristesse, c’est le troisième mouvement de la Hammerklavier, où il est dans la même sphère mais dans son versant obscur. Dans l’Appassionata, après la tendresse, on découvre clairement un sentiment de trahison. Tout le monde connaît ça. Cette impression d’être en confiance qui se fracasse sur l’évidence que l’on est berné, ça peut provoquer des tsunamis incontrôlables… notamment chez Beethoven !
D’autant que l’homme n’était pas un rigolo…
Attention, il pouvait être très sympathique, mais il battait ses domestiques, et il ne faisait pas semblant. Je crois même qu’il s’est battu avec ses frères. Donc je pense qu’un choc violent lui arrivant par surprise a dû susciter en lui une colère incommensurable. Ça, n’importe qui peut l’éprouver. En revanche, arriver à formaliser cette fureur et lui donner une telle forme a dû nécessiter un combat incroyable. Imaginez le paradoxe : arriver à exprimer l’émotion sans la dénaturer tout en lui assurant une construction d’une solidité irréprochable. Être allé au bout de cette entreprise représente, à n’en pas douter, un tour de force qui signe le génie d’un compositeur.
« Retrouver chez Beethoven ce que l’on a éprouvé, c’est miraculeux »
Cette certitude est-elle le résultat d’une analyse ou d’une longue fréquentation de la pièce ?
Les deux. La partition s’étudie et permet de comprendre ; mais, en la jouant, on fait mieux que comprendre, on sent. Hélas, trop souvent, emporté par cette urgence, par ce bouillonnement, on joue trop vite, ce qui écrête les sommets. Arrivé à une grande vitesse, on ne sent plus le relief. Il a disparu. Le paysage défile trop vite. C’est dommage car, en suivant le texte, on voit avec quel soin Beethoven a construit son drame comme une véritable pièce de théâtre.
Avec une chute inattendue !
Oui car, au moment où le compositeur a réussi à sublimer la forme qu’il s’est imposé à lui-même, l’œuvre débouche sur une coda en La bémol qui exprime une évidente satisfaction. À ce moment-là, on sent qu’il – donc nous à travers lui – a réussi à triompher de soi-même. À ce moment-là, on a réussi à se dompter. Là, on peut se lâcher. Par conséquent, là, Beethoven lâche tout. La frénésie s’impose. Avec elle apparaît le vrai Beethoven. Celui qui n’a plus besoin de se maîtriser parce que, c’est bon, il a vaincu. À tout le moins, c’est mon interprétation.

Cette poétique musicale vous inspire-t-elle dans votre vie ? En d’autres termes, est-ce le combat beethovénien qui nourrit votre vie ou est-ce votre vie qui nourrit votre compréhension de Ludwig van Beethoven ?
Hum, plutôt la seconde hypothèse. Quand on a vécu certaines situations, on comprend. On devient même reconnaissant d’avoir vécu ces situations. Sans elles, on n’aurait pas compris ! Si, dans ma vie, je n’avais pas vécu certaines situations, je n’aurais pu jouer l’Appassionata en la vivant. En m’y reconnaissant. En disant : c’est vrai, ce que je raconte. Je m’y retrouve. Beethoven me parle. Parle de moi. Victor Hugo le stipulait, dans la Préface des Contemplations [dont un exemplaire est ouvert sur le piano de l’artiste, ce 14 avril 2021] :
« On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! insensé, qui crois que je ne suis pas toi !
Ce livre contient, nous le répétons, autant l’individualité du lecteur que celle de l’auteur. Homo sum. »
Ça, c’est exactement ce que je ressens quand un compositeur a exploré des situations émotionnelles que j’ai traversées. J’ai l’impression qu’il parle de moi ; et, quand je fais la jonction, c’est miraculeux !
Pourquoi ?
Parce que je n’aurais pas pu inventer un langage comme ça. Je n’aurais pas su exprimer ce que j’avais ressenti. Beethoven l’a fait pour moi et, aujourd’hui, je peux porter cette émotion.
Avec l’idée qu’elle trouve un écho chez ceux qui auraient éprouvé un sentiment semblable ?
Pourquoi pas ? Retrouver chez Beethoven ce que l’on a éprouvé, c’est de la joie. Même dans une colère terrible.
« Si on attend la suite, ce n’est pas que la chute est mauvaise,
c’est que l’histoire est bonne »
Deuxième question sturapide : à propos des Préludes de Chopin, vous vous demandez à quoi ils préludent. Alors, de quoi le prélude est-il le prélude ?
À la base, cette remarque se fondait sur un jeu de mots. On parle toujours de « prélude et fugue ». Là, il manque systématiquement la fugue. C’est un peu étrange de préluder sans que rien ne s’ensuive. Imaginez un livre que de préfaces ! Bon, Borges a écrit Le Livre des préfaces, un bouquin génial puisque vous avez l’impression de lire toutes les œuvres imaginaires qu’il préface. En fait, il dit : « Je ne vais pas vous raconter l’histoire, mais je vais vous donner le sujet. »
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=d9sB65-rS5I[/embedyt]
Moins chic, mais pas peu savoureux, Patrick Cauvin alias Claude Klotz a aussi signé le Livre du roman (Jean-Claude Lattès, 1994), où l’on trouve tout, de la dédicace à la dernière page, sauf les romans dont ces paratextes grotesques sont extraits… En somme, ces exercices montrent-ils qu’un prélude réussi rend inutile un lude ?
Quand Chopin écrit ses Préludes, il les conclut toujours par des points de suspension. Il laisse à l’auditeur la responsabilité d’imaginer la suite. C’est aussi cela qui les rend particulièrement délicat à enchaîner. Si on les enchaîne trop vite, on ne laisse pas l’auditeur affronter le défi du : « Et alors ? Après ? » Or, c’est essentiel dans l’économie d’écriture de ces miniatures. C’est aussi en cela qu’elles sont proches de l’improvisation. L’improvisation vous laisse en suspens. Il faut laisser à l’auditeur son âme d’enfant qui lui fait réclamer la suite de l’histoire. Si on vous lance : « Et alors, qu’est-ce qu’il se passe, après ? », ce n’est pas forcément que votre chute était mauvaise, c’est souvent que votre histoire était bonne. Pour Chopin, le prélude est une manière de faire attendre.
Ce n’est pas le cas chez Chostakovitch, dont vous avez joué certains préludes en public…
En effet, chez lui, les préludes sont très complets. À la fin, l’histoire est close. On passe à autre chose. Chez Chostakovitch, il y a un désir d’absolu. Les scenarii qu’il décrit sont assez faciles à imaginer. Dans une berceuse, il cajole son enfant, et l’on comprend qu’il n’a qu’une peur : que l’ascenseur sonne à minuit. Et cette peur de Chostakovitch, comme la colère de Beethoven, on la sent. On sent la terreur qu’avait le compositeur d’être arrêté par le KGB à tout moment, comme n’importe quel citoyen soviétique. Sous cet angle, il n’y a pas de mystère. Une fois que vous avez compris « de quoi ça parle », c’est juste amusant de voir comment le compositeur a traité le sujet, comme quand il utilise simultanément deux thèmes qui n’ont strictement rien à voir pour dénoncer la propagande que répandait la radio.
Le même concept de « prélude » n’avait donc pas la même acception chez votre cher Frédéric.
Il est certain que Chopin avait une poétique très distincte. Il met l’auditeur sur une piste, et c’est à l’auditeur de rêver. L’énorme littérature que les Préludes ont inspirée est la preuve qu’il a réussi son coup. Après les Ballades, il disait souvent à ses élèves : « Essayez de deviner. » Sans être Schumann, il développe ainsi un côté un peu rébus, du type « je vous dis ça, mais je vous dis pas tout ». Aussi a-t-on l’impression, en le jouant, qu’il s’arrête trop tôt. D’ailleurs, Ferruccio Busoni jouait deux fois le premier prélude, l’air de dire : « C’est trop tôt pour m’arrêter, je vais pas me laisser avoir ! »
… mais, malgré la reprise de la vingt-cinquième mesure que vous pointez, il le jouait si vite qu’il le bouclait quand même en 0’45 tout compris.
Il exprimait ainsi une urgence vitale car, ce qui est très sûr, dans ce cycle, c’est que Chopin va vers la mort. Il le devine. J’ignore dans quel ordre chronologique il a composé les préludes mais, quand on joue le prélude en ré mineur, le doute n’est pas permis.
« J’ai pu faire des choses qui demandent du temps et du hasard »
Même si ce n’était pas le cas, la musique, posez-vous, prouverait que c’était quand même le cas !
Chez Chopin, souvent, la mélancolie est dans le diminuendo, comme chez les chanteurs capables de cet art sublime de prendre un son et de le filer. C’est l’une des grandes forces de Chopin. Donc on pourrait imaginer que la mort, pour lui, ne peut être qu’une mort à la Traviata, une mort énamourée ; et, pourtant, cette mort est parcourue d’éclats d’une incroyable violence. Ce qui est incroyable, dans ce vingt-quatrième prélude, c’est cela : la violence, grande et inattendue.
Autrement dit, Chopin n’est pas celui que l’on croit.
Non. Mais qui est vraiment celui que l’on croit qu’il est ?
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=G5OkSfbsQfI[/embedyt]
Troisième question sturapide : l’interdiction des concerts « pour des raisons sanitaires »a-t-elle exacerbé votre envie d’en donner ou, au contraire, a-t-elle apaisé le stress que cet exercice et ce qu’il y a autour (la promotion et l’obligation de remplir, par exemple) peuvent susciter ?
Vous plaisantez ? Ne pas pouvoir donner de concert est un manque, évidemment. On fait de la musique pour être entendu. Cependant, à défaut, on sait qu’il faut rentrer en soi et utiliser ce moment. Puisque l’on ne peut donner des concerts, faisons autre chose et tirons-en profit !
Quelle a été votre alternative au concert ?
J’ai fait un certain type de travail pianistique que je n’aurais jamais pu faire si j’avais dû assurer des concerts. J’ai amélioré ma technique. J’ai cherché du son – en fait, des sons différents pour des compositeurs différents. J’ai travaillé des sonates de Mozart. J’ai profité du blackout pour faire des choses qui demandent du temps et du hasard. C’est ce que m’a apporté la pandémie : du temps et du hasard. Mais vous voulez une confidence ?
Pourquoi seulement une ?
Commençons par une : je commence à en avoir un peu assez, du confinement, du couvre-feu, des restrictions, c’est clair. J’ai envie de retrouver le contact avec le public, et je vous remercie parce que, à travers vous, c’est un peu ça ce que je fais. À travers nos entretiens, je retrouve un certain public. Un public de lecteurs, mais un public quand même ; or, c’est le public qui me fait vivre.
Quatrième question sturapide : vous avez été coach de chanteur. Quel conseil donneriez-vous à un jeune pianiste qui se risquerait dans cette voie ?
Un coach est là pour encourager et donner confiance à l’autre. Par l’attitude, les conseils, le regard. C’est si important, le regard ! Certains coachs s’imaginent que, pour justifier leur travail, ils doivent manifester leur pouvoir en dirigeant. Mais la musique, c’est pas ça. C’est pas rabaisser l’autre et se hausser du col. C’est se mettre en harmonie. Partant, il revient au coach de trouver en lui les ressources intérieures qui lui permettent de s’harmoniser avec n’importe qui. Ce n’est pas chose aisées, mais c’est le défi et la beauté de ce travail : rien de plus, rien de moins.
Ha, méfiez-vous ! ma cinquième question sturapide est intime !
Marchez.
Dans les notices où vous décrivez les pièces que vous interprétez, inutile d’avoir fait des études très poussées en statistique pour constater que le sème le plus fréquemment employé doit être le mot « rêve ».
C’est possible.
Alors, qu’est-ce qui fait rêver Jean-Nicolas Diatkine ?
L’objet ou les conditions ?
« Je rêve de toujours demeurer dans l’authenticité »
Les deux, bien sûr.
Ce qui me fait rêver, le plus, en ce moment, c’est Schumann. Je le dis et le redis : Schumann me fait rêver. Mais si la question est : « De quoi je rêve ? », la réponse est à la fois simple et compliquée. Je rêve de contribuer à un changement d’état des gens. Je rêve que, par mon travail, je fasse en sorte que les gens s’aiment plus eux-mêmes et aiment plus les autres.
Pourquoi ?
Parce que je pense que c’est possible. Aussi rêvé-je de trouver dans la musique la fibre qui pourrait hâter cette mutation. C’est davantage du travail pour moi que pour les autres, mais c’est ça qui me pousse. Mon rêve, Beethoven l’a bien résumé en posant que ce qui vient du cœur retourne au cœur. Sauf qu’il faut être sûr que ça vient du cœur. Par conséquent, je rêve de toujours demeurer dans l’authenticité. Quelles que soient les circonstances de ma vie.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2PMbwKhBIGY[/embedyt]
Sixième question sturapide : vous avez beaucoup évoqué le rôle de la spiritualité, ce qui laisse résonner d’autres entretiens publiés sur ce site, de Cyprien Katsaris aux soufis, vivant leur engagement musical à l’aune de leurs convictions religieuses ou intimes. Êtes-vous pas étonné que les musiciens parlent si peu soit de leurs convictions, soit des enjeux qu’elles sous-tendent, comme si la musique se résumait à interpréter des trucs hyper difficiles ou à jouer des partitions selon de stricts critères historico-musicologiques ?
Je ne me sens pas obligé de jouer des « trucs hyper difficiles ». Heureusement, car je n’ai jamais eu l’impression d’être un musicien doué à qui on demande d’être un animal de cirque. Je n’ai même pas l’impression d’être doué tout court. Pour moi, jouer du piano a toujours été difficile. Ça demande un effort. Je n’ai pas de facilités. Partant, j’ai besoin de puiser mon énergie dans quelque chose qui est plus fort et plus vaste que moi. C’est pourquoi la spiritualité est essentielle. Elle seule vous fait percevoir quelque chose de plus grand que vous.
Le chanteur Ricet Barrier disait que la raison humaine ne dépasse pas les bornes de son imagination. Vous rétorquez que si, grâce à la spiritualité !
Je pense qu’il faut tendre vers cette aspiration au dépassement de soi grâce à quelque chose qui nous dépasse. Néanmoins, cela comporte un risque : confondre musique et spiritualité. Par exemple, en tant que musicien, par la musique, je nourris mon for intérieur sur les intentions humaines. Si j’étais un misanthrope forcené, ça ne fonctionnerait pas, sur scène. Les gens le percevraient, d’une manière ou d’une autre.
Certains misanthropes sont très populaires !
Grand bien leur fasse ! Il n’empêche que, pour moi, entrer en résonance avec les autres exige d’ouvrir sa bienveillance intérieure. Rien de sentimental, attention, rien de gentil ou de sucré : c’est de l’ordre de la connexion.
« On n’a jamais tué le nazisme en tuant les nazis »
Vous sous-entendez que parler de spiritualité, pour un musicien, ce serait prendre le risque de passer pour un gnangnan ?
L’important est de ne pas mélanger les sphères. Qu’elles se nourrissent mais ne se confondent pas. J’ai d’autres sphères où la musique n’est pas le centre. Des sphères où l’essentiel est de comprendre comment développer chez chaque personne sa confiance dans sa propre capacité d’illumination. Parce que, plus on donne confiance aux autres là-dessus, plus on a confiance dans la nôtre. Ainsi se met en route un ensemble vertueux qu’il faut protéger.
Protéger contre quoi ?
Contre la pensée contraire. Dire que tout le monde a une capacité d’illumination, ça paraît chouette. Las, tout le monde a aussi le contraire. On peut rapidement penser que telle personne ne vaut rien ou est mauvaise, donc qu’il convient de la jeter. Le psychopathe que nous portons en nous pousse à se débarrasser des gens qui nous indisposent ou nous résistent. Or, c’est contre cette réaction que nous nous battons. Les gens mauvais, il faut les améliorer plutôt que les jeter pour une raison simple : on-ne-peut-pas-les-je-ter. On n’a jamais tué le nazisme en tuant les nazis. Ce n’est pas en se débarrassant des gens que l’on tue une idée ; c’est en affrontant l’idée que l’on change les gens. Il est possible qu’une telle conviction entraîne chez moi une certaine façon d’être dans la musique. J’aimerais donner à la musique, avec d’autres, un rôle social beaucoup plus grand que ce qu’elle n’a jamais eu. En Allemagne, une grande proportion de la population fait de la musique ; la musique classique est populaire ; alors, pourquoi pas en France ?
Parce que, dans chaque pays, la musique n’a pas le même rôle ?
Évidemment. Tant pis si cette idée chagrine ceux qui postulent que la musique est universelle, donc qu’elle doit avoir le même rôle partout. Ce n’est pas du tout le cas. En revanche, il est patent que l’origine de la musique est essentiellement religieuse. Les cérémonies religieuses ont crée la nécessité d’écrire de la musique – ça, c’est assez clair. L’associer à la spiritualité ou à la transcendance n’a donc rien d’inconvenant.
« J’aime l’impression d’être arrivé quelque part »
Septième et dernière question : puisque, en tant qu’artiste, vous revendiquez, selon l’expression du philosophe et musicologue Jean-Jacques Goldman, de tout faire pour nous envoler, pouvez-vous nous révéler combien de temps vous passez, vous, sur votre simulateur de vol et quel rapport cette passion entretient-elle avec votre pratique artistique ?
Je l’utilise de temps en temps. Par exemple, il m’arrive de décoller avant de commencer à travailler, puis d’enclencher le pilote automatique pour six ou sept heures de voyage ; et, quand j’ai fini mon travail, j’atterris. Entretemps, je n’y pense plus du tout, mais il me permet de faire une transition pas trop violente entre la réalité et le monde de la musique, deux pôles parfois très, très éloignés. Malheureusement, c’est un peu chronophage quand on est novice et que l’on doit apprendre les procédures ad hoc. Cela dit, une fois la base maîtrisée, on peut se laisser aller ; et il m’arrive d’y passer du temps, oui.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fqzEzU-0E_s[/embedyt]
Est-ce un hobby commun aux musiciens d’élite ?
Vous voulez dire aux musiciens de métier ? Pas que je sache, mais j’ai vu qu’un chef d’orchestre, élève de Claudio Abbado, avait la même passion que moi. Il emporte son simulateur dans tous ses hôtels, et il se colle devant quand il a la tête farcie à force d’explorer ses partitions. Le simulateur de vol est un passe-temps qui détend énormément tout en maintenant une certaine activité cérébrale. Quand on s’y attelle, il faut être attentif à un grand nombre de détails. Il devient ainsi un intermédiaire très plaisant car il donne l’impression, fausse ou fondée, d’avoir voyagé et d’être arrivé quelque part.
Avez-vous développé une réflexion sur ce sujet, ou votre passion est-elle préservée de votre capacité analytique ?
Non, je pense que ça m’aide psychologiquement, donc je me suis demandé pourquoi je faisais ça. J’ai toujours aimé les avions, mais ça n’explique rien ; et c’est en lisant la biographie de Yehudi Menuhin que j’ai eu une bribe de réponse. Yehudi raconte qu’il trouve beaucoup plus facile d’apprendre un morceau dans le train parce qu’il voit défiler le paysage, ce qui constitue une énorme stimulation cérébrale. Je pense qu’il y a quelque chose du même ordre avec le simulateur de vol. C’est un stimulus. Donc un stimulant.
… et nous n’avons toujours pas la réponse à la question de base : combien de temps un artiste peut-il consacrer à cette passion non professionnelle ?
J’ai honte de dire que je l’ignore.
Pourquoi honte ?
Parce que c’est mauvais signe !
Ou bon signe : quand on regarde sa montre, c’est plutôt mauvais signe, non ?
J’imagine que cela dépend des circonstances, et qu’il conviendra de laisser votre question ouverte à l’imaginaire de chacun… y compris au mien !
Pour acheter le disque incluant trois sonates de Beethoven, c’est ici.
Pour lire d’autres petits papiers sur Jean-Nicolas Diatkine, c’est çà et là.




































































