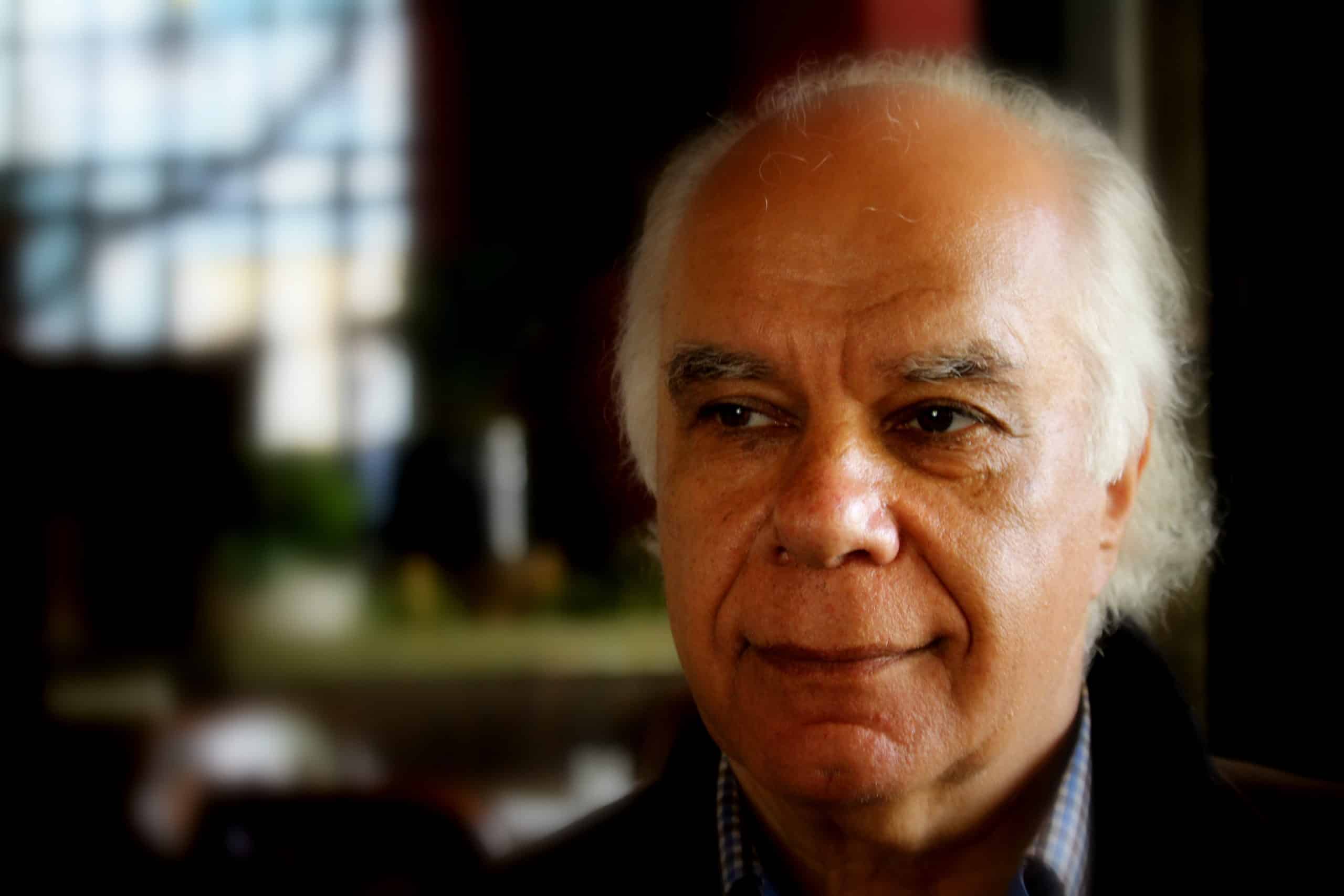
En ce jeudi saint de la mi-avril 2022, sous le grand soleil des Batignolles, les Parisiens rigolent fort aux terrasses des cafés. Bien que je n’aie pas exprimé une grande estime pour Olivier Bellamy, j’ai rendez-vous à 15 h avec Pierre Réach, dont M. Bellamy livrette le dernier double disque et a soutenu le musicien lors de ses émissions. À 14 h 58, Pierre Réach m’envoie un Texto très signifiant : « Je suis à l’intérieur. » À l’intérieur du café, soit. Mais, plus généralement, à l’ère des m’as-tu-vu, des frétilleurs et des tourmentés de la façade, l’artiste est aussi quelqu’un à l’intérieur tout court – et il le démontre, mots à l’appui.
À l’occasion de la parution du premier double disque de son intégrale des sonates de Beethoven, en partie chroniqué ici, le pianiste, passionnant derrière un clavier ou devant un micro, nous laisse libre accès à ses secrets :
- les dessous du projet,
- l’importance de l’enseignement dans sa pratique artistique,
- ses réactions face aux soubresauts de l’actualité,
- ses projets et quelques-uns de ses rêves
habitent un entretien à bâtons rompus dont, après le feuilleton, l’intégrale est publiée ci-après.
1.
Les paradoxes d’un rêveur
Pierre Réach, nous allons commencer en parlant – selon vos termes – d’un « objet pas intéressant », donc de votre disque. En effet, vous avez déclaré que « le disque n’est qu’une photo de ce que vous faisiez à une époque, mais c’est fini ! Or, il y a toujours des secrets pas encore découverts dans les messages de la musique. » Pour beaucoup d’artistes, un disque est un aboutissement. Diriez-vous que, pour vous, qui en avez gravé moult, c’est le début d’une frustration esthétique ?
Je vais vous répondre de plusieurs manières qui vont peut-être vous paraître contradictoires. Oui, le disque est une photo de la manière dont joue un artiste à un moment précis. Cependant, il est souvent le fruit d’un travail très élaboré, souvent pendant plusieurs années. Wilhelm Kempff a gravé trois ou quatre intégrales des sonates de Ludwig van Beethoven. C’est bien le signe d’une tension qui se joue entre la fixation instantanée et la nécessaire évolution du musicien.
Comment caractériseriez-vous ce que contient cette « évolution » ?
Évolution n’est pas révolution. Il s’agit moins d’adopter ou d’adapter des approches radicalement opposées que de continuer à découvrir. Ce que vous appelez « frustration esthétique » est surtout un bel hommage à l’incroyable polysémie des chefs-d’œuvre sans cesse remis sur le pupitre. Les sonates de Beethoven – mais pas qu’elles ! – sont des sources inépuisables d’inspiration pour les interprètes, quelles que soient les époques. Je le dis souvent à mes élèves et à mes proches : il est incroyable que des œuvres écrites il y a 250 ans – 250 ans, rendez-vous compte ! –, comme celles de Johann Sebastian Bach, ne cessent d’être jouées et rejouées.
Cette actualisation perpétuelle contribue-t-elle à leur pérennité, ou est-ce leur caractère exceptionnel qui justifie ces interprétations incessantes ?
Incessantes, je ne sais pas : en France, Bach a longtemps été oublié. En revanche, une œuvre qui ne cesse d’être rejouée démontre qu’elle résonne avec l’environnement des différents moments où on la joue. Dire d’une œuvre qu’elle est géniale n’est donc pas la juger « très actuelle » mais la trouver « très actuelle à toute époque », ce qui n’est pas la même chose.
Dans cette diachronicité de l’interprétation, vous concevez votre disque comme une photo qui s’inscrit dans l’album (ou, feignons d’être moderne, dans le Pinterest) d’un artiste et d’une œuvre.
Oui, une photo de l’œuvre elle-même, mais aussi une photo de l’époque.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lZ_Rs-SZfvY[/embedyt]
En quoi le double disque qui inaugure votre intégrale des sonates de Beethoven correspond-il à cette conception ?
En 2022, à mon âge – qui n’est pas si jeune –, j’ai fixé la façon dont je sens les sonates hic et nunc. Toutefois, aussi biscornu que cela semble, je suis à la fois pour et contre le disque. C’est même pour cette double raison que j’aspire à en graver ! Sergiu Celidibache, un de mes dieux, disait que le disque a des limites pour refléter une vision à cause de l’acoustique et de la technique. Il est vrai que rien ne peut remplacer
- le souffle d’une salle de concert,
- l’émotion du public et
- la présence de l’artiste.
Ouvrons une parenthèse, si vous le voulez bien.
Allez-y ! J’aime beaucoup les parenthèses, même s’il est parfois – et parfois seulement – triste de les fermer.
J’ai eu la chance de rencontrer Arthur Rubinstein et de profiter de ses conseils lorsque j’ai gagné une médaille au concours qui porte son nom, en Israël. Il s’était intéressé à moi et m’a proposé de travailler avec lui, ce qui est effectivement arrivé pendant plusieurs années, de 1974 à 1979. Par la suite, j’ai eu le bonheur, par la suite, de compléter ses avis par ceux d’Alexis Weissenberg, de Paul Badura-Skoda et de Maria Curcio, après Yvonne Lefébure et Yvonne Loriod, au Conservatoire national de Paris. Ainsi, des artistes exceptionnels m’ont transmis une exigence de jouer de manière très authentique la musique de très grands compositeurs comme Beethoven, Bach ou Schubert, par exemple.
En d’autres termes, la photo de votre disque paru cette année est multistrates : elle porte trace de votre art du moment, mais aussi de votre expérience de plusieurs décennies comme artiste et pédagogue ET de votre appropriation des conseils donnés par de grands anciens !
En effet, et c’est ce que je voulais vous dire à travers cette apparente digression. Je ne suis pas contre le disque pour des questions d’émotion ou de technique ; je suis contre le disque dès lors qu’il est considéré comme un point final. Un enregistrement
- se positionne par rapport à une tradition,
- témoigne d’infléchissements et
- illustre une personnalité.
Le double disque que je viens de publier n’a certainement pas pour ambition de livrer une version définitive des six sonates que je présente. Et pas par modestie ou insatisfaction, notez bien ; juste parce que, par définition, la musique n’est jamais terminée. En ce sens, le disque est une illusion. Il ressemble à un point final alors qu’il n’est qu’un point virgule.
Pourtant, vous arrivez aujourd’hui avec un projet triplement marmoréen, si je puis m’exprimer ici. Il y a
- la statue du commandeur : Beethoven ;
- le statut de l’artiste qui publie un double disque ; et
- le Graal de toute discothèque : une intégrale.
Que de solennité, que de solidité !
Ha, mais le disque est une illusion. C’est quelque chose de très factice. Aucun disque ne résoudra jamais le mystère de Beethoven. Sans doute est-ce la raison pour laquelle Beethoven est grand, d’ailleurs ! Le fait que la version gravée soit merveilleuse n’y peut mais.
Même l’une ou l’autre interprétation de Wilhelm Kempff n’est pas une perspective satisfaisante ?
Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas ! J’adore Wilhelm Kempff dans Beethoven. J’adore Rudolf Serkin. J’adore Daniel Barenboim. J’adore de très nombreuses versions…
… mais toutes demeurent insatisfaisantes à vos oreilles ?
Heureusement !
Pourquoi ?
Si, hypothèse absurde, une version était définitive, plus personne ne jouerait les sonates de Beethoven ! Cela ne signifie pas que je considère que telle ou telle version d’un grand maître a des défauts, si tant est que, à leur niveau, un défaut prétendument objectif ne puisse être interprété comme une qualité subjective ; au contraire, c’est que j’y découvre de nouvelles splendeurs qui enrichissent la beauté des œuvres et donnent des raisons supplémentaires, s’il en avait fallu, pour continuer d’explorer ces partitions – donc de les jouer et, le moment venu, de les enregistrer.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0RE3O5RVj7A[/embedyt]
Enregistrer Beethoven tout en admirant d’autres enregistrements de Beethoven serait donc plus logique que contradictoire, voire présomptueux ?
Bien sûr que je me trouve très présomptueux d’emprunter ces chemins-là ! Cependant, la musique a ceci de particulier qu’elle n’a pas de vérité. En musique, il y a des mensonges, des faux pas, des trahisons, mais la vérité n’existe pas. Sinon, pourquoi croyez-vous que de grands maîtres réenregistrent des compositions qu’ils ont déjà magnifiquement fixées ?
Si je vous suis bien, vous êtes contre le disque en tant qu’il représenterait une version définitive, tant pour l’Histoire de la musique que pour la sensibilité d’un artiste. Est-ce à dire que vous êtes favorable au disque pour les mêmes raisons : chacun d’eux est susceptible de poser des jalons dans l’histoire des interprétations, non pas dans une perspective de progrès mais dans un élargissement du spectre herméneutique, ce qui nourrit le rayonnement d’œuvres que vous admirez ?
Soyons honnête, pas seulement. D’un point de vue concret, le disque est aussi l’occasion de partager son travail avec des amis, des proches, des mélomanes, des curieux ; c’est quand même merveilleux – d’une part parce que l’on ne travaille pas ses pièces pour le seul plaisir de les jouer pour son piano personnel ; et, d’autre part, parce que tout le monde ne peut pas venir vous écouter. N’oublions pas que, pendant la pandémie, qui n’est pas terminée, les concerts avaient même été supprimés ! La concrétisation d’un enregistrement est donc irremplaçable, quelque inaccomplie soit-elle par nature.
En somme, la réflexion de Sergiu Celidibache que vous citiez est faussement pragmatique : quand il parle de technique de captation, il ne parle pas que de technique.
Non, sa réflexion ouvre un espace quasi métaphysique qui, banalement, n’a pas été vraiment compris. Certains ont dit : « Bien sûr que l’on ne peut pas retrouver l’ambiance d’une salle de concerts dans un micro, la belle affaire ! » Or, cela va plus loin que cela. Sous une apparence de trivialité, le chef d’orchestre interrogeait l’essence même de l’interprétation. L’enregistrement d’un disque n’est pas qu’une question de technique – celle de l’ingénieur du son ou celle de l’interprète. Elle rappelle surtout que le musicien ne joue pas seul. Quand il donne un concert, il sent comment réagit le public. Celui-ci peut le stimuler comme il peut le décourager. Et ça, dans le disque, ça n’existe pas car vous êtes devant une seule personne qui s’appelle le micro.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sQTjXKtV0kY[/embedyt]
Dans votre dialectique artistique, il est donc nécessaire et non contradictoire d’être pour et contre l’enregistrement en studio…
Je me méfie de l’opposition binaire. Elle est souvent fallacieuse. En pédagogie aussi, je puis sembler paradoxal : je suis à la fois pour et contre les concours internationaux. L’esprit de ces grands-messes est effrayant. Il m’arrive souvent de faire partie de jurys importants ; et je constate que chaque candidat pense à qui a joué avant lui et qui va lui succéder. Donc il ne pense ni à la musique, ni à lui. Comment le lui reprocher ? Aussi, sur le principe, faudrait-il déconseiller aux jeunes artistes de se frotter à cette comédie inhumaine. Sauf que, en même temps, il n’est rien de tel qu’un grand concours pour faire découvrir un artiste et permettre à des gens importants dans l’économie musicale de se laisser bluffer par son talent, puis de l’engager, etc. En musique, le pour et le contre restent complémentaires car relatifs !
Mais la relativité a des limites : si tout était vraiment relatif, vous n’auriez pas trouvé le temps, l’énergie et la folie d’entreprendre une intégrale des sonates de Beethoven !
Quand j’étais enfant, mes parents m’ont emmené à tous les concerts de Kempff et de bien d’autres génies. Très vite, en tant que pianiste, j’ai eu le rêve de graver cette intégrale. Partant, très égoïstement (mais un artiste peut-il n’être jamais égoïste ?), ce projet est un accomplissement pour moi. Maintenant, j’ai mon âge, je l’assume, et je ne veux pas laisser passer le moment d’aller au bout de ce rêve.
D’autant que vous auriez pu chercher à enregistrer ces trente-deux mastodontes avant. Vous avez préféré attendre…
Je ne sais pas si j’ai préféré. En revanche, je crois que tout vient à son heure, et je ne pense pas que, quand j’étais plus jeune, j’aurais été assez mûr pour mener à bien cette ambition. Sans arrogance, croyez que je m’en méfie, je crois que je le suis à présent.
2.
L’homme derrière le monument
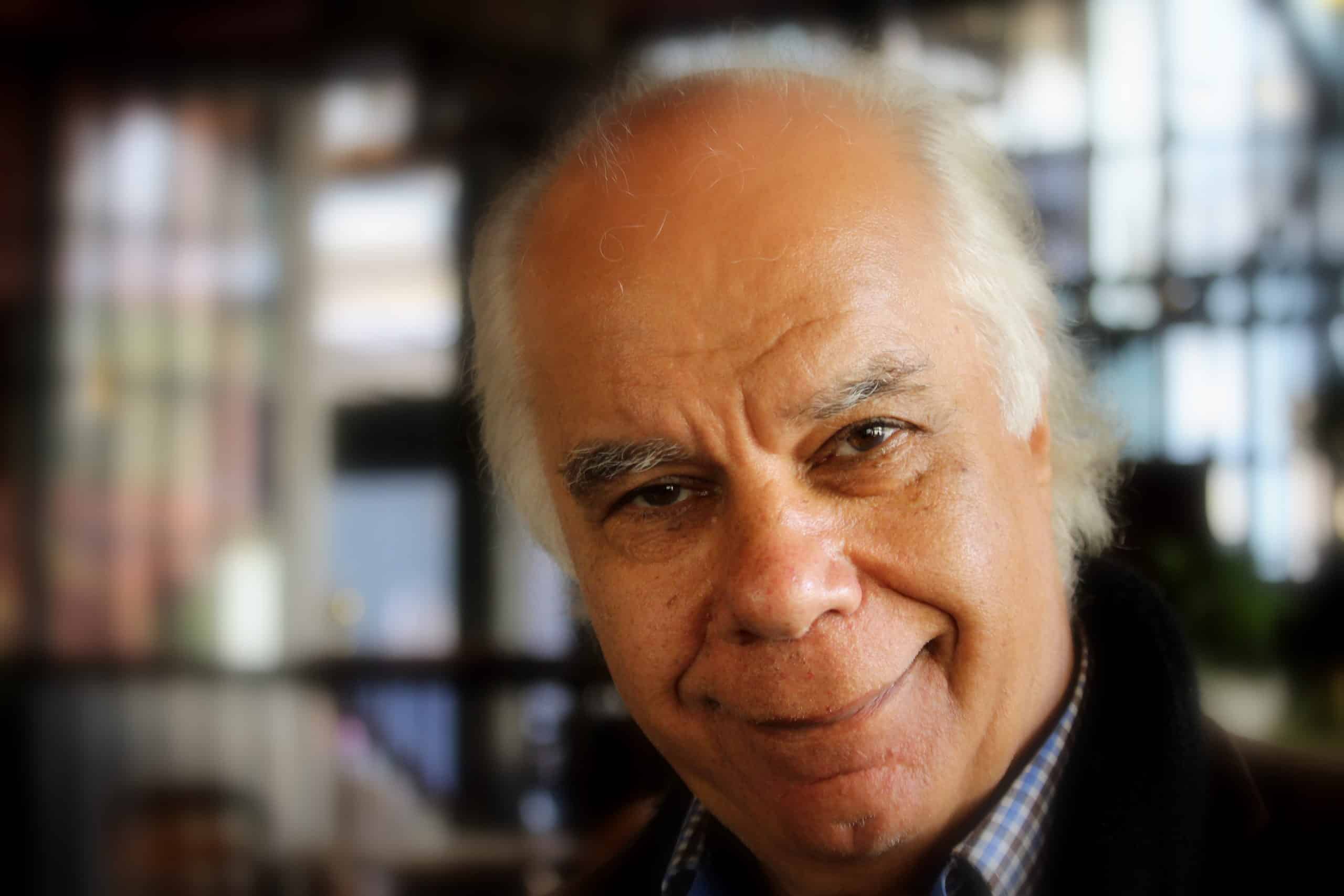
Pierre Réach, quand on décide d’enregistrer une intégrale des sonates de Beethoven, on pense forcément au texte avant même de penser à son interprétation.
Le texte, c’est l’essentiel. Plus le temps passe, plus je suis convaincu qu’il ne faut rien ajouter à ce que Beethoven a écrit.
Pour reprendre l’expression de Jean-Marc Luisada…
… qui est un de mes grands amis…
… interrogé par vos soins après son concert à Piano-Pic en août 2021, les sonates de Beethoven sont-elles le « bœuf bourguignon » (à 4’25 de la vidéo infra), id est le plat de résistance de tout pianiste ?
Bien sûr, au même titre que le Clavier bien tempéré ou les Variations Goldberg – que je joue beaucoup – de Bach. Les trente-deux sonates de Beethoven sont une sorte de Bible.
Vraiment ?
Bon, l’appellation est un peu facile, pour un pianiste. Mais votre question interroge ce qu’il y a dans cette musique et, comme dans la Bible, il y a tout. J’ajouterai que, ce qui est très curieux, c’est que je m’en suis rendu compte pendant la pandémie. En effet, pour moi comme pour beaucoup de musiciens, l’arrêt des concerts a été un désastre. Les vedettes et les moins-vedettes qui, à mon instar, avaient moins de projets mais en avaient de trrrès beaux, notamment en Extrême-Orient, en Chine et au Japon où j’allais trois fois par an, nous nous sommes retrouvés sans un seul projet pour 2020 et 2021.
Cet arrêt total vous a-t-il paru sain ou scandaleux ?
Ni l’un ni l’autre. Je l’ai pris comme un fait. C’était comme ça, je n’y pouvais rien changer.
En avril 2022, j’imagine que ça repart…
Il y a des frémissements en Chine et au Japon, mais la question de la quarantaine pose des problèmes évidents.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1DCokBEbD8Q[/embedyt]
Êtes-vous de ces artistes qui ont trouvé profit à la pandémie ?
Profit alors que tant de gens mouraient ou souffraient, dans leur corps et dans leur âme ? Certainement pas, vous êtes fou ! En revanche, pendant ce que j’ai ressenti comme une punition puisque, du jour au lendemain, on nous a dit que nous ne jouerions plus, nous dont la vie consistait à jouer, j’ai senti comme tout le monde – vous me parliez de Jean-Marc, dont je suis très proche, mais d’autres pairs me disaient quelque chose d’assez similaire – le danger de la dépression. Pour les pianistes, le confinement signifiait : « Remets-toi devant ton piano mais abandonne ici tout espoir. »
En dehors de la déception liée aux annulations, n’avez-vous pas éprouvé un certain soulagement en étant contraint de souffler un peu ?
Au contraire ! Figurez-vous que, après des années de récital, je me suis rendu compte de ce que signifiait tout ce qui est autour du concert. Je n’avais pas conscience, ou pas autant conscience, de l’excitation que représentait l’envie, l’exigence, la nécessité que tout soit prêt, que tout soit bien pour une date. Je n’avais pas conscience de la merveilleuse envie que l’on va voyager. Je n’avais pas conscience, ou pas à ce point, de l’incroyable énergie qui habite le fait d’être dans une loge, de s’habiller et de se préparer. Pourtant, tout ça faisait partie du concert. Tout ça faisait partie de notre métier…
… et tout ça a disparu.
Oui. Il n’y avait plus que la partition. Rendez-vous compte ! Tous mes concerts avaient disparu. Le concert, ça n’existait plus. Je me suis retrouvé uniquement devant mes partitions. Alors, je vais le dire avec honte, parce que je suis conscient que, pendant que je me gobergeais de Beethoven, des gens périssaient à l’hôpital, mais, moi, cette situation d’enfermement m’a appris beaucoup de choses. Désormais, je crois que je travaille mieux, et je ne pense pas avoir été le seul musicien à changer ma manière de travailler.
Sauriez-vous dire pourquoi ?
Parce que l’interdiction des concerts nous a confrontés à la musique et a effacé le reste. Les musiciens ont été exemptés de tout ce qui n’est pas la musique elle-même. Pour ma part, je le dis avec modestie, je crois avoir progressé.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3UQm-mzPeqU[/embedyt]
Un artiste multireconnu, un virtuose adulé, un prof d’élite, peut-il réellement progresser ou aspirer à progresser ?
Évidemment. Tenez, un exemple : je me suis rendu compte, pour parler des sonates de Beethoven particulièrement, que le respect du texte était essentiel.
N’en aviez-vous pas eu conscience avant ?
Pas à ce point. Quand on est pris dans l’urgence habituelle, on n’a pas forcément conscience de tout ce que le compositeur a indiqué.
Pourquoi ?
Mais parce que c’est énorme ! Il y a tant d’indications, de détails voulus et même demandés par le compositeur… Regardez la question du tempo. Chacun peut avoir sa conception du tempo. Il n’y aura jamais de réponse définitive, encore moins en valeur absolue. Aussi nous faut-il penser le tempo d’un point de vue relatif, c’est-à-dire par rapport au texte et chacun par rapport à l’autre.
Donc les tempi restent un mystère. Avez-vous percé l’énigme des nuances ?
J’y ai beaucoup réfléchi même si, quand on parle de nuances, il faut aussi parler de la dynamique et, comme pour les tempi, penser moins de façon absolue que de façon relative en ménageant – parce que c’est ce qu’exige le compositeur – des contrastes permanents. Et puis, les nuances sont un ensemble. Pour les évoquer, il faut aussi parler de la valeur des silences et de ce que l’on appelle tout simplement « jouer en mesure ». Il n’est pas question du moindre rubato, hors ce que Beethoven a marqué. Par exemple, dans « La Tempête »…
… qui figure dans le premier double disque de votre intégrale…
… les ritenuti sont nombreux et précis. Nous devons les respecter absolument et rigoureusement. Ces élargissements ne sont pas laissés à la discrétion de l’interprète. Il n’est pas question de se permettre quoi que ce soit. Il-faut-res-pec-ter-le-texte, rien d’autre.
Le confinement a donc dopé votre rigueur.
Oui, peut-être parce que je l’ai d’abord vécu – et je n’ai pas été le seul dans ce cas – à la manière d’une punition. Quelqu’un que l’on punit, ce n’est pas quelqu’un que l’on tue. On ne lui ôte pas la vie. On le remet sur un supposé bon chemin. Eh bien, la pandémie en général et le confinement en particulier ont été une punition pour moi, et je crois que cette punition m’a remis sur le droit chemin, en l’espèce celui qui suit la volonté explicite de quelqu’un comme Beethoven.
Cette rigueur, conçue ici comme la conscience aiguë d’exécuter à la lettre le testament d’un compositeur, vous a-t-elle donné l’impulsion dont vous aviez besoin pour franchir le Rubicon et osé, enfin, de vous attaquer à l’intéGraal du pianiste : enregistrer les trente-deux sonates, tel un organiste d’une certaine envergure qui doit graver l’intégrale Bach ?
Quand on envisage d’enregistrer une intégrale, il faut se demander ce qu’elle apporte de plus qu’un florilège. Or, vous savez, Beethoven et les sonates pour piano, c’est très particulier. Beethoven n’avait pas grand-chose à voir avec un Mozart, lequel écrivait parfaitement dès son plus jeune âge. Beethoven, lui, a composé ses premières sonates alors qu’il approchait de la trentaine. À titre de comparaison, Chopin avait composé ses deux sublimes concerti à l’âge de dix-neuf ans ! À l’inverse, l’opus 111, qui clôt la série, n’est pas du tout une de ses dernières œuvres pour piano. L’opus 126 est consacré aux Bagatelles. Les grands quatuors, la Missa solemnis, la Neuvième symphonie, tout ça, c’est après. Donc enregistrer les trente-deux sonates exige de renoncer à l’idée d’un panorama biographique de Beethoven.
D’autant que le côté biographique, vous vous en fichez – contrairement à un Jean-Nicolas Diatkine, par exemple…
Oui, la vie du compositeur, je m’en fiche complètement, c’est l’art qui m’intéresse. Partant, enregistrer l’ensemble des sonates de Beethoven, même si elles ne couvrent pas l’ensemble de la vie du compositeur, c’est exprimer l’essentiel de son art.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=PDaUTIbqdqo[/embedyt]
Comment caractériseriez-vous cet « essentiel » ?
Il y a ce côté de défi juvénile, une énergie incroyable, comme une explosion que l’on sent dès la première sonate, très impressionnante de personnalité, de contraste, de brio car elle exige une grande virtuosité ; et, dans la Hammerklavier comme dans les trois dernières sonates, il y a ce côté métaphysique, généreux, presque fraternel, qui est proprement inouï. En somme, enregistrer les trente-deux sonates, c’est décrire ce parcours passant de l’élan à la passion (songez à l’Appassionata, bien sûr, même à la Sonate au clair de lune écrite avant !) pour aboutir à une réflexion sur la condition humaine, finalement. Par conséquent, pour répondre à votre question, c’est bien la rigueur qui me pousse à enregistrer une intégrale. Pas l’ivresse de graver une Intégrale, avec un I majuscule : l’exigence de tout enregistrer parce que ce tout forme un tout. Les trente-deux sonates, par-delà leur diversité, forment un monde qui se tient.
Prouvez-le-nous, de grâce !
Regardez la sonate op. 111. Elle n’a que deux mouvements. Le premier décrit une sorte de lutte incroyable, non pas agressive mais violente. Suit une arietta en forme de méditation philosophique très douce qui s’achève sur un silence qui préfigure l’éternité. Anton Felix Schindler, un contemporain du compositeur, le poursuivait en s’étonnant : « Mais vous avez oublié d’écrire le troisième mouvement ! » alors que l’on ne peut rien écrire après le second mouvement. Et Beethoven de finir par lui répondre : « Je n’avais pas le temps. »
Envisager une intégrale, est-ce pas osciller entre la tentation de l’unification (montrer que le tout est un tout) et celle de l’ultracaractérisation (montrer que, par-delà l’étiquette « intégrale », chaque partie est spécifique) ?
Il est possible que cette tension participe de l’intérêt du projet, pour l’auditeur comme pour l’interprète.
Vous-même, êtes-vous sensible à la dimension monumentale du projet artistique que sous-tend cette idée d’intégrale ?
Non et oui. Non parce que, pour être honnête, je n’aime pas tellement les intégrales précisément parce qu’elles sont rarement géniales du début à la fin. Il est parfois préférable, selon moi, de se constituer soi-même une intégrale idéale, sans considérer que l’ensemble doit être joué par le même interprète. Mais oui, je suis sensible à cette dimension monumentale parce que, évidemment, je suis fier de porter un tel projet. Il est sûr que, pour moi, c’est le projet de ma vie, une sorte d’accomplissement qui m’habite complètement… et qui vient juste de commencer puisque deux disques sont parus sur la dizaine qui est prévue.
3.
La passion du génie

Pierre Réach, après avoir évoqué l’interprétation et le rôle du texte, il est temps d’aborder l’art de construire une intégrale. Les organistes rusent avec Bach, en proposant des pièces par temps liturgique, par genre ou par type d’instrument, par exemple. Votre proposition pour Beethoven ne consiste pas davantage à proposer un déroulement chronologique des sonates. En témoigne ce double disque où vous rapprochez l’opus 31 des dernières sonates. Ce choix du contraste prélude-t-il à une poétique de la friction, ou a-t-il vocation à rester exceptionnel ?
Je n’ai pas une posture systémique. Chaque double disque sera construit spécifiquement. Ce sera le seul système que j’utiliserai ! Pour le premier double disque, je suis parti d’une évidence : je veux enregistrer les trois dernières sonates depuis toujours. Cette trilogie sublime était ma priorité. Or, nous vivons dans un monde où rien n’est acquis. J’en ai conclu que si jamais – ce qu’à Dieu ne plaise – la marque de disque ne pouvait pas m’emmener au bout de l’aventure, au moins, j’aurais enregistré les sonates que je préfère.
Vous les avez associées aux trois opus 31.
Pour la même raison : je les adore depuis toujours, notamment « La tempête », mais aussi celle que l’on appelle « La caille », une étiquette que je déteste, et celle que l’on appelle « La boiteuse », autant de titres qui ne sont évidemment pas de Beethoven. Cependant, ouvrons une parenthèse : cette question des titres charrie des histoires très drôles. Ainsi de la vingt-et-unième sonate dite « Waldstein », op. 53. En France, on l’appelle « L’aurore ». Je me rappelle que, quand j’étais petit, j’avais des disques de ce très grand pianiste français que fut Yves Nat, et où figurait cette sonate. J’ai retrouvé tantôt le programme d’un concert sublime de Wilhelm Kempff qui mentionnait également la sonate sous ce nom. Et Romain Rolland, que j’adore et qui a écrit des pages merveilleuses sur Beethoven, explique que, sous prétexte que le thème pouvait paraître décrire un lever de soleil, les Français ont adopté ce titre qu’ils croyaient allemand. En réalité, certains contemporains germaniques avaient dit : « Diese Sonate ist einen Horror », ce qui n’a pas exactement le même sens !
En attendant la Waldstein, vous offrez un paquet incluant les trois dernières et les trois opus 31. Pourquoi ?
Le couplage ne me paraît pas inintéressant. Les trois opus 31 ont un côté dramatique voire enjoué, surtout le troisième. Ils se tiennent, comme les trois dernières sonates se tiennent.
- L’opus 109 a un éclairage très particulier, parfois même un peu féminin sans jamais être efféminé, empreint de poésie et de tendresse, à même de laisser beaucoup d’interrogations (sauf le deuxième mouvement) ;
- l’opus 110, c’est la générosité à l’état pur, avec le cœur qui bat dans les arioso avant les fugues ; et
- l’opus 111, c’est le sphinx, avec un diptyque associant la volonté farouche à l’éternité de l’arietta.
Quelles sonates pour leur succéder ?
La prochaine session d’enregistrement, si tout va bien, aura lieu entre le 20 et le 30 juin. J’articulerai un programme en apparence peut-être un peu plus décousu, mais autour de sonates qui ont un double point commun : d’une part, je les adore ; d’autre part, je pense qu’elles sont prêtes. Il y aura
- la toute première, qui annonce l’Appassionata et pas seulement parce qu’elle est écrite dans la même tonalité ;
- la quatrième, une merveille en Mi bémol et en quatre mouvements qui, à mon avis, est la première des grandes sonates et ouvre la voie aux sonates romantiques ;
- la septième, qui inclut le célèbre et sublime Largo ;
- la huitième dite « Pathétique » ;
- la dixième, en Sol, que l’on ne joue pas si souvent, en dépit de sa douceur et de sa poésie ;
- la douzième, connue notamment pour sa marche funèbre, qui était la sonate préférée de Chopin ;
- la quatorzième dite « Clair de lune », encore un titre qui me laisse pantois ;
- la quinzième dite « Pastorale » ;
- l’Appassionata et
- la sonate dite « à Thérèse », dédiée à Thérèse de Brunswick,
l’une des candidates au titre d’« immortelle bien-aimée », même si Paul Badura-Skoda refusait de trancher ce qu’il qualifiait d’enquête policière ! Toutefois, on sait que cette « immortelle » était à Prague en même temps que Beethoven, qu’elle était déjà mariée et qu’elle était d’un rang social beaucoup trop élevé pour que le compositeur pût espérer quoi que ce fût. Le mystère qui entoure son identité ajoute sans doute de la beauté à cette histoire…
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qJ5lkhYmU8w[/embedyt]
Puisque la captation du deuxième double disque s’approche à grands pas, il est temps de poser une question désagréable mais peut-être pas si fielleuse qu’il y paraît : pourquoi une nouvelle intégrale ?
Je ne pourrai jamais résoudre cette question. Que dire ? Peut-être que je porte en moi ce projet comme une nécessité, et que, plus je grandis en âge, plus je suis convaincant que, ce qui compte le plus, dans la vie en général et dans l’art en particulier, c’est la sincérité. Si vous n’êtes pas sincère dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes, ça ne passera pas. La sincérité ne suffit pas, mais elle porte ce que vous faites et ce que vous êtes. Quand je joue Beethoven, je suis sincère.
Que signifie « être sincère dans Beethoven » ?
Quand je dis que je suis sincère dans Beethoven, c’est que, d’abord, j’aime profondément cette musique. Je ne la joue pas par obligation, je la joue par nécessité, vous sentez la nuance ? Ensuite, quand j’interprète une sonate, je crois accéder à une espèce de vérité. Si je ne suis pas vrai à ce moment, ma vie n’a aucun sens. Ça ne sert à rien que j’existe. Quand je mourrai, j’aurai eu une inexistence inutile. En revanche, si je parviens à partager cette sincérité à travers mes interprétations, je n’aurai pas vécu en vain.
Reste l’Everest à gravir et à justifier : à la difficulté technique, à la complexité musicale, à l’équation économique complexe – bref, aux problèmes que pose tout projet ambitieux, qui plus est quand certains grands décideurs se gobergent de la « crise du disque » pour justifier des options cheap, puputes ou ressortissant du copier-coller ronronnant, s’ajoute le drame (ou, moins sûrement, la chance) de n’être pas le premier à escalader cet à-pic !
Bien sûr, j’ai conscience que l’ascension est exigeante. Elle exige d’être raisonnablement fou. Raisonnablement, parce qu’il faut avoir conscience de sa folie. Fou, parce que, bien que conscient de sa folie, on ose se glisser dans la voie tracée par de nombreux prédécesseurs. Par conséquent, si votre question est : « Est-ce que les Fnac ont besoin d’une nouvelle intégrale, alors qu’il y en a plein et que Pierre Réach est moins connu que des stars comme Lang Lang ? », elle n’est pas sans pertinence. Cependant, il y a plus fort que ce réalisme : le sentiment qui m’habite et qui me pousse à le faire, ne serait-ce que pour mes enfants, mes proches, mes amis et pour les musiciens qui m’ont compris. Je veux leur laisser quelque chose. Oui, je veux laisser quelque chose.
Un artiste ne tient-il pas ce genre de propos systématiquement, dès qu’il sort un disque ou présente un nouveau récital ?
Mais heureusement ! Heureusement que, quand nous montons des projets, quand nous suons sang et eau pour maîtriser et creuser les beautés d’une partition, quand nous mettons en avant les programmes que nous choisissons de porter au disque ou sur la scène, heureusement que nous sommes convaincus que nous ne jouons pas seulement du piano : nous jouons notre vie ! C’est tellement d’investissement, de travail, d’émotions et d’espoirs que la tiédeur routinière n’a pas sa place – ou ne devrait pas l’avoir !
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vRkS0KLZ5Tc[/embedyt]
Cependant, la récurrence des mêmes éléments de langage, quelque sincères soient-ils, ne risquent-ils pas de dévaluer les mots ? En termes moins choisis, à force de dire qu’il se donne toujours « à fond », un artiste ne banalise-t-il pas son engagement ?
Je ne sais pas si je dis toujours que je suis « à fond », selon vos termes ; mais un artiste qui jouerait Beethoven sans être « à fond » ne mériterait pas d’être un artiste ! Je vous parle simplement, à ma façon, avec ma sincérité, de ce que je ressens à l’idée d’enregistrer l’intégrale de Beethoven. Pour être honnête, je pourrais – vous avez raison sur ce point – tenir le même langage pour les Variations Goldberg [début à 1’14 sur la vidéo ci-dessus]. Même si, en termes de durée, l’œuvre est moins spectaculaire qu’une somme de trente-deux sonates, pour moi, les enjeux sont proches : un chef-d’œuvre, une pièce que j’adore, et un répertoire ultra enregistré, y compris par les plus grands. Pourquoi capter les Variations encore alors que Glenn Gould, ou alors que Murray Perahia, par exemple ? Eh bien, je les ai enregistrées deux fois. Parce que je les adooore depuis toujours. C’est l’une de mes grandes passions dans la musique. Je continue à les travailler régulièrement car elles me servent de gymnastique cérébrale et m’aident à muscler mes réflexes. Donc, presque toutes les semaines, je les joue une ou deux fois.
Effectivement, les Variations sont un tube déjà souventes fois entonné – sur ces petites pages, nous en avons évoqué une production pianistique en disque et en concert, ainsi qu’une proposition organistique. On en revient donc à la tension entre feu intérieur et apparence de présomption superfétatoire.
Ce n’est pas une apparence : enregistrer une intégrale des sonates de Beethoven, c’est présomptueux. Déjà à l’échelle musicale, mais imaginez à l’échelle du monde ! Est-ce que la première chose dont l’humanité a besoin, c’est de l’intégrale des sonates de Beethoven par Pierre Réach ? Non, non, trois fois non, j’en ai pleinement conscience. Cependant, cet état d’esprit est malsain. J’y vois un prétexte à la paresse. Si on écoute ce genre de discours, on ne fait rien. Jamais.
Est-ce à dire que la dimension déraisonnable de ce projet, loin d’être un frein, est un stimulant qui vous convainc que vous êtes dans le vrai ?
Dans le vrai, je ne sais pas, mais qu’il faut le faire, oui. J’ai toujours pensé comme ça. J’aime tenter des choses hors de ma portée. J’aime vivre au-dessus de mes moyens. Ça m’est arrivé fréquemment. Je ne suis pas une exception. On est beaucoup, parfois, à faire des bêtises voire des folies. A posteriori, quand on analyse son comportement, on se dit : « Mais c’est du grand n’importe quoi ! »
Pourtant, quand on vous voit, on croit avoir affaire à quelqu’un de raisonnable !
L’un n’empêche pas l’autre ! Globalement, je suis quelqu’un de raisonnable, au sens où je ne crois pas avoir posé des actes parce que mon ego était hypertrophié. Je le reconnais, il m’est arrivé de commettre des erreurs – qui n’en a pas commis ? Du moins les ai-je commises avec sincérité. Je reconnais très facilement mes sottises et mes fautes, et j’adore me remettre en question. Par exemple, il m’est arrivé de travailler des œuvres avec certains grands artistes qui ont réussi à me donner à comprendre que j’étais à côté de la plaque. À chaque fois, je n’ai pas hésité à défier les convictions que j’avais bien ancrées en moi. C’est cela, pour moi, progresser. Cette attitude est indispensable, dans la musique ; et je rends grâces à mes élèves qui m’ont beaucoup appris, dans ce domaine. Ils m’ont souvent amené à me remettre en question tant dans le domaine de l’interprétation que dans ma manière de leur parler, de les traiter et de les considérer.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Ox2xqludPu8[/embedyt]
Alors posons la question de l’intégrale d’un point de vue musicologique, après l’avoir posée d’un point de vue personnel. Certains « sachants » affirment que, parmi les trente-deux sonates,
- certaines sont passionnantes,
- beaucoup très intéressantes et
- quelques-unes tout à fait inutiles,
ne devant leur survie qu’à cet étrange goût du marché musical pour l’exhaustivité. Dans cette perspective, un florilège des sonates n’est-il pas plus raisonnable qu’une intégrale ?
Je me méfie du concept de « raisonnable », pour les raisons, précisément, que nous venons d’évoquer. Néanmoins, je vais, pour une fois, vous répondre très directement. Comme vous, j’ai lu dans tel ou tel traité voire telle ou telle Histoire de la musique, que certaines sonates – comme certaines symphonies – de Beethoven, sont jugées « moins bonnes » que d’autres. Si vous m’en croyez, à part pour une sonate – en l’espèce l’opus 79, qui succède à celle pour Thérèse et n’est pas aussi géniale que les autres –, je suis convaincu que les trente-et-une autres sont exceptionnelles ; et, même si je n’ai pas encore eu le temps de m’y coller, j’ai l’intention, puisque tout se passe sur les réseaux sociaux, avec mon p’tit iPhone, de me filmer en commentant, exemples à l’appui, chaque sonate que je porte en moi avec passion, afin de convaincre, en trois ou quatre minutes, qu’il n’y a pas quatre ou cinq sonates de géniales dans le corpus beethovénien, mais trente-et-une.
Vous pensez que le nombre des sonates amène à douter que Beethoven ait pu être génial à chaque fois ou presque ?
Je crois que l’important, comme pour la question du raisonnable, est de s’entendre sur la notion de « génie ». Suis-je en train de dire que toutes les sonates ont cette intensité coruscante de l’Appassionata ou de la « Clair de lune » ? Évidemment que non. Toutefois, je veux mettre en garde contre deux dangers :
- la paresse qui consiste à préférer réentendre qu’écouter ; et
- la foi dans la doxa qui considère que, fors l’Appassionata, point de génie !
L’Appassionata est géniale mais elle finit par tuer d’autres sonates tout aussi belles. Vous savez que, mon premier disque, pressé par RCA, était consacré à la sonate de Charles-Valentin Alkan, grand compositeur injustement oublié – peut-être parce qu’assez inégal – et grand ami de Chopin. Reste que sa sonate sur les quatre âges de la vie m’a ouvert des portes. Je l’ai fait découvrir à beaucoup, et c’est ce que j’aime : donner à découvrir. Tant de compositeurs ne sont pas reconnus à leur juste valeur ! Même chez Schubert, de nombreuses œuvres sont négligées, parce que ce ne sont pas celles que les programmateurs attendent… ou parce que les interprètes préfèrent aller au plus connu, les deux hypothèses étant complémentaires.
Votre petit côté provocateur semble prendre le dessus : avec cette intégrale, vous affirmez maintenant que vous aspirez à faire découvrir Beethoven !
Mais bien sûr ! Si, avec cette intégrale, je permettais aux mélomanes de découvrir des sonates inattendues, à côté des plus fréquentées, je n’aurais pas perdu mon temps. Tenez, il y a une sonate sublime et souvent mise de côté, c’est la « Pastorale »…
… qui arrive dans votre deuxième double volume…
C’est l’une des plus belles. Chaque fois que je joue les sonates en les travaillant, puisque, maintenant, je les ai dans les doigts, mon inclination pour elle se renouvelle. Ce genre de surprise me prend aussi chez d’autres compositeurs. Par exemple, je joue Chopin. J’adooore jouer Chopin. J’adore jouer Bach, aussi, c’est le plus grand ! Et que dire de Schumann ? Vient un moment où un classement, fût-il pseudo objectif, ne peut advenir. Le génie musical n’est pas l’exclusivité d’un compositeur, pas plus qu’il ne s’exprime dans une seule œuvre. Le génie musical est comme un ciel où brillent des étoiles innombrables qui nous attirent plus ou moins selon notre cœur, notre sentiment du moment, notre vie, nos habitudes, aussi. Les étoiles qui nous attirent moins n’en sont pas moins étoiles que les étoiles qui nous attirent plus.
4.
La quête du son
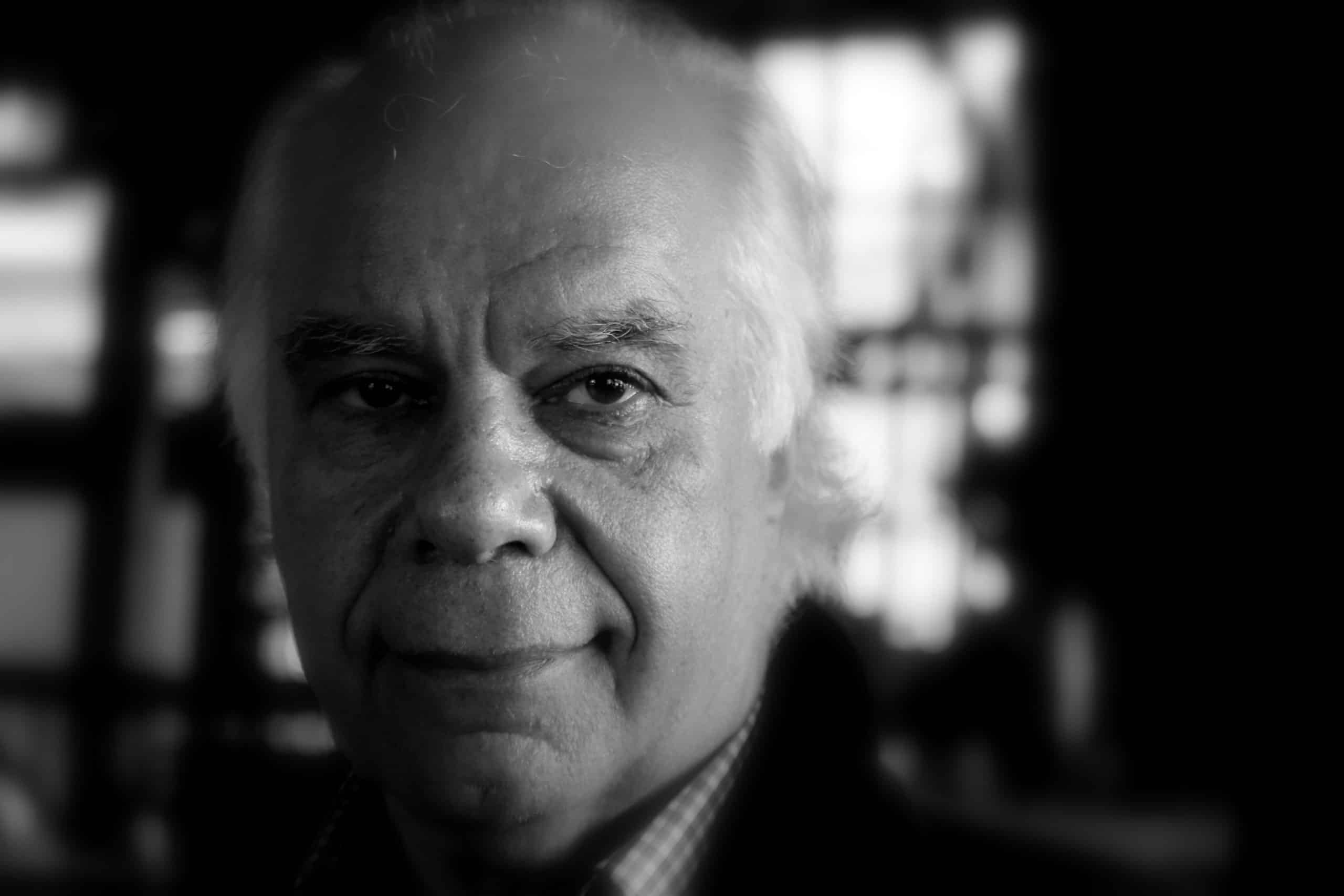
Pierre Réach, pourquoi avez-vous choisi d’enregistrer votre intégrale des sonates de Beethoven pour Anima, un petit label ? Même si le résultat est d’une qualité évidente, certains experts vous affirmeront que ne pas être édité dans une grosse écurie entraîne souvent une perte de visibilité. Qu’est-ce qui vous a décidé à « y aller » quand même ?
Votre question est loin d’être anodine. La taille de la maison de disques, sa notoriété, son ancienneté, les entrées qu’elle a dans les milieux médiatiques ou auprès des programmateurs n’est pas neutre du tout. Je vais vous répondre à travers mon expérience, qui m’a permis de connaître des situations variées. Au début de ma carrière, j’ai enregistré quelques disques pour RCA. Hélas, RCA France a fermé boutique. Ensuite, j’ai souvent enregistré pour des labels beaucoup moins importants. Ainsi, les Goldberg, je les ai gravées pour Saphir, et le disque a été repris plus tard par Calliope.
Donc, pour l’intégrale Beethoven, vous n’aviez pas peur, pour ainsi dire, de ne pas profiter d’une étiquette plus prestigieuse ?
Tout n’était pas écrit d’emblée. Le projet a d’abord pris corps en Chine. Je vous avoue que ça m’inquiétait un peu. Les Chinois sont tellement incroyables qu’ils imaginent que tout le monde a la même rapidité qu’eux. La suite a donné raison à mon intuition : on m’a proposé de graver l’intégrale en un mois. Bien sûr, j’ai refusé. J’estimais en être incapable. Mes interlocuteurs ont insisté, m’affirmant que j’allais y arriver. Ils aimaient la façon dont je jouais, et ils y croyaient vraiment ! En me fixant en Europe, la pandémie m’a ôté du pied cette épine en forme de défi car c’est à ce moment que Bertrand Giraud, directeur artistique d’Anima Records, m’a proposé de s’occuper du projet et d’enregistrer le premier double disque en Espagne. Il avait un atout maître dans sa manche : Étienne Collard, un ingénieur du son dont je connais l’excellence des captations. Alors, oui, Anima Records est un petit label – et alors ? Quelle importance ? De nos jours, les cartes sont rebattues. Allez à la Fnac demander un disque, il y a peu de chance qu’ils en disposent. Même si je ne me retrouvais pas en tête de gondole à Châtelet, je m’en fichais un peu. Ce qui comptait, c’était la promesse de qualité sonore et de conditions de travail qui m’était formulée. Que le label s’appelle Deutsche Gramophone ou Anima Records n’impacte en rien le résultat.
Est-ce votre expérience qui vous aide à relativiser l’attraction de l’étiquette ?
Disons que je préfère être traité avec respect et déférence par un petit label qui met à ma disposition des conditions d’enregistrement idéales, plutôt qu’être considéré comme un pianiste parmi tant d’autres qui enregistre à la va-vite pour des firmes prestigieuses type Decca ou autre. L’objectif du rendu doit primer sur la flatterie éphémère de la marque.
Justement, ce « rendu » mérite d’être un peu exploré. Comment enregistre-t-on Beethoven aujourd’hui ? Par exemple, comment choisit-on son instrument : pianoforte ou piano ? et si piano, quel piano – vous êtes certes un artiste Steinway, mais, à titre d’exemple, Jean-Nicolas Diatkine, artiste Steinway lui aussi, n’a pas choisi un Steinway pour son dernier disque Liszt-Wagner ? Cette décision est loin d’être un détail, car elle est souvent consubstantielle aux options d’interprétation…
J’ai beaucoup de choses à vous répondre à ce sujet qui, vous avez raison de le souligner, est fondamental. J’ai eu beaucoup de chance. En effet, la plupart du temps, j’habite à Barcelone, où je suis connu comme pianiste et comme professeur par la maison Jorquera, qui représente la firme Steinway à Barcelone. L’entreprise a mis gracieusement un instrument merveilleux à ma disposition – et elle va continuer à me soutenir de la sorte pour les prochains albums. Que demander de plus ?
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TxuHLyIjYFk[/embedyt]
Parlez-nous de ce Steinway que l’on entend sur votre double disque…
Dans les jours qui précèdent, il avait été joué par Arcadi Volodos et Evgueni Kissin, excusez du peu. Si un mauvais piano est une casserole, il faudrait inventer un mot pour désigner, a contrario, un piano extraordinaire ! Néanmoins, je n’ai pas choisi un Steinway parce que je suis un artiste Steinway. Il m’est arrivé de jouer sur des Yamaha exceptionnels. Il faut ainsi reconnaître que leur dernier CFX témoigne des progrès formidables accomplis par cette marque dans la quête infinie de la perfection. À d’autres occasions, j’ai aussi joué assez souvent sur des Fazioli. Je les aime beaucoup.
Vous n’êtes donc pas un pianiste monomaniaque !
Non, mais je ne suis pas sensible à tous les pianos non plus. Par exemple, je n’ai pas de dilection particulière pour les Bösendorfer. Ce n’est pas que leur qualité soit moindre, notez bien ; simplement, nous n’arrivons pas à nous entendre – ou, plutôt, je n’arrive pas à les amadouer ! Bref, ces pianos-là ne me conviennent pas. De toute façon, pour moi, Steinway est irremplaçable. Aussi la proposition de la maison Jorquera tombait-elle à merveille.
La tentation de jouer sur un pianoforte vous a-t-elle effleuré ?
Non.
Pourquoi ?
Écoutez, je joue beaucoup Bach au piano. Certains clavecinistes mal léchés pourraient s’en offusquer à bon droit, en un sens. Ce que je joue au piano, Bach l’a écrit pour un cembalo, id est pour un clavecin. Ce nonobstant, l’esprit de Bach est quelque chose d’unique. Il va au-delà de l’instrument mentionné sur la partition. Soit, il a écrit pour un clavecin. Faut-il le réduire à cet instrument ?
Sous-entendez-vous que le clavecin est plus clivant que le piano ?
Je ne crois pas. Personnellement, j’adooore le clavecin. J’ai beaucoup écouté les disques de Wanda Landowska…
… qui était aussi pianiste…
… et qui, par conséquent, connaissait sur le bout des doigts la spécificité du clavecin, à savoir que, quand vous jouez une note sur un clavecin, il n’y a pas d’étouffoir pour la brider ; si bien que toute note est accompagnée de sa résonance. C’est la raison pour laquelle je me bats contre les pianistes qui refusent d’utiliser la pédale de sustain dans Bach sous prétexte que les pièces étaient destinées au clavecin. Quelle idée ridicule ! Le son du clavecin inclut toujours une petite réverbération après l’émission de la note. Pourquoi l’en priverait-on en jouant la même œuvre au piano ? Voilà le premier point qui explique pourquoi il est légitime de jouer Bach au piano. Le second… Ma foi, le second est au moins aussi important. Le point central, chez Bach mais que chez lui, c’est le legato. Yvonne Lefébure, mon premier grand professeur, m’a élevé dans l’obsession du legato. Comment mieux rendre le legato qu’au piano ? Au fond, quel que soit le type d’instrument, la question qui demeure et demeurera toujours est celle de l’interprétation. Or, Bach n’a rien écrit sur les partitions qui nous donnerait des pistes pour les nuances et les tempi, par exemple. Partant, il nous revient de réfléchir sur la manière d’interpréter. À quelle vitesse est-il pertinent de jouer une fugue du Clavier bien tempéré ? Certains optent pour une lenteur extrême, tel Sviatoslav Richter ; d’autres leur donnent plus d’allant, tel Glenn Gould. Comment trancher ? Je dis souvent à mes élèves de penser à des cordes graves, alto ou violoncelle. Remémorez-vous le début des Goldberg. Si on imagine un archet qui joue, on peut avoir une idée du tempo opportun.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=CPpmhRc60F8[/embedyt]
Seriez-vous victime d’une sorte de synesthésie musicale ? Nous parlons piano, vous évoquez le clavecin, et nous voici parmi les cordes !
La musique est rebelle au cloisonnement et, pour ma part, j’aime beaucoup les transcriptions. J’ai souvent joué la Symphonie fantastique d’Hector Berlioz transcrite par Franz Liszt. Liszt n’a pas son pareil pour dénicher les sonorités d’orchestre dans le piano. Pensez que quelqu’un comme Robert Schumann, ne pouvant se déplacer pour l’entendre en version orchestrale, a connu l’œuvre de Berlioz dans sa transcription lisztienne ! C’est ce que j’aime dans les transcriptions : elles permettent de faire rayonner la beauté et l’esprit d’une œuvre. Si je joue une œuvre pour orgue transcrite par Liszt ou Busoni, mon but n’est pas de la jouer comme si c’était une pièce originellement conçue pour piano mais, grâce à mon instrument et à ses possibilités spécifiques, pas meilleures : différentes, de retrouver l’esprit de Bach à travers un autre instrument.
Jouer les Goldberg sur un piano et non sur un clavecin, et les sonates de Beethoven sur un piano et non sur un pianoforte, revient-il en quelque sorte à transcrire l’œuvre originale ?
Non, évidemment que non ; et cependant, cela remet au centre de l’interprétation l’instrument dont nous disposons. D’où ma préférence pour les Steinway. Ce sont les plus beaux pianos du monde, et…
… et les pianofortes ne trouvent pas grâce à vos yeux.
Je dois vous avouer que je n’aime pas le pianoforte. J’ai conscience que certains lecteurs s’en offusqueront. Ils seront en bonne compagnie : quand j’ai exprimé cette opinion à Paul Badura-Skoda, il n’était pas content ! J’aime le clavecin, j’aime le piano, mais je trouve que le pianoforte a un son bâtard, mal défini ; et je suis toujours un peu frustré quand j’entends les plus belles sonates de Beethoven ou même de Haydn jouées sur un pianoforte. Pardon à ceux que je vais décevoir ou blesser, je préfère être sincère : je n’aime pas le pianoforte.
En rejetant cet instrument, vous mettez en avant votre vision des partitions sans vous protéger derrière un paravent historico-musicologique.
Je m’en tiens à cette évidence : pour moi, pas question de graver une intégrale des sonates de Beethoven sur un pianoforte. D’une part parce que ses sonorités ne m’envoûtent pas ; d’autre part parce que je ne suis pas à proprement parler pianofortiste. Et puis, à mon sens, il n’y a pas à barguigner ! En 2022, les sonates de Beethoven, ça se joue sur un grand Steinway, point final.
5.
Le devoir de transmettre

Pierre Réach, vous faites partie de la grande cohorte des solistes pédagogues. Cette figure musicale s’impose largement aujourd’hui – le portrait que Le Monde vient de consacrer (6 mai 2022, p. 20) à Michel Dalberto s’ouvre sur une séquence d’enseignement dispensée à Ryutaro Suzuki autour de… l’Appassionata de Beethoven. Votre particularité, peut-être, partagée avec quelques-uns de vos collègues mais plus ouvertement assumée, est d’avoir l’enseignement chevillé au corps et à l’esprit, au point que vous ne distinguez pas, d’une part, votre activité de soliste et, d’autre part, votre activité d’artiste. L’une ne va pas sans l’autre, et vice versa. En cela, vous vous distinguez notamment de l’icône Martha Argerich dont on dit que l’enseignement n’est ni son pêché mignon, ni la plus grande de ses passions.
Non, c’est un fait – un fait regrettable mais un fait : Martha Argerich n’aime pas enseigner.
Bon, je sens que j’ai enfin trouvé le moyen de vous escagasser.
M’escagasser, non ! Aviver une déception structurelle, peut-être… Car, enfin, cette posture, c’est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, presque que je ne pardonne pas. Qu’une aussi grande artiste se refuse à transmettre des bribes de son génie, quelle tristesse ! Voilà une musicienne sublime, enchanteresse de Bach à Stravinsky ; voilà une poétesse qui a compris tous les compositeurs ; voilà une pianiste capable d’en restituer la moindre finesse ; voilà l’énergie et la justesse incarnées, le feu et la glace, l’amour et la tempête, quelqu’un dont la moindre de ses prestations ressortit d’une pertinence incroyable ; voilà, en somme, un trésor de la musique en général et du piano en particulier. Eh bien, je vous le dis tout rond, je ne peux donc pas comprendre que cette figure tutélaire n’ait pas le souci, l’envie, le désir brûlant – voire la conscience qu’il est de son devoir – de passer aux jeunes ce qu’elle sait. Je vais même être sévère, mais cette sévérité est à la hauteur de mon admiration : je trouve que ce refus est la preuve d’un immense et déplorable égoïsme.
Elle a donné quelques classes de maître, je crois…
Sans doute faites-vous allusion à cette anecdote selon laquelle, pour une fois qu’elle donnait une masterclass en Italie, soudain, devant un jeune qui ne lui semblait pas au niveau, elle s’est cabrée et elle a fait feu des deux fuseaux. Ni plus, ni moins ! Le pauvre gars a dû rester bien benêt… si la scène est réellement advenue. Olivier Bellamy, qui est mon ami et qui est aussi très proche de Martha Argerich, m’a affirmé que ce serait une légende urbaine dont se goberge le Landerneau du piano classique. Admettons que l’anecdote soit contestable. Reste une vérité incontestable, elle : le refus libre mais tellement scandaleux de ce génie du piano de diffuser un peu de sa science hors norme, de son talent fabuleux et de son âme si profonde, si riche, si subtile à la jeune génération.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NSpz2O8gY_E[/embedyt]
À l’opposé de cet égoïsme, vous avez développé une grande activité pédagogique selon des perspectives, disons, holistiques. Pour vous, tout ne se joue pas sur les 84 touches du clavier.
Bien sûr, la posture d’enseignement ne se limite pas à des leçons techniques, et je ne parle pas des fois où l’on est un peu la papa et la maman – en même temps – de tel ou tel étudiant un peu perdu. C’est quelque chose qui se découvre et se renforce avec l’expérience. Vous savez, j’ai eu de très grands élèves qui, aujourd’hui, donnent des concerts, comme Sélim Mazari, la Lituanienne Paula Dumanaite ou la Japonaise Natsuki Nishimoto, qui donne beaucoup plus de concerts au Japon dans son pays natal… et ça m’emplit de bonheur pour elle ! Mais, attention, j’ai eu aussi des élèves pas bons. Eh bien, dans les deux cas, j’ai toujours eu envie de les connaître en tant que tels, pas seulement en tant que wanna be virtuoses en cours de perfectionnement.
Le tri s’effectue progressivement, et vous ne perdez pas de vue les meilleurs !
Certains des bons qui souhaitaient rester en contact sont presque devenus des amis. Simon Adda-Reyss, qui fait une belle carrière et est devenu professeur-assistant au CNSM de Paris, m’a téléphoné l’autre soir à ce titre. Bref, pour répondre eu premier volet de votre question, quand on enseigne le piano, il n’est pas question de s’occuper seulement du piano.
D’autres enseignants, notamment certains jeunes arrivant au Graal suprême du titulariat au CNSMDP, tiennent en revanche, sans doute par prudence, à étanchéifier la frontière entre technique instrumentale et relation humaine. Vous, vous avez été converti à une pédagogie plus globale en tant qu’élève de Maria Curcio.
Maria Curcio a été mon professeur après que j’ai fini le Conservatoire. Quand on allait chez elle, on la payait pour la leçon (c’est normal, il faut que chacun gagne sa vie !) mais, après, on devenait très vite son ami, on dînait avec elle, on parlait de musique, et ces prolongements enrichissaient voire illuminaient son apport pédagogique. J’ai connu ça avec Alexis Weissenberg. Je ne le voyais pas souvent mais, quand il était à Paris, je tâchais de ne pas rater cette occasion. Avec Arthur Rubinstein, je ne peux pas dire que c’est allé aussi loin, et cependant nous avons eu des échanges très personnels sur des sujets qui allaient largement au-delà du piano. Ces expériences m’ont convaincu, par l’exemple, que, à un certain niveau, le piano ne se limite pas au piano, pas plus que l’enseignement ne se limite à l’enseignement. La transmission doit participer d’une certaine complicité voire d’un échange. Ainsi, je ne me suis jamais offusqué – au contraire ! – quand, au cours d’une leçon, un élève m’interrompt gentiment pour me dire : « Ne pourrait-on voir ce passage d’une autre façon ? » J’adooore ça !
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TCimXv5jg-o[/embedyt]
Tous les enseignants ne sont pas de cette eau.
Non, et c’est heureux qu’il n’y ait pas un moule unique ! Prenez Yvonne Lefébure, mon premier professeur au Conservatoire. Elle était le contraire de ce que je viens de décrire. Il n’était pas question de faire le contraire de ce qu’elle disait. Sinon, vous déclenchiez l’orage ! Eh bien, je crois que, sur ce point, cette sublime pianiste, cette artiste dans l’âme, cette pédagogue passionnée était dans l’erreur. Elle estimait enseigner la vérité ; partant, elle n’admettait pas qu’un autre monde fût possible. Ce n’était pas une question de supériorité, juste qu’elle pensait qu’il n’existe qu’une vérité et que le devoir du professeur est de l’inculquer à ses ouailles. Mille fois par cours, au moins, elle se mettait au piano et me disait : « Regarde, mon petit Pierre, ce que je fais. » J’aurais eu envie de lui répondre – et j’ai eu ô combien raison de m’en abstenir : « Voyons, madame, je ne vais pas vous imiter !»
On n’imagine pas Alexis Weissenberg disciple d’une semblable didactique…
C’était même tout le contraire ! J’ai vu dans un film paru après sa mort qu’il expliquait pourquoi il ne se mettait jamais au piano quand il donnait une classe de maître. Il disait : « Si je me mettais au piano, l’étudiant se sentirait obligé de me copier. »
Avez-vous réussi une synthèse entre la méthode Lefébure et la méthode Weissenberg ?
Disons que je ne suis d’accord ni avec l’un, ni avec l’autre, id est ni avec l’idée qu’il existe une vérité absolue d’interprétation qu’il faut copier telle quelle, ni avec une pédagogie strictement verbale qui n’illustrerait pas un propos par un exemple concret. Je crois qu’il faut se mettre au piano pour donner un exemple et développer l’imaginaire des jeunes, pas pour imposer une vision en affirmant qu’elle est la seule valable. Attention, n’exagérons pas : il y a des bases qui ne sont pas contestables – en l’espèce, celles que l’on voit dans le texte. Pour le reste, il y a des traditions, des possibilités, des options, mais pas de certitude. En musique, il faut vraiment se méfier de la foi en la vérité absolue. À titre personnel, je m’en méfie d’autant plus que, en tant que professeur, j’ai conscience de disposer d’un grand pouvoir. Dans une petite mesure, j’ai la vie de mon élève entre mes mains. Un peu de modestie, de prudence et d’écoute ne peut pas nuire.
Vous évoquez ici de grands élèves qui peaufinent leur interprétation et affinent leur technique. Parmi eux, vous avez dû dénicher des pépites et subir des chèvres…
Des chèvres, comme vous y allez ! En revanche, et j’en parle souvent avec des collègues, je reconnais qu’il m’arrive de croiser la route d’élèves dont je suis convaincu que, même s’ils arrivent à jouer les notes, c’est peine perdue.
Pourquoi ?
Ils n’ont pas de talent. Soit, énoncer de but en blanc cette intuition peut passer pour de la prétention ; et, pourtant, c’est, j’en suis sûr, une forme d’objectivité nourrie par l’expérience.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ghZ4reaZ5A0[/embedyt]
Comment gérez-vous cette tension entre lâcher : « Ne perds pas ton temps, c’est mort », et feindre qu’une carrière est encore accessible ?
Voilà la question… Quoi dire ? Évidemment, le premier membre de l’alternative n’est même pas envisageable. Vous pouvez casser quelqu’un avec des mots, lui faire profondément violence y compris en tâchant d’être mesuré et modéré dans votre propos. Vous pouvez vraiment tuer quelqu’un avec des mots.
Surtout vous qui travaillez avec des artistes qui se voient forcément un jour en haut de l’affiche…
Pas forcément, détrompez-vous, mais c’est un fait que j’ai affaire à des jeunes qui ont consacré leur vie au piano, à l’espoir d’en vivre et de faire carrière. Il est hors de question de leur dire de but en blanc qu’ils ont un bon niveau mais qu’ils n’atteindront jamais le très haut niveau, pourtant indispensable à leur projet. C’est une valse à trois temps :
- vous savez qu’ils n’ont pas l’étincelle, le talent, le génie nécessaires ;
- cependant, vous vous méfiez du pouvoir de destruction des phrases que vous pouvez prononcer ;
- et néanmoins, vous avez un devoir d’honnêteté, de sincérité.
Rien n’est simple, tout se complique… Alors, quelle est la solution, professeur ?
Un entre-deux sincère, probablement, qui consiste à ne jamais laisser croire à un élève qu’il aura probablement des engagements alors que vous vous doutez du contraire. Si les mots peuvent faire du mal, qui sait si s’exprimer à demi-mots peut faire ce moindre mal qui, in fine, est un bien pour celui qui perçoit le message ? Mais aussi, ça se saurait si enseigner le piano était aussi simple ! Transmettre ce que l’on sait à de grands élèves, c’est aussi assumer cette réalité : il arrive que de bons techniciens n’aient pas de talent ; c’est compliqué de le leur laisser comprendre sans les désespérer pour autant ; et, toutefois, la sincérité de l’enseignement est à ce prix.
Face à ces « presque bons mais limités », les « vrais bons » élèves vous rassérènent.
Ha, oui, quelle satisfaction quand je vois que quelqu’un comme Jordi Humet Alsius donne beaucoup de concerts en Espagne ! C’est un élève qui m’aimait bien et qui était content du travail que nous avons effectué ensemble, et ça me touche. Pour moi, l’enseignement n’est pas qu’un gagne-pain : artistiquement, émotionnellement, humainement, cette partie de ma vie est très importante.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WYu5rBZfaJo[/embedyt]
À l’occasion de l’hommage que vous avez rendu à Jean Fassina, un des vos professeurs, vous avez déclaré – et notre entretien le confirme – qu’un interprète ne pouvait pas ne pas être un pédagogue [voir vidéo supra, à 1’15]. Est-ce
- grâce à un sentiment qu’il existe une obligation de transmettre, ou
- à cause de l’intuition que l’enseignement peut éclairer autrement votre vision d’une œuvre voire du métier ?
Les deux, mais il y aussi une troisième chose ! Je dois reconnaître que le métier de pianiste a un côté exhibitionniste. Il ne faut pas avoir honte de dire que l’on aime se montrer. J’adore entrer en scène. J’adore jouer. C’est pourquoi la pandémie a été un moment terrible pour moi. J’avais besoin d’être en concert. Néanmoins, cette nécessité va au-delà de la prétention ; elle procède de l’évidence que la musique n’existe pleinement que quand elle est jouée. Sans cela, la partition est une lettre morte. Si cela vous chaut, vous pouvez passer des nuits entières à lire les quatuors de Beethoven, c’est merveilleux intellectuellement ! Ce nonobstant, le plaisir de jouer soi-même quand quelqu’un vous écoute est d’une nature très différente. Il s’articule autour de l’envie de donner ce que l’on a en soi, de même que, quand vous êtes profondément amoureux, vous êtes heureux d’offrir à l’être aimé le plus beau cadeau du monde ou de lui déclarer le plus joliment votre transport. Sur le même modèle, un artiste a besoin de donner à son public. Il est généreux par nature. Les artistes qui donnent par obligation et non par nécessité sont, au fond, très pauvres.
Cela fait écho à ce que narrait la mezzo-soprano Nora Gubisch en racontant « sa » pandémie. Elle expliquait que, au début, elle était heureuse de se retrouver avec « son homme [le chef d’orchestre Alain Altinoglu] et son fils », puis qu’elle a senti qu’elle devenait étrangement irritable… et elle a compris que le public lui manquait. Elle avait besoin de donner – et elle s’est mise, notamment, à donner des cours de chant par visioconférence…
En effet, en tant qu’artiste, mais aussi en tant qu’humain, comment ne pas donner ? Quand vous avez des gens qui, après leur journée de travail, se déplacent et payent pour venir vous écouter – pas vous entendre, pour vous écouter, c’est très différent –, comment ne pas avoir envie de les transporter par la musique en leur offrant un moment hors du temps et de l’espace, au contact des plus grands chefs-d’œuvre de la musique que vous avez envie de partager avec eux ? Quand vous êtes professeur au Conservatoire ou ailleurs, ou quand vous donnez des classes de maître en France ou à l’étranger, comment ne pas être inondé du bonheur de faire découvrir des pistes que les jeunes venus quérir vos conseils n’ont peut-être pas encore trouvées ? Un jour, un jeune m’a dit : « J’ai découvert cette œuvre grâce à vous. » Quelle joie ! J’ai lu un entretien où Sélim Mazari affirmait avoir appris à aimer Beethoven grâce à moi. Quelle fierté ! Voilà les plus beaux cadeaux qu’un élève pouvait m’offrir : ouvrir des portes, construire des passerelles, enrichir des mondes intérieurs…
Sauf que, maintenant, vous constatez que Sélim Mazari donne peut-être plus de concerts que vous…
N’essayez pas de me rendre jaloux ! Ce n’est pas dans ma nature, et ce genre de constat fait le contraire de me rendre jaloux : il me rend infiniment heureux.
Certes j’ai cru lire quelque part que vous aviez la réputation, rarement mentionnée pour parler d’un soliste, d’être un homme bon.
Bon ? Non, rassurez-vous j’ai de gros défauts comme tout le monde. En revanche, j’adooore quand mes élèves sont en capacité de partager ce que je crois être merveilleux.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3HgZ5eqrLxw[/embedyt]
Donc vous avez converti des élèves à Beethoven ; mais votre emprise va au-delà.
Je n’ai d’emprise sur personne – même sur moi, parfois, je doute ! Mais, plus sérieusement, vous avez raison, j’essaye de transmettre aux élèves ce qui, j’espère, a une chance de les aider. Par exemple, beaucoup ont des problèmes d’organisation. Je les appelle à la rigueur. Je ne veux pas entendre des : « Je suis un artiste, je me réveille tard… » Ben non. Il faut se lever tôt. L’art est un travail. Pas que, mais aussi. Souvent, notamment à Barcelone, mes élèves m’expliquent qu’ils n’ont pas que le piano dans leur cursus. D’autres disciplines les accaparent : harmonie, contrepoint, techniques corporelles… Certains tentent de s’en servir pour m’expliquer qu’ils manquent de temps pour travailler. Face à de tels propos, je suis intraitable. Pas par méchanceté ou par plaisir de donner des leçons de moraline, juste parce que c’est mon devoir de les avertir qu’ils font fausse route. Je martèle donc qu’il faut se lever tôt et organiser son planning de manière très pragmatique. Alors, tout ce que l’on veut vraiment faire, on peut le faire.
Cyprien Katsaris expliquait que cette structure et cette exigence, il les avait construites pour partie grâce à l’Église de scientologie. Il est heureux que d’autres enseignements, moins sujets à polémiques et inquiétudes, existent pour guider les futurs artistes !
Moi, je suis quelqu’un de très organisé. En général, je me lève très tôt. Sans regret : je n’arrive pas à bien dormir, le matin. Surtout, je me dis : le travail avant tout ! Or, le travail consiste à déterminer comment partager ce que l’on fait avec les gens. Vous ne devez pas garder pour vous ce que vous avez mis tant d’années à construire. Quand on donne des concerts devant des milliers de personnes, comme Martha Argerich, quand on a des aficionados par millions, quand on a un niveau technique superlatif et une sensibilité musicale aussi époustouflante, comment peut-on ne pas avoir le souci de partager son art avec la jeune génération ? J’avoue que ce gâchis me trouble…
À l’inverse, sur ce point, vous avez une grande admiration pour Yvonne Lefébure, en dépit de l’univocité de sa conception musicale.
Même si l’élève que j’étais n’était pas toujours d’accord avec les options privilégiées voire exigées par son enseignante, un cours d’interprétation par Yvonne Lefébure était un moment fantastique, peut-être encore plus épanouissant que ses concerts. Elle nous apprenait à partager avec les autres ce qu’elle aimait. Quand vous voyez un beau tableau, vous n’avez pas envie de le garder pour vous, n’est-ce pas ? Eh bien, la musique, c’est pareil. Il faut la partager avec ceux qui vous font l’amitié de venir vous entendre, en tant que concertiste ou en tant que professeur… voire les deux !
6.
L’éloge du doigté
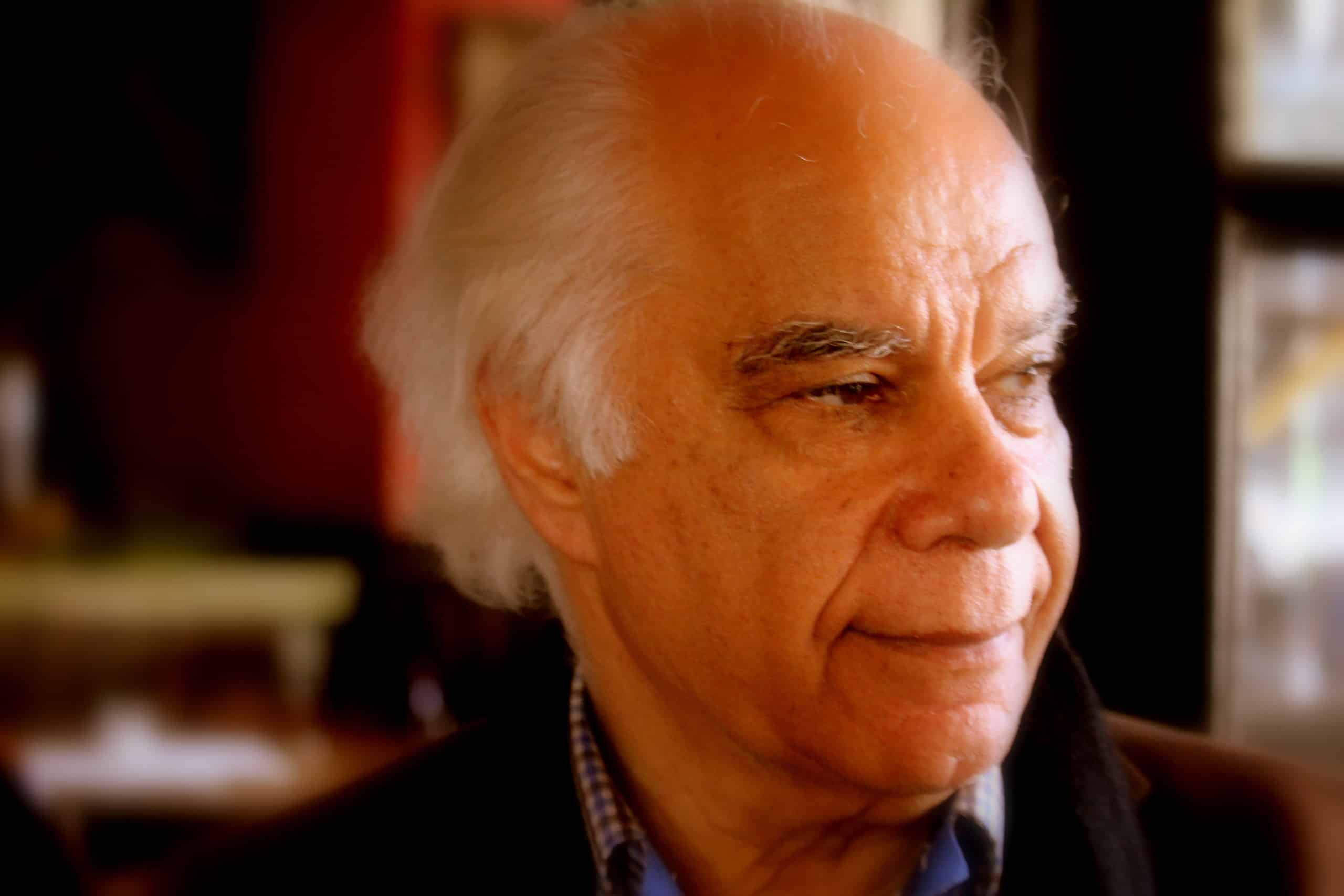
Pierre Réach, dans l’épisode précédent de notre saga, nous avons évoqué quelques principes généraux de l’enseignement du piano. Passons au concret, puisque le but de l’enseignement, au stade où vous suivez vos élèves, est de les transformer en concertistes. Or, vous avez expliqué – avec délectation – que vous aviez passé avec votre cher professeur Jean Fassina deux heures sur la première ligne du quatrième concerto de Beethoven.
C’est l’entière vérité.
Cela peut surprendre. La vie d’un artiste n’est-elle pas rythmée par des échéances à tenir ?
Si tout va bien, si.
Donc on ne peut passer deux heures sur chaque ligne de chaque partition.
On peut passer beaucoup plus, croyez-moi.
Cependant, il vous faut aussi avancer pour assurer l’ensemble d’un récital. À quel moment décidez-vous que sont fixés et intégrés
- tempi,
- doigtés,
- pédale,
- phrasé,
- sonorité,
- vision d’ensemble…
au-delà de la première ligne ?
Vous m’obligez à être sincère une fois de plus. Il m’est arrivé de donner des concerts pour lesquels je n’étais pas prêt. J’en avais pleinement conscience. Chaque musicien a connu ça pour une raison simple, qui n’est pas la paresse mais la nécessité de gagner notre vie. On nous propose un programme, on a besoin d’argent, on accepte et, le jour du récital, on n’est pas bons parce que les œuvres étaient trop longues, trop difficiles, trop lourdes à maîtriser en trop peu de temps. Ça ne m’est pas arrivé souvent, mais ça m’est arrivé. Deux ou trois fois. Je m’en souviens très bien, hélas. Je m’en veux encore. C’était scandaleux.
Qu’est-ce qui vous choque le plus : de vous décevoir, de proposer une prestation de moindre qualité que d’ordinaire ou d’abîmer votre image pour les quelques ultraconnaisseurs qui seront à même de constater que la peinture est un peu fraîche ?
Ce qui me choque, c’est de m’être abrité derrière un soi-disant succès qui donnait aux programmateurs l’envie de m’entendre. Bien sûr, dans le programme, il y avait des pièces qui allaient. En revanche, d’autres étaient purement et simplement imprésentables.
Par contraste, quand vous sentez-vous prêt à jouer ? Un de vos prestigieux collègues disait : « Quand je peux jouer mon programme au saut du lit… »
Je pense qu’il y a un moment où l’on se sent prêt grâce à l’imprégnation. La répétition a fait son œuvre. Je crois beaucoup à la répétition, au rabâchage, à la rumination. Tous les matins, il faut manger la même chose, la même chose et encore la même chose. En réalité, on ne répète pas. Chaque matin, c’est différent et, en général, c’est mieux, jusqu’au jour où on est tellement imprégné de l’œuvre que l’on finit par s’identifier à elle. J’ai eu ce sentiment. Je vous parlais de moments où je n’étais pas prêt : voilà l’envers de ces moments, ces instants où vous savez que vous jouez la pièce comme il vous semble juste et bon de la jouer. Peut-être d’autres estimeront que cette proposition ne leur convient pas, voire qu’elle est en contradiction avec l’esprit du compositeur, mais ces opinions m’indiffèreront dès lors que j’aurai la conviction que je joue comme j’estime devoir jouer. On peut se tromper aux yeux des autres, mais il ne faut pas se mentir à soi-même.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fouU50vN06g[/embedyt]
C’est cette insincérité à votre endroit qui, au premier chef, vous a blessé lors des récitals montés pour partie en catastrophe ?
Oui.
Comment cela vous est-il arrivé ?
Écoutez, à une certaine époque, il m’arrivait d’avoir des récitals très rapprochés puis une longue période blanche. Les récitals très rapprochés, il fallait les assumer, mais il fallait aussi assumer le déséquilibre du planning. Parfois, c’est compliqué.
J’imagine que l’été doit être un moment très dense !
Bien sûr, certains artistes souffrent de l’esclavage des festivals d’été. Le terme est excessif, et sans doute beaucoup de musiciens voudraient, sur le principe, subir cet esclavage-là. Toutefois, ce n’est pas drôle pour l’entourage. Pas question de partir quand tout le monde prend des vacances, d’une part parce que vous avez des engagements, d’autre part parce que si vous prenez huit jours de vacances, au retour, vous n’avez plus les doigts pour jouer. Il nous faut toujours être prêt, et d’abord sur un plan physique. Si vous avez un concert le lendemain, tirez un trait sur les soirées à rallonge et les activités festives ! D’autant que, moi, je suis assez discipliné. Il m’arrive d’être plus ou moins brillant ou juste, mais mon travail consiste à mettre les meilleures conditions de mon côté. Par le travail, par l’hygiène de vie, par l’exigence. Je ne donne pas un bon concert si je ne suis pas tranquille, si je ne me suis pas bien reposé, et, c’est une évidence, si je n’ai pas beaucoup travaillé.
Ce souci d’être prêt, vous en avez évoqué une des composantes : l’imprégnation par des doigtés rigoureux, qui évite toute improvisation.
Je me méfie de l’improvisation parce que je ne pratique pas du tout cet art. Mon grand ami Cyprien Katsaris a beau être un interprète génial de Chopin, Liszt et Beethoven, c’est aussi un improvisateur stratosphérique. Il est capable de partir sur un thème de Bach, il se promène par les opéras de Wagner, il en restitue les charmes tout en jouant une œuvre de Cyprien Katsaris qu’il crée à la volée [sur la vidéo infra, la vidéo arrive à 1’15]. On a l’impression d’être éclairé tour à tour par Beethoven, Brahms et tutti quanti. C’est sublime ! Moi, je n’ai pas ce talent-là. Je ne sais pas improviser.
Vous ne vous y êtes pas beaucoup essayé, sans doute…
Certes.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wN2dggrckDA[/embedyt]
D’où votre passion pour les doigtés. Expliquez-nous le rapport !
Le doigté, c’est le contraire de l’improvisation. C’est Jean Fassina, que nous évoquions tantôt, qui a attiré mon attention sur ce point lors de mes années de formation. Ce très grand pédagogue n’est pas à sa place dans notre vision de l’école française de piano. Il estimait que les doigtés étaient essentiels ; et j’ai compris qu’il avait raison parce que, quand vous choisissez un doigté, quand vous l’écrivez, quand vous le fixez, à force de reprendre un même passage avec les mêmes enchaînements, vous développez – en sus des mémoires auditive et visuelle – une mémoire musculaire et tactile. De plus, votre doigté n’est pas un pense-bête, il est partie intégrante du phrasé que vous souhaitez construire. Certains de mes doigtés, je ne pourrais plus les changer car ils font partie du texte d’une manière physique. Dans beaucoup d’instruments, une part importante du travail consiste à choisir ses doigtés car ils sont consubstantiels au phrasé, au legato, à la musicalité que vous cherchez à obtenir.
Dans votre hommage à Jean Fassina, vous avez même souligné l’expressivité intrinsèque à certains doigtés. Selon vous, le meilleur doigté n’est pas forcément le plus simple car, si le compositeur a écrit un passage particulièrement ardu, ce n’est pas toujours pour qu’il ait l’air de glisser comme l’eau sur les plumes d’un canard…
Non. Si tout devient facile, on gomme le grain de la partition. Je vais vous surprendre en affirmant crânement que l’écriture de Beethoven est quelquefois gauche. Or, dans l’édition d’Artur Schnabel – un très grand pianiste beethovénien et schubertien, mort au début des années 1950 –, cet artiste a proposé des doigtés magnifiques.
Pour tous ceux qui ne seraient pas concertistes – il y en a encore quelques-uns, je crois –, pouvez-vous donner une idée de ce qu’est un « doigté magnifique » ?
Un bon doigté est un doigté fonctionnel, qui aide l’interprète à garantir la fluidité de ce qu’il joue. Un doigté magnifique est un doigté difficile mais qui, quand vous arrivez à surmonter cette difficulté, rend justice du phrasé tortueux et évolutif d’un passage. Spontanément, on pourrait avoir tendance à aller vers la facilité. Or, un trait difficile, c’est un trait difficile, les deux mots sont importants. C’est un trait, donc il faut le jouer d’un trait ; et il est difficile, donc il ne s’agit pas de gommer cette difficulté, il faut en faire de la musique. Aussi faut-il se méfier par exemple des arrangements qui consistent à se servir des deux mains. Soit, vous gagnez en brio ; mais vous désamorcez la tension qui est pourtant constitutive de sa musicalité. Sur ce passage-là, Beethoven ne vous demande pas d’épater la galerie. Il exprime un élan soudain et la complexité qu’il y a à l’exprimer ou à le vivre. En se facilitant le travail, l’interprète annihile la puissance dramatique de cette antinomie.
Comment lutter contre cette aspiration plutôt saine à ce que vous appelez la facilité ?
La facilité est une tentation très humaine contre laquelle l’exigence doit nous conduire à lutter. En somme, ce doigté magnifique dont nous parlons, c’est un doigté jouable mais qui respecte la tension dramatique, donc qui n’est pas forcément celui vers lequel pousse l’inclination au moindre effort ou au « joli ». Chez Beethoven, la plupart du temps, le « joli », c’est vilain. En tout cas, le beau est rarement joli ; et, aux moments opportuns, les doigtés doivent participer de cette esthétique particulière, si puissante, et de l’expressivité musicale, si prenante.
7.
La possibilité du sublime
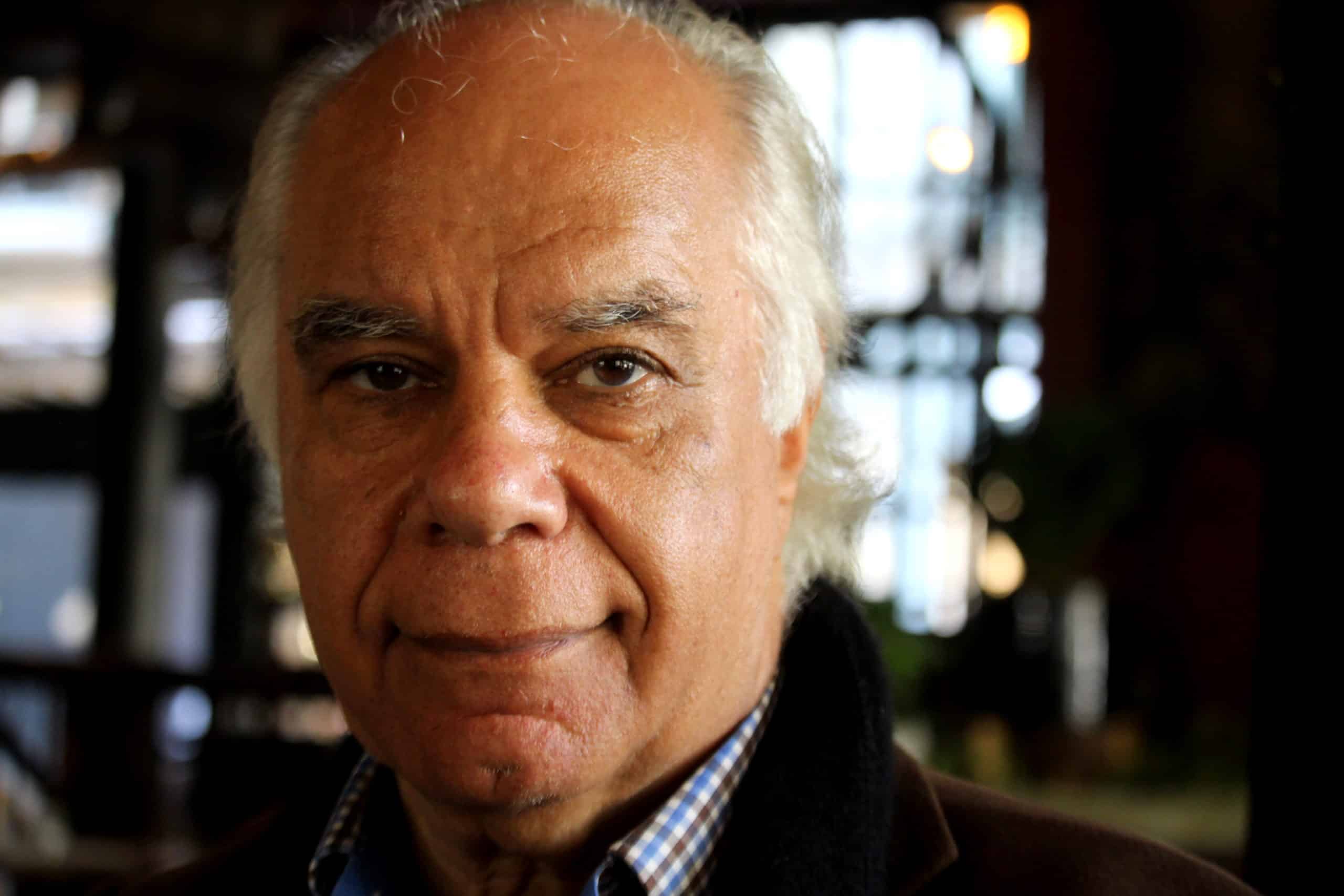
Pierre Réach, nous avons évoqué quelques-unes des spécificités qui habitent votre art de l’interprétation donc votre art de l’enseignement, les deux étant difficilement dissociables. Toutefois, nous avons omis de pointer l’une de vos originalités pédagogiques. Contrairement à de nombreux enseignants, vous plaidez pour un professorat partagé. La faute à votre expérience : vous avez constaté combien la multiplicité des guides éclairés vous a aidé à trouver votre voie propre. Cette conviction n’est pas majoritaire dans la sphère française. Beaucoup de vos confrères exigent l’exclusivité auprès de leurs meilleurs éléments – pas forcément par hybris, du reste, aussi pour éviter de « confuser » leur précieux élément. Comment aidez-vous vos élèves à synthétiser des avis possiblement contradictoires ?
J’aime beaucoup évoquer la contradiction avec mes élèves. Il n’est pas question d’en faire un tabou. Certains élèves me disent parfois qu’ils sont allés à un concert où ils ont entendu un grand artiste interpréter une œuvre que j’adore… mais qu’il joue d’une manière très différente de moi. Je connais des professeurs qui se ferment en constatant que leur omniscience est remise en question. Cette attitude m’est très étrangère. Cela dit, votre question me rappelle un souvenir. J’étais encore en culottes courtes ou, du moins, au lycée, quand mes parents m’ont emmené prendre une première leçon privée chez Yvonne Lefébure. Je me rappelle comme si c’était hier que mon père lui a dit : « Il faut que nous vous avouions que nous aimons beaucoup Wilhelm Kempff. Ses disques tournent tous les dimanches à la maison, et Pierre en raffole. » Aussitôt, j’ai senti ma nouvelle prof exaspérée. Très. Elle a fini par nous faire comprendre que Kempff, oui, soit, c’était pas mal, mais une artiste comptait avant tous les autres.
Elle ?
Bingo. Peut-être était-ce l’héritage d’une certaine école voire d’une certaine époque, j’en accepte l’augure. Toutefois, avec le recul, les années qui ont passé, je trouve ça très décevant. À mon sens, c’est au contraire une chance d’avoir plusieurs visions d’une même œuvre, ne serait-ce que parce qu’un professeur, ce n’est pas quelqu’un qui vous enseigne une illusoire vérité. C’est quelqu’un qui vous aide à trouver votre chemin. On a besoin de quelqu’un pour avancer sur les questions techniques, mécaniques ou physiques ; mais on n’a pas besoin de quelqu’un qui dise : « Regarde ce que je fais, moi. » Un professeur doit montrer la voie et proposer de parcourir le chemin ensemble. Il mettra en garde contre certaines directions menant tout droit au mauvais goût, par exemple. Cependant, si un grand artiste propose d’autres perspectives que celles évoquées par le professeur, le professeur comme l’élève doivent être émerveillés. J’ai accompagné certains élèves au concert.
Vous n’aviez pas peur que cela remette en cause votre enseignement voire votre prestige ?
En aucune manière, voyons ! Il faut profiter de la merveille ensemble. Tant pis si la phrase qui vient peut être mal interprétée, il faut jouir ensemble. C’est assez poser que je ne comprends pas la démarche « exclusiviste » de certains de mes pairs. Je déteste ce qui est exclusif. Ce qui est exclusif est petit.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=DtnljX1bjRs[/embedyt]
À l’opposé, vous louez la générosité et l’exigence des professeurs qui vous ont marqué ; et vous ajoutez à l’endroit de l’un d’eux un compliment qui eût pu passer pour une critique voire du mépris : « Je travaillais avec lui parce qu’il ne me gênait pas. » Comment, dans le creuset de votre enseignement, travaillez-vous l’alchimie entre la liberté laissée à la créativité ou à la personnalité de l’élève, votre propre modestie qui se méfie de la vérité unique ou absolue, et l’absolue nécessité voire l’obligation redoutable de le guider afin d’éviter qu’il ne se fourvoie ?
Votre question est large car, au fond, elle interroge l’essence de la valeur artistique propre à chaque musicien. Au-delà de ses capacités techniques, indispensables, évalue-t-on un musicien en fonction de la beauté voire de la puissance de son interprétation, ou l’évalue-t-on en fonction de sa similitude avec une vision de l’œuvre que l’on estime la seule intéressante ? Chez les jeunes pianistes, la question est encore plus cruciale. Je rêve d’un concours d’entrée au conservatoire qui ne s’arrêterait pas à l’évaluation du don manuel des candidats. Ce critère est important, certes, mais combien de fois ai-je pas entendu des candidats ayant à l’évidence tant de choses à nous dire… et que l’on va mettre de côté parce que les malheureux ont lâché une fausse note ou trébuché sur un trait ?
Vous êtes souvent appelé à siéger dans des jurys de concours – c’est un sujet que nous avons aussi abordé avec le violoniste Augustin Dumay, convaincu qu’il vaut mieux faire juger des violonistes par des pianistes que par des violonistes ! Selon vous, qui coconstruisez les palmarès à certains beaux concours français comme aux impressionnantes compétitions de Rio ou d’Istanbul (entre autres…), que serait un concours juste ?
La notion de concours est polysémique. Elle recoupe notamment les concours d’entrée et les compétitions nationales voire internationales. Pour les concours d’entrée, ma réponse est simple : la recherche du potentiel doit primer. Un potentiel physique – une petite main, c’est rédhibitoire ! – et un potentiel musical. Pour les concours internationaux, ma réponse n’est pas beaucoup plus compliquée à formuler : il faut évaluer sa capacité à nous transporter par son interprétation et sa singularité.
Comment cerner ce potentiel et cette capacité ?
L’expérience suffit. Parfois, lors d’un concours d’entrée, il n’est pas besoin de plus d’une minute dans une sonate plutôt commune pour que l’on pense : « Là, il a dit quelque chose, je trouve qu’il doit entrer. » De même, lors d’un concours international, quelques notes, une nuance, un legato, une respiration, une présence peuvent d’emblée vous happer et vous laisser penser que ce gars-là (ou cette fille, évidemment), a quelque chose à nous dire.
Si vous l’acceptez, attardons-nous sur ce concept de « dire quelque chose », qui peut paraître un tantinet nébuleux à ceux qui n’ont pas votre background…
Je vais essayer d’être plus précis. Un concours d’entrée évalue au premier chef le niveau technique général d’un impétrant. Néanmoins, il devrait aussi s’intéresser, presque à égalité, à sa capacité à faire de la musique en plus de jouer des notes. S’il joue bien quoique imparfaitement des notes, cela ne m’effraie pas. Il veut entrer dans une école pour apprendre. Donc, ce que je cherche, moi, y compris quand je suis juré pour les concours internationaux, c’est le potentiel de musicalité.
Dès lors, ne peut-on s’étonner de votre goût pour l’exercice du jury ? Dans les concours internationaux, vous ne devez pas souvent être satisfait des palmarès !
Il m’arrive de ne pas être d’accord par ce que la majorité a décidé. Inquiets des rumeurs, beaucoup de mes collègues s’offusquent des petits arrangements qui truqueraient les résultats. Moi, ce qui me chagrine le plus, c’est que, souvent, on prime la perfection absolue. Une défaillance digitale, même minime, paraît irrémédiable. Notre époque veut ça. Avec les disques en studio, avec les vidéos sur Internet, montées à l’envi, on érige en critère suprême l’absence de fausse note, alors que l’on sait très bien deux choses : un, elle est souvent fausse (il a fallu plusieurs prises pour arriver à ce lissé admirable) ; deux, elle est toujours limitante.
On ne peut parler des concours internationaux sans creuser un chouïa la question des injustices, qui ne sont pas toujours qu’affaires de goût et d’esthétique…
Vous faites allusion aux conflits d’intérêts ? Sachez que de plus en plus d’organisations demandent aux jurés de signer des attestations solennelles affirmant qu’ils n’ont pas d’élèves parmi les candidats.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=uuhElaEJbQA[/embedyt]
Alors mettons les pieds dans le plat : certains candidats ne sont-ils pas protégés ?
Il est normal que, si vous avez fait travailler un artiste, vous vous sentiez plus en adéquation avec la proposition qu’il présente. Ce n’est pas pour recevoir un prix par contumace que vous poussez un candidat, c’est parce que ce qu’il joue correspond à ce que vous aimez entendre. Toutefois, ici comme ailleurs, les fantasmes ne sont pas à la hauteur de la réalité : je ne crois pas avoir constaté tant que ça d’injustices absolument flagrantes.
En somme, vous vous méfiez et de l’objectivité, et du complotisme.
Disons que je crois aux coups de chance.
Pardon d’insister, mais il est de notoriété publique que certains de ces coups de chance ne sont pas donnés exclusivement par Dame Fortune.
Peut-être.
Accusé Pierre Réach, dites-nous ce que vous avez sur le cœur.
Ma foi, je l’ai fait.
Bien. Et si vous évoquiez le concours Chopin 2021, dans ce cas ?
C’est vrai, en octobre dernier, j’ai avoué sur Facebook que j’étais en colère. Un jeune Japonais avait délivré une prestation sublime. Il a été éliminé après le troisième tour. C’est immonde.
Le fait que ce soit l’élève de votre grand ami Jean-Marc Luisada n’impacte-t-il pas votre jugement ?
Écoutez ses prestations, vous verrez bien que non.
Pour être précis, le 17 octobre 2021, vous avez écrit :
Honte au concours international Frédéric Chopin de Varsovie, qui vient d’éliminer Hayato Sumino, jeune artiste d’un talent exceptionnel qui a donné des versions idéales et si émouvantes notamment de la Sonate funèbre, des Mazurkas, de la Polonaise-Fantaisie, des 1er et 3èmescherzi. Le prestigieux jury a-t il ainsi perdu toute simple conscience pour renvoyer de la sorte un de ceux qui ont su faire vibrer dans toute la salle l’âme unique de Chopin et qui ne figure pas parmi les 12 finalistes ? Un véritable scandale et surtout une grande tristesse. Il faut absolument écouter ou réécouter sur le site du concours les trois premières épreuves de ce jeune pianiste d’une inspiration et d’une perfection qui resteront un des grands moments de ce concours depuis qu’il existe.
Je ne me suis pas fait que des amis, sur ce coup…
… même si vous avez récolté des centaines de likes !
Ça ne change rien au fait qu’ils ont éliminé ce jeune homme et l’ont empêché de passer en finale, préférant refiler des prix à d’autres Japonais, notamment à Kyohei Sorita, second prix ex aequo, pianiste sérieux sans doute mais qui n’arrive pas à la cheville artistiques de son compatriote éjecté.
Donc il existe des injustices !
Que voulez-vous y faire ? C’est comme ça. J’espère que la suite donnera raison à ceux qui se sont outrés ; et j’espère contribuer à exprimer ma sensibilité dans les concours qui m’invitent à leur jury.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Wp5fpweqjDo[/embedyt]
En dehors des arrangements et des stratégies, dont on peut craindre qu’ils soient exacerbés dans les compétitions les plus importantes, un jugement, aussi « sincère » soit-il, pour reprendre un terme qui vous est cher, ne doit-il pas être partagé entre un présupposé (à ce niveau, tout doit être nickel) et une aspiration (en plus de la nickelitude, j’espère un p’tit quelque chose de bouleversifiant) ?
Il m’est arrivé maintes et maintes fois, lors de ces fameux concours internationaux, d’ouïr de vrais artistes qui avaient sublimé l’œuvre imposée… mais avaient eu une petite défaillance. La balance entre le sublime et la faute de doigt me paraît plutôt peser en faveur du sublime ; cependant, je ne suis pas sûr que mes arguments soient toujours entendus.
Ça ne vous empêche pas de persister et signer.
J’imagine que, si l’on m’invite fréquemment dans des jurys importants, c’est parce que l’on a conscience que, pour le dire de façon binaire donc caricaturale, le clan de la perfection froide et glacée doit être confronté au clan de l’émotion inspirante. Ma conviction est que si quelqu’un a réussi à montrer sa singularité, sa personnalité, son originalité d’interprète, nous autres, les artistes confirmés, nous devons en tenir compte.
Cela rejoint votre réflexion pédagogique – preuve que l’interprétation et l’enseignement ne font qu’un, selon vous.
Oui, en tant que pédagogues, nous devons travailler là-dessus aussi. Si vous vous rendez compte qu’un élève arrive à porter la profondeur de Bach, par exemple, plutôt que la poésie ou l’impressionnisme d’un Debussy, il faut l’encourager dans la voie qui est la sienne.
Vous n’êtes pas favorable aux pianistes à large répertoire ?
En dépit d’exceptions notables, donc exceptionnelles, comme l’indique leur nom, je crains que, à un certain niveau, il soit compliqué de tout jouer. Quand on étudie, c’est différent. Il faut tout connaître. Arrive néanmoins un moment où l’élève doit être guidé par rapport à ce qu’il aime lui. Voilà l’une des missions qui incombe au professeur : trouver dans quel répertoire l’étincelle que l’on a perçu en lui trouvera de quoi devenir flamme. Chercher ce qui permettra à l’élève d’épanouir au mieux sa sensibilité est un projet très différent de celui qui consiste à imposer une manière de jouer, fût-ce en pensant sincèrement agir pour le bien de l’élève. Enseigner, c’est aider l’élève à se trouver lui-même et à s’aventurer sur son chemin. On l’aide mais, le chemin, c’est lui qui le prend.
8.
Le volcan de l’inattendu

Pierre Réach, comment construit-on son répertoire ? Vous expliquez qu’il faut aller vers ce que l’on aime plutôt que ce que l’on vous impose. Est-ce la raison pour laquelle votre spectre est aussi large – à votre tableau de chasse, vous avez notamment accroché les trophées Bach, Liszt, Mendelssohn et Messiaen ?
C’est Messiaen qui vous étonne ? Figurez-vous que j’ai gagné le concours Messiaen et que j’ai eu la chance d’être l’élève d’Yvonne Loriod, laquelle m’a initié à la musique de son époux.
La musique qu’Olivier Messiaen a offerte au piano est protéiforme. Quel aspect vous touche le plus ?
J’admire surtout la partie mystique de ses compositions. Les Vingt regards sur l’Enfant-Jésus constituent à mes yeux un sommet de l’écriture pianistique.
Cette inclination complète votre passion pour Bach et la musique romantique. Veillez-vous à transmettre ce double discours à vos étudiants : d’une part, approfondissez ce qui vous porte ; d’autre part, ne vous y enfermez et gardez, au-delà de votre précarré, un souci de complémentarité – et de réalisme, aussi : personne ne ferait une carrière que sur Alkan ?
Là encore, je dois vous apporter une réponse en apparence contradictoire, ce qui n’est pas un faux-fuyant car vous savez combien je me méfie des vérités univoques. Voyez-vous, il est certain que chacun de nous a des chemins de prédilection ; cependant, il existe des bases universelles que l’on doit intégrer par un apprentissage rigoureux.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=58tYvdBGYDE[/embedyt]
Vous ne croyez pas aux vérités musicales universelles, mais…
… mais certains passages sont inévitables pour éduquer la main et l’esprit d’un pianiste. Quand un élève me dit, et ça m’est arrivé : « Je n’aime pas Bach, je préfère les œuvres romantiques », je lui réponds : « Désolé, tu es dans ma classe et, dans cette classe, on n’ignore pas Bach », et j’essaye d’argumenter. La connaissance de Bach est unique. Le legato, la polyphonie, la distinction des plans sonores, c’est-à-dire la quintessence de Bach, sont des éléments indispensables pour jouer Chopin ou Schumann. De même, si un élève me dit : « J’adore Bach et Beethoven mais Brahms et Schumann, bof »… eh bien, j’en suis triste.
Pourquoi ?
Je ne peux pas imaginer le monde sans Schumann. Sans Schubert non plus, d’ailleurs.
Comment gérez-vous ce genre de situations ?
J’essaye de comprendre. J’échafaude des hypothèses. Peut-être mon interlocuteur est-il dans une période de sa vie où il est trop cérébral. L’émotionnel l’effraie.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=H7tmSptSDH8[/embedyt]
Et, malgré votre souci d’ouverture, vous l’obligez à « passer par là » ?
Plus ou moins, parce que j’ai confiance en l’être humain. Nous pouvons évoluer. Dans la mesure où cela reste raisonnable, j’essaye de ne pas imposer, et je me réjouis quand quelqu’un me dit qu’il a envie de travailler du Bach, du Beethoven ou du Schumann, par exemple. L’important reste de respecter la hiérarchie qui existe entre les œuvres. Par exemple, vous ne pouvez pas commencer à jouer Beethoven avec la sonate Appassionata, ni Schumann avec le Carnaval ou une autre œuvre très compliquée. Chez tous les compositeurs, il existe des œuvres tout aussi merveilleuses et plus abordables. La poésie de Schumann ou de Debussy, vous pouvez l’aborder avec les Arabesques – pour Debussy, ce serait folie de s’attaquer en première intention aux Préludes ! De grâce, jouez les premières sonates de Beethoven avant d’aborder les dernières !
Donc, même au haut niveau, la tentation d’aller plus vite que la musique existe ?
Bien sûr que si. Il arrive que certains professeurs se fassent plaisir. Comme eux-mêmes suent sang et eau sur les dernières sonates, ils les proposent à leurs élèves. C’est honteux. Il faut respecter la hiérarchie des œuvres et admettre que, dans la connaissance d’un compositeur, il y a aussi une logique. Vous ne pouvez comprendre, assimiler et vous imprégner des dernières œuvres sans vous être frotté aux précédentes, ne serait-ce que pour connaître l’évolution musicale du compositeur lui-même !
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xt4hL6vMRNg[/embedyt]
L’auditeur de votre intégrale des sonates de Beethoven échappe à la chronologie voire à la progressivité des sonates. Néanmoins, l’articulation des œuvres que vous proposez à chaque double disque participe-t-elle pour partie d’un projet pédagogique cherchant à mieux faire connaître tel ou tel aspect du compositeur ?
Il faut bien distinguer la pratique musicale et l’écoute. Pour la pratique musicale, commencer par les dernières sonates est une absurdité. Pour l’écoute, c’est très différent. Dans mon projet d’intégrale, il n’y a aucune envie de guider l’auditeur vers « mon » Beethoven ; et pour une raison simple : selon moi, Beethoven est tout entier dans chaque sonate. Pour qui sait écouter, dans la première sonate, il y a le Beethoven de l’Appassionata !
Est-ce à dire que l’écriture de Beethoven n’évolue guère qu’à la marge ?
Non, bien sûr que non. L’écriture évolue. Cependant, le caractère beethovénien est constant. Les stéréotypes coutumiers opposant les « œuvres de la maturité » aux « œuvres de jeunesse » se révèlent inopérants, ici, à supposer qu’ils le soient chez d’autres aussi souvent que certains paresseux s’efforcent de l’imaginer.
On en revient à votre souhait de dissocier l’écriture, qui vous passionne, de la biographie, qui ne vous intéresse seulement pas.
Ce n’est pas qu’elle ne m’intéresse pas, c’est qu’il ne faut pas réduire l’écriture à la biographie… parce que ça ne fonctionne pas ! Je vais vous donner un exemple qui l’illustre pile poil : dans les trois opus 31…
… qui ouvrent votre intégrale…
… la troisième sonate est la plus heureuse, la plus joyeuse des trois – écoutez le Presto con fuoco ! Il compose cette œuvre au moment où il écrit le testament de Heiligenstadt.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=yxUtEGmcoGQ[/embedyt]
Vous en reproduisez une partie dans votre livret. Pour le présenter, on peut dire que, en 1802, Beethoven a vingt-quatre ans. Il s’exile pour préserver son ouïe (en réalité, pour cacher sa surdité), admet avoir pensé à se tuer et répartit ses biens entre ses frères en envisageant le moment où il sera passé ad patres[1].
Dès lors, que l’on cesse de nous importuner avec cette réduction plate et erronée de l’œuvre à la vie. La vie d’un compositeur, il n’est pas mauvais de la connaître, par soif de culture et aussi par curiosité. Toutefois, je suis de plus en plus certain que la création des grands génies artistiques – pas seulement dans la musique – est similaire à une grande explosion volcanique que rien ne peut laisser prévoir. Une explosion volcanique ne dépend pas de l’air ambiant.
Aujourd’hui, des centres de surveillance sismique tâchent de prévoir les plus grandes explosions !
Ces centres sont capables de définir l’imminence d’un danger, mais ils sont incapables d’expliquer pourquoi le danger survient à tel moment plutôt qu’à tel autre. Bien que je respecte la tentative des musicologues et des historiens de la musique qui ont voulu établir des parallèles, je suis fermement convaincu que leur systématisme ne correspond pas à l’essence profonde du génie créateur.
Cependant, parfois, il n’y a pas qu’une coïncidence temporelle. Maints compositeurs ont ouvertement traduit leurs émois humains en notes de musique…
Vous me faites penser à Un amour de Beethoven d’Abel Gance, avec Harry Baur. On voit Beethoven marcher dans la campagne, ce qui est une activité effectivement pratiquée par le vrai Beethoven, autour de Vienne. À un moment, il arrive près d’une grange. Il entend une femme qui pleure son bébé mort. Là-dessus, Harry Baur se met au piano et joue le mouvement, très chantant et très tendre, de la Sonate pathétique ; et on voit l’actrice cesser de pleurer puis sourire. Évidemment, c’est gentil, efficace, émouvant, magnifique… mais ce n’est pas du tout comme ça que les choses se passent. Aucun grand créateur n’a prévu ce qu’il va advenir. Beethoven lui-même notait ses idées sur un papier pour s’en souvenir plus tard, car le jaillissement était, chez lui, absolument inattendu.
En conséquence, pour vous, la chronologie de composition des sonates n’a pas d’importance.
En tout cas, elle ne me semble pas signifiante musicalement. Partant, elle ne guide pas le découpage de mon intégrale.
Permettez-moi d’insister : qu’il n’y ait pas de linéarité absolue, soit ; ce nonobstant, de là à nier une évolution du style ou de l’écriture au fil du temps…
Peut-être, si l’on souhaite user de ce prisme, y a-t-il une forme d’évolution, encore que… C’est une évolution difficile à définir et à lisser. Le côté inattendu de la composition reste, à mon sens, primordial. Tenez, un exemple : dans les trente-deux sonates, vous avez deux monstres – la Waldstein, celle qu’on appelait « L’Aurore » pour les raisons saugrenues dont nous avons parlé ; et, après une toute petite sonate de deux mouvements, l’énorme Appassionata. Vous avez donc çà des crêtes puis, là, des sonates aussi belles quoique moins importantes.
En schématisant donc en caricaturant, vous voulez dire que Beethoven n’a pas écrit une vingtaine de brouillons au début puis une douzaine d’énormités pour finir.
Cet ensemble, même si notre esprit rationaliste trouve cela impatientant, se dérobe à la logique humaine habituelle et, disons-le, médiocre. Penser que l’on commence petit et que l’on finit grandiose, c’est pratique pour s’orienter dans la vie, mais ça ne correspond pas à la réalité, et encore moins à la réalité d’un génie. Le génie est empirique. Il ne fournit pas de mode d’emploi. Il n’est pas préparé. Il est, improbable, imprévisible, irréfutable.
Vous n’avez jamais été tenté par la composition ?
Non, jamais. Néanmoins, j’ai du mal à imaginer que le compositeur génial se pose devant une table et se dise : « Alors, qu’est-ce que j’ai écrit, avant ? D’accord, bon, ben, logiquement, ce serait bien si j’écrivais un morceau plus long, ou plus difficile, ou plus tarabiscoté, etc. » Je crois à l’éclair qui oblige le génie à se poser devant son écritoire et à composer ce qui le traverse. Je crois au génie sans pourquoi. Je crois à l’œuvre de Beethoven, pas à l’explication de son œuvre par sa vie.
[1] Une traduction est disponible ici.
9.
La magie des affinités

Pierre Réach, on ne peut évoquer votre activité d’interprète sans parler de votre activité de pédagogue… ou en omettant votre activité de directeur artistique de festival. Certes, dès que vous en avez l’occasion, vous prenez soin de préciser que les problèmes d’organisation liés à la gestion politique de la pandémie sont des grains de poussière comparés à la souffrance des patients qui se sont retrouvés en réanimation. Toutefois, comment intègre-t-on l’aléatoire sanitaire dans la pérennisation d’une manifestation culturelle ?
Il y a presque vingt-cinq ans, le festival Piano Pyrénées, qui s’appelle aujourd’hui Piano Pic, est né d’une idée que mon ami le docteur Christophe Baillet et moi-même avons eu. En 1997, le lancement s’est fait en fanfare : nous avons monté le piano par hélicoptère sur la terrasse du Pic du Midi à 2800 mètres, et un récital a été donné. Le buzz a fonctionné, TF1 est venu, ça a lancé le festival, et le festival existe toujours.
Avant ce coup de maître, façon François-René Duchâble larguant un piano dans l’eau, vous aviez déjà élaboré une expérience de « festivaliste »…
Oui, j’avais créé le Printemps musical du pays provinois. De très, très grands artistes ont répondu favorablement à mon invitation, comme Jean-Philippe Collard, Brigitte Engerer, François-René Duchâble dont vous parliez et qui a lancé le festival. Je dois lui rendre grâce car cet artiste jouait et joue admirablement, c’est une chose ; mais, de surcroît, il m’a beaucoup, beaucoup aidé. Au début, nous avions très peu d’argent. Vraiment très peu. Cela se peut comprendre : les municipalités ont peine à accorder leur confiance d’emblée. Aussi les artistes venaient-ils par amitié, en dépit de cachets, disons, un peu exigus.
Piano Pic prouve que, sans être un serial entrepreneur, vous aviez déjà un certain background avant de…
Bien sûr. Et j’ai aussi fomenté un festival qui, hélas, n’existe plus, à Palma de Majorque. Et j’ai aussi suscité un festival à Shanghai, dont j’ai cédé la direction à un collègue. Et j’ai créé un festival qui persiste à Castelnaudary, près de Carcassonne.
Actuellement, le principal festival dont vous vous occupez reste le festival des Pyrénées.
Oui.
Alors, pourquoi un artiste qui enregistre des chefs-d’œuvre et qui joue dans le monde entier s’encombre avec cette grosse machine, car c’est une grosse machine ?
Ha, pourquoi le cacher ? J’adore faire jouer mes amis. Pas parce que ce sont mes amis : parce que, parce que (si) ce sont mes amis, je sais qu’ils vont se surpasser pour le public venu les écouter en toute confiance.
Vous voulez vous distinguer du copinage…
Bon sang, Bertrand Ferrier, quand vous pouvez inviter Jean-Marc Luisada pour illuminer le festival de Bagnères-de-Bigorre, c’est du copinage ?
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6KhqKKTNq10[/embedyt]
Je ne sais pas. J’ai organisé un festival où votre ami Cyprien Katsaris a joué. C’était carrément par copinage qu’il est venu – heureusement parce que… bref. Mais vous-même venez avez reconnu que vos collègues venez jouer par amitié.
Par amitié, cela signifie a minima : je n’ai pas besoin de toi pour vivre ; donc j’accepte des cachets infiniment inférieurs à mon standard… mais crois bien que cela ne m’empêchera pas de donner à la hauteur de ma réputation.
Tout de même, François-René Duchâble ne devait pas vivre de l’air du temps…
Mais justement ! Il est venu au festival contre une rémunération qu’il n’aurait jamais acceptée ailleurs. Cela a permis de partager son talent gigantesque avec un public – je n’aime pas dire : avec des gens, il y a un côté méprisant dans cette formulation – qui n’en aurait pas profité sans notre connexion. Si c’est le pire crime qui peut se cacher sous le terme de copinage, vive le copinage, vertuchou !
Jean-Marc Luisada est aussi venu par amitié.
Que croyez-vous ? Même les vedettes sont sensibles au projet artistique ! Ils sont payés, c’est le minimum ; mais ils savent que nous ne sommes pas un festival comme La Roque d’Anthéron. Donc ils viennent jouer pour partager leur immense talent à un prix inhabituel pour eux. Pour moi, pour le public fidèle, pour les curieux qui ont osé se risquer dans notre festival, c’est un plaisir immmmense. Et pas parce que l’artiste est connu : parce que sa musicalité est garante d’un plaisir ineffable.
Vous avez dit que, pour vous, partager l’émotion de vos pairs est presque aussi important que de jouer vous-même.
C’est la vérité. Vous n’imaginez pas la puissance de la joie quand j’ai quelqu’un que j’aime et qui joue sa musique dans mon festival.
À titre collectif, on comprend ce que l’organisation d’un festival peut vous apporter. Qu’en est-il d’un point de vue plus personnel ?
Clairement, ça m’a un peu mis dans l’actualité. Les festivals que j’ai imaginés ont acquis une certaine reconnaissance, notamment celui des Pyrénées, qui a lieu lors de la deuxième quinzaine de juillet depuis un quart de siècle dans un cadre somptueux. Le plus important est que ce festival m’a permis d’être en contact avec nombre d’artistes. Ça m’a beaucoup appris. La confidence qui va suivre, je vous la livre sans regret ni agacement. Reste que j’ai dû organiser environ un demi-millier de concerts, ce qui ne signifie pas que j’ai engagé cinq cents artistes puisque beaucoup ont été réinvités. En général, je les présente en quelques mots au public avant qu’ils entrent en scène. Cet introit m’a permis de constater que quelques invités sont venus comme à un concert standard : ils viennent, ils jouent, ils sont payés, ils partent, et nous nous quittons sur un « Merci, au revoir ». Quelques autres gardent contact avec vous…
Logiquement intéressé, non ?
J’ai un peu d’expérience dans ce domaine aussi et, sans me flagorner, je sens très vite ce qui ressortit de la politesse visant uniquement à être reprogrammé et ce qui relève d’une connexion plus profonde, liée à un instant, un espace, un possible. Je parle beaucoup avec les artistes. Je m’occupe d’eux. Je les invite, etc. Même sur quelques heures ou quelques jours, certaines attitudes ne mentent pas.
Parmi tous vos invités, certains entrent dans vos critères et deviennent vos chouchous, voire vos superchouchous quand ils étaient déjà vos favoris.
Un tout petit nombre. Parce qu’ils ont compris que leur implication viscérale dans ce projet de partage était irremplaçable. Être en capacité de leur donner l’occasion de partager la musique qu’ils aiment avec notre public, fidèle et souvent chaleureux, est une joie irremplaçable. À titre personnel, j’ajouterai que la participation à Piano Pic de musiciens comme François-René Duchâble, Gary Hoffman ou Cyprien Katsaris, par exemple, demeurera éternellement irremplaçable.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NJZ9rM3w75I[/embedyt]
Pourquoi ?
Les avoir fait jouer a approfondi notre amitié, quoique celle-ci n’en soit pas dépendante.
En quel sens ?
C’est parce qu’ils sont mes amis qu’ils ont accepté de jouer, et c’est parce qu’ils ont accepté de jouer que notre amitié s’est encore développée. Ils n’avaient pas besoin de cette invitation mais, étant miraculeusement disponibles aux moments proposés, ils ont saisi cette occasion pour développer ce qui nous unissait.
Vous soulignez ainsi qu’organiser un festival ne consiste pas seulement à définir un cap artistique ou à arbitrer dans la distribution des cachets. C’est aussi une affaire d’engagement, au sens fort, de la part tant de l’invitant que de l’invité ; et, en bien ou, parfois, en mal, cette dimension n’est pas sans impact sur les relations que vous nouez, que celles-ci aient été antérieures ou qu’elles aient été suscitées par l’événement.
Il est certain que, à travers les festivals que j’ai lancés, j’ai beaucoup appris en termes de relation humaine. De sorte que, je tiens à le préciser, je n’en veux à personne. Il a pu arriver que l’invitation fût moins concluante que je ne l’espérais, tant pis, j’apprends de ces demi-échecs. Ce type d’échange entre directeur et artistes fonctionne aussi autour d’affinités. On peut faire des efforts, des deux côtés de la barrière, mais ça ne se commande pas, les affinités !
D’où des déceptions.
Oui, quelquefois. Et alors ? La seule façon de ne pas être déçu est de ne rien espérer, et ce n’est pas dans ma nature !
De quel ordre, les déceptions ?
Vous savez, l’équipe d’organisation est restreinte. Alors, quand un artiste vient à Piano Pic, je me défonce, si je puis dire, pour m’assurer qu’il est bien accueilli. Je me mets en quatre pour vérifier si l’hôtel lui convient. Je surveille scrupuleusement que, dans sa loge, avant le concert, il a bien son verre d’eau et, le cas échéant, le plat qu’il désire, avant le concert. En tant qu’artiste, je sais combien comptent ces détails qui n’en sont pas ; et il m’arrive d’être surpris – ou il m’arrivait de l’être – que toutes nos petites attentions ne soient pas suivies, a posteriori, par un petit mot de remerciement, par exemple, à destination de notre association. Piano Pic s’appuie sur une équipe volontaire, motivée, généreuse, et j’apprécie – qui ne l’apprécierait ? – quand les artistes prennent le temps de saluer le travail de ces petites mains sans qui rien.
10.
La courtitude de la vie
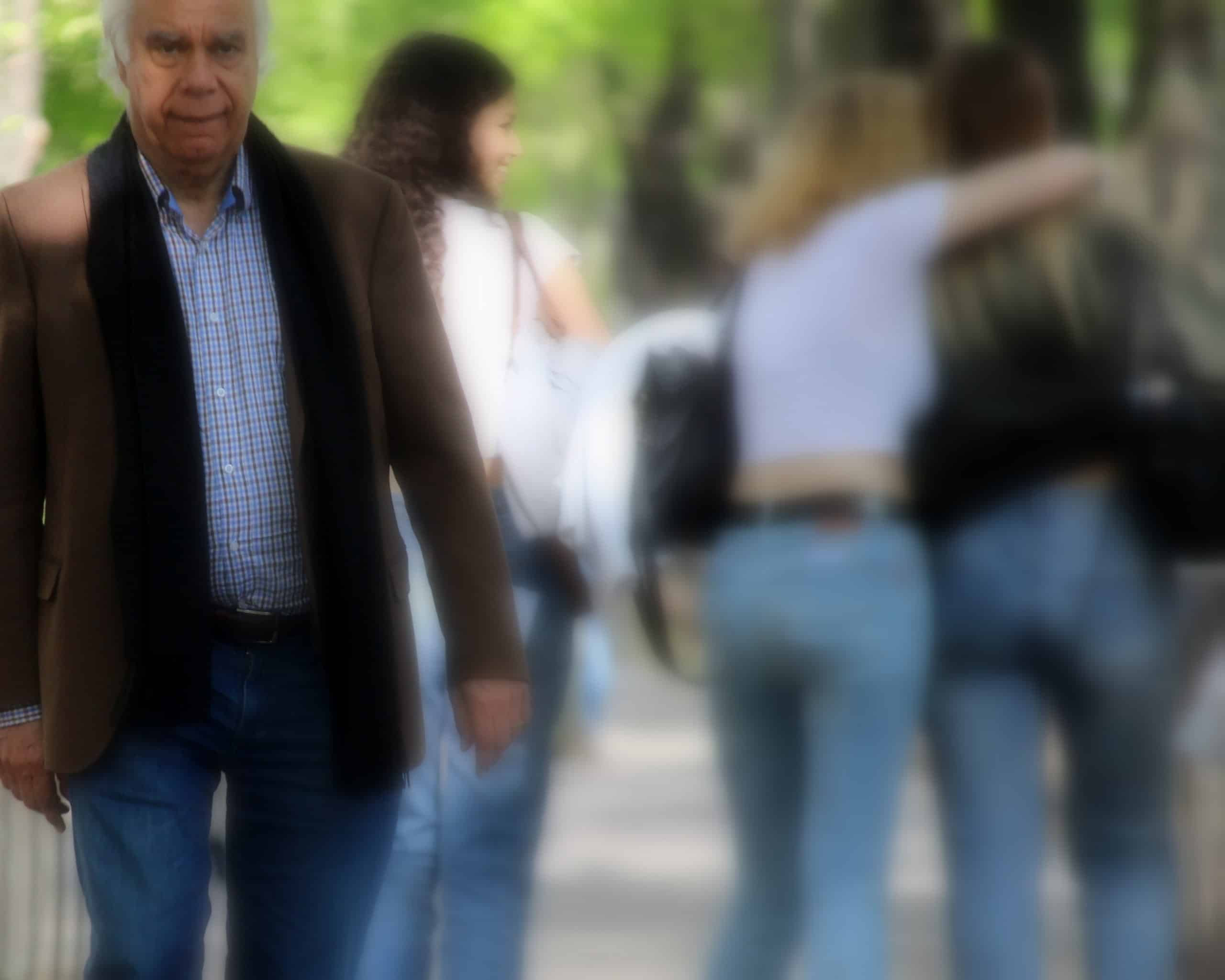
Pierre Réach, en tant que directeur artistique du festival Piano Pic, vous vous préparez aux nouvelles joies et aux nouvelles déceptions éventuelles – c’est rare mais ça arrive – pour l’été 2022. Comment se relève un festival après l’interruption liée aux règles sanitaires censées juguler l’épidémie de Covid ?
C’est compliqué, et ça n’a rien de magique. Certaines grandes manifestations ont tremblé. J’ai tremblé. Par conséquent, en 2020, quand la vague de Covid a tout submergé et que nous avons pris le confinement de plein fouet, j’ai dit à l’équipe du festival : « Il faut montrer que le festival dure toujours. On ne peut pas arrêter ainsi. » Évidemment, nous avons annulé tous les concerts MAIS j’ai décidé de venir jouer, gracieusement – toutes les subventions avaient sauté. Donc on a loué un piano, et j’ai joué avec le masque, en plein air et j’ai donné un récital, juste pour montrer que Piano Pic n’était pas mort.
La preuve : vous avez repris.
Oui, avec toutes les difficultés que l’on peut imaginer. Par exemple, en 2021, on a engagé les artistes programmés en 2020 ; même chose pour l’édition de cette année, dont la composition était prévue pour 2021. À présent, nous allons pouvoir repartir de l’avant. Survivre pour un humain comme pour un festival, c’est beaucoup de travail, et c’est aussi une chance que nous devons être fiers de faire fructifier.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=CWVUDguP-Vo[/embedyt]
Les mesures sanitaires ont néanmoins laissé des traces durables.
Là aussi, j’ai beaucoup appris, et pas seulement pour le festival ! Je me souviens de ces grandes salles avec tout le public masqué, seuls les yeux émergeant… Quelle vision ! Une anecdote à propos de ces masques. En septembre, dans ma classe de Barcelone, j’ai eu de nouveaux élèves dont je n’ai vu qu’une partie du visage. Or, percevoir la réaction des élèves rien qu’en observant leurs yeux, c’est extrêmement difficile. J’ai donc dû m’adapter, et je pense que les communications entre les gens ont beaucoup changé.
Il y a eu le masque, il y a aussi eu les distances…
… surtout pour quelqu’un comme moi qui ai l’habitude de m’approcher des élèves et de les toucher !
Ha, vous me rassurez. Quand je donnais des leçons à des élèves modestes, je précisais aux mamans que je toucherais leurs protégées. Je voyais dans leur regard la méfiance…
Mais il faut toucher les élèves ! Sinon, comment montrer la relaxation des épaules, la souplesse du bras ou le mouvement du poignet ? Eh bien, j’ai dû faire sans. Inventer. Bricoler. Drôle d’époque !
Au reste, pas sûr que cette phase soi-disant exceptionnelle soit terminée.
Vous avez raison, ça n’est pas terminé le moins du monde. Au moment où nous parlons, Shanghai est confiné ; et nous, nous enlevons les masques. Je pense que c’est de la folie furieuse. Je connais des gens qui, malgré trois doses de vaccin, ont actuellement le Covid.
C’est plutôt inquiétant quant à l’efficacité du vaccin, non ?
C’est surtout la preuve qu’il faut aider le vaccin en portant le masque. L’efficacité ne dure que six mois.
Peut-être même moins, si l’on en croit la proposition d’ajouter une quatrième dose…
Il est certain que le vaccin ne nous exonère pas d’un devoir de prudence ; et il est patent que, en ces temps troublés, le bon sens n’est pas la chose du monde la mieux partagée.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9EMmCT3or9Y[/embedyt]
En dépit de ce climat incertain, le programme de Piano Pic 2022 est avancé et revendique, derrière la prééminence du piano, un certain éclectisme chez les artistes (vedettes et jeunes pousses) et dans le contenu des programmes (de la musique savante au jazz)…
Je vais le dire sincèrement : ce n’est pas moi qui impulsé l’envie d’intégrer un concert de jazz. Je me dois simplement de prendre acte de ce souhait de l’association.
On ne vous sent pas convaincu.
J’en suis un peu étonné, et certainement pas parce que je n’aime pas le jazz. Toutefois, programmer du jazz dans un festival de musique classique me semble une contradiction dans les termes. De plus, programmer un concert de jazz ne me paraît pas très solide. C’est comme si on disait : « Attention, la musique classique, c’est ennuyeux et élitiste, on va donc proposer un concert plus facile d’accès. »
Un concert de jazz, c’est plus « facile » ?
Disons que, à cette aune, j’aurais préféré que nous organisions un festival de jazz !
Mais vous avez accepté cette entorse.
Si des gens dévoués attendent ça avec autant d’impatience, pourquoi se braquer et leur refuser ce plaisir ?
Être directeur artistique d’un festival à la fois grand et petit oblige donc à composer avec les bonnes volontés et les mauvaises décisions ?
Je ne parlerais pas de « mauvaises décisions », plutôt de décisions dont je ne puis être pleinement solidaire, ce n’est pas la même chose. Cela étant, oui, il est vrai que je suis parfois contraint d’avaler des pilules un peu amères – amères non pas pour mon ego, mais parce que je pense qu’elles nuisent au festival ou, du moins, à l’idée que j’en ai. C’est aussi cela, le travail d’équipe.
Cela va-t-il jusqu’à inviter des artistes dont l’esthétique vous parle peu ?
Oui, cela m’est arrivé. Vous ne pouvez pas être à la tête d’une équipe sans tenir compte des avis, et en tenir compte concrètement, même si vous vous y résolvez à reculons. Par chance, je pense qu’il y a toujours quelque chose de bien à découvrir, y compris chez des musiciens pour qui vous n’avez pas une inclination naturelle.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=plEQlJJaI_g[/embedyt]
La diversité du festival est aussi celle des formations : musique de chambre, récital et concerts symphoniques sont au programme. Cela m’inspire deux questions qui ne font peut-être qu’une. D’une part, est-ce une volonté d’offrir un panel pianistique allant au-delà du solo, de s’ouvrir à un public que le solo effraierait, de fidéliser vos festivaliers en leur donnant l’occasion d’aller écouter plusieurs concerts aux formats variés ? D’autre part, cette diversité est-elle éruptive (nous parlions de volcan en évoquant la geste créatrice), au sens où elle montrerait le foisonnement de ce qui existe derrière un « concert de piano », ou est-elle canalisée, au sens où elle s’appuierait sur une colonne vertébrale (thématique, historique, esthétique) propre à cette édition 2022 ?
J’avais envie que Philippe Bianconi vienne. Je le connaissais de réputation, mais je n’avais jamais eu l’occasion de le convier. Il se trouve que nous sommes représentés par le même agent, Brice Devolf. J’ai donc pu lui proposer de donner le concert d’ouverture au sommet du pic du Midi. Il a aussitôt accepté. Le lendemain, un concert était prévu dans la vallée. Jean-Marc Luisada avait triomphé en 2021 ; nous voulions donc absolument le réinviter cette année. Tout ou presque est de la même eau.
En somme, pas de fil rouge bankable ?
Ce qui unit les concerts de Piano Pic, ce n’est pas une colonne vertébrale, ce sont des coups de cœur. Je ne souhaite pas donner une autre ligne directrice, par exemple thématique. J’estime qu’un artiste n’est jamais meilleur que quand il fait ce qu’il a de meilleur en lui. À partir du moment où j’ai sollicité un musicien parce que j’aime son travail et que j’ai envie que le public du festival le découvre ou le redécouvre, quel besoin d’ajouter une étiquette thématique sur l’emballage ? La vie est trop courte pour lui ajouter des contraintes.
Est-il plus difficile de « vendre » aux collectivités un festival centré sur vos inclinations plutôt qu’un ensemble marketté autour d’une thématique censée être accrocheuse – « Femmes et musiciennes », « Diversités », « Vous avez dit le divin Mozart ? », « Pianos métis », etc. ?
Je ne sais pas. Je sais simplement que tout peut se passer. Une subvention peut arriver bien après qu’il était prévu, coulant le festival. Ça arrive. Beaucoup de manifestations se sont cassé la figure à cause de ce genre de contretemps pas vraiment musical. Il faut prendre du plaisir et le partager. Je ne proposerai jamais à un artiste de venir en lui imposant de jouer du Mozart parce que, cette année-là, on a choisi Mozart comme thématique. C’est absurde ! Dès lors, si l’artiste que je trouve génial ne joue pas Mozart, je ne l’invite pas ou je l’oblige contractuellement à jouer une œuvre de Mozart ? Mais quelle idée stupide ! Au contraire, Christophe Baillet et moi ne dérogeons pas à une règle : demander aux artistes de jouer ce qui leur fait plaisir. Toutefois, nous essayons d’éviter les doublons afin d’éviter les comparaisons.
Pourquoi ? Si tous sont de grands artistes, quel est le risque ?
C’est un jeu dangereux. Une année, nous avons eu la chance d’accueillir des artistes comme… je ne veux citer qu’un nom pour éviter de faire une liste incomplète, mais imaginez seulement Abdel Rahman El Bacha. Comment voulez-vous que je lui dise : « On veut que vous veniez mais à condition que » ? Ce serait ridicule.
11.
L’effroi de la tempête

Pierre Réach, nous avons évoqué le festival Piano Pic en montrant comment vous avez développé ce projet, comment vous concevez votre travail de directeur artistique à l’écoute de l’équipe qui vous entoure, comment vous avez réagi quand les règles sanitaires ont éteint le monde du spectacle vivant, mais nous avons à peine effleuré un point : vous êtes rétif au marketing et rechignez à labelliser chaque édition sous un titre accrocheur.
Non, je persiste et je signe ! Bien que cela puisse être mal perçu, il n’y a pas de ligne directrice globale au festival. Cependant, certains pianistes peuvent, à titre individuel, développer une sorte de série. C’est mon cas, à travers l’intégrale Beethoven que j’égrène à la demande de l’association, car les retours du public sur les précédents concerts ont été vibrants.
Une thématique serait trop restrictive ?
Surtout, elle sonnerait faux car définir une thématique, c’est s’en écarter. Vous avez une thématique autour d’un compositeur ? Il faut montrer les relations qu’il entretenait avec tel ou tel confrère, lui rattacher d’autres œuvres de son époque (parce que harmoniquement ou structurellement proches… ou au contraire très différentes), le frotter à une création contemporaine pour élargir le spectre et surjouer sa modernité, etc. À l’inverse, quand vous n’avez pas de thématique, vous vous rendez compte que, au fond, vous pouvez découvrir a posteriori une ligne directrice sans avoir eu besoin de vous contorsionner pour faire rentrer de force le talent des invités dans une petite case limitante.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ATPm2YMfuC0[/embedyt]
Derrière le directeur semble percer l’artiste expérimenté…
Vous savez, il y a de longues, longues années, j’ai joué la Symphonie fantastique de Berlioz transcrite par Liszt lors d’une édition du festival Berlioz. À l’époque, son directeur n’était autre que l’excellent chef d’orchestre Serge Baudo. La thématique est Berlioz, mais Liszt y était aussi le bienvenu…
Derrière le nom de Berlioz, se cache en effet une grande diversité de compositeurs mis à l’honneur. Cette année, le concert d’ouverture, dirigé par Debora Waldman, se concentrera autour de trois compositeurs : Ibert, Sohy et Dvořák…
… et c’est partout pareil ! Regardez le festival Lisztomanias de Châteauroux, une manifestation passionnante à laquelle j’ai participé maintes fois. Pour se renouveler, ils ont dû élargir leur thématique et associer d’autres compositeurs à Liszt : une année Beethoven, une autre Brahms…
Estimez-vous que cette ouverture soit une bonne ou une mauvaise chose ?
Avant d’être bonne ou mauvaise, elle est inévitable. En musique, rien n’est pire que l’enfermement et le ronronnement. Cela dit, d’un point de vue musical, c’est évidemment une bonne chose. J’avoue avoir du mal à comprendre pourquoi il faudrait se contenter d’un compositeur unique, se limiter à lui et exclure tous les autres ! Ce nonobstant, d’un point de vue logique, si vous construisez tout un festival autour d’un compositeur et que vous vous rendez compte que ce n’est pas tenable sur la durée car trop restreint, la spécificité même de votre manifestation se dissout. C’est à la foi inéluctable et un peu dommage.
Une ligne directrice n’est pas forcément liée à un compositeur…
Bien sûr, certains festivals s’orientent plutôt vers des titres propres à chaque édition, du type : « Les animaux dans la musique » ou « Le thème de l’eau », où se presseront Liszt, Ravel et Debussy au côté du prélude op. 28 n°15 de Chopin dit « de la goutte d’eau »… Je trouve ça ridicule et regrettable : tant d’effort pour monter une manifestation, inviter de grands interprètes et se coller une étiquette réductrice qui vous barre l’horizon, c’est presque triste.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=oO-5ImGAVN0[/embedyt]
C’est fort de vos convictions – fussent-elles parfois tempérées par les initiatives des membres de l’association du festival – que vous avez maintenu le cap de Piano Pic, y compris face à la tempête de la pandémie. Au moment où nous échangeons, un nouveau choc secoue la planète : la guerre en Ukraine. Il n’est certes pas besoin d’être musicien pour être ému devant les déchaînements de violence dont les échos nous parviennent. Toutefois, comment un artiste réagit-il quand il constate les conséquences éhontées voire carrément effrayantes de la guerre sur la culture : déprogrammation de certains pianistes, chefs ou orchestres parce qu’ils sont russes, déprogrammation de certaines œuvres parce que, par exemple, Tchaïkovski était russe, interdiction aux candidats de participer à certains concours – tel celui de Dublin – parce qu’ils sont russes ?
Ce qui se passe actuellement est un enfer, et cela me touche triplement : en tant qu’homme, en tant que musicien et en tant que juif. Deux membres de ma famille sont morts à Auschwitz, et une sœur de mon grand-père a péri dans le camp de concentration de Theresienstadt. Je suis allé en Israël à Yad Vashem, l’institut international pour la mémoire de la Shoah. J’ai trouvé le nom des miens dans l’ordinateur qui contient le nom de tous les israélites massacrés par les nazis. Si vous ajoutez à cela le fait que j’ai une grand-mère arménienne, j’aime autant vous dire que, pour nous, « génocide » n’est pas un mot dénué d’émotions ou de sens.
Vous l’avez vécu, et cela résonne en vous.
Oui, dans ma famille, nous avons connu les persécutions. Nous en avons été victimes. Nous savons ce que c’est. Toute mon enfance a été marquée par les dires de mes parents. Ma famille vient de Prague. Mes parents ont quitté la Tchécoslovaquie pour la France après l’invasion de Hitler. Dès 1939, mon père, qui adore la France et a été naturalisé, s’est engagé à corps perdu dans la Résistance. De Gaulle l’a félicité personnellement. Ceci vous explique pourquoi ce qui se passe en Ukraine m’horripile. D’une part, je suis bouleversé par ce que l’armée russe inflige au peuple ukrainien ; d’autre part, je trouve qu’il existe énormément de points communs entre la folie du dirigeant actuel de la Russie et Hitler.
Les sachants pointent également des différences qui rendent cette guerre irréductible à la spécificité du projet nazi d’extermination.
Certes, la Shoah est spécifique, quoi qu’il advienne ; certes, aussi, nous n’avons pas connaissance de l’existence de chambre à gaz, et il n’existe pas de traque à grande échelle des Ukrainiens dans d’autres pays. Ce sont des différences majeures, je n’en disconviens pas. Reste que le processus d’extermination des civils est très proche de la méthode nazie. Voilà pourquoi je suis peut-être plus ému que d’autres, à cause de cette petite fibre en moi qui se tord en voyant que la Bête immonde ou quelque chose de très proche s’est réveillée, et qu’elle s’est remise à massacrer avec fureur. Je n’ose imaginer ce qu’éprouveraient mes parents s’ils étaient encore de ce monde. Et pourtant, on peine, ici, à se représenter les atrocités qui sont commises. Chaque jour, c’est pire. Ça n’est pas près de s’arranger. C’est une catastrophe.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sSYYHBoL2JQ[/embedyt]
Face à votre émotion profonde, deux attitudes paraissent envisageables : arrêter de jouer du piano, car à quoi cela rime-t-il quand tant d’humains sont frappés par une armée redoutable ? ou continuer de jouer parce que, si plus de musique, alors quoi pour préserver le sentiment de beauté qui constitue une partie de notre humanité ?
Aussi curieux que cela semble, les deux attitudes que vous schématisez ont quelque chose de complémentaire. Certains matins, j’ai honte d’être en sécurité, chez moi, de me lever pour devoir jouer du piano, de jouir de la vie… Comment ne pas avoir conscience du scandale qui consiste à prendre son petit café au soleil pendant que des maternités sont bombardées, que des femmes sont violées en toute impunité, que des civils sont écrasés sous les décombres de leurs immeubles, que des charniers horribles seront probablement découverts demain ? C’est insupportable, il faut le dire et le redire. Mais je vous renvoie la question : que voulez-vous que l’on fasse ? Se morfondre, renoncer, s’apitoyer ? Accueillir des réfugiés si l’on dispose de l’appartement et du temps adéquats ? Soit, et après ? Évidemment, on peut prier pour les victimes, si l’on est croyant ; on peut participer à des collectes, si l’on est confiant ; cela n’ôte pas le sentiment d’impuissance qui renforce notre colère devant les crimes. À côté du festival, nous donnerons un concert dont toute la recette partira en Ukraine. C’est à la fois symbolique et microscopique. En réalité, nous ne pouvons que constater l’évidence : un génocide est en train de se dérouler à l’Est de l’Europe. La mort frappe. Les missiles détruisent. Un régime totalitaire essaye d’effacer tout un peuple, qui se défend de manière admirable. Je ne comprends pas qu’un événement aussi terrible se déroule à nos portes.
Vous semblez laisser entendre que vous auriez pu aller sur place pour aider…
Je n’ai plus l’âge, hélas, mais j’espère que l’on va intervenir autrement qu’en envoyant des armes. Tout le monde a peur. Peur de l’arme nucléaire. Peur de savoir comment l’on se chauffera, l’hiver venu. Il faut arrêter d’avoir peur pour soi-même. Il faut prendre des décisions radicales. Vite. Bref, je ne suis pas très optimiste.
Même si ce n’est pas comparable en termes de dégâts physiques, le monde de la musique est aussi touché par cette guerre.
Écoutez, j’ai un ami russe qui est souvent venu à Piano Pic et qui enseigne au conservatoire Tchaïkovski. Je veux dire par-là que ce n’est pas un paysan valeureux mais illettré, c’est vraiment quelqu’un qui appartient aux sphères privilégiées de la société russe. L’autre jour, ce personnage m’a envoyé un courriel hallucinant où il m’expliquait que, contrairement à ce que ressasse la propagande occidentale, les Russes sont en campagne pour dénazifier l’Ukraine, voilà pourquoi ils sont partis en guerre. Que des gens cultivés, que des artistes dans l’âme, que des esprits aiguisés, que des musiciens talentueux se fourvoient ou se complaisent dans de telles contrevérités me laisse pantois et nourrit l’effarement dans lequel la guerre en Ukraine me plonge.
12.
La couleur de l’air

Pierre Réach, nous avons évoqué certains aspects du passé (les années de formation), du présent (le disque, le festival, l’enseignement), et de l’actualité (notamment le Covid et l’Ukraine). Essayons d’imaginer ce que peuvent attendre vos fans dans un avenir proche ou plus lointain, entre récitals en solo, musique de chambre, accompagnement d’artistes lyriques et poursuite de l’aventure intégraliste…
Existe-t-il des fans de Pierre Réach ? Je ne sais. En tout cas, vous avez raison d’insister sur le spectre large qu’ouvre le piano, car cela correspond à l’image que je me fais de la musique. Quand je fais travailler un élève – qu’il soit en début de perfectionnement ou déjà professionnel –, j’obtiens toujours de bons résultats en appliquant la même méthode : s’il y a un chant à la main droite et un accompagnement à la main gauche, il faut jouer la main gauche et chanter la main droite. Ça marche très bien avec les sonates de Mozart ou de Beethoven, par exemple. Peu importe si vous chantez juste ou comme une casserole, il faut chanter.
Pourquoi ?
D’abord, ça développe, dans le cerveau, l’indépendance entre chant et accompagnement. Lorsque vous remettez les deux mains, vous sentez combien le chant doit chanter et combien il a besoin de l’accompagnement pour s’épanouir. Cela me ramène loin en arrière ! Quand j’étais petit, j’avais travaillé avec une assistante d’Yvonne Lefébure. Dans les inventions de Bach, elle m’incitait à jouer une voix et à chanter l’autre, ou à jouer une voix piano et l’autre forte.
Cette place de la voix (entendue comme la ligne mélodique mais aussi comme la vibration humaine) doit influer aussi sur votre jeu, tant en soliste qu’en chambriste et, évidemment, en accompagnateur.
Vous disiez que j’étais incapable de parler de mon activité d’interprète sans parler de mon activité de pédagogue. Vous pourrez dire aussi que je suis incapable de parler de mon activité de soliste sans parler de mon activité de chambriste. Car, pour moi, sans parler du fait que le répertoire est génial, celle-ci est guidée par une obsession : la vibration humaine. Ne connaître que le répertoire de piano solo est une faute immense. J’enrage quand certains élèves conçoivent le répertoire de manière restrictive, sans avoir l’idée de tout ce que représente la puissance de la musique de chambre.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=uEgnovRLXOU[/embedyt]
Vous enragez ET vous devez jubiler en pensant à ce que vous allez leur révéler…
Peut-être. Mais je dis la même chose en musique de chambre à mes élèves : « Quand vous travaillez votre partie d’accompagnement, vous devez être capable de chanter ou, a minima, d’entendre ce que fait le violon. Si vous ne l’entendez pas, cela signifie que vous êtes seulement focalisé sur votre partie, et c’est une catastrophe parce que, quand vous collez deux parties séparées dans la musique de chambre, ça n’est jamais ensemble. »
En quel sens ?
Avec deux bons professionnels, les notes tomberont simultanément, mais, dans l’esprit…
[Ici, interruption de la serveuse du Dôme (Paris 17), envoyée par son chef de rang
pour encaisser les consommations hors de prix alors qu’il s’allait dire de belles choses sur l’esprit.]
… pour moi, la musique de chambre, c’est l’ensemble qui compte. Le chant est transcendé par le merveilleux accompagnement – merveilleux pas parce que le piano s’en charge, mais merveilleux parce que, dans les grands chefs-d’œuvre, l’accompagnement augmente le chant. Tenez, une anecdote pas si anecdotique que ça : en classe de musique de chambre, j’ai eu il y a peu un jeune élève d’un bon niveau qui m’affirmait que, avec le cerveau, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Et il s’emportait en expliquant : « L’accompagnement d’une sonate pour piano et violon de Brahms, c’est difficile ! À la fin, comment voulez-vous que je sois à la fois complètement dans mes notes à moi et dans l’écoute du violoniste ? » J’aime ce moment où les jeunes défient – respectueusement – les figures d’autorité. Alors, je lui ai dit : « Tu respires de l’air ? Alors je vais te demander de penser que l’air a une couleur. Celle que tu veux. Vert ? Fort bien. Dorénavant, pense que tu respires un air vert. Et maintenant, écoute-moi bien. Le violoniste, avec son violon, c’est la même chose. Ce que tu joues, au départ, c’est de l’air normal. Mais, quand il joue avec toi, l’air devient vert. Essaye avec cette idée. » Il est revenu le lendemain. Il était transformé. Donc j’ai pu approfondir. Je lui ai dit : « Si une note du violon est éclairée par le piano, l’harmonie de l’accompagnement change. » Et j’ai senti qu’il a commencé à comprendre que la musique de chambre fonctionne sur un dialogue entre solistes. Il n’y a pas une vedette et un faire-valoir. Il existe ou il doit exister un aller-retour entre les intervenants.
Ce n’est pas toujours le cas.
Non. En musique de chambre, beaucoup de pianistes jouent bien. Ils accompagnent, et c’est en place. Mais ça n’est pas entendu. Donc, c’est beaucoup et c’est très peu. À l’opposé, vous avez des pianistes moins virtuoses qui valorisent plus la quintessence de ces moments. Souvenez-vous de Gerald Moore ! Quand il accompagnait les grands chanteurs, il n’y avait pas d’un côté le piano, de l’autre la voix. Ils étaient unis. Quand vous avez conscience de la nécessité de cette fusion et que vous êtes aussi soliste, cela influe nécessairement sur votre souci de travailler à plein la différenciation des plans sonores et la polyphonie. Il y a du sublime dans la réapparition du thème, quand une partie se tait ou, plutôt, joue plus doucement afin de mettre en relief une idée. Pour moi, c’est ça, la musique de chambre.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rLERRGqo1Oc[/embedyt]
Dans une veine proche, vous aimez accompagner…
… d’autant que Joan Martín Royo, le baryton espagnol, est un très grand ami. On a souvent donné le Voyage d’hiver de Schubert, et pas mal de Schumann aussi. L’accompagner est un bonheur.
Vous avez souvent pratiqué la musique de chambre, avec un chanteur ou un instrumentiste…
Bien sûr, j’ai connu de vrais moments d’émotion avec Gary Hoffman et Gérard Poulet, entre autres. Hélas, la pandémie a distendu ces liens…
… mais la vie musicale, amputée, blessée, handicapée, essaye de reprendre. À ses basques accourt la critique. Comment l’artiste que vous êtes gère-t-il ce rapport au jugement ?
Je vais vous dire : il serait malhonnête de prétendre que les critiques ne sont pas importantes, les bonnes comme les mauvaises. Les bonnes sont un encouragement, les mauvaises peuvent être prises comme une leçon. Ce n’est pas toujours facile, mais j’essaye de penser qu’une critique négative dénonce quelque chose qui n’a pas plu. Peu importe si la formulation est exagérée ou si le fondement du jugement est éminemment contestable. Il faut accueillir l’idée que votre travail n’a pas plu et ne peut sans doute pas plaire à chacun. En revanche, je n’accepte pas qu’une critique démolisse. À ma connaissance, ça ne m’est jamais arrivé. Mais je connais des artistes tout à fait talentueux qui ont été laminés au début de leur carrière par des mots détestables de l’organiste Bernard Gavoty, qui avait la lâcheté de signer sous le pseudonyme de Clarendon.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bqOOQdFjRL8[/embedyt]
On connaît au moins un autre organiste qui, non pas au Figaro mais chez Diapason, signe courageusement ses forfaits du pseudonyme de Paul de Louit…
À mon sens, un critique, quand il n’est pas content, ne devrait pas écrire pour ne pas dire qu’il a aimé s’il n’a pas aimé. Ce que je déteste par-dessus tout, c’est l’extrémisme. On en a parlé tout au long de cet entretien : la vérité n’existe pas. Alors, pourquoi encenser ? À quel titre démolir ? C’est tellement difficile, de jouer, à un moment précis, quelles que soient nos circonstances personnelles – un deuil, une maladie, une souffrance quelconque ! Donc, si j’étais critique, je n’écrirais pas si je ne suis pas content ; et je n’oublierais jamais que, chez n’importe quel artiste, même si on n’aime pas sa façon de jouer ou d’être, il y a toujours quelque chose de bien. D’autant qu’il faut souligner quelque chose de très important : une pièce de théâtre reste à l’affiche quelques jours, quelques semaines voire quelques mois. Un film, c’est pareil. Un livre, c’est encore mieux. Le concert, c’est une fois. Une seule. La critique est d’autant plus dangereuse que des gens peuvent lire la critique et être convaincu par sa teneur alors qu’ils ne sont pas allés au concert. En conséquence, je trouve ça horrible quand on compare le temps passé par un critique pour tuer un artiste avec les dizaines de milliers d’heures passées devant l’instrument, ou la suffisance d’un sulfateur avec les doutes existentiels de tout musicien luttant pour faire résonner un monument du répertoire. Comment accepter qu’un zozo incapable de jouer une gamme de Sol vous juge parce qu’il n’a pas apprécié votre pianissimo à la mesure 42 ? Pour moi, ça n’a pas une si grande importance que cela, mais je ne trouve pas toujours ce système tout à fait juste.
En somme, comme à peu près tous les artistes, vous détestez les critiques.
La question est plus compliquée, et dépasse les « bonnes » ou les « mauvaises critiques ». Mais qu’est-ce que ça veut dire, critiquer ? Si quelqu’un a aimé, je préfère qu’il écrive : « J’ai eu la chance de vivre un moment magnifique, de redécouvrir une œuvre que je croyais connaître ou d’être ébloui par un musicien dont je croyais ne pas aimer le travail », etc. Et s’il n’aime pas, c’est son droit, qu’il n’écrive pas ! Pourquoi médire des artistes ? Si vous n’aimez pas tel interprète, il vous reste quelques milliers d’autres à aller applaudir, alors, évitez-le !
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=RXOLj-fdQyc[/embedyt]
Selon vous, un critique ne devrait pas exprimer une déception ? Pourtant, reconnaissez-le, sortir honnêtement déçu d’un concert et en éprouver chagrin voire colère, ça arrive, non ?
Même si on a ressenti une déception, il faut éviter l’assassinat. Ressentir une déception et déverser son fiel au vu et au su de qui n’en veut, ce sont deux attitudes qu’il conviendrait de distinguer.
Vous n’avez pas connu la joie de vous faire assassiner par quelque critique ?
Il m’est arrivé de souffrir de mauvaises critiques, mais jamais de critiques détestables, heureusement ! Je touche du bois, j’espère que ça ne viendra jamais.
Vous redoutez le bazooka qui vous descend en flèche davantage que le papier sirupeux où se cache, en réalité, la petite vacherie qui empoisonne tout le reste ?
Les deux sont violents, vous avez raison. Après, ce genre d’incident fait partie de la vie. C’est même plutôt bon signe, en un sens ! Seuls les morts ont toutes les qualités. Tant que vous êtes vivant, vous plairez à certains et déplairez à d’autres. Cela n’exonère pas les critiques d’éviter la méchanceté dès à présent.
Soyons concrets. Comment imaginez-vous exprimer une déception sans paraître méchant ?
Il faut expliquer pourquoi on n’est pas d’accord avec la proposition de l’artiste, pourquoi on ne la comprend pas… et ne pas oublier de mentionner ce qu’il y avait de magnifique à côté de ce désaccord esthétique. Parce qu’il est séant de ne pas négliger une caractéristique humaine : nous sommes capables de ne pas aimer quelque chose qui, malgré qu’on en ait, est beau voire grand. Quand je vois qu’est oubliée la beauté au profit d’une divergence artistique acrimonieusement portée en place publique, ça me chiffonne et, j’espère, me chiffonnera toujours !
13.
La bonne surprise

Pierre Réach, nous avions clos l’épisode précédent en évoquant la relation que l’artiste entretient avec la critique. Peut-être serait-il malin de conclure l’ensemble de notre entretien précisément autour de cette question du lien qui unit un artiste et un public. Ce lien va au-delà du partage d’une grande œuvre musicale entre un interprète et des auditeurs, En effet, lors d’autres entretiens, il vous arrive de rappeler que, à notre époque où la science s’est développée avec orgueil, restent, inébranlables et irréductibles, « la peur de la mort, la tristesse, l’angoisse, la non-compréhension des choses ». Lorsque vous vous produisez en concert ou au disque, est-ce, par l’exploration de diverses formes de beauté, une manière de mettre en résonance certaines de vos émotions profondes – que vous transcendez grâce aux œuvres que vous interprétez – avec celles, peut-être pas si différentes, au fond, du public ?
Je crois que, des deux côtés de la scène, on est là pour partager. En tant qu’artiste, c’est une nécessité. Nous devons partager. C’est pour cela que nous travaillons dur. C’est pour cela que nous vivons. Voilà pourquoi le récital, la musique de chambre, l’enseignement et la direction artistique sont si intimement liés dans mon existence et dans mes propos : chaque proposition est la manifestation spécifique d’un même désir de partage. Il est bien connu que le bonheur est la seule chose au monde qui grandit quand on le partage !
En réalité, derrière
- le décorum du concert,
- l’exigence de l’artisanat qu’est l’exécution,
- les interrogations musicales qui transforment une interprétation en œuvre d’art éphémère ou fixée sur disque,
vos propos semblent rappeler, par petites touches, qu’il se joue quelque chose d’existentiel dans la musique. Pas seulement quelque chose d’esthétique, ce qui n’est déjà pas si pire !
L’opposition entre esthétique et existentiel me paraît ici très superficielle, si je puis me permettre. La musique comme l’existence sont fragiles. Certains de mes amis sont malades. Certains d’entre eux n’ont pas survécu à la pathologie qui les a frappés. Cette brièveté de la vie, cette fragilité, j’y pense tout le temps. À partir d’un certain âge, vous êtes obligé de vous lever en disant : « Quelle chance j’ai d’être vivant, en pleine santé et, en plus, en capacité d’exercer un métier passionnant ! » Je vis cet éblouissement chaque matin. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas oublier les gens qui sont gravement malades.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=y8H48lFAvm0[/embedyt]
La musique que vous interprétez explore ce cycle mêlant inquiétude, joie, gratitude… et re-inquiétude derrière.
L’art est propice à cette sorte de maelström. Il existe un lien évident entre une grande œuvre et la contemplation de la condition humaine – la vie, la mort, l’amour, les soubresauts auxquels nous confronte la vie… Du reste, ce n’est sans doute pas qu’une question d’art.Je ne suis pas sûr que quelqu’un qui serait absolument absent de toute communication artistique, qui vivrait sans la musique (savante ou pas), la littérature, serait épargné par ces problématiques. On est forcément confronté aux misères et grandeurs de notre condition, et aux aléas psychologiques que cela entraîne. Le musicien essaye d’en nourrir son idée de la beauté, c’est sa spécificité.
Dans cette perspective de sublimation, la musique a-t-elle un rôle à jouer, ou joue-t-elle un rôle différent selon le vécu de ses interprètes et de ses auditeurs ?
La grande musique, la musique classique, celle qui nous émeut et que nous aimons, peut nous aider à transcender nos existences. J’ai ressenti très fortement cela avec Bach, peut-être parce que la dimension religieuse est très présente dans son travail.
Sous quelle forme cette part religieuse résonne-t-elle chez vous ?
Personnellement, je ne suis pas religieux. Je ne pratique pas. Je pense être croyant, mais j’aurais quelque difficulté à vous préciser ce en quoi je crois. Disons que je crois volontiers qu’il y a quelque chose qui nous dépasse. Je le pense. En revanche, en jouant ou en écoutant de la musique – et pas uniquement à travers la musique, d’ailleurs –, il m’est arrivé d’éprouver des émotions qui me rapprochaient d’une forme de croyance. Par ce terme, j’entends la présence de quelque chose de beau qui ne se limite pas à la sphère humaine. Voilà pourquoi j’aime beaucoup la littérature, singulièrement l’œuvre de Jean d’Ormesson. J’ai toujours admiré ses livres parce qu’ils expriment cette intuition dans une langue éblouissante. Tout en étant plutôt raisonné et en admettant que, par définition, l’on ne peut comprendre ce qui nous dépasse, cet écrivain communique une émotion, une foi, une ferveur ; et, moi, je crois à la ferveur.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZjWaN1JVDEM[/embedyt]
Vous avez dit que la musique et la littérature ne sont pas les seuls aliments qui nourrissent votre appétence métaphysique.
Non, l’astronomie y contribue aussi.
L’astronomie ?
Eh oui !
Comment êtes-vous tombé dans cette marmite ?
Mes parents m’ont obligé à suivre mes études jusqu’au baccalauréat. À leurs yeux, et je peux le comprendre, la carrière de musicien était trop aléatoire pour ne pas avoir de sortie de secours si les choses tournaient vinaigre. En classe de mathématique, en cinquième ou en quatrième, donc vers 1965, j’ai eu un professeur que j’adorais. Il m’a initié à l’astronomie. On découpait les articles des journaux et on les collait dans un cahier spécial ! Ce domaine m’a passionné, au point que je suis devenu un des plus jeunes membres de la Société astronomique de France. J’avais même envisagé de devenir astronome ! Or, à l’époque, l’astronomie n’avait rien à voir avec ce que l’on a aujourd’hui – toutes les images de la NASA, ces milliards de galaxies que capturent des télescopes comme Hubble… C’est l’époque des premiers Spoutnik. On découvre la face cachée de la Lune. On suit l’aventure de la fusée russe qui s’est écrasée sur la Lune… Tous ces mondes nourrissaient puissamment l’imagination. En dehors de l’aspect scientifique, disons-le, ça fait rêver !
L’astronomie est-elle encore une de vos passions ?
Oh, oui ! Cette passion ne m’a jamais quitté. Maintenant, sur le plan technique, je n’y comprends plus rien et je ne suis pas du tout à la page. M’est restée néanmoins la fascination pour « le silence éternel des espaces infinis ». Contrairement à Pascal, ils ne m’effraient pas. Ils m’aspirent et m’inspirent.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0MLzaPfiKkg[/embedyt]
Ce nonobstant, votre sensibilité à la transcendance et au mystère ne se résout pas à laisser une religion la happer. Vous êtes juif mais non pratiquant. Vous êtes croyant sans dogme. Vous aimez Bach pour sa religiosité (entre autres…) quoique vous ne soyez pas luthérien. La musique peut-elle être, aussi, un lieu où s’exprime à la fois la foi, haha, en une transcendance et son irréductibilité aux mots et à la fixité ? On en revient au début de notre entretien, où vous asséniez la seule vérité dont vous êtes sûr : il n’existe aucune vérité dont on peut être sûr !
Je suis partagé entre deux évidences qui, pour le coup, sont contradictoires. D’un côté, comment croire à une vérité religieuse absolue dans un monde aussi déchiré, où tant d’humains souffrent, se détestent et se massacrent, parfois même à cause de vérités religieuses censément absolues ? D’un autre côté, comment comprendre l’incroyable hasard qui fait que, au milieu de l’univers, nous sommes vivants sur ce bout de planète ?
Cela pourrait vous inciter à croire en un dieu créateur.
Hélas, comment comprendre l’espérance en un dieu qui serait partout dans l’univers, auprès de chaque créature, dans une sorte d’éternité absolue et qui, pour autant, ne serait pas indifférent au sort du plus misérable vermisseau ?
Comment avez-vous résolu cette tension ou, a minima, comment vivez-vous avec elle ?
Bah, j’ai constaté que l’on n’y comprend rien ; donc j’essaye de m’en tenir à la conclusion la plus logique : inutile d’y penser.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=YZ5oD2tMbA0[/embedyt]
La musique ne vous y ramène-t-elle pas « à l’insu de votre plein gré » ?
En jouant certaines œuvres, notamment de Bach et certaines sonates très émotives de Beethoven, je me rends compte que, peut-être, nous avons une fibre émotionnelle qui se branche sur ce que vous appelez une transcendance, en tout cas qui est susceptible de vous donner le sentiment d’une élévation.
Ce n’est pas un sentiment partagé par tous.
Oui, mais un musicien est un peu un guide. Il doit vouloir montrer au public ce qui est de son ressort. Il doit passer les œuvres merveilleuses qui ont été écrites et dont on a de la chance de pouvoir jouir. Pourtant, je connais personnellement des gens qui n’aiment pas la musique. Elle ne les émeut pas. Ils ont pris l’habitude de vivre sans Beethoven, sans Mozart… Pourquoi pas ? Bien sûr, pour moi, c’est un peu triste et très étonnant, mais j’espère qu’ils ont autre chose…
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=my69HOvhM_8[/embedyt]
… autre chose pour les guider vers le sentiment de transcendance ?
Oh, vous savez, le sentiment de transcendance est une intuition magnifique qui ne résout pas tout et pose énormément de questions. Arthur Rubinstein a eu un joli mot, à ce sujet [à 51’57 sur la vidéo supra]. J’adorais cet artiste et je suivais le maximum de ses entretiens. Un jour de 1973, il avait quatre-vingt-six ans et Jacques Chancel, pourtant excellent interviewer, a eu le mauvais goût de lui demander : « Vous pensez que, après cette vie, il y a un ailleurs, qu’on peut aller ailleurs ? » Demander ça à une personne très âgée, ça ne me semble pas d’une élégance folle. Magnanime, l’artiste avait répondu : « Ça m’est complètement égal. Ça m’intéresse comme si on me demandait ce que j’attends de mon prochain voyage à Zambonia ou à Tombouctou. On va voir ! »
Est-ce aussi votre posture ?
Hum… Pour être une dernière fois sincère, je vous dirai que, après la mort, je ne sais pas s’il y a quelque chose ; mais, s’il y a quelque chose de beau, de grand, de lumineux, quelle bonne surprise ce sera !






































































