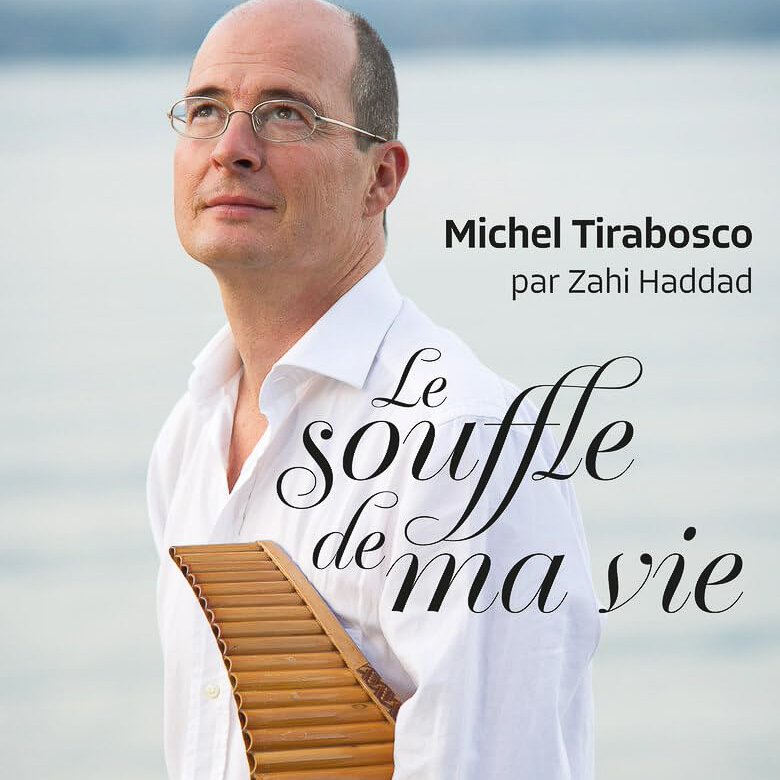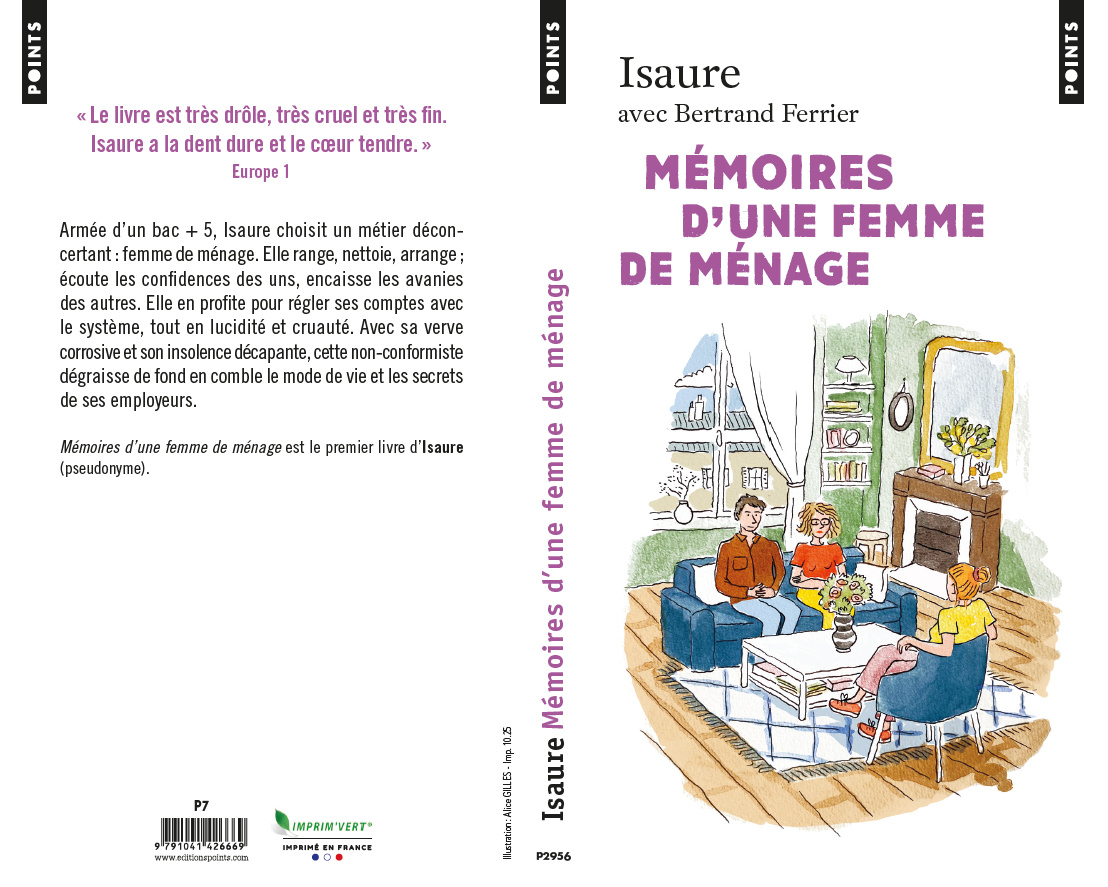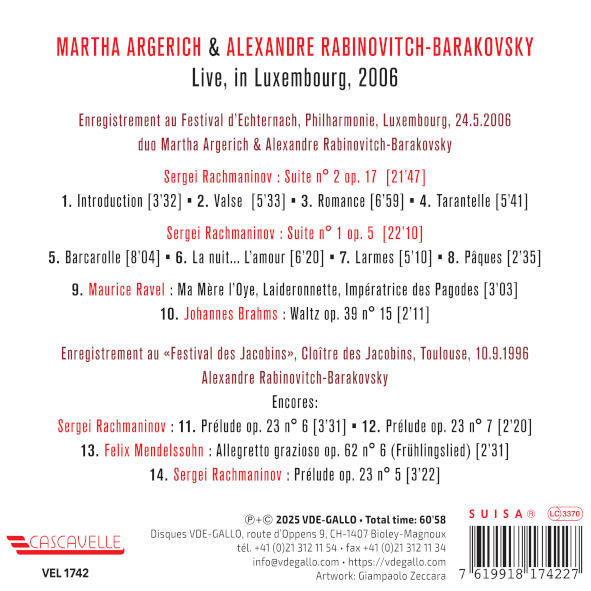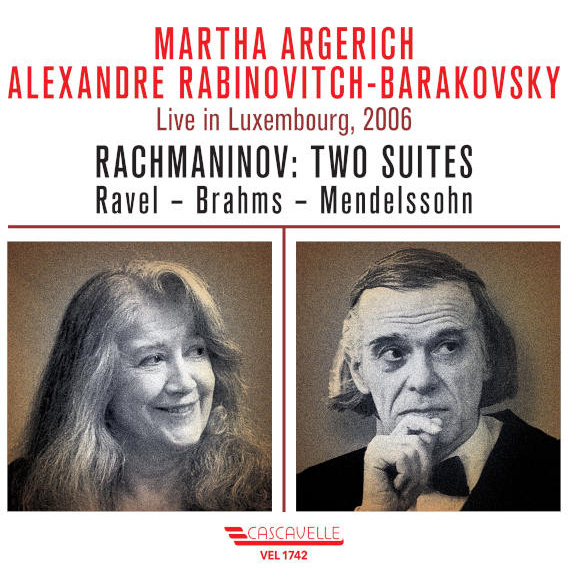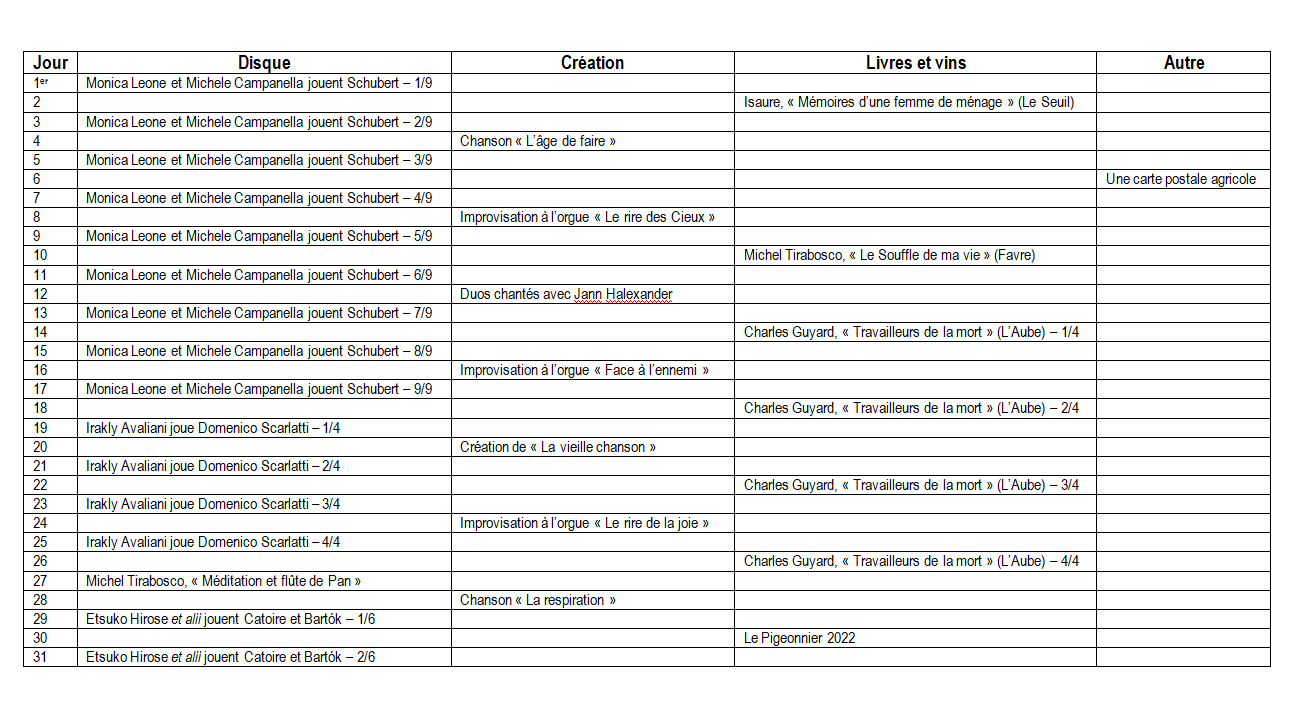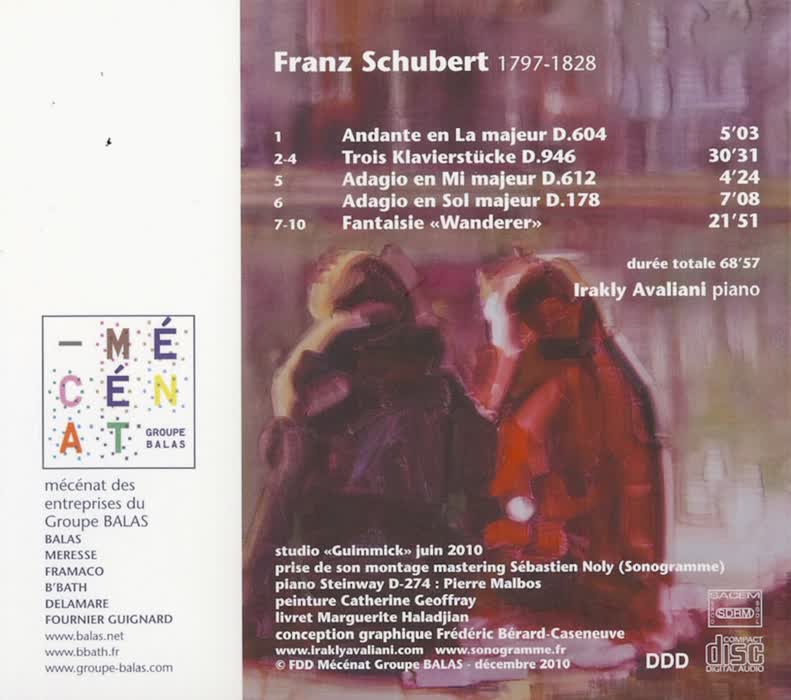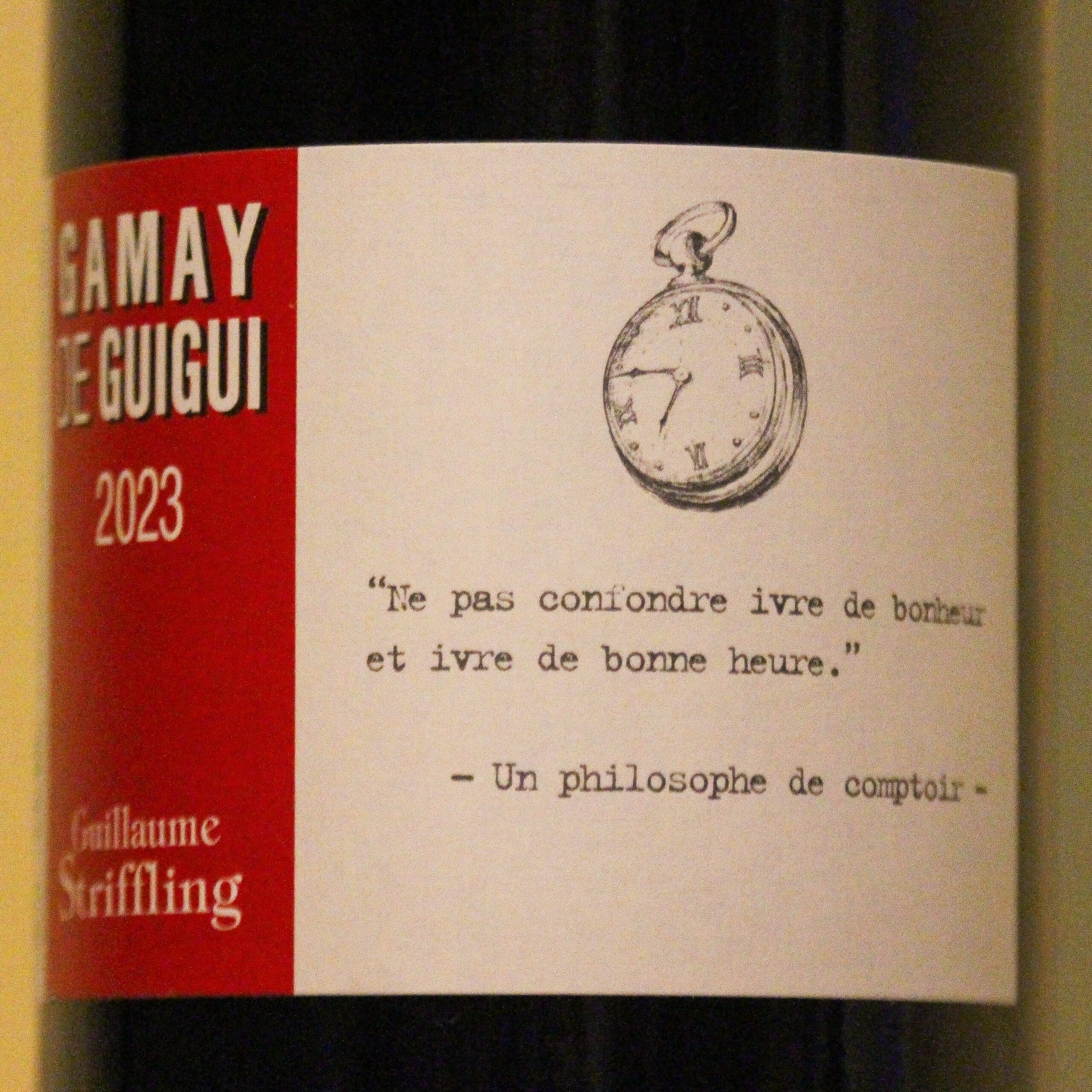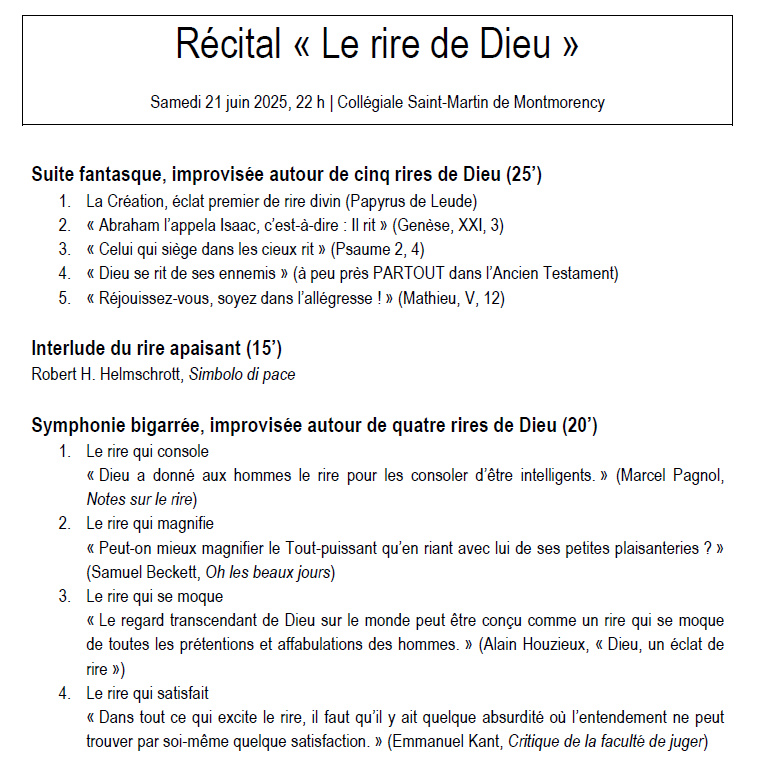Dans son premier disque, Born in Monaco (liens à retrouver ci-dessous), la technique de Slava Guerchovitch nous avait davantage impressionné que son expressivité. Son deuxième opus promet un Ravel imaginaire donc déçoit, puisque le propos n’est pas d’imaginer Ravel mais de rendre hommage à son imaginaire, à la fois « quête de beauté et défi technique » : le contenu ne correspond pas au titre. Néanmoins, l’on apprécie que les frères Guerchovitch s’investissent dans l’objet-disque en rédigeant la note d’intention et le livret, disponible en anglais et, c’est de plus en plus rare, en français.
Premier imaginaire sur le pupitre, celui qui anime célèbre Sonate pour violon et piano en Sol, où le compositeur vise, selon les interprètes, à « transporter l’auditeur dans des univers sonores contrastés ».
L’allegretto, lancé entre 6/8 et 9/8, file bon train. Les qualités requises sont au rendez-vous :
- légèreté,
- capacité à dialoguer,
- souplesse du geste donnant à l’auditeur une confortable impression d’évidence et de naturel.
Au piano cristallin de Slava répond le violon de David, qui déjoue le risque de la surinterprétation : le vibrato est maîtrisé, le phrasé est net, le son est chaleureux.
Les frères se jouent des difficultés techniques avec maestria. Mieux, au fil des modulations tonales et rythmiques, ils maintiennent une vision presque univoque de l’esquisse, de la caresse, de la suggestion. Essentiellement joué piano, ce premier mouvement gagne en limpidité rêveuse ce qu’il perd en
- tensions,
- contrastes et
- rugosités.
Une lecture très éloignée de versions plus énergiques telles que celle que l’on a pu chroniquer jadis ici ; donc une lecture intéressante puisque singulière.
Le deuxième mouvement est un blues motorisé sur une bitonalité : le violon reste en Sol quand le piano s’installe en La bémol. Sur des pizzicati secoués par des accents, le piano prend sa posture d’accompagnateur ouvrant la voie à un comparse « nostalgique » et glissant.
- Contretemps,
- contrastes d’attaques et
- trouvailles harmoniques nullement contenues à un exercice de style encore moins à une parodie
sont ici mis en valeur par une interprétation précise voire sage. Les musiciens se risquent néanmoins à métamorphoser leurs instruments lorsque le besoin s’en fait sentir. Le piano à queue sait alors sonner en mode bastringue ou saloon ; et le Sanctus Seraphino de 1739 joué par David Guerchovitch se mue brièvement en banjo. Sans se laisser tenter par le plaisir d’une musique canaille, les complices proposent une version
- propre,
- sérieuse et
- élégante
de l’audacieuse effronterie de Maurice Ravel.
En La bémol, un perpetuum mobile à trois temps conclut la sonate. L’allegro résolu lance peu à peu un violon impressionnant. Derrière la logorrhée des quatre cordes, le piano assure
- la pulsation de la mesure,
- le groove des contretemps et des accents, ainsi que
- les mutations harmoniques.
Les amateurs de versions
- radicales,
- incarnées et
- exubérantes
passeront leur chemin. Les mélomanes moins fouyouyous se laisseront
- séduire par l’art du toucher de Slava,
- ébaubir par la ténacité de David, et
- convaincre par la connexion entre les deux musiciens…
même si le prochain morceau de la set-list est la version pour piano seul de « Ma mère l’Oye », que nous commencerons à découvrir dans une prochaine notice. À suivre, donc !
Pour écouter gracieusement le disque en intégralité, c’est ici.
Pour l’acquérir, c’est par exemple là.
Pour retrouver les chroniques autour du premier disque de Slava Guerchovitch, cliquer sur les hyperliens infra.
Johann Sebastian Bach
Maurice Ravel 1 et 2
Franz Liszt











































![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)