44 – Jour J
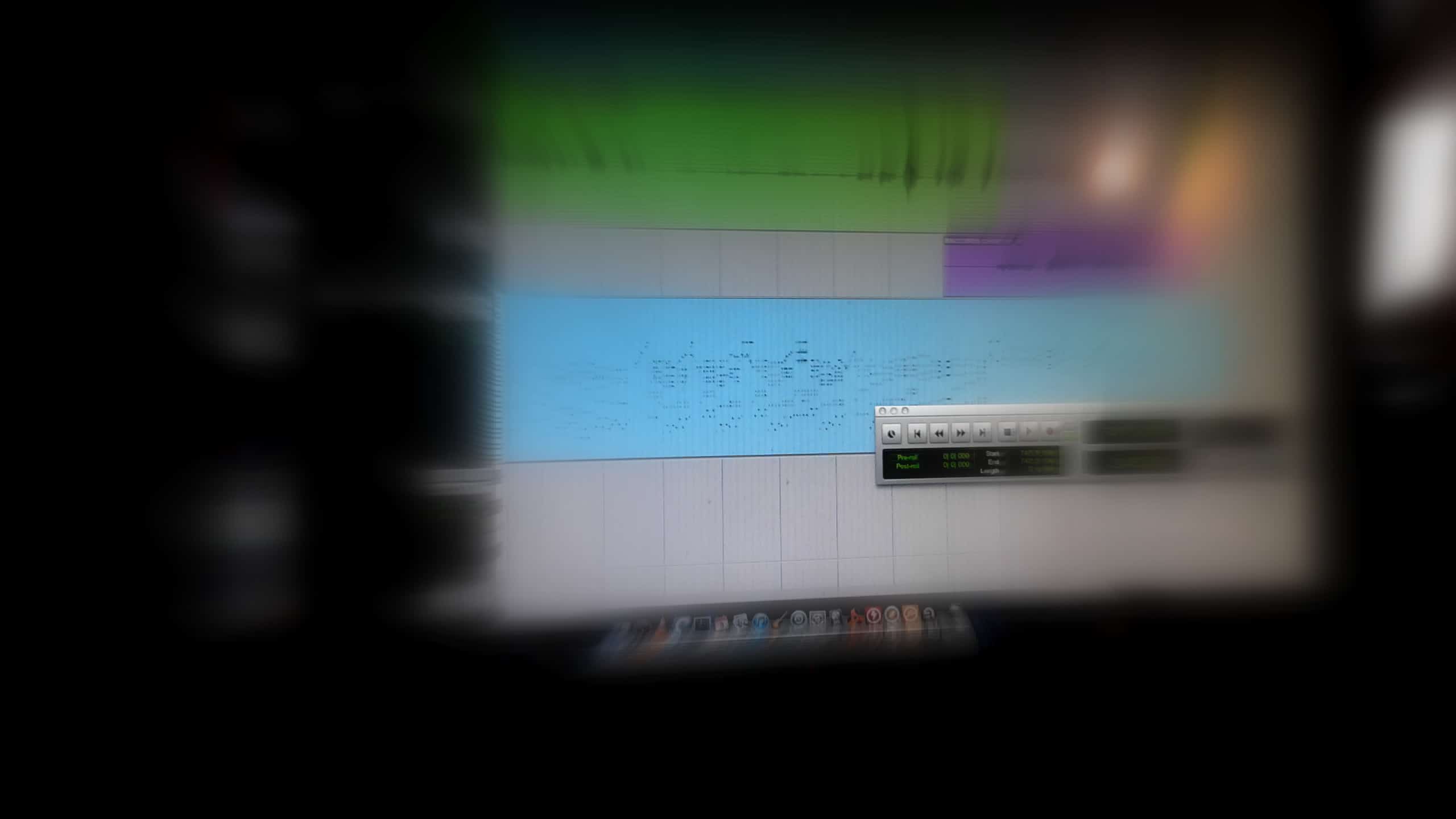
Ça commence. Sans être en avance, on avance. Plus que huit séances.
Comme un Romain, on écrit des « Je t’aime » en braille mais en évitant de brailler, façon Jean-Pierre Ferland. Jamais faux-cul, toujours focus, avec nos culs ronds comme des horloges, nous comptons le temps – le preste – à rebours. Sur les pointes.
Merci aux supporteurs ululateurs.
To be continued, inch’Allalalalah.
Partir, ce n’est pas arriver
Du 3 au 7 juin, j’enregistremente 44 chansons. Jamais vous dites vous saviez pas que ça se passait ici, et ce sera parfait.
Le projet « 44 », c’est :
- 8 ans de bourlingue de scènes en bistros, et réciproquement ;
- + de 100 concerts avec piano ou guitare à fredonner des chansons maison avec du texte dedans (et de la musique aussi) ;
- + de 200 chansons fredonnées en solo ou en trio, en « vedette » ou en partageant la scène avec Bernard Joyet, Francesca Solleville, Jean Dubois, Claudio Zaretti, Barthélémy Saurel, Jann Halexander, Michel Bühler ;
- 1 proposition du label Lalouline pour enregistrer 44 chansons avec du texte dedans (et de la musique).
Le projet « 44 » consiste à :
- enregistrer 4 albums de 11 chansons en 5 jours dans un studio idoine, devant les micros d’un ingé son spécialisé dans la chanson ;
- proposer ces albums en streaming par l’intermédiaire du label Lalouline ;
- réaliser un bel objet-disque avec livret de 24 p., rassemblant, sur deux CD, les 44 chansons ;
- diffuser ces chansons et en profiter pour en chanter de nouvelles sur scène !
Le projet « 44 » réunira 4 albums en 2 disques :
- chansons à l’ancienne ;
- chansons géographiques ;
- chansons amoureuses ; et
- chansons dans le miroir.
Le projet « 44 », c’est aussi des potins.
- Les chansons seront enregistrées « dans les conditions du direct » en piano-voix, avec l’apport ponctuel du jazzman virtuose Pierre-Marie Bonafos.
- Un premier tour de chauffe, en version guitare-voix, a rassemblé 44 chansons selon le même découpage à la Comédie Dalayrac (Paris 2), du 16 avril au 7 mai.
- Le dalmatien qui porte le disque avec ses 44 taches (env.) s’appelle Debussy de la Lorette en Cornouailles.
- La photo de l’album a été capturée par l’équipe de Kuhuru.com. Les autres photos sont de Bertrand Ferrier, sauf celles qui ne sont pas de lui, ça va de soi.
Surtout, ce projet « 44 » ne pourra devenir, juste, « 44 », que si vous – inutile de finir la phrase, n’est-il pas ?
À quoi va servir le financement ?
Le financement permettra la réalisation du projet « 44 » en nous permettant de régler les frais suivants :
- Enregistrement (captation, mixage, mastering) : 700 €, dont 50 % financés par le label Lalouline
- Droits de reproduction du disque (SDRM) : 350 €
- Fabrication (digifile 2 disques + livret 24 p.) : 1000 €
- Graphisme (conception, mise en page, photographie) : 1000 €
- Rémunération extravagante du musicien additionnel : 100 €
- Envois, promotion et p’tits coûts inattendus : 200 €
- Total général, incluant les frais bancaires et la commission Ulule : env. 3333 €
(On aurait bien mis « 4444 € », ç’aurait été plus rigolo – une autre fois, peut-être ?)
Et sinon, soyons fous, si les dons dépassent nos espérances, ils seront employés dans deux perspectives :
- organisation d’un concert dans une salle adaptée ;
- et accentuation de la promotion du projet, pouvant inclure la réalisation d’un beau clip – on avait pensé à en faire un moche, mais c’était encore plus cher.
À propos du porteur de projet
Bertrand Ferrier est docteur ès Lettres en Sorbonne et lauréat du DESS d’édition de Paris-XIII-Villetaneuse, et pourtant ni prof de fac ni directeur éditorial de Flammarion, c’est dire si son sort est hyperplus désespéré que lui. Il aime faire la sieste. Il est organiste titulaire à Paris. Il a publié une vingtaine de livres et en a traduit deux cents autres – dont Eragon. Il adore discuter avec p’tits nanimaux et gros chiens. Il a enseigné à l’université pendant neuf ans. Il est chauve et chevelu, mais il n’a jamais fait de cheval – comme quoi, ça n’a aucun rapport même si ça commence presque pareil. En tant que conseiller littéraire, il a coulé beaucoup moins de maisons d’éditions que ne le stipule la légende. Il boit beaucoup de thé mais pas que, oh non. Il aime les gros mots et le subjonctif imparfait. Depuis 2016, il programme un festival de musique classique, incluant une vingtaine de concerts chaque année. Ah, et aussi, il chante. Par le fait même, donc.
Bernard Reichel, Œuvres orchestrales, VDE-Gallo

Troisième chronique autour de l’œuvre de Bernard Reichel, cette notule est l’occasion de découvrir un peu plus la part orchestrale de ce compositeur suisse, après une évocation de son travail pour orgue et une autre de son travail pas-que-pour-orgue.
En guise d’apéritif, Intrada (1945, 6′) fait résonner cordes et cor pour l’énoncé du thème. Clarinette et hautbois dialoguent ensuite avec les cordes. La pièce s’articule autour des ensembles et des duos entre cordes et bois, basson inclus bien entendu. Le compositeur fait l’effort de garder en évidence le thème qui, ainsi, paraît comme une véritable colonne vertébrale, non comme un prétexte. Des à-côtés surgissent grâce aux bois, parfois soutenus par les cordes. Jusqu’à la résolution en suspens, une énergie oscillant entre légèreté pétillante et solennité sourd des notes répétées, des tenues énergiques et des montées harmoniques.
D’un seul tenant, la Pièce concertante pour flûte et orchestre (1953, 16′), dirigée par le fiston-altiste Daniel, illustre dès son titre la tension propre au compositeur entre maîtrise de la science traditionnelle de la composition et volonté d’y fomenter sa griffe personnelle. Une introduction énigmatique commentée par le célesta est réinvestie par le soliste et les cordes, cœur de l’orchestration reichélienne. Raymond Meyland tâche de rendre au mieux la polymorphie de son rôle : tantôt leader, tantôt accompagnateur privilégié des collègues tuttistes. Séduit cette capacité à développer une idée de façon multiple tout en gardant le motif prégnant, l’instituant fil conducteur susceptible d’accueillir et de guider l’auditeur.
Une maîtrise remarquable des différents modes (tonalité, mais pas que) aguiche l’esgourde, d’autant que les cordes et les percussions roumaines interviennent avec intention. Vers le mitan, un sursaut d’énergie secoue l’orchestre, proposant une dérive harmonique seyant à la chaleur du son soliste. Tensions et variations d’humeur animent alors la pièce. L’opposition entre cordes et cors activent provisoirement les frictions. La flûte, volontiers virtuose, exacerbe les échanges, dans une atmosphère fluante que l’orchestre, audiblement motivé bien dirigé. La dernière partie est lancée par le célesta, qui associe le soliste aux bois et aux cordes, base de l’orchestration reichélienne.
Les deux grands morceaux suivants morcellent le quart d’heure en suite. La première Suite, habilement dirigée par le fils-de, commence sur les deux mêmes notes que le morceau précédent. Elle enquille des danses historiquement exotique, en s’inspirantd’un projet scénique autour du Conte d’été. Les Préparatifs dans le château, avec piano s’il vous plaît, s’ouvrent sur une série d’accords néo-médiévalisants. S’y exprime l’essence – autant que l’inculte que nous sommes le suppute – de Bernard Reichel : connaissance des codes qui ring a bell aux auditeurs, et souci de les dépasser. En clair, on entend de quoi que ça fait référence à, et on se réjouit que le compositeur contemporain ajoute son KetchUp à la chose, même si on n’aime pas la sauce tomate sucrée – c’est une image, une expression. Les différences de nuances sont bien rendues, comme la solennité de la Marche nuptiale, plus martiale que nuptiale (mais je ne me suis pas marié, ça peut jouer). La Sarabande, enchaînée, résonne de solennité – ça veut rien dire, mais j’aime bien – avant que la Danse des pages ne virevolte avec l’ironie de la musique parodique, tambourin en tête, surtout dans les cinquante premières secondes avant qu’un développement reichélien ne prenne la suite (ha-ha), puis qu’une troisième partie ne renoue avec la parodie.
Un bref Intermède remet le langage reichélien – entre harmonie consonante et mutations mimées par la tenue des violons 1 – au centre de la question. La Danse des fauconniers et archers – transcrite pour les amateurs de lecture digitale comme Danse des lauconniers – renoue avec la parodie brillante chère au compositeur qui, quelque créateur qu’il soit, n’oublie jamais de rendre hommage aux prédécesseurs donc aux langages musicaux d’antan, tout en démontrant sa propre maîtrise de l’art. Le grand mouvement final, intitulé quasi alla Satie – avec lequel Bernard Reichel ne devait guère avoir à faire, à part partager quelque poire sportive – quelque chose comme « Danse générale en forme de danse fantasque », sorte de valse entrecoupée de passages binaires. L’orchestre, sous la direction du fils-de tâche de rendre la fraîcheur de cette composition ravissante de maîtrise et de modestie. Les respirations soulignent la qualité des musiciens roumains et leur souci de donner à entendre la musique fors leur propre participation – et fors la digne prise de son de Cornelia Andreescu.
La Suite pour orchestre de chambre (1969, 15′) s’ouvre, avec la rigueur suisse de, eh bien, rigueur, sur un Prélude. Le livret nous apprend que la suite « se compose de cinq morceaux formant un ensemble », ce qui nous aide hypervachement à entrer dans la musique de Bernard Reichel – faut pas laisser les compétents incompétents écrire des trucs, c’est souciesque. Les cordes se taillent la part du lion, tandis que les bois se taillent la part des forêts. Le « Modéré » qui suit tente d’équilibrer la donne, articulant l’échange entre solistes et tuttistes jusqu’à la suspension offerte par les clarinettes. Le remarquable Scherzo vibrionne, cors compris, autour d’un motif concis comme les aime le compositeur, maître ès écriture mais viscéralement, structurellement, philosophiquement piètre développeur de mélodies (et pas que parce qu’il portait de grosses lunettes, non). La Méditation s’organise autour d’une seconde mineure qu’il s’agit d’orchestrer – bref mais formidable moment – et ce « formidable » est dédié au lecteur qui tantôt vitupéra contre mon emploi contemporanéiste du terme. Le Finale prétendument allegro est certes élancé, mais élancé alla Reichel : il s’articule autour des trois notes d’une tierce. L’énergie, excellemment rendue par les musiciens que galvanise Modest Cichirdan, se cristallise autour des timbales qu’aspirent in fine les cordes.
En conclusion, voilà un disque qui associe le savoir-écrire pour orchestres de Bernard Reichel et la substance dudit Bernard Reichel, autant que nous la puissions jauger. Rigueur, maîtrise et efficience sont les maîtres-mots qui nous paraissent sourdre de ce disque. Par conséquent, oui, nous en pouvons conseiller l’acquisition car ce n’est ni strictement parodique (du faux médiévalisant) ni ennuyeusement – si si – technique. Bernard Reichel tient les deux cordons de cette bourse musicale. Il sait écrire, mais il est aussi un créateur avec sa propre substance. Cette tension entre bienséance et présence harmonique fait une partie du prix de ce disque à la fois agréable – c’est tout sauf une critique – et intéressant.
Pour écouter le disque en intégrale, c’est ici.
Pour acheter ce disque qui le vaut bien, c’est là.
Ariane Dubillard, « Ma chanson de Roland », Théâtre des déchargeurs, 28 mai 2019
La captatio benevolentiae
Tout arrive, nous sommes allés voir une fille de. Tant pis si cela choque, on attend le procès : sans en prendre une, il nous faut le révéler aux ignorants de notre trempe, Ariane Dubillard n’est rien d’autre que la fille du Roland. D’où son nom, précisément : Ariane Dubillard. On aurait pu se douter, mais bref, le fait est que Roland Dubillard est la substantifique moelle, fort rabelaisienne, du spectacle que la dame a joué, édité aux éditions Camino verde, et qu’elle remixe pour l’occasion avec un prélude flash forward inédit. D’où le titre, Ma chanson de Roland. Comme quoi, tout cela est finement pensé, quoique jamais trop intellectualisé.
Aussi, dans la présente notule, tâcherons-nous de montrer que, conformément à ce « requiem pour violon et marteau » évoqué en ouverture des Diablogues, où la rencontre des deux protagonistes est évoqué comme un moment cognant voire déchirant, la suscitation, la rencontre et la séparation arianiques tournoient autour d’un substantif : l’insaisissabilité. Soit, stipulons-le aussi sec : que ceux qui en déduiraient que, du coup, c’est un spectacle chiant déchiantent de suite. La comédienne est formidable, la griffonneuse est douée, la chanteuse est rouée, la mise en scène de Michel Bruzat n’est pas toujours claire (principe de l’escabeau, rôle des multiples verres d’eau…) mais n’en fait pas trop ; bref, ce spectacle est une joie. Mais bon, si on commence comme ça, on est encore plus sûr que d’habitude que personne lira la suite. Tant pis, on aura au moins écrit la fin avant le début, c’est cohérent avec l’objet décrit ici.
Le spectacle
Car, oui, c’est ainsi – la fin avant le début – que commence, alla Philippe Chatel (« Est-ce la fin du début ou le début de la fin ? Nous, on dit que F-I-N, ça ne veut pas dire fin »), Ma chanson de Roland. En effet, la comédienne s’aperçoit ex abrupto qu’elle a bien remercié poliment les zozos, mais itou oublié de « faire le début ». Or, le début, pardon pour la dame, ça date. Façon Amélie Nothomb, elle évoque sa vie à six mois. Puis la vie avec Babar-Roland. Puis la mort de Nicole, la maman. « Elle s’est tuée ce matin. Non, elle ne reviendra plus. En général, c’est définitif. » (Soyons imprécis : toutes les citations sont faites « approximatif », selon la terminologie higelinienne, car nous n’avons point le texte sous les opercules enlunettés.)
Peut-être inspirée par l’humour astiérique, spécifiquement percevalien, la dame raconte comment, à six ans, elle était partagée d’une grand-mère à l’autre : trois nuits chez mamie, trois nuits chez grand-mère (on s’y couche à 23 h, comme quoi faut pas se fier aux appellations, c’est comme les vins) ; ou quatre nuits chez mamie, cinq nuits chez grand-mère, deux nuits chez mamie, une nuit chez grand-mère, etc. Sur ces entrefaits mathématiques, la chanson de « la pauvre petite fille » entraîne l’arrivée de l’accordéon dont, par principe, nous devons dire du mal même si, en dépit de notre peu de goût pour l’instrument, nous devons reconnaître la pertinence des interventions et de la présence concentrée de Sébastien Debard.
Ariane est une créatrice. C’est notamment l’inventrice de la pastille pour rire. Si, la pastille pour rire, chacun connaît ou pourrait connaître : tu suçotes une pastille Vichy en tant qu’elle est une pastille pour rire, tu ris, ça devient une pastille pour rire. Bref, plus tard, inspirée par « Avec l’ami Bidasse » qui, au moins par son début, sonne comme du Mozart et du Schubert, la damoiselle compte être – affirme-t-elle après l’être devenue – une vraie chanteuse allemande. Et pourquoi pas ? En vrai, rien n’existe. La pastille Vichy peut se ririfier. L’ami Bidasse peut se classifier. La nuit, la pluie, on les peut sûrement photographier. On peut rêver de tout maîtriser. Illusion, bien sûr. Mais l’illusion, ç’a beau être pourri comme le velcro, on s’y accroche. Jusqu’au jour où, pof, velcro et illusion cèdent, et l’on dégringole. Un exemple ? « Quand je suis née, stipule la narratrice, j’étais pareille à l’été ; mais tout a fondu comme neige. » En vrai de vrai juré craché, rien ne dure, même le mou. Tout s’effrite, et pas que chez McDo – et je crois que, en matière de jeux de mots laids, on est comblé.
Pour autant, ne dramatisons pas, Ariane vit quand même rue du Bac, y a pire zoo à Paris. Avec la nouvelle compagne de Roland, mais quoi ? La quinzagénaire assume de se confronter à l’insaisissabilité, il est temps, quand mamie-la-pas-rigolote s’y reprend à trois fois pour trouver son prénom. Quelque chose lui échappe. La vie, sans doute. Comme quand papounet est bourré et sous médoc et qu’il n’est plus lui-même, illustrant l’insaisissabilité des gens, après maman qui s’est défilée – insaisissabilité des femmes.
Pareil pour mamie, qui meurt à 19 h 30 : insaisissabilité des vivants, ces gens très particuliers. Ariane elle-même en personne est une jeune femme blonde « très violente et très calme » : insaisissabilité de soi. À la magnifique punchline de la folle Mama Béa Tekielski (« Ta main, comme une hirondelle, qui dessine un printemps étrange »), la narratrice répond par l’évocation d’un « petit doigt toujours en marge, comme toi ». Ben oui, insaisissabilité du corps. Prolongeant ces caractéristiques, le cœur aussi se met à l’insisassibilité. Roland n’est-il pas évoqué à travers son goût pour Juana, « la ralentie » d’Henri Michaux qui, jadis, n’avait « qu’à étendre un doigt ». Insaisissable comme une drogue, que ledit Henri n’a pas négligée, l’héroïne s’enfuit loin de son père (« au sixième ») sans pour autant s’échapper : « Quoi que tente un œuf dans son aérodynamisme, il reste un œuf », pontifie avec humour Roland.
Peut-être, au fond, ne reste-t-il que deux vérités : l’éléphant est irréfutable ; et seul l’œuf, aussi rapide et futile fût-il, peut être saisi.
À mesure qu’Ariane s’émancipe, se développe la correspondance qu’elle nourrit avec Roland, signe et revendication de l’insaisissabilité. Elle est libre un max, en hauteur dans son sixième, et pas que l’arrondissement, comme en longueur – par exemple en Asie. Devant son insaisissabilité, Roland vitupère tendrement : « Six mois, à mon rythme, ça fait douze » ; « Je voudrais savoir ce que nous sommes devenus » ; « Je ne t’écris pas beaucoup car t’écrire me fait souvenir que tu n’es pas là »… Pourtant, l’affaire n’est pas que distance : comme sa mère qui avait des absences dans le pied, id est un tempérament voyageur, Ariane imite le chanteur qui affirme « respecter ceux qui racontent des histoires » tout en préférant raconter des géographies – elle s’enfuit car « il y a trop d’histoires, ici, j’ai besoin de géographies ».
Ça tourne court quand elle donne cours car elle sévit « dans une salle de glace : il fait – 25° ». La victoire de celle qui cultive un look alla Marie-Aude Murail et un chant façon Michèle Bernard ? « En Chine, désormais, je passe inaperçue. » Insaisissable, où qu’elle soit. La phrase qui sert de baseline au spectacle (« J’ai assez grandi, il me prend l’idée de naître ») précède le tout meilleur moment : concaténant des événements, l’artiste associe la Hochschule de Francfort, Molière, Marivaux, Jean-François, oubliant au passage de donner des nouvelles du hérisson évoqué tantôt, ce qui est un peu triste. Ce flash forward est formidable, mais c’est aussi un pivot qui, en quelque sorte, précède le deuil du héros, le papa. D’ailleurs, il anticipe sur la chanson de Roland annonçant : « Je l’ai rencontrée à la foire du Trône, et ça ne m’a rien fait. » Ledit Roland en fait un AVC. Insaisissabilité que pointe la fille car « tu es vivant et tu me manques ». Au fond, vivre comme mort, s’insaisissabiliser soi-même, est-ce un genre que l’on se donne… ou un judicieux dégenre qui dérange ?
Prolongeant ce genre de préoccupation en écho à un Barthélémy Saurel qui se demande : « L’eau sait-elle que la vapeur, c’est elle ? », Ariane s’interroge : « Qui sait nager mieux que l’eau ? qui sait aussi se noyer mieux qu’elle ? » Dans ce monde fluant, flou, liquide, la narratrice aimerait ne pas augmenter du choix des poses le poids des choses. Concernée mais pas prête à se laisser cerner, elle s’évapore, découvrant « de nouveaux quartiers, de nouveaux Franprix », assumant préférer « les rallongis aux raccourcis », et osant se révolter contre les camisoles chimiques : « Les médicaments, c’est nul. On ferait mieux de se parler et de s’allonger tout nus dans le noir. » On pense à feue Maurane s’adressant à Arnould-son-pianiste : « J’aime quand tu me vêts en toute nue, quand je suis toute nue avec toi, quand nous sommes tout nus tous les deux, je crois que le message est passé » (et la dame ajoutait « il s’en fout complètement »). Mais voilà, ces fuites vertigineuses finissent par donner le vertige. Même la belle Ariane en perd le fil : « Je ne sais plus où je suis ni où je dors », revers de l’auto-insaisissabilité. La fragilité de l’opposition entre histoire et géographie frappe derechef quand l’héroïne, fors toute pose, affirme que « le seul endroit où je veux m’installer, c’est l’instant ».
Gardienne d’une maison dont les proprios juifs sont partis « définitivement en vacances » à l’hospice, elle tombe amoureuse de l’édifice. L’occasion de claquer quelques punchlines à sa façon, comme « L’amour s’en fout des barres d’immeuble » ou « Je fais provision de provisoire ». Ce qui ne préserve pas Roland, éphémère donc éternellement insaisissable : « Le mot toujours restera pour toujours dans ta voix qui dit toujours », affirme la fistonne. Or, elle se met curieusement à bégayer quand elle évoque l’aphasie de son père, comme Romain Didier, au Café de la danse, affrontait son trou de mémoire au moment de chanter – non, pas « Elsa Haimer » mais « Amnésie », une chanson dont, précisément, le refrain gémit : « Ram’nez-moi d’vant un papa… Non, c’est pas lui. »
Ainsi, l’insaisissabilité se renverse. Celle de la fifille devient celle du papa. Le regard le reconnaît quand, dans la maison de l’Essonne acquise sous la houlette de Maria (et enfin appelée « La Saucée »), on met un couteau à droite de l’assiette du patriarche comme si on ne savait pas qu’il serait incapable de s’en servir. Dès lors, comme si l’insaisissabilité était intérieure, on rêve que les noyaux des pruniers se souviennent des fleurs. Comme si l’insaisissabilité était contagieuse, « à la fin, tu étais devenu une transparence et nous-même, à vivre autour de toi, nous avions fondu ». Comme si l’insaisissabilité était elle-même illusion insaisissable, le disparu paraît « toujours vivant quand je ferme les yeux, et aussi quand je ne les ferme pas. »
Décidément, ne les fermons pas, ces yeux intérieurs, mais sachons nous endormir dans la beauté des choses que nous réussîmes à construire, échafauder, imaginer, espérer, transcender, fomenter voire, parfois, vivre.
La conclusion
Une excellente actrice est à saisir au Théâtre des déchargeurs jusqu’au 15 juin, du mardi au samedi. C’est un moment qui n’est certes pas destiné aux seuls connaisseurs de Roland Dubillard ou aux amateurs de théâââââtre drôôôôôlement référentiel. C’est une proposition qui associe humour, talent, savoir-faire et intelligence, entre théâtre, chanson, mémoires, hommage et truc-spécifique-à-Ariane-Dubillard.
En fait, c’est un peu comme un clavier au moment de composer le prochain Goncourt. On se dit que vingt-six lettres, c’est au moins une douzaine de trop, et puis on s’y fait au point de ne s’en pouvoir passer. L’actrice, l’auteur et la chanteuse vont sans doute encore densifier ce riche spectacle dont quelque fan de l’éternité façon Allen pourrait dire que, même si on accroche de bout en bout, passé le flash forward, il peut sembler, en l’état, peut-être un peu long, surtout sur la fin qui ne répond pas vraiment à l’accroche liminaire. Toutefois, dès la première (pour laquelle, précisons à l’intention de nos lecteurs, nous avons payé notre place), il semblait déjà tellement précieux que l’on le peut recommander, pour ce que vaut ou vache ce genre de louange, avec enthousiasme et, comme écrivait Roland D., « plus facilement qu’une migraine et sans aspirine – comme l’existence » mais en mieux.
Pour réserver, c’est ici.
Alexandra Didenko chante Moussorgsky et Wagner, Centre Chostakovitch, 27 mai 2019
Ceci n’est pas un récital. Ou alors, juste par la bande. Bien plutôt, ceci est une audition de fin d’année – disons la mise en examen versaillaise d’une artiste ukrainienne désormais sise en France. Ce soir de mai, la miss, transcrite tantôt Oleksandra, tantôt Olexandra, dans la bio d’un programme mal traduit en français, passe son épreuve de fin de master dans les locaux chic de l’Association internationale Dimitri Chostacovitch. Comme il sied, ce qui ne rend pas le geste moins appréciable, les siens ont souscrit à la tradition associant bulles et dernier diplôme – même si, au début de son récital mastoc, accompagné par le pianiste-chef-orchestrateur-compositeur David Jackson, on imagine que la future diva n’avait pas le cœur à la légèreté festoyante.
Le programme s’ouvre sur les « Chants et danses de la mort » composés, sur des poèmes fougueux mais peu poétiques d’Arséni Golénichtev-Koutouzov – comte de son état, ce qui est un argument justifiant la prétention, de poésie mais pas que – par Modeste Moussorgsky, ce qui résonne en ce lieu puisque Dmitri a orchestré le cycle bien avant que l’excellent Kalevi Aho ne s’y re-risque. On regrette la présentation aussi profuse que confuse d’une prof munie d’une liasse de papiers assortis de griffonnages ésotériques, d’un accent exotique et d’un propos souvent verbeux, du genre :
- « Moussorgsky et Wagner sont in-mélangeables, mais ils ont un tronc commun », bon sang, tronc commun, ça passe à la fac, pas quand on ne se peut mêler ;
- « Vous, auditeurs, allez partir où vous n’êtes pas encore jamais allé », c’est mignon mais assez dispensable, etc. (on passe les histoires de numérologie aussi vagues que peu utiles dans ce contexte).
On aurait préféré une présentation plus dense de l’artiste, et plus signifiante des textes qu’elle s’apprête à chanter : comme insupporte cette pédanterie associée à la tentation de jouer les présentateurs médiocres sur l’air du « Qui a déjà entendu du Wagner ? », boudu, t’es dans le sixième arrondissement de Paris, chez des passionnés de Chosta, te prends pas pour Jacques Martin, mârde ! Pis si personne avait dit : « Moi, moi ! », t’aurais fait quoi ? une petite danse de la joie ? une crise de chaudes larmes ?
Quand les artistes sont enfin autorisés à prendre possession de l’espèce d’espace scénique, la difficulté du défi saute aux oreilles. Passer une audition « finale » de chant dans une salle sans résonance, il faut oser. Avec sa coiffure de folle façon Cassandre de Kaamelott!, son maquillage créatif et son costume résolument engagé (même si le projet jacksonnien de black and white, vanté par la prof débordante de paroles, nous échappe à mégadonc), sans un mot, la candidate énonce sa promesse : incarner ce qu’elle exprime vocalement. Dès les premières mesures, animées par un accompagnement sobre, elle marque une appétence pour l’intégrité dans l’excès que l’on tendrait à caractériser comme slave. Pour rendre crédible et vivant son projet, Alexandra Didenko s’appuie sur un grave profond et un aigu qui ne lui pose point souci. Après que la mère a « insufflé le sommeil de la paix » pour accompagner la mort de son enfant, la mort en personne drague une nénette pour qu’elle se suicide.
Malgré un vibrato qui peut sembler parfois un peu présent, l’artiste démontre une aisance certaine et dans les différents registres, et dans les différents « passages » auxquels doit se frotter une mezzo. L’impression d’une certaine authenticité, disons : spontanéité, sourd d’un souci, sans doute, de ne pas esthétiser le médium, par opposition aux extrêmes de la tessiture, pour mieux rendre le dramatisme de la pièce, que valorise le travail de synchronisation avec David Jackson.
Après avoir niqué un bébé et une donzelle, la mort, boulimique, attire à elle un paysan bourré en lui faisant confondre une tempête de neige et des champs de blé où, l’été, dansent les faucilles. Pour éradiquer le risque de monotonie ou de convention, Alexandra Didenko privilégie l’incarnation, quitte à se mettre en risque – ce qui, pour un récital de fin de cycle, est appréciable. On note avec joie la volonté de rendre les différentes atmosphères – de l’air populaire aux moments dramatiques – grâce aussi au soutien d’un pianiste en percussion et impressionnisme (généreuse pédale !), avant que la mort ne s’intéresse aux charniers martiaux avec un projet, que nous traduisons en substance : « La bataille est finie ! Je vous ai tous en mon pouvoir ! » Le pianiste, fortement sollicité, suit la mezzo dans ses désirs de virulence et de contraste qui donnent sens à la narrativité du texte – ce qui, détail qui n’en est pas un oblige, ne nous empêche pas de nous étonner que l’instrumentiste joue l’ensemble de son programme sur des photocopies.
Deuxième gros patouillis au programme, les Wesendonck lieder, autrement dit les mélodies écrites par Richard Wagner l’amoureux à partir des poèmes de celle qu’il rêvait de, soyons poète, faire sienne, madame Mathilde Wesendonck. Le premier épisode, rend hommage à l’ange qui est « descendu vers moi ». Ici, l’on croit deviner une artiste peut-être trop désireuse d’augmenter sa résonance dans la partie nasale du masque, ce qui, par moments, grignote un peu de sa musicalité. Le deuxième épisode demande, en toute modestie, à la « création éternelle » de ne plus bouger afin que l’auteur puisse kiffer la joie de « l’âme qui, toute, se noie dans une autre ». Bref, c’est caliente, donc l’occasion pour David Jackson de secouer ses saucisses. La chanteuse s’échine à rendre les dynamiques qui font vibrer la partition jusqu’à la partie apaisée. À cette occasion, on constate qu’Alexandra Didenko ne craint jamais d’en faire trop, et cela se comprend :
- d’une part, elle parle à l’univers, pas avec Joe le clodo – ça rigole pas, faut s’engager ;
- d’autre part, comment exprimer la passion autrement qu’avec passion ?
Le troisième épisode, tapi « Im Treibhaus » (« Dans la serre »), professe que les « pauvres plantes » qui chougnent sont comme la narratrice : « Nous avons beau vivre dans la lumière et l’éclat, notre foyer n’est pas ici. » Raspingue, Richard réutilise un tube du Ring (il vient d’en finir avec la Walkyrie), tandis que la candidate revendique sans fard son refus d’une performance strictement technique. Connecté avec Tristan und Isolde, le quatrième épisode évoque les « Schmerzen » (« Douleurs »), et ce n’est peut-être pas un hasard si, pour la première fois, la virtuose s’accorde alors un trait d’humanité en se raclant la gorge avant le début de son nouveau lied. En dépit d’un piano peut-être un brin puissant pour la salle, Alexandra Didenko parvient à nouer avec lui de beaux effets de dialogue pour se réjouir que « la douleur seule apporte la joie », ce qui paraît complètement stupide, d’autant que ce n’est pas parce que l’on n’est pas poète que l’on va se priver d’exprimer notre sentiment devant un texte de babache.
Le cinquième épisode mathildien se love dans un climat apaisé. Les « Träume » (« Rêves ») ressortissent derechef d’un projet tristanique, baguenaudant autour d’une âme qui sent captive sans, toutefois, « s’évanouir comme écume marine dans un néant désolé ». L’impétrante y démontre trois qualités complémentaires de son engagement interprétatif fuyant la neutralité comme Patrick Balkany les journalistes :
- maîtrise des tenues donc du souffle ;
- sens du crescendo, et
- technique remarquable du chant piano.
Ajoutons une cinquième qualité : l’art de recevoir les applaudissements, atout non négligeable. Cette qualité trouve à s’exprimer après « Desdemone », la relativement brève mélodie de Dimitri Chostakovitch dont la pontifiante présentatrice nous promet être la première mondiale. Sur une mélodie presque accrocheuse, l’Ukrainienne fait valoir la puissance de son organe, comme si revenir au russe l’aidait à se libérer d’une partie des précautions dont on a cru l’entendre s’encombrer, par modestie, lors des lieder précédents.
En réalité, l’inédit de Chosta introduit une troisième partie de l’examen, centré sur les pièces de bravoure et les grands airs. Lors de son nouvel interlude, la parleuse semble se lasser de son propre verbe, expliquant par exemple que, grâce à ses longues phrases, ses difficultés d’attaque et de prononciation, l’air de Marfa dans La Khovantchina est un « cheval d’arçon » (de bataille ?), typique des héroïnes comme Erfa (mélange de Marfa et d’Erda). En dépit de l’exigence présentée par son nouveau défi, la chanteuse fait apprécier d’autres qualités que sa résistance, illustration d’une technique solidement acquise, telles que :
- la volonté d’entrer de suite dans l’air, sans adaptation, comme si elle était déjà plongée dans l’opéra ;
- l’envie d’exprimer son énergie, quitte à privilégier la virulence sur la tonicité ;
- la préoccupation musicale, qu’illustre un beau travail de synchronisation, forcément réciproque, avec David Jackson.
L’air d’Erda extrait de L’Or du Rhin, annonce l’inéluctabilité, sinon la proximité, du crépuscule des dieux. Comme pour l’illustrer, la voix se prend dans la résonance du piano approfondie par la pédale de sustain. Le pianiste fait de son mieux pour rendre la profondeur de l’orchestre. Aux Erda gravissimes que l’on entend parfois, façon Qiu Lin Zhang, Alexandra Didenko oppose une déesse plus humaine. Sa vision de la maîtresse – enfin, d’une des maîtresses – de Wotan est moins ténébreuse que lyrique. De la sorte, l’artiste semble proférer moins une condamnation que le récit, inéluctable, d’une destruction d’ores et déjà actée, gravant sa personnalité d’interprète au terme d’une set-list où l’ambition le dispute à la gourmandise.
En conclusion, au terme d’un programme impressionnant, exécuté de bout en bout avec foi, exigence et maîtrise, on aurait beau jeu de noter çà plus de volonté que d’assurance, là un bout de rôle qui méritera encore d’être mûri, ou sporadiquement telles caractéristiques qui seront affaire de goût (résonance, intensité perpétuelle, spécificités du vibrato…). L’ensemble n’en témoigne pas moins d’un métier déjà charpenté que, à l’issue du spectacle, ses gentilles attentions à l’égard des spectateurs venus l’applaudir ne démentent pas. Que les hiboux de la bonne fortune continuent donc d’accompagner Alexandra à travers les terres mystérieuses de l’art lyrique !
J-7
À 7 jours de l’enregistrement des 44 chansons constituant le premier quadruple album du sieur Bertrand Ferrier, check complet avec Réjean, l’ingé son et coach vocal. On a fait des chikiti et des sss sss ; on a débattu pour savoir si une chanson à 12/8 ressortissait d’un shuffle ternaire ou d’un quatre temps ; on a branché des jacks, débranché des jacks, rebranché des jacks, constaté que ça ne marchait pas puis que ça marchait, ce qui est mieux que l’inverse ; et on a même déniché un piano à queue qui, contrairement à mémé, n’avait pas été totalement poussé dans les orties.
Du coup, on a trouvé que l’on avait bien bossé pour la journée et que l’enregistrement s’annonçait pour le mieux. Au fait, vous avez jusqu’au 2 juin pour le soutenir. Compter sur votre soutien serait un plus positif, que vous pouvez manifester en versant quelques menus ou pas menus sesterces ici. Du coup, certains que vous verserez quelque obole dans notre cybersébile, nous vous souhaitons une journée pleine de bitounious qui font gling et de taraillettes qui s’illuminent.
Soupçons

Comme quoi que j’aurais croisé un p’tit dalmatien de cinq mois avec qui j’aurais joué, et qu’il aurait laissé un indice sur mes vêtements ? Coïncidence, monsieur le préposé à la maréchaussée. L’ADN de poussière n’est pas la reine des preuves. J’ai, simplement, décidé de dessiner une empreinte de patte de chiot sur mon jean. Parce que nous sons libres, mon chéri. (T’y crois ou pas que M. Chien veut passer mon fute au BlueStar aux fins de me coller en GAV pour attouchements sur mineur de moins de six mois ?)
J’aime mieux me chanter tout seul ma petite chanson dégagée

Antipissons sur le résultat des élections, et ressortons la chanson du 25 mai 2014.
Organisez, rrrorganisez, qu’ils disaient…

Le 28 juin 2019, dans le cadre d’une manifestation nationale intitulée la « Nuit des églises », la paroisse Saint-Martin de Montmorency ouvre la collégiale pendant 12 heures afin que chacun, indépendamment de sa foi, puisse y vivre une expérience inédite et « à la carte ». En effet, il sera possible de participer (gratuitement) à l’ensemble des manifestations ou de ne se faufiler dans la collégiale que le temps d’une petite visite ! De 18 h 30 à 6 h 30, messe solennelle, repas festif, et surtout visite aux flambeaux, récitals originaux, derviche tourneur, exposition de calligraphies et lectures mises en musique – entre autres – rythmeront cet événement culturel sis dans un magnifique monument cultuel. Au programme…
- 18 h 30 : grand-messe avec deux orgues, trompette et chœur
- 19 h 30 : repas sur le parvis
- 20 h 30 : visite contée aux flambeaux
- 21 h 30 : récital orgues et hautbois
- 22 h 30 : chants soufis et derviche tourneur
- Minuit : « L’heure de l’extase » pour récitants et deux orgues
- 1 h 30 : lectures de l’Apocalypse
- 3 h 30 : pop louange
- 5 h : grandes orgues et cinéma
- 6 h : laudes
- 6 h 30 : p’tit-déj’ des survivants















