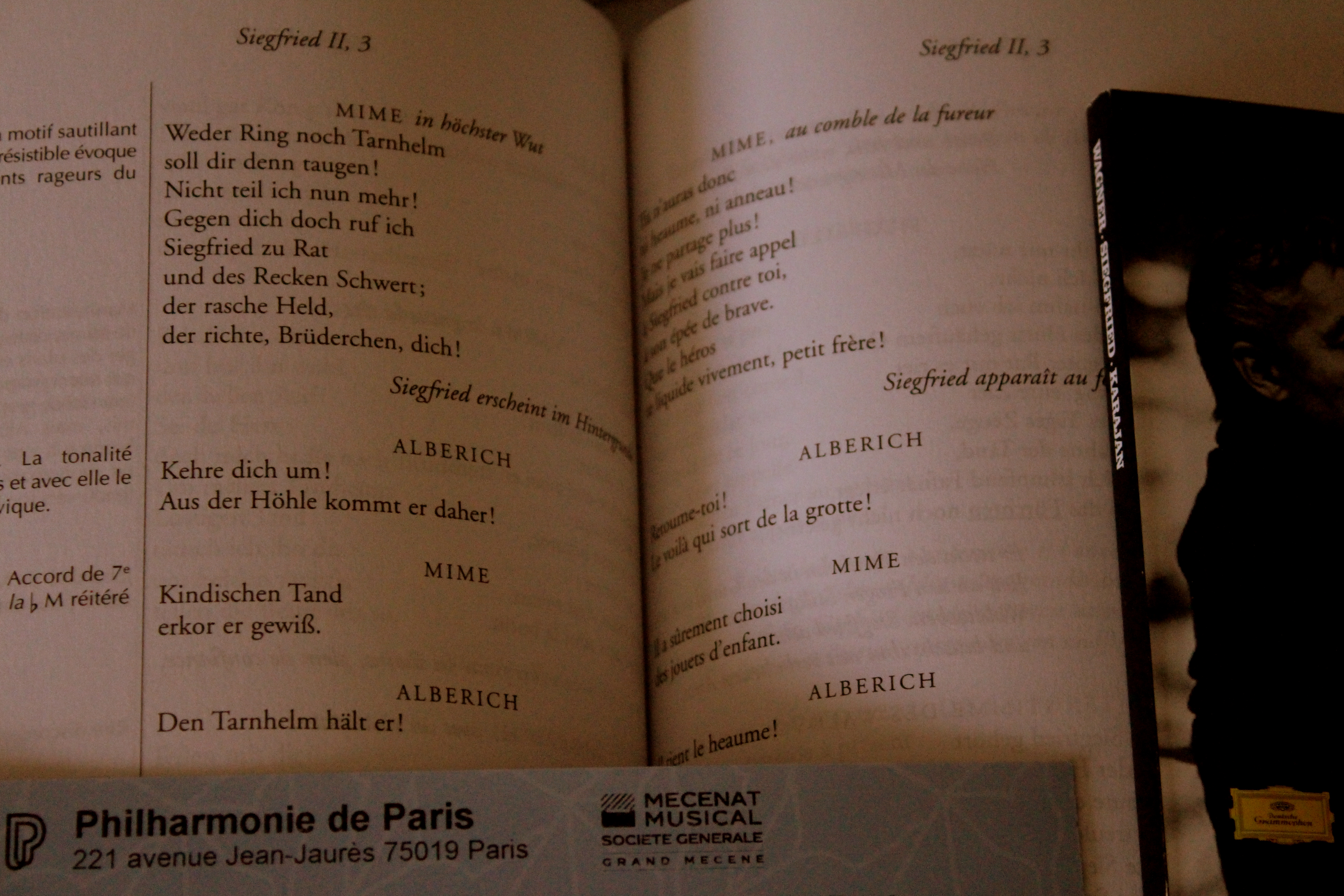Le Crépuscule des dieux, Philharmonie de Paris, 23 septembre 2018
On va pas se mentir, après le Siegfried de la veille, c’est le grand moment que tout wagnérophile attend. Le moment qui suscite une jubilation inquiète dépassant même le plaisir d’aller applaudir un « compositeur antisémite » dans ses œuvres, ce qui, espère-t-on, fait suer en abondance les bien-pensants luttant, moyennant bénéfices, Légion d’Honneur et reconnaissance éternelle pour courage admirable, 85 ans plus tard, contre les pires heures nauséabondes les plus sombres de notre Histoire, ce qui n’est pourtant pas peu. Ce 23 septembre est donc le jour, attendu depuis le 23 mars – et, plus largement, la réservation du billet pour L’Or du Rhin – du Crépuscule des dieux, aka par les snobs à permanentes pluzoumwin violettes croisées la v(i)eille à la sortie comme le Gueutedamrounegue. À peine plus long que Siegfried, cet aboutissement de la tétralogie du Ring claque comme un Everest pour les chanteurs, l’orchestre et les spectateurs incontinents (le premier acte dure deux heures cinq), au point que la Philharmonie promet un bouclage en 4 h 45 – il faudra, entractes compris, 45’ de plus. Subséquemment, voici venue, alléluia, l’occasion de présenter quelques remarques sur la réalité d’un concert à la Philharmonie.

La grande salle de la Philharmonie vue par Rozenn Douerin à la demande d’un passionné des « plans de coupe ».
D’abord, un constat : il y a beaucoup plus de chiottes au parterre qu’en haut ; il est vrai que les décideurs vont rarement dans les étages. Après la couleur diarrhée foireuse choisie pour souiller cette salle, cette discrimination de la vessie à l’aune du portefeuille est une honte de plus à mettre au crédit des nouvélophiles. Ensuite, puisque l’on aborde le sujet, un dégoût : combien d’années de réseautage pour fourguer un jingle au son de chasse d’eau au moment d’ouvrir les représentations ? On imagine la réunion des « designers sonores », mais l’évoquer m’eût obligé à croquer des scènes en des termes que rigoureusement ma mère m’a défendu d’citer ici. Enfin, un amusement : suite, suppose-t-on, à la rumeur ouïe hier (« c’est pas comme à Vienne, ici, les chanteurs sont sonorisés »), la Philharmonie fait préciser pour le quatrième tome que « le concert sera enregistré », donc que, si y a des micros, c’est pas pour que Carla Bruni ou Zaz puisse chanter Brünnhilde, ou pour compenser une Monnaie provisoire, pauvres connes de tout sexe.
Bien.
Et maintenant, laissons la musique grouver.
- Valery Gergiev après l’acte I. Photo : Rozenn Douerin.
- Valery Gergiev après l’acte I. Photo : Rozenn Douerin.
L’histoire
Voir ici.
- Vie d’orchestre, tout est dans le regard, 1.
- Vie d’orchestre, tout est dans le regard, 2.
Le concert
Reconnaissons-le d’emblée : pour le grand jour, l’orchestre du Mariinsky ne paraît pas tout à fait sous son meilleur (grand) jour. Certes, on écoute une phalange rouée, rodée et pas érodée ; mais de nombreuses scories sont là pour nous rappeler que le concert est une prise de risque permanente, surtout sur une telle durée : dérapages redoutés et advenus du premier cor solo, fourchage du clarinettiste solo jusque-là impeccable comme son collègue si important à la clarinette basse (principe de l’auditeur : on retient les fausses notes, presque jamais les bonnes), départs moins synchrones que la veille – des signes d’humanité dans un océan de beautés sonores, peut-être aidés par une direction d’un chef plus précis sur ses gestes vers les chanteurs qu’en direction de ses serviteurs instrumentaux.

Mikhail Vekua (Siegfried) et Olga Volkova. Photo : Bertrand Ferrier.
Le plateau vocal est impressionnant, chœur puissamment fonctionnel compris, quoique peut-être plus sujet à subjectivité que la veille. Mikhail Vekua chante Siegfried après avoir chanté l’opéra-titre la veille. Par prudence, subodore-t-on, il fait annoncer qu’il « relève de maladie ». Sans doute a-t-on donc mal ouï lors de l’épisode précédent, qui nous avait époustouflé techniquement. Aussi nous tournons-nous vers notre voisine avec un sourire entendu – un sourire de connard, donc, que nous maîtrisons, c’est curieux, super bien : évidemment, on ne peut pas chanter deux trucs aussi énormes en vingt-quatre heures. Alas, we should have known better : Violeta Urmana nous avait fait le coup à Bastille. L’homme-phare sera constant, impeccable, franc devant les difficultés, maître de son souffle, faraud devant les aigus, tonique dans ses dialogues. S’il peine à nous émouvoir ou, plutôt, si nous peinons à être ému par son incarnation, il serait insultant de n’insister que sur sa performance technique : son souci musical est patent, comme en témoigne une ligne vocale qui ne se dérobe jamais devant les nuances, donc les redoutables piani. Ce ténor est super fort sa mère, par Zeus.
- Tatian Pavloskaya (Brünnhilde). Photo : Bertrand Ferrier.
- Tatian Pavloskaya (Brünnhilde). Photo : Rozenn Douerin.
Tatiana Pavlovskaya est Brünnhilde avec constance et mérite. Constance : la voix est au niveau du rôle, sans dureté dans les extrêmes de la tessiture et avec un très joli médium. L’artiste n’en fait jamais des caisses, ni vocalement, ni scéniquement – pas de tenue extravagante, pas de surjeu immobile. Elle chante avec talent, sans tenter de feindre un charisme sexy ou tellurique que ni sa personnalité, ni son don, ni son travail, ni son savoir-faire ne lui donneraient. C’est sans doute rédhibitoire pour nous faire frissonner pendant toutes ses interventions, mais cela reste une performance mélodieuse devant laquelle il convient de s’incliner. Car à la constance s’ajoute le mérite : sa dernière tirade, qui conclut la tétralogie, est extraordinaire. Pendant un quart d’heure, la cantatrice oublie sa retenue et fait vibrer la salle. Certes, elle est obligée de demander au « coursier » Grane d’aller se faire cramer avec elle, mais elle touche lors de son stupide sacrifice à quelque chose qu’elle avait simplement effleurée jusqu’à ce moment. Ça larmoie autour de nous, avec justice : Tatiana Pavlovskaya est plus qu’une solide Brünnhilde.
Alors que les filles du Rhin chantent leurs rôles plutôt correctement – peut-être Irina Vasilieva en Wellgunde nous séduit-elle moins qu’Ekaterina Sergeeva en Flosshilde ou Zhanna Dombrovskaya en Woglinde –, aucun personnage secondaire n’est desservi par son interprète. Olga Savova grave son personnage dans les impressionnantes profondeurs de la fille de dieu plus soucieuse de son destin que de sa race, ce qui est plutôt honnête de la part de Waltraute. Fort de sa voix sûre et de son aisance scénique, Roman Burdenko est un Alberich bête, méchant et impuissant comme il sied. Elena Stikhina, Brünnhilde brillante le vendredi, rayonne dans sa robe beaucoup plus échancrée que la veille : voilà une Gutrune qui, timbre assuré et sensibilité loin des mièvres sensibleries, exprime à la fois l’envie de mâle et la mâle envie de mener sa vie en assumant les hauts comme les bas. Evgeny Nikitin est le Gunther parfait, celui qui ronchonchonne et fait la gueule – mais on aimerait bougonner comme lui ! Et, cerise sur ce majestueux gâteau, Mikhail Petrenko est le Hagen puissant qu’il faut pour tenter de tout manigancer… en vain.
- Avant l’acte III. Photo : Bertrand Ferrier.
- Avant l’acte III, 2. Photo : Bertrand Ferrier.
- Mikhail Vekua (Siegfried). Photo : Bertrand Ferrier.
- Le regard de la prima donna Tatiana Pavlovskaya (Brünnhilde). Photo : Bertrand Ferrier.
- Roman Burdenko (Alberich) et Evgeny Nikitin (Gunther) presque souriant. Photo : Bertrand Ferrier.
- Evgeny Nikitine (Gunther). Photo : Bertrand Ferrier.
- Mikhail Petrenko (Hagen). Photo : Bertrand Ferrier.
- Elena Stikhina (Gutrune). Photo : Bertrand Ferrier.
- Les Nornes Zhanna Dombrovwkaya (Woglinde), Irina Vasilieva (Woglinde) et Ekaterina Sergeeva (Flosshilde). Photo : Bertrand Ferrier.
- La solitude de Valery Gergiev. Photo : Bertrand Ferrier.
La conclusion
Peut-être n’est-ce pas la version la plus aboutie que nous ayons ouïe ; mais, comme version scénique 100 % russe, ce Ring de la troupe à Valery Gergiev se pose là dans la hiérarchie du savoir-faire, de la juste distribution et des grands chanteurs méconnus. Sans être souvent tellurique, cette interprétation de la tétralogie séduit grâce au métier de l’orchestre et à la richesse du réservoir vocal de l’ex-empire soviétique. C’est déjà fort fieffé, malepeste.
Siegfried, Philharmonie de Paris, 22 septembre 2018
Re-driiing ! Ce samedi 22 septembre, nous étions au lancement des deux derniers épisodes de la tétralogie du Ring wagnérien. Le samedi, quatre heures de musique sont annoncées, entrecoupées de deux entractes. C’est le Mariinsky qui vient boucler l’affaire commencée tantôt avec son grand manitou, et laissée en plan après une célèbre chevauchée. Le prix, cossu pour une version de concert sans brochette de vedettes, a-t-il contribué à laisser çà et là de nombreuses places vides ? Qu’importe puisque cela nous permettra de tester différentes configurations et de vérifier, une fois de plus, l’inégalité de l’acoustique (au premier balcon, préférer être vers le fond, face jardin).
L’histoire
Voir ici.
Le concert
La prestation du soir souffre d’un défaut évident, du moins pour le critique – que trouver à redire ?
L’orchestre de Valery Gergiev est sérieux à défaut d’être survitaminé, ce qu’il est rarement sous la direction de la star gergiévique ; et, en dépit de l’absence des vedettes wagnériennes du moment (le cantateur tatoué excepté), le plateau vocal est d’un niveau stupéfiant. Ce soir, Mikhail Vekua affronte la première partie de son Everest : non seulement le Siegfried de Siegfried, mais re-Siegfried le lendemain. Deux rôles à la double exigence technique et quantitative, ce qui peut être désigné sous le syntagme musicologique de « truc de ouf », même si, logiquement, Siegfried devrait périr en cours de route, et non en roue de croûte – cela ne voudrait rien dire. Le ténor, crâne rasé comme presque tous ses confrères, est impressionnant. Certes, il n’a pas le charisme de notre référence, Torsten Kerl, euphémisme ; mais il chante avec aisance, esprit et décontraction ; il a l’air heureux que tout se passe bien pour lui et ses confrères ; et, s’il est encore un brin contraint par la partition, conformément à ce qu’autorisent les versions de concert, il a les aigus, le souffle et la résistance requis. Puissant.
Pourtant, à notre applaudimètre, il est devancé par Andrei Popov. Le sournois Mime touche davantage que le héros-titre grâce aux circonstances : il semble malade, mouchant et s’asseyant dès que possible, picolant tant qu’il crée des jeux de scène pour chouraver des bouteilles à ses partenaires, inquiétant à ce point que Siegfried se décale d’un pupitre afin d’éviter ses miasmes. Or, sa fragilité n’est que visuelle : contrairement à Evgeny Nikitin en mars, il est parfait de bout en bout. Il rend excellemment les trois principaux registres de son personnage (discours intérieur furibond, discours extérieur sournois, autocitations nasales) ; il a les aigus et la maîtrise de l’incarnation requises ; et, si l’on compatit à la souffrance physique du mec – on sent qu’il va au-delà du bout de lui-même –, on salue surtout la technique, l’assurance et la maîtrise du chanteur. Comme dirait un philosophe indochinois, putain de respect, mec, et bravo en sus.
- Evgeny Nikitin (Der Wanderer) vs Roman Burdenko (Alberich), épisode 1. Photo : Bertrand Ferrier.
- Evgeny Nikitin (Der Wanderer) vs Roman Burdenko (Alberich), épisode 2. Photo : Bertrand Ferrier.
- Evgeny Nikitin (Der Wanderer) vs Roman Burdenko (Alberich), épisode 3. Photo : Bertrand Ferrier.
- Evgeny Nikitin (Der Wanderer) vs Roman Burdenko (Alberich), épisode 4 : Andrei Popov (Mime) est mandaté pour demander à Roman d’arrêter de se la ouèj. Photo : Bertrand Ferrier.
Le Wanderer du susnommé Evgeny Nikitin est excellent : profond, maîtrisé, précis, sans esbroufe. Roman Burdenko (Alberich) rend avec talent le bouillonnement double qui l’anime, entre haine intérieure et fureur extérieure de voir, sans vouloir y croire tout à fait, que les autres sont plus malins et plus forts que lui. On a hâte de le réentendre le lendemain… Mikhail Petrenko, acclamé ici en 2013, est impeccable : sa voix monstrueuse et néanmoins musicale est idéalement adaptée au dragon Fafner. Les filles sont à l’avenant. L’oiseau d’Anna Denisova est éblouissant de lumière… sans le recours au miroir ridicule qui escagassait à juste titre dans la version Bastille. L’Erda de Zlata Bulycheva est parfaite : graves de circonstance, aigus sans reproche, sérieux indéridable qui donne l’impression que le rôle et la personnalité s’accordent. Quant à la Brünnhilde d’Elena Stikhina , prévue en Gutrune le lendemain, son rôle est, proportionnellement, court, mais il suffit pour mettre en émoi la Philharmonie. Projections, notes extrêmes, intention, osons encore un terme technique : wow.
- Mikhail Petrenko (Fafner). Photo : Rozenn Douerin.
- Zlata Bulycheva (Erda), Evgeny Nikitin (Der Wanderer surpris) et Anna Denisova (Waldvogel). Photo : Rozenn Douerin.
La conclusion
Une interprétation instrumentalement sûre et vocalement solide ; en prime, une idée pour l’Opéra faussement dit « national » de Paris à travers un modèle de plateau national porté par un orchestre national – quoi d’autre ? D’ici que les poules se dentifient, une idée : vivement que les dieux crépusculent.
Jean Guillou, « Œuvres pour orgue », Augure
 Le label Augure, consacré à l’édition d’un hénaurme best of Jean Guillou encore en construction, structure son catalogue autour de deux pôles. D’une part, la mise sur le marché des « grands récitals » de l’idole ; d’autre part, plus ponctuellement, l’enregistrement par le maître de telle ou telle composition. Le disque d’Œuvres pour orgues, enregistré par Jean Guillou en 2013, s’inscrit dans cette logique, inaugurée par Cantiliana en 2012 et qui fera l’objet d’une prochaine recension. Avantage des disques d’orgue, cette gravure est, en prime, l’occasion, pour ceux qui ont notamment loupé les trois disques Philips gravés autour de l’inauguration, de découvrir un instrument singulier, celui de la salle Scarlatti du conservatoire de Naples, une pièce Tamburini construite d’après les plans dudit Guillou et finalisée par Zanin, une bête de 4 claviers dont l’achèvement semble avoir été aussi complexe que son potentiel se révèle intéressant. L’accord est parfait ; et la prise de son de Gianni Ruggiero, assisté de Mauro Santinello avant le mixage de Jean-Claude Bénézech, est très appréciable. Voici donc une joyeuse occasion d’entendre des pièces iconiques (Suite pour Rameau) ou quasi contemporaines de l’enregistrement sous les doigts et semelles du maestro. C’est pourquoi, dans les lignes qui suivent, nous retracerons quelques souvenirs du voyage fait en leur compagnie et personnalisable à votre guise si vous souhaitez, à votre tour, accomplir un périple via, par exemple, cette agence de voyage qui vend le ticket à 10 €.
Le label Augure, consacré à l’édition d’un hénaurme best of Jean Guillou encore en construction, structure son catalogue autour de deux pôles. D’une part, la mise sur le marché des « grands récitals » de l’idole ; d’autre part, plus ponctuellement, l’enregistrement par le maître de telle ou telle composition. Le disque d’Œuvres pour orgues, enregistré par Jean Guillou en 2013, s’inscrit dans cette logique, inaugurée par Cantiliana en 2012 et qui fera l’objet d’une prochaine recension. Avantage des disques d’orgue, cette gravure est, en prime, l’occasion, pour ceux qui ont notamment loupé les trois disques Philips gravés autour de l’inauguration, de découvrir un instrument singulier, celui de la salle Scarlatti du conservatoire de Naples, une pièce Tamburini construite d’après les plans dudit Guillou et finalisée par Zanin, une bête de 4 claviers dont l’achèvement semble avoir été aussi complexe que son potentiel se révèle intéressant. L’accord est parfait ; et la prise de son de Gianni Ruggiero, assisté de Mauro Santinello avant le mixage de Jean-Claude Bénézech, est très appréciable. Voici donc une joyeuse occasion d’entendre des pièces iconiques (Suite pour Rameau) ou quasi contemporaines de l’enregistrement sous les doigts et semelles du maestro. C’est pourquoi, dans les lignes qui suivent, nous retracerons quelques souvenirs du voyage fait en leur compagnie et personnalisable à votre guise si vous souhaitez, à votre tour, accomplir un périple via, par exemple, cette agence de voyage qui vend le ticket à 10 €.
Regard (2010, 17’), seule composition d’un seul tenant ici gravée, s’ouvre sur un duo que perturbe l’arrivée d’un plein jeu puis d’une colère de fonds. L’éclatement du discours fait se percuter des accords en colère, ponctués par le retour du duo, dont la registration change sans cesse, contrastant avec la rudesse des accords graves et furieux. La notion de duo, volontiers tremblante, se double ainsi d’un discours, eh bien, je dirais : double, associant des envolées propulsées d’abord sur trois notes, ainsi que des grognements tentant de ramener les interrogations à la raison. « Gardez vos yeux dans vos poches cernées, les enfants ! » semble pester la norme, tandis que la pulsion vitale de curiosité s’y refuse. Cette tension avive la curiosité de l’auditeur : sans souci de le brosse-à-reluirer grâce à des mélodies charmeuses, le compositeur exploite un orgue fort riche pour qui sait le registrer afin de raconter une histoire. Jamais grisé par la puissance décibélistique, si si, toujours soucieux de contrastes, l’interprète offre au compositeur une tribune élégante pour un discours dont la fin en fade out est un dernier pied-de-nez aux habitudes tuttistes qui démangent parfois les organistes au moment de la péroraison. Au long de ce Regard, l’écriture est à la fois inventive (c’est varié), construite (la récurrence de structures reconnaissables, même quand elles se mélangent, crée l’unité diégétique nécessaire pour soutenir l’écoute pendant un gros quart d’heure) et pertinente pour un gros machin comme l’est un grand orgue. En conséquence, l’écoute ne souffre pas du divertissement : simplement entendu, Regard est ridicule, atomisé, in-signifiant ; écoutée, la pièce devient très intéressante à défaut de séduire tout auditeur – en somme, comme un regard qui, anodin, glisse sur les choses alors que, appuyé, il gagne parfois en profondeur et toujours en signification.
Enfantines (2012, 16’), composée de six segments, s’ouvre sur une pièce faisant écho à Regard : un discours liminaire, sautillant, est opposé à une colère d’abord grave puis déchaînée. La deuxième pièce interroge davantage, sur deux claviers, la capacité d’imaginaire tapie dans le souffle flûté de l’orgue. On retrouve le détaché caractéristique du musicien au début de la troisième pièce, qui semble chercher sa route entre ligne tressautante appelée à réapparaître, grognements des graves et tenues tremblantes d’où émerge sporadiquement un cornet ou le commentaire ternaire de la bombarde. La quatrième pièce, plus courte, paraît prolonger la précédente, avec ses tenues tremblantes, accompagnées de trilles, et ses ponctuations rares à la pédale. C’est aussi le cas de la miniature qui lui succède, comme si le compositeur proposait davantage une esthétique unie qu’une variété plaisante – la fin en petit tutti en sus. La dernière pièce ressasse un motif descendant, à la logique déjà exploitée, et des accords irréguliers. Tout se passe comme si elle tentait de synthétiser les éléments du discours utilisés jusqu’à présent : dégringolades, accords brefs dans le grave, tenues tremblées, usage des anches et notamment de la trompette, pour permettre d’identifier un leitmotiv à l’aide de récurrences qui se consument dans une fin en tutti. (À noter que le compositeur propose une description de son œuvre sensiblement différente à celle que vous venez de parcourir, comme quoi, c’est bien aussi de lire ce que celui-qui-sait en dit.)
Suite pour Rameau (1979, 20’), commande dijonnaise, articule une suite de neuf miniatures inspirées par des titres du susnommé Jean-Phil’. On mentirait en prétendant avoir saisi partout en quoi elles ont quelque chose d’anacréontique, comme l’affirme pourtant le compositeur, si, par cette évocation du poète antique et de sa descendance artistique, l’on entend de façon schématique la présence d’une certaine tension érotique ; mais l’on veut bien subodorer, dans le choix des titres, une volonté de privilégier le sous-entendu, le behind the scenes, le mystère de l’Eros voire le plaisir de la recréation – toute œuvre n’est-elle pas manière de procréation ? – dont la danse, chérie par les amateurs de pensées impures, est un judicieux médium véhiculatoire. Dès lors, rien d’étonnant à ce que la première pièce soit un « rondeau », qui cherche sa v(o)ie entre des séries d’accords disjoints ou enchaînés. Une étrange arythmie secoue la pièce, réveillée paradoxalement par des séquences plus paisibles qu’encadrent des grondements furieux zébrés d’une noire énergie – mmm, je sais, « noire énergie », c’est bien pourri, mais je laisse quand même : s’autoénerver est parfois de salubrité intime. L’« air tendre pour la rose » est un duo balancé entre des fonds, accompagnant, et une sorte de cornet nasardisant que la fermeture de la boîte expressive éteint. « L’indiscrète », fragment le plus bref, est quasiment figuratif : on retrouve les accords répétés ou tenus et les voix graves qui tentent de contenir l’aigu farfouineur. La « gavotte » offre une danse de pantins, à la fois clairement balancée à quatre temps et sans cesse en déséquilibre.
Après que le ressassement et l’énergie ont souligné le caractère à la fois circulaire, donc enfermant, et joyeusement antinormé de la danse, « Le neveu de Rameau » parcourt à nouveau le clavier avec une voix aiguë rythmée à deux temps et sa réponse grave. Des motifs ascendants interrompent ce systématisme, puis se fondent dans le flux liminaire avant de déclencher l’ire de l’orgue et la conclusion sous forme de rush cacophonique. Les « tendres plaintes » jouent l’ambiguïté érotique par l’opposition entre la lourdeur des accords et les mélopées indécises que poussent les anches dans les aigus. Même registration, tiens donc, ô ironie, pour « L’ingénue » en duo composé, là encore, parfois ponctué par une pédale symbolisant, peut-être, soit le grondement du désir, soit le danger de l’ingénuité, l’un n’empêchant pas l’autre, yallah. Comme pour les « tendres plaintes », c’est à la voix ingénue qu’est dévolue la dernière phrase. « Diderot » surprend puisqu’elle se présente comme une pièce chiffrée de Rameau, ici incarnée dans la réalisation de l’interprète, toutefois revendiquée dans la note d’intention comme l’art de « mêler réalité et fiction créatrices ». Tout cela se finit par « La rebelle », une pièce associant traits et puissants accords, avec échos malicieux et « gouttes d’eau » à la main droite. L’usage sporadique de la bombarde fissure cette répartition de bon aloi. Il finit par déclencher des épisodes furieux, brisés par le retour du motif liminaire qui, autour du tourbillon de sa vélocité, cristallise deux accords conclusifs.
Dix Pièces furtives (1998, 15’) constituent la dernière composition au programme. Revendiquées comme « extrêmement simples », usant volontiers du tremblant comme pour souligner leur apparente modestie et leur filiation guillouistique, ces miniatures respectent, au long de leurs quatre-vingt-dix secondes en moyenne, une structure immuable : duo paisible (plages 17, 20, 22, 23), solo avec accompagnement (18), duo rythmique (19), duo progressant crescendo grâce à une mélodie à deux tons et une basse rythmique (21), duo à harmonisation répartie entre les deux mains (24), duel d’anches arbitré par la pédale et fini en plein jeu (25), et duo paisible qui, lui, finit par froncer les sourcils (26). L’ensemble forme un petit kaléidoscope d’une partie des goûts harmoniques et des formules d’écriture que le compositeur chérit.
 L’improvisation finale (5’) prouve, réprouve et reprouve ces penchants, tant elle semble, d’abord, prolonger la composition précédente. Du reste, c’est cette continuité différenciée qui séduit dans le disque : c’est à la fois toujours du Guillou et jamais exactement le même Guillou. La diversité dans l’unité, l’unité dans la diversité – le dialogue liminaire de la dernière plage les illustre. Puis les saucisses s’agitent. Des traits zèbrent le clavier, alternant avec la tentation de l’accord provisoirement reposant. L’arrivée du tremblant sur les anches dans le médium est combattu par la pulsation arythmique de la main gauche et de la pédale. La répétition des accords annonce une envolée vers les ondulants, une nouvelle fois brisée par les fumerolles des anches aiguës opposées au grondement de l’accompagnement ou au déchaînement de l’orgue. La pulsation de la pédale anime un crescendo ondulant que la puissance des pleins jeux magnifie. Surgit alors un decrescendo où le tremblant généralisé préfigure, malgré que les derniers éclairs de flûte en aient, l’aspiration vers le silence.
L’improvisation finale (5’) prouve, réprouve et reprouve ces penchants, tant elle semble, d’abord, prolonger la composition précédente. Du reste, c’est cette continuité différenciée qui séduit dans le disque : c’est à la fois toujours du Guillou et jamais exactement le même Guillou. La diversité dans l’unité, l’unité dans la diversité – le dialogue liminaire de la dernière plage les illustre. Puis les saucisses s’agitent. Des traits zèbrent le clavier, alternant avec la tentation de l’accord provisoirement reposant. L’arrivée du tremblant sur les anches dans le médium est combattu par la pulsation arythmique de la main gauche et de la pédale. La répétition des accords annonce une envolée vers les ondulants, une nouvelle fois brisée par les fumerolles des anches aiguës opposées au grondement de l’accompagnement ou au déchaînement de l’orgue. La pulsation de la pédale anime un crescendo ondulant que la puissance des pleins jeux magnifie. Surgit alors un decrescendo où le tremblant généralisé préfigure, malgré que les derniers éclairs de flûte en aient, l’aspiration vers le silence.
En conclusion, on est de nouveau séduit par l’engagement d’un label non seulement à proposer un large aperçu du travail de son champion, mais à le proposer dans d’excellentes conditions : choix éditoriaux convaincants, prise de son soignée et livret riche – trilingue, incluant la composition de l’orgue, introduction du label et témoignage du compositeur. Certes, pour montrer que nous avons lu le contenant presque autant qu’écouté le contenu, ou peut-être pour montrer que, bien que ce disque nous ait été offert, nous écrivons ce qu’il nous paraît pertinent d’écrire, no matter what, ô courage culturel quand tu nous tiens, bref, nous pourrions signaler quelques bizarreries d’ortho-typo-mise en page, du genre : Enfantines est décrit en troisième place alors qu’il s’agit de la deuxième pièce (l’argument du « c’était plus pratique pour la mise en page » serait, bien entendu inopérant) ; on salue « madame le directreur » avec smartphone et appareil photo, souvenir donc d’un ancien temps d’il y a cinq ans ; il est mentionné un « Grand Plein-Jeux » au GO ; et, sur le fond, on aurait aimé savoir, par exemple, comment le choix de ces pièces s’était effectué : proximité des compositions confrontées à une pièce plus ancienne, souci d’enregistrer des œuvres peu ou mal enregistrées jusqu’ici (dire qu’elles « couvrent quarante ans » alors qu’il y en a une des années 1970 et 3 de 1998 à 2012 n’est pas tout à fait convaincant), etc. Moralité : même content, l’auditeur n’est jamais content. Et pourtant, guilloutophile ou curieux sans tabou trouvera dans ce disque de qualité de quoi picorer à loisir : une longue pièce, des pièces unitaires mais fractionnées, et une impro. Une seule restriction – ne pas espérer que ce disque entonne une jolie musique de fond. Voilà une heure vingt à écouter vraiment ; faute de quoi, l’on préfèrera, je sais pas, moi, une intégrale des sonates de Telemann pour flûte à bec alto, viole de gambe, clavecin et une bonne tisane coupée à l’eau purifiée.
Tristan und Isolde, Opéra de Paris, 19 septembre 2018
Non, on ne retourne pas écouter Tristan und Isolde que pour voir des fesses, la bite du sosie de Michael Lonsdale, du nichon et de la chatte poilue, même si y en a – c’est la « vision » de l’opéra selon Peter Sellars et Bill Viola, et elle a, tout à fait fortuitement, ce double petit plus d’être hors sujet (quel génie !) et réemployable pour n’importe quel opéra. On y retourne pour l’orchestre et les voix, mais « on » ne doit pas être le seul à s’essssscagacer de cette arnaque puisque Bastille est loin d’être plein, ce 19 septembre, fait rare pour un Wagner parisien, et ce nonobstant fait explicable sans doute par l’inanité scénique des productions et choix de l’ère Lissner, heureusement presque sur la fin.
L’histoire : voir ici.
Le double scandale : d’une part, la pseudo « mise en scène », sans décor hormis un parallélépipède servant de lit et d’estrade, avec une vidéo ridicule et des pseudo-costumes de Martin Pakledinaz (t’as été payé combien pour ta petite virée dans une friperie, mec ?), est une honte que nous évoquâmes tantôt. D’autre part, il est insupportable que l’État continue de financer un opéra « national » où pas un artiste sur le plateau ne soit national – ni Philippe Jordan, ni Peter Sellars, ni Bill Viola, ni Martin Pakledinaz, ni James F. Ingalls (spécialiste des lumières carrées), ni Alex MacInnis (« live video editor », ha ha), ni José Luis Basso, ni, chez les solistes, Andreas Schager, ni René Pape, ni Martina Serafin, ni Matthias Goerne, ni Ekaterina Gubanova, ni Neal Cooper, ni Nicky Spence, ni Tomasz Kumięga. Fermer aux artistes hexagonaux une scène si chèrement payée par leurs compatriotes est une dégueulasserie presque sans nom dont il nous semble juste de continuer de nous offusquer, mârde.
La représentation : face à un opéra somptueux qui exige tant de tous les acteurs, il faut une troupe de haute volée. L’orchestre, sous la baguette de Philippe Jordan, chouchou de Bastille (hormis quelques folles essayant de se faire remarquer en ouh-ouhtant à la fin, faut bien s’occuper après les Gay games), est à la hauteur des hautes attentes placées en lui. Bien que le tempo annoncé soit légèrement plus rapide qu’à l’accoutumée – le chef comptait gratter 5′ sur chacun des deux premiers actes, ce dont le site de l’Opéra ne semble pas au courant, au contraire –, on est saisi par la beauté des timbres, la capacité à jouer à la fois ensemble ET avec le plateau, la richesse des couleurs obtenues, la précision des attaques, l’évidence des solistes et la concentration générale – on avise ainsi Sabrina Maaroufi et ses flûtes, toujours « dans son match » alors qu’elle joue, quantitativement, peu. Un rabat-joie pointera, ravi, çà un départ perfectible, là un défaut d’accord entre les violons et les clarinettes, rappelant à cette occasion que c’est moins risqué d’être violoncelle solo que cor solo ; nous n’aurons pas ce niveau de fatuité car la splendeur des cordes et la cohérence du propos nous a happé, même s’il nous manque, c’est notre goût, cette tension sporadique et cette exploration des contrastes d’intensité qui ne sont certes pas la marque de fabrique du chef maison. Car, boudu, quel souci des chanteurs et, surtout, quels préludes et quel finale, maou ! En revanche, avouons avoir été déçu, pour une fois, par le chœur d’hommes, il est vrai expulsé dans les loges, en hauteur afin de participer à la spatialisation du son. Leur première intervention nous a paru méchamment fausse, et l’acoustique spécifique n’a, par la suite, pas valorisé la banda des matelots et soldats souvent entendus à meilleure fête.
- Appréciez les costumes, 1. Nicky Spence (Ein hirt, Ein junger seemann), Matthias Goerne (Kurwenal), presque René Pape (König Marke). Photo : Bertrand Ferrier.
- Appréciez les costumes, 2. Philippe Jordan (fournit son costume), Ekaterina Gubanova (Barngäne), Neal Cooper (Melot à la brosse), Tomasz Kumięga (Ein Steuermann). Photo : Bertrand Ferrier.
Le plateau vocal : alors que l’on nous avait annoncé des solistes désespérants, l’ensemble est de belle tenue. On le sait, l’opéra exige beaucoup des deux têtes d’affiche, mais de façon croisée : Isolde bosse plus que Tristan au I, un peu plus puis autant que lui au II, moins mais jusqu’au bout dans le III – et, donc, vice et versa. Martina Serafin connaît l’ampleur de la tache – voir la vidéo infra. Comme à chaque fois que nous l’avons ouïe en ces lieux, elle associe virtuosité, résistance et honnêteté avec un charisme patent. On la sent, par moments, soucieuse de ne pas trop en faire, mais elle intègre cette prudence dans le paradoxe de son personnage, à la fois fragile, victime et chef de bal (Isolde, c’est quand même l’histoire d’une nénette fiancée à un mec, mariée à un deuxième et, grâce à la drogue, partie avec un troisième après en avoir séduit un quatrième : on n’a pas affaire à la prude midinette de base, hein). Tristan, lui, doit assurer jusqu’au bout, avec un troisième acte qui cristallise la thématique de l’opéra – pendant trois fois quatre-vingt minutes, ça ne cause que d’une chose : l’attente. Au I, on attend d’arriver au port ; au II, Isolde attend que les chasseurs soient loin pour retrouver Tristan ; au III, Tristan attend qu’Isolde le rejoigne pour le guérir, c’est-à-dire mourir. Dans cette perspective, Andreas Schager prend son rôle à cœur. Même si la voix craquotte, notamment dans la seconde partie du troisième acte, même si on le sent souvent tendu, il assure sa partie et rassure les inquiets. En revanche, il subit de plein fouet l’absence de mise en scène. Malgré sa bonne bouille de Torsten Kerl, lui ne semble pas être un acteur-né, et son corps ne suit pas les belles inflexions de son timbre. Le troisième acte en est une illustration, où il ne cesse de se grattouiller le brushing, ce qui est son tic préféré, comme en témoigne la photo qui ouvre la présente notule, prise au moment des saluts. Néanmoins, essayons d’estimer que l’important, dans le contexte sellarsien, reste le son et l’intention – or, sur ces deux points, l’artiste « répond présent ».
Parmi les rôles secondaires principaux, si j’puis dire, saluons le roi Marke de René Pape, idéalement taillé pour l’artiste avec ses deux grandes scènes où la puissance de la voix et l’autorité de la posture ne souffrent guère contestation. Ekaterina Gubanova (Brangäne) semble parfois manquer de puissance dans les graves, mais on la sent surtout gênée par la pseudo mise en scène, id est empêtrée dans des postures ridicules – elle est tantôt immobile, tantôt en train de caresser sa patronne, ce qui ne lui permet pas de donner à son personnage le tiraillement cornélien qui la déchire (elle devait empoisonner Isolde à mort, elle lui a empoisonné la vie). Neal Cooper en Melot aurait gagné à être mieux dirigé et designé ; en effet, il a peu d’interventions ; autrement dit, les costume, coiffure et posture sont d’autant plus importants – va-t’en essayer d’incarner ton personnage complexe (c’est le meilleur ami de Tristan, mais il le trahit parce qu’il voudrait se taper sa nana) quand on te demande de poignarder un héros à main nue. Ce nonobstant, notre vraie déception est liée à Matthias Goerne, Kurwenal bougonnant, engoncé dans ses sons nasaux, et il est vrai sabordé, lui aussi, par Peter Sellars (« quand t’as rien à faire, ben, t’as qu’à te coucher, voilà, et puis après tu te dandineras pendant tout le troisième acte, ça t’aidera à pousser »).
En conclusion, quel dommage que l’enjeu dramatique – parce que, bon, un opéra, en dehors de la performance musicale exceptionnelle que cela exige, ça raconte une histoire – soit mutilé par cette version sellarsique ! Cette tare n’impacte pas seulement le côté visuel, elle influe aussi sur la projection, l’incarnation, le dépassement des personnages par le talent et le savoir-faire des artistes. Certains ont su composer avec cette donnée mutilante ; elle a fait plus de dégâts chez d’autres. En d’autres termes, on ne peut pas dissocier, et c’est en général heureux, le spectacle de la musique, même sur l’air du « t’as qu’à fermer les yeux, ça passe mieux ». En bridant les artistes, en souillant la composition, Peter Sellars, ses complices d’arnaque et ses commanditaires insultent l’institution de l’Opéra, les spectateurs payants et la musique elle-même, en plus de mettre en mauvaise posture un plateau pourtant de haut niveau. Un seul mot, après trente-trois représentations de cette billevesée : révolte !
Artemandoline, « Concerti napoletani per mandolino », Deutsche Harmonia Mundi

C’est d’abord une question d’ignorant qui nous happe : pourquoi, aujourd’hui, enregistrer un disque de mandoline baroque, même composé exclusivement de « premières mondiales sur instruments anciens » ? Allons plus loin dans les questions bêtes, puisque nous sommes assez doué dans ce domaine : pourquoi écouter une telle proposition ? Le disque de concerti napolitains pour mandoline que publie ces jours-ci Artemandoline répond à ce doute balourd d’une triple façon – et, hop, d’entrée, un p’tit chiasme, ça promet.
- La musique pour mandoline, vue par les Napolitains, pulse, groove, zouke et impressionne puisqu’elle cherche avec gourmandise, à « charmer, séduire et divertir », stipule le livret.
- Elle marque un moment très important de l’histoire instrumentale napolitaine, ville où la musique semblait essentielle.
- À Naples, elle est double : d’une part, elle est spécifique (quoi que le court texte de présentation peine à donner des exemples concrets de cette spécificité, de même qu’il omet d’expliquer pourquoi enregistrer ces œuvres dans une église de Longwy… ou pourquoi recourir à une peinture anglaise et dix-neuviémiste afin d’illustrer la couverture du livret) ; d’autre part, elle transcende les barrières de genre. En effet, le disque propose d’explorer ce répertoire à travers le seul prisme du « concerto pour mandoline », mais l’instrument avait aussi droit de cité dans l’opéra et dans toutes sortes de formations (duos, trios…).
Depuis 2001, l’ensemble baroque qui affirme ainsi sa position revendique de « rechercher et ressusciter les chefs-d’œuvre oubliés de la musique pour mandoline » et de « communiquer ses trouvailles au grand public ». Impliquant exclusivement des instruments d’époque, l’ensemble fondé par Marie Fe Pavón et Juan Carlos Muñoz a publié sept disques selon un principe d’exécution : « L’interprète doit parvenir à être assez libre, spontané, anticipatif (sic) et étonné dans sa création intime et dans la nouveauté qu’il fait surgir. »

De fait, dès le concerto en Eb de Giovanni Paisiello (1740-1816), on est saisi par l’énergie que concentre Marie Fe Pavón dans les attaques, les variétés d’irrégularité, les différences d’ornementation, les nuances (voir par ex. la reprise d’une simple formule piste 2, 0’46, quand la sonorité change complètement !). Les accompagnateurs, peut-être un peu uniformément présents, ne ménagent pas leur peine pour faire vivre une musique où la vitalité est indispensable : martelée par des mini-fanfares ou des premiers temps très marqués, elle compense largement une écriture orchestrale qui paraît, soyons faraud, peu inventive. Heureusement, la relative banalité de cette composition codifiée est transcendée par trois éléments :
- une interprétation sous tension,
- la liberté avec laquelle l’interprète rend les enchaînements d’arpèges a priori planplans, et
- la qualité du dialogue sporadique entre soliste et ensemble (voir par ex. piste 3, vers 3’50).
Donc, après un quart d’heure d’écoute, notre scepticisme s’est dégonflé. Voici une musique pétillante et roborative qui donne envie d’écouter la suite.
En l’espèce, la suite est constituée par le concerto en Bb de Giuseppe Giuliano (dix-huitième siècle), pris en charge par Juan Carlos Muñoz. Le tempo liminaire, « maestoso », qui n’empêche pas d’avancer, met en beauté les envolées prestissimes de la mandoline, exigeant du soliste une extrême agilité. L’effet peut paraître facile, opposant les ploum ploum de l’orchestre aux libertés du mandoliniste ; il n’en est pas moins percutant. Sur cette lancée, le bref « lento non troppo » qui suit oppose à nouveau l’orchestre au complet à l’accompagnement léger voire à l’unisson (piste 5, 1’40). C’est fort bien exécuté, en prélude à un « allegro » ternaire que le brio des violons lance sans faillir. De la sorte, la musique associe une simplicité d’écriture et une exécution de haute volée, proposant ainsi une découverte – au moins pour l’ignorant qui écrit ces lignes – certes pas bouleversante mais tout à fait pimpante.

Not your average viole de gambe. Source : http://www.artemandoline.com/media/. Photographe non précisé.
Le concerto suivant, en G, est l’œuvre de Domenico Caudioso, dont la légende propose qu’il soit un pseudonyme involontaire de Domenico Cimarosa, ce qui serait plus rutilant. Marie Fe Pavón est à nouveau sur le ring. On apprécie le souci de variété du compositeur, qui ne se contente pas de développer, au métier, un thème sans falbala : on est ainsi sensible à la brève petite tentation mineure, qui va au-delà du simple plaisir motorique procuré jusque-là par des compositions très corsetées. À nos oreilles, hélas, le début du « largo » n’est pas aussi inventif. Par chance, la mandoline arrive à l’emballer par les bavardages et les inégalités dont elle enveloppe sa partie en C, qui permet d’atteindre, une fois n’est pas coutume, une coda orchestrale élégante, id est libérée des blam-blam-blam habituels. L’« Allegro » conclusif revient aux principes de base (rapidité et alternance orchestre – petit ensemble avec soliste), mais l’on y goûte une certaine inventivité dans les modulations (par ex. piste 9, vers 2’15) et un goût certain pour les petites cellules mélodieuses, ce qui éveille l’intérêt de l’auditeur, par-delà la virtuosité tectonique de la gratteuse de cordes.
Le concerto en A de Carlo Cecere (1706-1761) qui suit met en valeur la précision de Juan Carlos Muñoz. Carlo Cecere, comme les gens cultivés – donc tous – le savent, aurait été un compositeur vedette d’opéra. Ici, il a façonné une pièce parfaite pour servir de piédestal à un soliste que n’effraie pas la vitesse d’un « Allegro » pourtant annoncé « non presto ». En sus d’une main droite fofolle, on apprécie, sur la partie finale du mouvement, la synchronicité du mandoliniste avec ses compères. Le « largo » obligatoire n’a pas davantage peur de prendre son temps et de reproduire la même structure que le premier mouvement. Le « grazioso » ternaire, tâche d’apporter un peu de légèreté dans un opus un peu terne au sens de : pas notoirement original, comparé à ses prédécesseurs. La mandoline fait ce qu’elle peut pour cela, en choisissant des liaisons ou des coupures entre notes donnant l’illusion de petits bonds – ces respirations sans ritendo, pleines de grâce, trahissent l’attention aux détails de l’interprète. Néanmoins, si l’on est impressionné par la dextérité des musiciens et leurs tentatives pour jouer autant de musique que de notes, l’on peine à se laisser à nouveau séduire par une œuvre sédimentée dans des codes que ne relève pas une pointe mélodique épicée, une incongruité patente ou une idée bizarre balancée tout à trac dans le flux sonore.
Trouvera-t-on le bonheur avec le mot de la fin, qui revient au compositeur du début ? Le concerto en C de Giovanni Paisiello est au moins nouvelet car il donne l’occasion à l’auditeur d’écouter une troisième mandoliniste, Alla Tolkacheva. D’emblée, les tentations de modulation qui courent sur la partition, ainsi que le ton décidé de la soliste, avec des prises de risque poussant le frisson à sa limite (voir piste 13, 2’05), réveillent notre curiosité. La cadence du « Tempo giusto », quelle belle indication de vitesse, est l’occasion d’entendre la musicienne derrière la virtuose. Un violon trrrès langoureux dialogue avec elle dans le « Larghetto alla siciliana ». Ici, le temps s’étend plaisamment sans traîner pour autant. Refusant le contraste criard, l’« Allegro » final, allègre mais non pas vivace, ne s’enivre ni de vin, ni de vertu, ni de vitesse excessive, préférant se laisser éclairer par l’énergie et la poésie que la mandoliniste met jusque dans les arpèges, grâce à des attaques diversifiées et des contrastes d’intensité. L’orchestre dialogue alors avec lui-même avant de laisser la vedette à la soliste, dont la délicatesse sans chichi sait tirer le meilleur d’un quart d’heure baroque un brin répétitif (forte – piano, majeur – mineur, arpèges brisés et réitérés, structures de mouvement identiques, reprises…).
En conclusion, oublions les défauts du site pourtant très esthétique d’Artemandoline, où, par ex., le nouveau disque n’est pas encore référencé et où de nombreuses photos – dont celle du patron – sont floues. Soulignons plutôt la qualité de ce disque Sony, où tout est finement interprété, jusqu’à la dernière note de ces soixante-cinq minutes de musique, posée avec art. Sans doute convient-il de ne pas écouter le disque d’un trait, afin de mieux goûter le charme de cette musique toujours jolie, parfois époustouflante, mais souvent trop prévisible pour soutenir une audition attentive sur la durée – ces concerti n’étaient probablement pas conçus pour être ouïs enchaînés. Prises séparément, les cinq parties de cette réalisation, retranscrite par l’ingénieur du son Arno Op Den Camp et soutenue par le Luxembourg, lancent en s’ébrouant des gouttelettes de joie raffinée et légère sur l’auditeur, même peu frotté de ces eaux savantes. Partant, les concerti napolitains pour mandoline s’apparentent à une musique à déguster par petites gorgées plutôt qu’à picoler à grandes lampées : n’est-ce pas, signe de qualité quasi suprême, ce que l’on souhaite aussi des meilleures dives bouteilles ?
Jean Guillou, « Les symphonies », Augure

C’était un temps très raisonnable. On mettait les vivants à table et, s’ils avaient le bon relationnel, on faisait jouer leurs symphonies par l’orchestre de l’ORTF. Depuis les années 1970, les décideurs ont changé les destinataires de leurs commandes, et la troisième symphonie de Jean Guillou est restée partition morte. En guise de pied-de-nez, fin 2015, le label Augure, dédié à la pas-morte vedette de Saint-Eustache (contrairement à feus les chefs ici convoqués, l’organiste par excellence était en concert ce 16 septembre à la cathédrale de Toul pour propulser son Offrande musicale), éditait les deux symphonies de son héraut – pour une fois, les deux orthographes sont correctes. Partant, voici quelques aperçus d’un disque disponible ici pour 15 €.
Judith-Symphonie, le monstre qui ouvre le bal, pèse plus de trois quarts-d’heure. Son projet : évoquer le Dieu des juifs et proclamer la menace qui pèsera toujours, selon la légende, sur ceux qui en voudront à l’auto-proclamé « peuple élu ». Tout s’ouvre sur un capharnaüm de 3’33, prélude à la vocalise d’1’50 de Judith (Chrystyna Szostek-Radkowa – la graphie est celle de la création, eût-elle été simplifiée ou dékristianisée par la suite), à peine ponctuée doublement par les timbales. Un commentaire s’étale peu à peu dans l’orchestre avant que la voix ne s’élève derechef, commentée avec énergie par cordes, piano et xylophone. L’énergie orchestrale atteint de nouveaux sommets avant un silence qui matérialise l’abandon divin d’Israël aux mains de ses ennemis puisque surgit le terrible Assur. Quasi tonal, le martèlement qui accompagne la description de cette invasion, ouvrant la voie à une riche harmonisation messiaenique (piste 1, autour de 15’35). La même articulation tétralogique alternant solo de la mezzo – commentaire instrumental – texte – chant accompagné conduit au deuxième mouvement après qu’une fougue cuivrée a été injectée dans les veines orchestrales.
Les sonorités graves et une guitare électrifiée, so seventies, secouent la « décision de Judith de sauver Israël ». La timbale martèle le danger encouru par le pays. La soliste, impressionnante, qui plus est pour un live, doit à la fois dire le texte, le vocaliser, le parler (début du troisième mouvement), le répéter tout en précisant, féministe que « non enom cecidit potens eorum » mais que le Seigneur « tradidit eum in manus feminae, sed Judith » le renversa parce qu’elle était trop bonne de sa partie visagale (« in speciei faciei suae »). La troisième partie, qui confirme la maîtrise précise de Renard Tchaïkowski, s’articule autour de la séduction. En conséquence, elle travaille davantage la résonance comme pour souligner l’envoûtement que suscite le corps de la veuve grâce à un habile strip substituant à ses vêtements de deuil des atours olé-olé (je traduis approximatif). Guitare et trompette annoncent et encadrent le grand moment de séduction fétichiste (« sandalia eius rapuerunt oculos eius ») précédant la décapitation suraiguë.
Le déferlement qui suit, marquant l’arrivée du quatrième mouvement, est plutôt une débandade en forme de marche d’échec. Les juifs sont excités car ils sont « arescentes in siti », d’où l’importance de bien s’hydrater. Cuivres et timbales déferlent pour accompagner le triomphe d’Israël et la louange d’Adonai, dont la puissance serait donc sexy puisque liée à la science en cordonnerie des femmes au joli minois – mais ce n’est pas le lieu de s’amuser du ridicule vétérotestamentaire ou de s’emporter en dénonçant les horreurs et perfidies perpétrées quotidiennement par l’état israélien avec la bénédiction de tous les donneurs de leçons géopolitiques qui, bref. C’est surtout le lieu d’apprécier le sens du tutti, piano et cymbales inclus, qui anime Jean Guillou jusqu’aux faux silences (plage 4, 10’). Le contraste avec le long grave résonnant qui suit est supérieurement narratif. Le couronne la menace finale contre les méchants « insurgenti super genus meum ». C’est sûr que, avec des missiles contre des pierres, c’est plus facile, mais un symphoniste qui chanterait la gloire du peuple palestinien opprimé plutôt que celle d’un peuple qui a réussi aurait sans doute moins de succès. Faute, sans doute, d’avoir obtenu l’autorisation de l’Ina de retoucher les fichiers, l’éditeur conclut cette symphonie par 1’10 d’applauses – si notre hypothèse est bonne, c’est la preuve que, avec ou sans le dégueulasse immondice qu’est la spécialiste familiale du taxi, cette officine étatique est stupide et gérée en dépit du bon sens, tant le decrescendo superbe et prenant qui conclut cette symphonie avec une force formidable aurait gagné, au disque, à être libéré de la gangue du réel.
En conclusion, cette œuvre ambitieuse est certes parfois datée (ha ! la guitare électrique dans les orchestres des années 1970 !) ; toutefois, son discours est surtout évocateur, supérieurement orchestré et très diégétique (au sens où il se passe des choses) : l’inverse du film muet – pas l’image, le son, de très bonne qualité et bien mis en valeur par un livret qui « donne les paroles ».

Chrystyna Szostek-Radkowa et Jean Guillou. Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Krystyna_Szostek-Radkowa_i_Jean_Guillou_Judith_Symphony.jpg.
La seconde symphonie, d’une grosse vingtaine de minutes, est présentée par le compositeur comme un monodrame, concept popularisé en musique classique sous l’égide de l’Erwartung d’Arnold Schönberg. Le monodrame est une narration théâtrale qui n’exprime qu’un point de vue (Erwartung est un monologue). En l’espèce, sera présenté le seul point de vue des cordes, et l’on sent cette tension entre l’énergie permanente du drame et l’oscillation stimulante entre unissons remarquablement concoctés sous l’égide d’André Girard et clusters hypnotisants.
Un éclair parcourant l’ensemble du spectre sonore zèbre le début du Con fuoco liminaire. Puis les plans sonores distinguent le suraigu et le chant de l’alto. Un motif écartelé parcourt les solistes avant qu’un même unisson ne prélude à l’entrée des violoncelles et contrebasses. Le titre du mouvement l’annonçait : pas de mélodie, on n’y voit que du feu. L’orchestre de chambre rend avec force l’opposition entre le motif pentatonique, les moments de fureur et les unissons colériques. Les archets disparaissent alors pour que surgissent, dégingandés, des palanquées de pizz. À la sournoise, les archets reviennent à l’approche du Très lent ouvert par les sons très graves des contrebasses.
Souvent en duo, le mouvement oppose aux zigzags des cordes abyssales une ligne discontinue chantée tout uniment dans les médiums et aigus. De rares clusters ponctuent cet unanimisme. Puis l’opposition entre ces deux pôles (clusters et unissons) s’accentue autour de longues tenues. Des pizz bruyants animent le sourd combat qui se déroule, derechef arbitré par les archets en fin de bal. Le retour du Tempo primo scinde aussi les acteurs aigus entre notes ultra rapides et motif brisé. Un envol général (piste 7, vers 1’) enflamme le discours, s’interrompt, renaît, retrouve les contrebasses qui grondent vivacissimo avec le chœur. Un nouvel unisson ouvre chemin – même moi, cette formulation m’irrite, mais je la laisse quand même, ben, je sais pas, peut-être parce que, mais ce n’est qu’une supputation – au dernier mouvement, Très lent comme le deuxième, entre aigus à l’unisson et contrebasse en pizz. Le procédé, opiniâtre, persiste pendant deux longues minutes, comme s’il couvait un feu indéterminé, dont seules les fumerolles demeurent quand les ultragraves des contrebasses l’emportent coll’arco. Le tout se conclut par des applauses qui gâchent une fois de plus ce fade out majestueux quasi wagnérien, mais on imagine qu’Augure n’a pas géré non plus ces pistes à sa guise – et puis, soyons sincères, l’on aurait itou applaudi cette pièce profonde et puissante.

Jean Guillou lors de la création de sa première symphonie. Source : http://classik.forumactif.com/t4199-jean-guillou.
En conclusion, ces deux symphonies, associant accessibilité du discours et complexité de la composition, laissent un sentiment ambigu : regret que l’organiste ait, par la suite, été renvoyé à son travail d’organiste-compositeur-pour-orgue, et curiosité de continuer, via l’orgue, l’exploration de cet univers sonore, ambitieux à défaut d’être mélodique, plus intrigant que plaisant – ce qui, sur la durée d’un disque, est loin d’être un vice –, intéressant par son énergique rugosité plutôt que chou tout plein grâce à la bienveillance de ses soieries moirées. Donc rendez-vous pour, bientôt, de nouvelles découvertes dans le décidément passionnant catalogue guilloutique d’Augure.