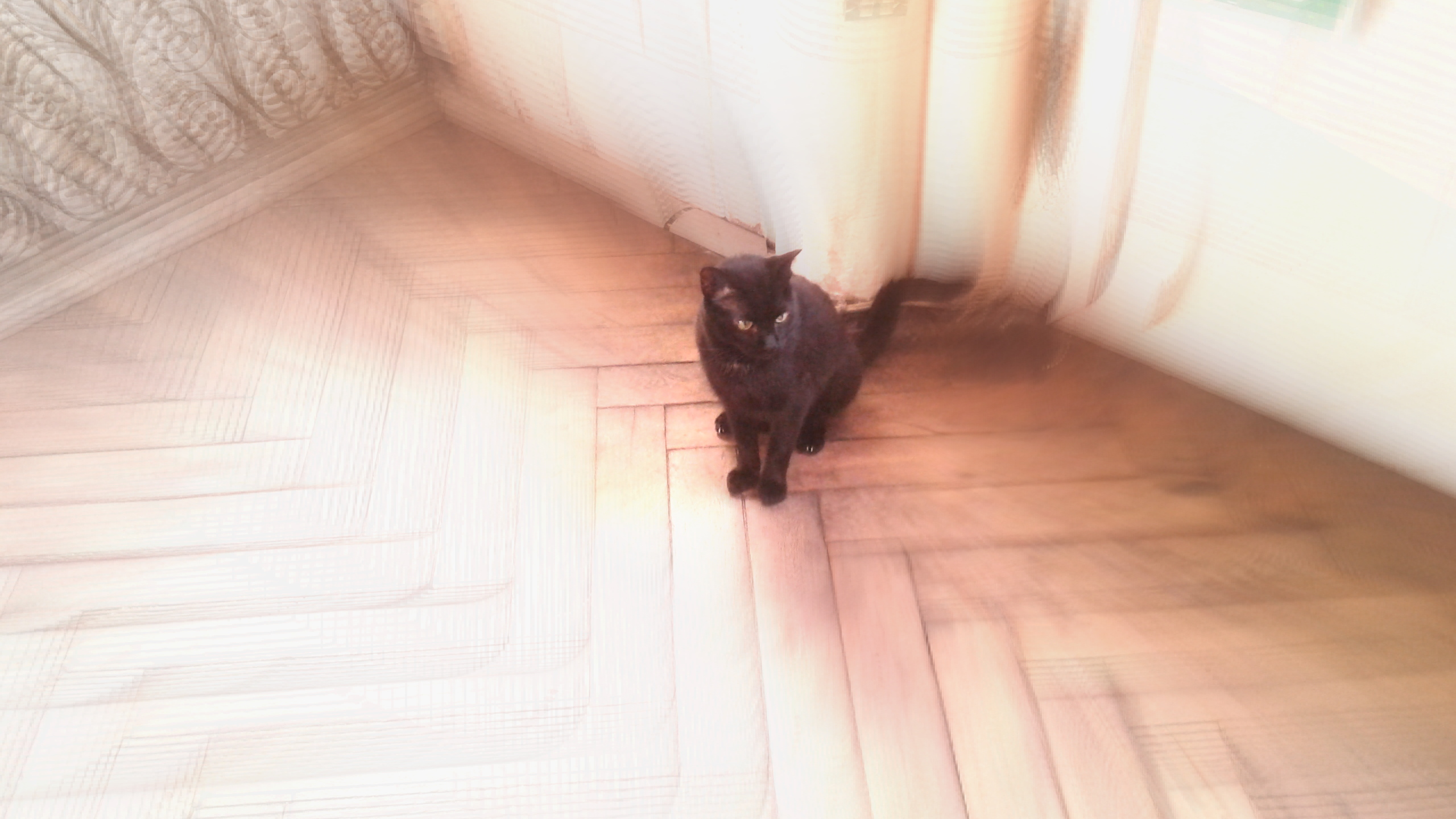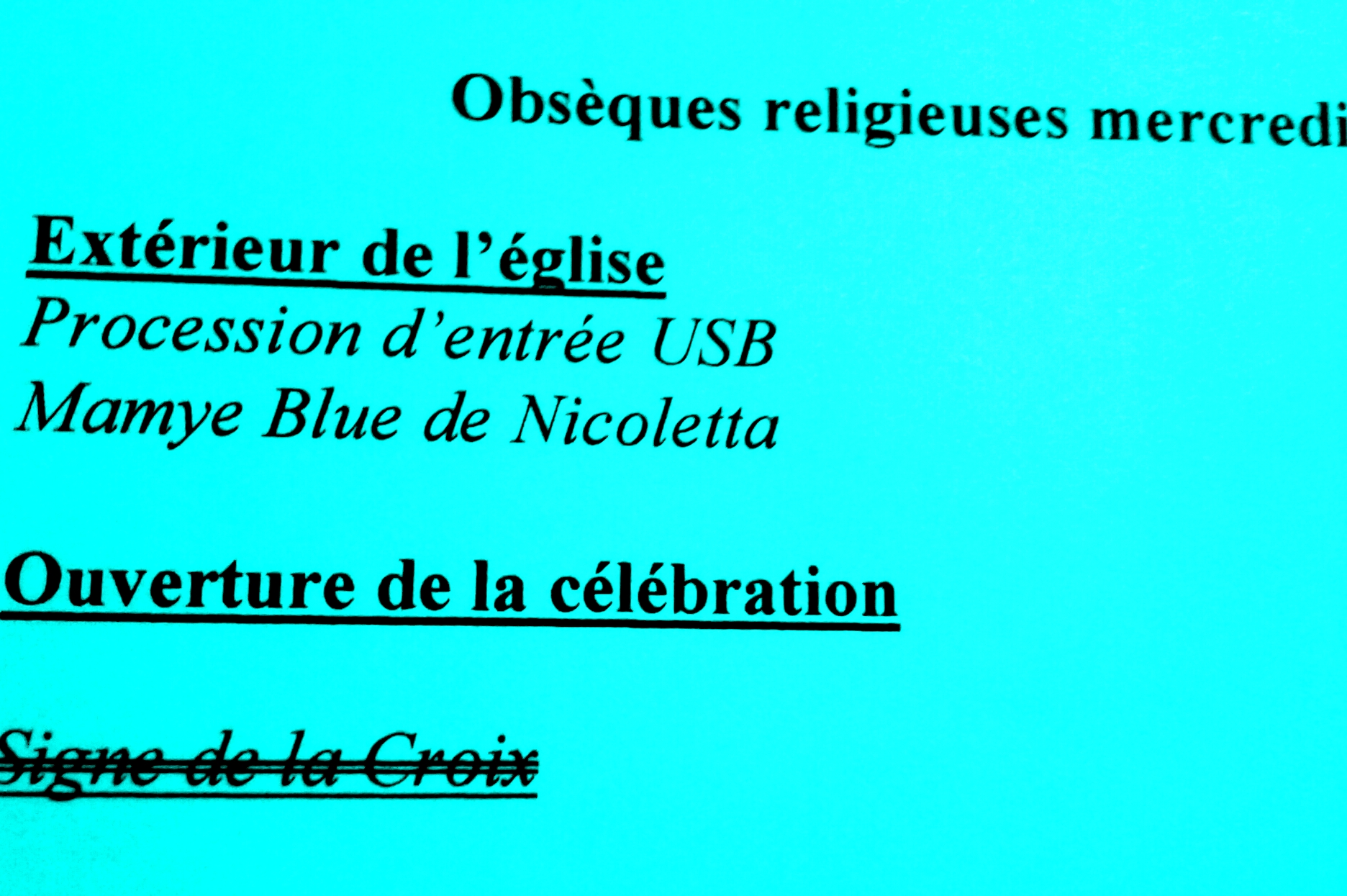En attendant Yann Liorzou…
Magnifique et généreux concert du du(j’ai pas fini)o Hervé Désarbre – Julien Bret, si fidèle à Saint-André de l’Europe alors que l’orgue devrait leur sembler risible, vu leur aura… Ben non. Ils viennent y registrer et répéter ; ils préparent un programme hyperspécifique, passionnant et sciemment farfelu ; on apprend par inadvertance qu’ils répètent aussi en secret à Saint-Ambroise jusque dans l’après-midi précédant le concert ; et ils vous montrent qu’ils sont aussi heureux de retrouver un orgue qu’ils connaissent bien que de rencontrer un public avide de découvertes pétillantes en tout genre.

Aussi devons-nous nous poser une question essentielle : sont-ce des personnes totalement ou partiellement responsables de leurs actes ? Et là, Votre Honneur, je voudrais intervenir avec force, et pourquoi pas, si vous me le permettez, avec férocité : mazette, admirez ce putain de sérieux, ce putain d’engagement, cette sériositude dans l’émotionnalité, mârde.
Je conçois néanmoins, Votre Excellente Sollicitude, que, dans ce monde de ploucs et de merdeux, donc de nous (sauf vous, Saint Absolu de la Perfection), l’exigence musicale associant le répertoire et le contemporain, le virulent et le joyeux, le percutant et le soyeux, soit discréditée. Ce nonobstant, Sa Sainteté du Jugement Dernier, soyez sûre que nous partageons votre avis : ces gars-là furent mentalement déficients en revenant donner un concert superlatif en l’église Saint-André de l’Europe de Paris. Mais bon, si, vous, vous le pensez sérieusement, Sublimissime Déréliction de l’Être, on vous emmerde. Physiquement, j’veux dire. Parce que ce fut un concert wow, avec des gens wow. Alors, si t’aimes pas les bons moments partagés avec un public curieux et gourmand, vas-tu donc bien te faire lanlère, sombre fake que tu es.
« Les Hollandais à Paris, 1789-1914 », Petit Palais, 12 mai 2018
 Exposition à succès, « Les Hollandais à Paris (1789-1914) », fomentée par Mayken Jonkman et Stéphanie Cantarutti, vient de fermer ses portes au Petit Palais parisien. Elle s’est appuyée sur le vivier d’artistes hollandais (« un millier ») ayant séjourné dans la capitale française durant la période concernée, en les mettant parfois en relation avec des peintres hexagonaux ayant représenté une scène similaire. De la sorte, elle a proposé aux visiteurs une déambulation chronologique dans une peinture qui interroge la notion de représentation selon trois grands prismes transversaux.
Exposition à succès, « Les Hollandais à Paris (1789-1914) », fomentée par Mayken Jonkman et Stéphanie Cantarutti, vient de fermer ses portes au Petit Palais parisien. Elle s’est appuyée sur le vivier d’artistes hollandais (« un millier ») ayant séjourné dans la capitale française durant la période concernée, en les mettant parfois en relation avec des peintres hexagonaux ayant représenté une scène similaire. De la sorte, elle a proposé aux visiteurs une déambulation chronologique dans une peinture qui interroge la notion de représentation selon trois grands prismes transversaux.
Le premier prisme est celui de la figuration de scènes localisées, dans la Ville (Montmartre au premier chef), dans les ateliers (entre Chaptal et Sorbonne, notamment) et dans la nature (de Barbizon à Fontainebleau). Ces scènes de vie ou de ville mettent, par exemple, en valeur la palette de Philip van Bree, polarisée entre l’ocre et les ombres (« Vue de l’atelier de Jan Frans van Dael », 1816), ou le sens narratif d’un Johan-Barthold Jongkind claquant, dans « Notre-Dame vue du quai de la Tournelle » (1852), un saisissant contraste entre la vie des petites gens sur les quais, avec mini-activités et silhouettes microscopiques, et le hiératisme d’une cathédrale semblant blanchir le ciel menaçant. Le même Jongkind peut, au contraire, planter une « Rue Notre-Dame » (1866) quasi déserte, où l’absence d’événements humains redonne sa place à un personnage d’un autre type : l’écrasante lumière. Dans ce tableau s’exprime la tension entre représentation sèche (murs et toits impeccablement droits) et évocation par touches de couleur de la route. Ce différentiel de « réalisme » capte le regard avec force. Néanmoins, comme le montrent les jolis paysages tristes de La Haye à travers sa station de Scheveningue, même si l’on doute que l’« humour » décelé en ces gris par les commissaires ait fait rire l’office du tourisme de l’époque, bref, souvent, l’importance des localisations extérieures place la nature, locale comme un arbre dans la ville ou cosmique comme la météorologie et la force des éléments, au cœur des sujets qui peuvent, surtout à la fin du dix-huitième siècle, s’enivrer de bouquets de fleurs exubérants, rendus avec volupté (et fruits) par Gerard van Spaedonck (1781). En somme, localisés ou abstraits de la géographie, ces peintures interrogent moins des lieux que le sujet de la peinture.
Le deuxième prisme est donc celui du miroir. La peinture paraît se donner comme un miroir d’art se promenant le long d’un chemin. Sans doute est-ce pour cela que nombre de tableaux s’adonnent à la métapeinture : représentation d’ateliers, autoportrait de Vincent Van Gogh (1887), rôle du modèle, peintre représentant un peintre en train de peindre (tel Jacob Maris avec « Le Peintre Frederik Kaemmerer au travail à Oosterbeek », 1861) tissent un fil rouge qui met en abyme l’expression artistique et incitent le visiteur à décentrer son regard, fût-ce par l’invocation d’autres arts comme celui qu’évoque une délicate pianiste. C’est une évidence : le sujet de la peinture semble fréquemment être le peintre lui-même, qu’évoquent la mise en scène de confrères au travail, la représentation de proches, le choix du cadrage (dialogue franco-hollandais exposé autour des moulins de Montmartre ou de la forêt), le saisissement de bizarreries (tapis mal disposé pour le « Baptême sous le Directoire », 1878, de Frederik Hendrik Kaemmerer), et bien sûr les techniques superlatives exigées pour la réalisation de la plupart de ces pièces (voir, par ex., le travail de lumière sur « Les ombres de Francesca da Rimini et de Paolo Malatesta… », 1854, d’Ary Scheffer). L’exposition touche ici son but : elle ne met pas en scène une thématique mais des artistes partageant certaines similitudes ; et cette unité, quoique relative, se retrouve tant dans l’objet (la figuration de scènes localisées) que dans le sujet (la métapeinture) et le projet (la représentation par des techniques variées).
[Absolument, je l’admets sans détour : c’est à tout le moinsss lourdaud comme récap’ de plan et annonce de dernière partie, mais ça structure un peu le discours en dépit de la linéarité de la présentation, alors bon.]

Frederik Kaemmerer, « Un baptême sous le Directoire », 1878, détail. (Appelez-moi le responsable tapis. De suite !)
Le troisième prisme avec lequel nous nous proposons d’embrasser l’exposition par-delà les clivages chronologiques est celui du projet de représentation, id est du travail sur les matières et la création de l’illusion. Sur ce plan, l’exposition est passionnante car elle offre aussi bien des exemples de perfection léchée (« Portrait de Jacobus Blauw » par Jacques-Louis David, 1795), d’abstraction géométrique (« Compositie XIV » de Piet Mondrian, 1913) ou vaguement évocatrice (« Paysage avec arbres » du même, 1917), de pointillisme dégingandé (« À la Galette » de Kees van Dongen, 1904-1906), d’impressionnisme méticuleux (« Vue depuis l’appartement de Theo » de Vincent Van Gogh, 1887) ou hallucinatoire (hypnotique « Bal Tabarin » de Jan Sluijters, 1907, gobé par les festons d’artifices lumineux), etc. Cette variété met à la fois en valeur l’unité de certains artistes et la multiplicité de techniques dont certains surent faire preuve. Sur ce plan, les Israels père et fils, Jozef et surtout Isaac, sont de bonnes illustrations de ces artistes capables de travailler tant dans la précision que dans l’à-plat évocateur, fort séduisant. Ajoutez à cela des tableaux qui, quoique figuratifs, séduisent avant tout pour leur travail sur les matières et les couleurs (« Le kimono rouge » de George Hendrik Breitner, 1893)… et la profusion de chefs-d’œuvre concentrés dans un espace à taille humaine, et vous comprendrez que les rares bémols (par exemple l’absence de sens de circulation conseillé dans les salles, alors que certains tableaux se répondent chronologiquement) sont étouffés par les dièses accidentant la mélodie des brava.
[Non, là, c’est vrai, ça n’est pas clair du tout, euphémisme, mais j’aime bien, alors je laisse en cadeau aux amateurs de remotivation de syntagmes figés.]

Quand « pas le droit de prendre photo » alors que moult autres le font (la preuve, photos exclusives de Josée Novicz ci-dessus), promeneur toujours prendre n’importe quoi pour se venger car lui tenir bon la (c)rampe.
En résumé, un beau rassemblement artistique qui, au vu de l’affluence des derniers jours, eût mérité une prolongation.
Come on, BB: le bremier bécital d’orgue réserbé aux combositeurs cobbençant bar un B

« Encore un concert planplan avec des artiss qui viennent rentabiliser des programmes déjà joués mille fois, comme pour tous les récitals d’orgue ? » Allez, cours te jeter sous le premier métro venu. Cours. C’est pour ton bien, tu es tellement benêt. Et, si c’est pas toi qui as proféré cette sottise, aboule ton minois, ça va zouker sec avec deux organistes internationaux, de la musique baroque-classique-populaire-contemporaine, avec deux mains ou huit pattes, et une pincée d’humour qui rend infiniment sapide le talent et le savoir-faire. 1 h 10′ de grande joie, avec écran grand itou, entrée et sortie libres – on voulait faire plus, mais on veut pas écraser la concurrence, non plus : vu qu’on s’en tampiponne, c’eût été dommage.
Na, hop et youpi.
Négociation

« – … et cette fois, Bertrand, vous n’incrustez pas le chat du curé, sans quoi Julien ne travaillera pas, sous prétexte que le « tibonomm », je cite, ressemble trop à ma féline Pétronille.
– Voyons, Hervé, pas deux fois le même gag. Pour qui diable me prenez-vous ? Cette fois, j’ai juste amené M. Chien.
– Oh, le con, le con, le con. »
Les jours Ferrier, on déguste…

… par exemple, grâce à Thierry Welschinger et à ses produits méticuleusement choisis, présentés avec engagement et simplicité même à des ignares comme votre serviteur, cette fleur de Labet, stupéfiante.
Jean-Pierre Morgand, « L’Homme qui passe après le canard »
Avec Les Avions, Jean-Pierre Morgand est devenu l’homme de la « Nuit sauvage », hit de l’année 1986. Trente ans plus tard, il se retrouve sur la tournée des « stars 80 ». Le choc est sans doute bénéfique et violent pour l’ex-vedette devenue vedette des ex – des ex-jeunes, des ex-dragueurs, des ex-gens à espoir, des ex-futurs-quelque chose dont la nostalgie sut être monétisée par un marchand habile. Jean-Pierre Morgand ne crache pas dans la soupe. En tournée, il attend, juste, l’intermède grotesque qui voit la scène squattée par des humains déguisés en canards. Jaunes, les canards. C’est le chant du signe : après c’est à lui. Depuis quelques années, à côté de quelques aventures musicales plus confidentielles, Jean-Pierre Morgand « des Avions » est, donc, « l’homme qui passe après le canard », ce qui, pour un musicien, reste plus flatteur que l’inverse.
L’Homme qui passe après le canard est le titre du nouvel album de Jean-Pierre Morgand, et l’intitulé du quatrième morceau d’icelui. Le disque, soutenu par le musicien fou du Nord François Marzynski et le mélomane déraisonnable Jean-Pierre Ficheau, a été financé de façon spectaculaire par crowdfunding (plus de 8600 € récoltés, ça ne rigole plus même si c’est à peine quelques pourcents de ce que Hallyday, parmi d’autres profiteurs, gagnait en tant que « nouveau talent » auprès des financeurs étatiques des faiseurs de disques français). Le morceau qui lui sert de simple est une sorte de récit désabusé et souriant sur fond musical. Derrière ses airs rassemblant la soirée disco de Boris et le récit légionnaire et corse de Polo Lamy, « L’homme qui passe après le canard » dessine un portrait sympathique et vivement évocateur du chanteur affrontant son passé, vivant à présent grâce à lui et tentant de se construire un avenir via de nouvelles chansons.
Ce titre constitue la pierre d’angle de la première veine, supposée d’inspiration autobiographique, qui bat dans ce disque (avec « Là », « Maman » et « Par terre »). Sur des mélodies souvent contenues dans une simple tierce, la voix, traînante et cependant entraînante, ha-ha, oscille entre Alain Bashung (écoutez « laisse une trace quasi éternelle » dans « Par terre »), Stephan Eicher (« Et là, tout va bien » dans « Et même si ») et Paul Personne (« Pas assez d’amour » sur la fin de « TCDA »), comme si le chanteur tentait de déguiser en spleen vocal protéiforme une oscillation personnelle entre désarroi existentiel et plaisir de créer de la musique avec un savoir-faire certain.
La deuxième veine de l’album est à peine une veinule, en un mot. Elle croise chanson presque « à texte » et pop, après une introduction celtique dont on peine, faut bien l’dire, à comprendre l’intérêt (le fait que le compositeur ait un nom à consonance bretonne serait une justification fort consternante – que penserait-on d’un peu de musique nègre pour ouvrir toute composition écrite par une personne à peau sombre ?) : « Les grandes filles », seule chanson à ne pas être écrite par le chanteur, festonne, autour d’une ligne logique et sans chichi, un texte simple et clair qui détonne joyeusement au regard des autres créations.
La respiration est d’autant mieux venue que la troisième veine de l’album fait couler en elle le sang de la pop sciemment basique (« Fatigué », « Éphémère »), avec des paroles résolument cradossées (« Où est passé l’éphémère ? / Non non non non / Où est-il don[c] ? ») voire quasi indochinoises dans leur non-sens souvent égotiste (« Debout sur le grand quai du matin, je proclame des horizons lointains / Une fille me croise, se retourne, me pose comme un soleil ») ou leur agrammaticalité (« attendons le vent tourner »). Si l’on aime ce je(u), on appréciera particulièrement le potentiel trouvé dans la simplicité inachevée de « Et même si » comme dans l’idée intrigante de « TDCA » (« Trop d’chansons d’amour, pas assez d’amour »). Alors que la plupart des chansons sont centrées sur un « je » qui serait saturant sans le contrepoint sporadique de la deuxième personne du singulier et des références à d’autres chanteurs (Bob Dylan, Phil Collins, JJG…), Jean-Pierre Morgand a l’intelligence de varier les tempi de ses chansons, l’air de rien, entre pulsations excitées et ballades languides, permettant une écoute continue jamais inintéressante de son disque – une performance, pour un enregistrement revendiquant sa dimension pop, laquelle privilégie l’efficacité de la chanson à l’attention sur le long terme.

Faut-il encore une preuve que nous avons apprécié cet album ? Dans notre omnipotence prétentieuse d’auditeur, il nous donne oh, des regrets, des regrets, des regrets ou, du moins, quelques regrets – ce que ne nous aurait pas inspiré un disque insipide. Regret, par exemple, sur les codas des chansons simples et efficaces, où l’on s’attend à ce que la sauce monte alors que, pof, faute de créativité, de temps ou de technicité guitaristique, elle redescend et laisse notre désarroi dialoguer avec notre imagination – on peut subodorer qu’un tel dérapage eût partiellement contredit l’esthétique sans fioriture excessive ici déployée… n’empêche. Regret, aussi, subjectif mais assumé, de la présence récurrente d’une voix féminine, souvent en arrière-plan alors que, eh bien, disons que cet accessoire nous paraît saper pour partie l’énergie ou le potentiel onirique des morceaux concernés. Regret aussi, sans les pouvoir blâmer, des paroles parfois bancales – mais l’on veut bien admettre, ou presque, que la facile répétition du premier couplet « pour tenir les 3’30 » peut être considérée comme constitutive d’une certaine chanson pop. En revanche, je regrette sans regret la pudeur poétique de l’artiste, qui reste souvent, sage comme une absence d’images, au bord du délire higelinien, de l’apocalypse textuelle façon Tekielski, de l’explosion musicale des postludes, pile au moment où notre p’tit goût personnel nous eût laissé espérer que l’affaire s’emballât et fît entrer telle ou telle chanson dans une dimension nouvelle. C’est cette même sagesse, sans doute, cette même retenue, que l’on retrouve dans des arrangements parfois trop semblables (débuts « Par terre » et « TCDA ») ou peinant à, pardon, décoller (quasi a capella sur le fade out de « Fatigué » : y avait un truc à creuser, bon sang, ça partait hyperbien !).
Dans l’ensemble, en dépit des réserves propres à l’exercice de la critique, suppute-t-on, ce disque, coloré comme un canard, qui passe de l’énigmatique et assez convaincant « Rose » à l’assez énigmatique et convaincant « Rouge », fait agiter agréablement oreilles et restes de capillarité grâce à un produit de qualité. Et ce, sans subvention publique. Double signe de qualité, coin coin.