Des cons posant le ton, décomposons le temps
– T’as 6 h de déplacement, ce credi ? C’est génial, surtout pour quelqu’un qui aime lire !
– Déjà, je lis kanchefeuh, donc chut. Mais baste, sot, je vais te spliker. J’ai pas 6 h de transport, j’ai plutôt ce qui suit.
Aller
- 10’ marche
- 5’ attente métro
- 15’ métro
- 7’ marche
- 8’ attente départ train (précaution)
- 15’ train
- 10’ voiture
- 20’ attente début célébration (précaution) [hors « retard »]
Retour
- 10’ rangement église
- 3’ attente chauffeur
- 10’ voiture
- 10’ attente train
- 15’ train
- 7’ marche
- 5’ attente métro
- 15’ métro
- 10’ marche
- Il manque 5’ : peut-être j’ai le droit de souffler ?
Comme j’ai de la chance, ce credi, je repartais l’après-midi. Mais t’as raison, pov’ naze : pourquoi les ploucs qui prennent les transports ne lisent pas davantage ? Moi, j’ai cunidé.
– Ouais, ben quand tu penses à tous les malheureux dans le monde, sans parler des migrants chez nous…
– CHTONC. Rien de personnel, hein : j’exprime le transport que mes pairs les privilégiés éprouvent pour la canaille de ton acabit. Allez, bisou.
Partichien

Tentative d’infiltration canine d’un projet, fomenté avec ORGANpromotion, pour un festival hommageant Johann Sebastian Bach et Robert Maximilian Helmschrott.
Je suis enfin à vendre !

Suite à l’arrêt de l’exploitation par Hachette Jeunesse, nous sommes en mesure de vous proposer de découvrir en grand format les 1200 premières pages, les seules intéressantes, des « Chroniques des temps obscurs » de Michelle Paver.
Le pitch : « L’aventure commence il y a six mille ans. L’Esprit du Mal s’est emparé d’un ours. Seul Torak, douze ans, peut le défier. Pour cela, il doit trouver l’harmonie entre les hommes, la nature et les animaux. Accompagné d’un jeune loup qui lui ressemble comme un frère, Torak s’engage dans la Forêt Profonde. Alors commence un étonnant périple au cœur d’une nature magique, fascinante et hostile… »
Parmi les critiques : « Une série incroyable et passionnante » (Nagui) | « Haletant, effrayant, passionnant. Torak, le frère des loups, est en marche et personne ne l’arrêtera. » (Stéphan de Pasquale, RTL) | « C’est vachement bien » (Bertrand Ferrier, traducteur)
Comment obtenir ces magnifiques parallélépipèdes feuillus : pour les trois premiers tomes en grand format, envoyer un chèque de 30 €, frais de port compris en France métropolitaine, à l’ordre de Bertrand Ferrier. Adresse : 86, rue La Condamine | 75017 Paris. Attention ! Quantité limitée !
Hervé Désarbre, Notre-Dame de Paris, 21 avril 2018
Les conditions des auditions d’orgue à Notre-Dame de Paris ne sont sans doute pas idéales pour apprécier un concert – contrairement aux conditions rencontrées il y a un an pour une vigile pascale sa mère : dans la vraie vie d’une audition, entre la mamie claudiquante de l’accueil qui fait chier le monde dans son rôle de harpie inefficace et stupide, et les touristes qui parlent sans cesse et circulent à haute voix quand ce n’est pas l’inverse, il faut un réel effort de concentration pour apprécier les subtilités de l’orgue. Contre une entrée gratuite (et une sortie payante, ce qui est scandaleux quand on sait que les artistes ne sont pas payés), on peut néanmoins y entendre, presque chaque samedi, de bons techniciens ou de très grands instrumentistes. Ce samedi 21 avril, le jeu en vaut les trente-six chandelles : Hervé Désarbre est à la console.
Pour la circonstance exceptionnelle, l’organiste du ministère des armées et titulaire du Val-de-Grâce n’a pas changé ses habitudes : il a préparé un récital sur mesure, en fonction tant du temps imparti (40’) que de la taille gigantesque de l’orgue, en maintenant son goût pour les musiques rares. Autobiographique, la set-list s’articule en trois pôles entrelacés – les racines géographiques et musicales du musicien (Jean Henry et Aloys Claussmann) ; ses maîtres (André Fleury et Guy Morançon) ; et ses amis, vivants ou feus (Jean-Dominique Pasquet, Jean-Pierre-Leguay, François Vercken et Jean-Jacques Werner).
Le concert s’ouvre sur le prenant Scherzo en si mineur d’Aloys Claussmann (1850-1926), un choix tonal audacieux car, en dépit de la difficulté technique, la pièce ne fricote guère avec le spectaculaire. En clair, on est loin du pouët-pouët souvent utilisé par les rganiss pour signaler que, ça y est, le concert a commencé. Hervé Désarbre place d’emblée la musicalité au premier chef dans son récital. Il faut bien cela pour énoncer trois brefs Préludes de Jean-Pierre Leguay (né en 1939). Chez ce compositeur, marqué par ses années à Notre-Dame et récemment bouté hors de sa tribune pour cause de date de péremption trépassée, nulle tentative de séduction affriolante. Le prélude VII offre une exploration posée de motifs épurés ; le Xb, plus riche, additionne des petites fusées, des guirlandes et des trilles qui se répandent ; et le XV fomente des images sonores par des à-plats travaillant sur la résonance et les harmoniques, au fur et à mesure que le discours, appuyé sur des structures reconnaissables mais transposées, grignote vers l’aigu. On est séduit, sinon par un langage musical qui nous scepticise toujours, même si ça ne veut rien dire, du moins par la complémentarité des pièces ainsi que par l’art de l’organiste, fin concepteur de programme, pour jouer avec le silence et la respiration, talent d’habitué indispensable dans ce grand vaisseau, sans déliter le propos.
Le Scherzetto sur un thème breton de Jean-Dominique Pasquet (né en 1951), est une aimable concession au plaisir de l’ouïe et des anches, après le ton abrupt des trois préludes. Il rappelle ce que la science de l’écriture et le renforcement du lien entre musique populaire et orgue peuvent s’apporter mutuellement. Alors que les chapelles fracturent l’Église, notamment en matière de musique mais pas que, c’est frétillant. Apaisant, l’Andantino sans titre officiel d’André Fleury (1903-1995) sonne d’abord comme une gymnopédie délicate, avant qu’une seconde section développe l’idée en faisant se répondre soprano et pédale. Derechef, on goûte une pièce où la subtilité des harmonies et la délicatesse de la registration adressent un délicat médius préalablement humecté puis tendu bien haut à la supposée nécessité de spectaculariser, si si, l’intégralité de tout concert classique « pour que les gens » (moi, donc) « ils s’ennuient pas trop ». Pour autant, il ne s’agit pas de perdre ses auditeurs dans un programme entièrement concentré sur fonds et mid-tempi ! Hervé Désarbre le sait bien ; et, comme son titre le laissait pressentir, la pièce suivante, Le Dragon à sept têtes et dix cornes de Guy Morançon (né en 1927) dépoussière les tuyaux, nettement désaccordés en ce soir de grande chaleur, et ondule les vitraux. La pièce s’accorde parfaitement avec le potentiel de l’orgue. Elle précipite un déluge de gros clusters puissants et des notes qui en ruissellent, privilégiant le climat sur la continuité agogique. (Oui, j’avais envie de glisser « agogique », j’hésitais entre le nom et pit-être l’épithète, j’ai tranché. Comme ça, c’est fait, on n’y pense plus. En tout cas, moi, je n’y pense plus. Mais c’est vrai que je suis pas souvent un modèle. Bref.) Une juste registration donne à cette composition l’occasion de produire ce que, au dix-neuvième siècle, les comptes-rendus de discours appelaient « beaucoup d’effet ».
Dialogue de sourds entre les anges des cieux et le diable des enfers, de François Vercken (1928-2005), propose une écriture plus complexe. La ligne mélodique semble prendre plaisir à se désagréger dans la volupté des dissonances dont Hervé Désarbre rend à la fois la souple irrégularité et la rage sourde – hé-hé, un chiasme, c’est cadeau. Des séquences contradictoires et répétitives se déforment jusqu’à ce que s’agrègent des à-plats sonores s’émiettant vers le silence. Les méchantes langues diront que, au moins à une première écoute, le titre est sans doute plus évocateur que la musique, en dépit du soin porté à la registration et à une réelle interprétation qui aille au-delà de l’énonciation de notes.
C’est sans doute pour nous, oups, pour leur répondre que, résolument œcuménique, l’interprète propose aussitôt les Variations sur O Filii de Jean Henry (1889-1959), résolument tonales mais assez subtiles pour proposer, après des festons autour du thème, une brisure thématique, comme si l’œuvre butait sur le premier segment de l’hymne. Les déformations, guidées par un thème toujours reconnaissable, dût-il être énoncé par une pédale obstinée, s’achèvent sur une happy end joliment amenée, et ce n’est pas une insulte, d’autant que l’œuvre cède in fine à la joyeuse tentation du majeur (pas le doigt, cette fois, voyons). Comme ne disent pas les militaires : bien écrit et bien ouèj. Pour finir de façon classique mais pas trop, Hervé Désarbre envoie l’artillerie lourde, en l’espèce représentée par la Toccata issue du « Triptyque » de Jean-Jacques Werner (1935-2017). L’œuvre, sciemment virtuose, respecte les canons de la toccata pour un finale, avec ses mains virevoltantes et sa solide base de pédale têtue et puissante. Le musicien en profite pour rappeler, outre son art de l’exécution technique, sa maîtrise des différents plans sonores, transformant en musique ce qui aurait pu n’être que secouage de saucisses, et en émotion ce qui aurait pu ne demeurer que performance. En somme, malgré ou grâce aux clichés, ça groove et ça secoue. Respect.
C’est dire si on est fier d’accueillir tantôt Hervé Désarbre en personne à Saint-André de l’Europe, en compagnie de l’incroyable Julien Bret, titulaire de Saint-Ambroise et compositeur pétillant. Rendez-vous, donc, le 12 mai, pour vérifier si cette notule était un exercice de vile flatterie, de publicité galvaudant la notion de critique… ou un vrai avertissement prévenant les amateurs de belle musique qu’il faut assssolument save the date.
Mikołaj Zieleήski, « Rosarium Virginis Mariae », La Tempesta, Divox
C’est l’un des stéréotypes les moins faux du monde : les Polonais adorent Marie. En témoigne la publication, chez Divox, d’un disque explorant le répertoire marial (ou assimilé) d’un compositeur polonais peu connu, ayant vécu dans la seconde moitié du seizième siècle.
Bien sûr, ce disque publié en 2018 mais enregistré en 2014, Rosarium Virginis Mariæ par La Tempesta dirigée par Jakub Burzyήski, est un fake. Osons même le qualifier, vu le contexte, de pieux mensonge. En effet, Mikołaj Zielénski n’a jamais écrit un rosaire pour la Vierge Marie. Jamais. Dans une notice assez détaillée, Jakub Burzyήski, le maître d’œuvre fier d’être stylé comme un Cameron Carpenter, dévoile avec un aplomb intéressant les mille et une astuces environ qu’il a déployées pour former ce programme d’une heure, articulé selon trois des quatre mystères (joyeux, douloureux et glorieux). Parmi ces stratégies, citons-en treize – oui, treize. Pourquoi ne se laisserait-on fasciner que par les chiffres ronds, bon sang ?
- Le choix d’une vingtaine de pièces parmi les 123 contenues dans les deux recueils parus à Venise en 1611 ;
- la juxtaposition de pièces en fonction des similitudes de tonalité ;
- la transposition à la quinte ou à la quarte juste ;
- l’association, en fonction des textes, de pièces en réalité dispersées, afin d’imaginer un oratorio avant même l’apparition du genre ;
- le tri par l’instrumentation visant à donner une cohérence à chaque section (par ex., pour les mystères douloureux, choix d’œuvres privilégiant les voix, les cornets et les saqueboutes) ;
- la retitulation évocatrice (la superbe « fantaisie en 2 », plage 8, est ainsi liée, assez arbitrairement semble-t-il, au couronnement d’épines) ;
- la réécriture de sections pour coller à logique liturgique (dans l’hymne finale, ajout de deux versets sur la même mélodie que le premier, seul réellement écrit par le compositeur, en modifiant notamment l’instrumentarium mais-pas-que) ;
- l’ajout de ritournelles entre certains versets ;
- les choix d’instrumentarium, faute d’indications précises (cornets, violons, gambes, saqueboutes, dulcianes et distribution de la basse continue) ;
- les options de chanteurs (falsettistes et ténors aigus pour les parties supérieures, baryton pour la partie dite « ténor ») ;
- l’alternance des modules (par ex. a capella puis chœur avec soliste vocal et instruments) afin de réaliser une « partition [globale] plus logique et transparente, ce qui enrichit le son et la couleur de cette musique » ;
- la diversification des répartitions pour les motets à quatre et cinq voix (solo / luth et orgue de chœur, soliste et instruments, tutti et instruments) ;
- la « déconstruction » de la composition d’un verset pour ne laisser que deux chanteurs, orgue et luth, pour « recréer une pratique du compositeur » qui, au sein d’un groupe de monodies choisissait d’embellir telle ou telle.

Ces stratégies répondent à un triple désir : reconstitution d’une œuvre sur laquelle toutes les précisions ne sont pas apportées ; lisibilité de ladite reconstitution (cohérence du projet, variété des formes) ; respect d’une certaine tradition musicologique. Nous laisserons les spécialistes s’offusquer de ces manipulations, courantes mais rarement justifiées avec un tel soin, ou de l’utilisation d’un tableau du dix-neuvième siècle en couverture – la relative pauvreté iconographique, incluant la reprise de mêmes photos dans le livret et sur sa dernière page montrant clairement que le projet est plus pensé musicalement que picturalement ! L’idée d’un florilège organisé, complémentaire du désir documentaire d’intégrale portée chez Dux par Stanisław Gałoήski il y a quelques années, paraît tout à fait pertinente pour diffuser une musique qui, toute envoûtante qu’elle fût, avait d’abord une portée fonctionnelle et n’était pas écrite pour une écoute continue.
Aussi les éventuelles critiques d’experts nous paraissent-elles, ici, aussi peu impactantes que les pseudo contrôles antidopage visant les cyclistes professionnels (du dopage), dans la mesure où le résultat, dûment motivé par le chef, est doublement convaincant. D’une part, la musique de Mikołaj Zieleήski témoigne d’une sûreté d’écriture qui dépasse le métier médian des compositeurs de la Renaissance, à travers un spectre de musiques très large (instrumentale, vocale ou les deux ; en petit ou gros effectif) que met en lumière l’unicité thématique. D’autre part, parce que l’interprétation de La Tempesta et des solistes donne à entendre un engagement séduisant tant des instrumentistes que des chanteurs, ingrédient indispensable pour rendre l’énergie de certaines pièces… d’autant que, malgré les efforts de Joanna Popowicz et Antoni Grzymała, l’acoustique de l’église réformée de Varsovie, trop généreuse en réverbération à notre goût, rend souvent indistincte la profusion des tutti.
En conclusion, la beauté de cette musique et l’interprétation attentive (magnifique « Assumpta es Maria » à huit, plage 15, par ex.) valident le travail de La Tempesta et méritent de dissiper le mythe qui associe la musique du seizième siècle à l’ennui. Contrairement au topos cité en ouverture de cette notule, ce stéréotype n’est pas toujours injustifié mais, souvent, si ; et cette musique polonaise du seizième siècle, reconstituée avec soin et respect pour nos petites esgourdes contemporaines, le prouve avec force.
2 ou 3 personnes, selon la police

J’y étais, je peux témoigner : il n’y avait personne, à la manif, comme en témoigne cette photo du cortège en train de se former, une heure et demie avant le départ effectif. En revanche, c’est vrai et pardon, il y a eu des heurts (des coups de Soleil, au moins). L’ambiance était délétère, et tout le monde disait : « Au fond, le Pharaon Ier de la Pensée Complexe a raison, oh oui, tellement raison. »
Pour inciter les autres à reconnaître la défaite des Français devant la puissance du Banquier Suprême, le Snam-Cgt a joué des airs tristes qui ont incité les gens à pleurer et à se frapper entre manifestants, parce que nous n’avions rien à foutre dans la rue, même si nous étions un ou deux, à la rigueur, selon le « cabinet d’experts financé par Le Figaro », journal dont l’objectivité de lèche-cul est l’honneur de la presse française. Ainsi que le stipule le Barnabooth du richissime Valéry Larbaud,
« Ah ! il faut que ces bruits et que ce mouvement
Entrent dans mes poèmes et disent
Pour moi ma vie indicible, ma vie
D’enfant qui ne veut rien savoir, sinon
Espérer éternellement des choses vagues. »

C’est donc tout à fait par hasard si j’ai croisé tel ou tel avec mon T-shirt customisé. Voyons. Par hasard, on vous dit. Fi.
Jean Muller, « Les variations Goldberg », le disque, Hänssler
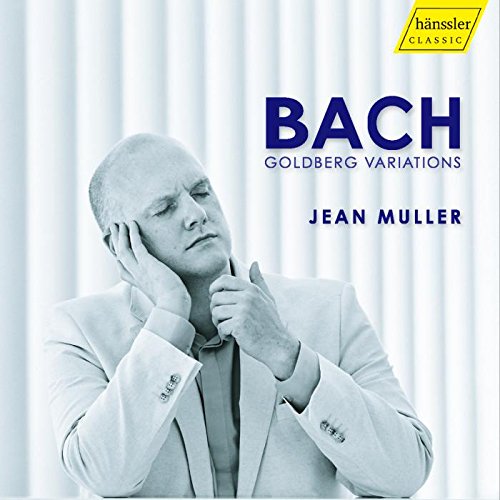
Après avoir ouï les Variations Goldberg en concert sous les doigts enthousiasmants de Jean Muller, après avoir reçu confirmation par Stéphane Blet des admirables qualités de l’interprète dans tous les répertoires pianistiques (y compris dans les œuvres pas piquées des hannetons dudit Stéphane Blet !), est-il raisonnable d’écouter le disque sur lequel l’artiste a préalablement gravé les trente-deux pièces entendues en live ? On connaît les deux risques majeurs : déception pour l’auditeur, répétition pour le critique. Par chance, dès les premières notes, fin du suspense pour le risque numéro un : pas de déception en vue. Fin décembre 2015, lors des trois jours d’enregistrement sous les micros de Marco Battistella, la patte Muller était déjà là.
En effet, d’emblée, avec cette aria ultralente, le pianiste laisse chacun s’imprégner du thème qui, de façon plus ou moins reconnaissable, va irriguer ces cinquante minutes de musique. Les variations suivantes et l’aria finale, au tempo tout aussi modéré, confirmeront, en revanche, le risque de répétition pour le critique. C’est un risque paradoxal puisque l’artiste, au contraire, choisit avec pertinence d’alléger la partition des reprises les plus fastidieuses – la basse ressassée étant un élément lui-même assez répétitif ; mais c’est un risque dont il faut bien assumer les conséquences.

Hélas, donc, nous nous répéterons. À cause d’un enregistrement séduisant à tout point d’audition, nous voilà derechef contraint de pointer la clarté du discours qui anime cet « art de la variation » – par complément à l’« art de la fugue », ce que Gilles Cantagrel appelle « les arts du varié et du variable », dans J.-S. (sic) Bach : l’œuvre instrumentale (Buchet-Chastel, 2017, p. 249… et non 155 comme l’annonce l’index). Nous sommes obligé de réitérer notre rengaine admirative sur, entre autres,
- le sens du swing (variation 7) ;
- la rigueur de cette force qui va sans barguigner (8, 10) ;
- la légèreté (9) de ces doigts qui coulent (11) avec délicatesse (13) ;
- l’art convaincant de retenir l’énoncé du thème (mettant par ex. en valeur la bizarre séquence enchaînant D7/F# sur Fm dans 25) ;
- la particularité d’avoir des balles de ping-pong montées sur ressort à la place des saucisses terminant les mains des hommes ordinaires (17) ;
- le souci de moduler l’énergie quand reprise il y a (atténuation dans 12) ;
- la capacité à dessiner la polyphonie même dans le brouhaha des notes virtuoses (14) ;
- la manière de faire chanter les moments d’apaisement (15) ;
- le sens du toucher (jeu sur les liaisons et les détachés dans 19) ;
- le plaisir de la virtuosité rigoureuse (20, 27 par ex.), de l’ironie et des contrastes, grâce à un judicieux temps d’enchaînements des pistes audio, et… Bon, ça ira pour cette fois.
Des critiques par-delà les brava ? Et pourquoi pas ? Même si on aimerait dénoncer, effarouché comme une Vierge voyant ses reproductions dans une rue de Lourdes, l’absence légère d’ornement sur la mesure 20 de la première aria, car ce serait sans doute hyperclasse, on préfère admettre que, parfois, même si l’on a conscience du renoncement à la facilité que constitueraient de plus nets contrastes d’intensité, on frétillerait si davantage de nuances coloraient des monolithes (22, 27), quelque solides et bien amenés fussent-ils. Autre exemple : n’aurait-on pu envisager un complément de programme, la version Muller pesant 49’20, ce qui laissait la place pour quelque autre gourmandise susceptible d’agrémenter le disque…
Toutefois, en l’état, cette version pour piano, concise et maîtrisée, nous paraît mériter les applaudissements les plus sonores et pour l’artiste, et pour cette réalisation pensée sur le fond (choix des reprises jouées), sur la forme (choix du piano) et sur le rendu (choix des techniques de prise de son). Une belle ouvrage.











