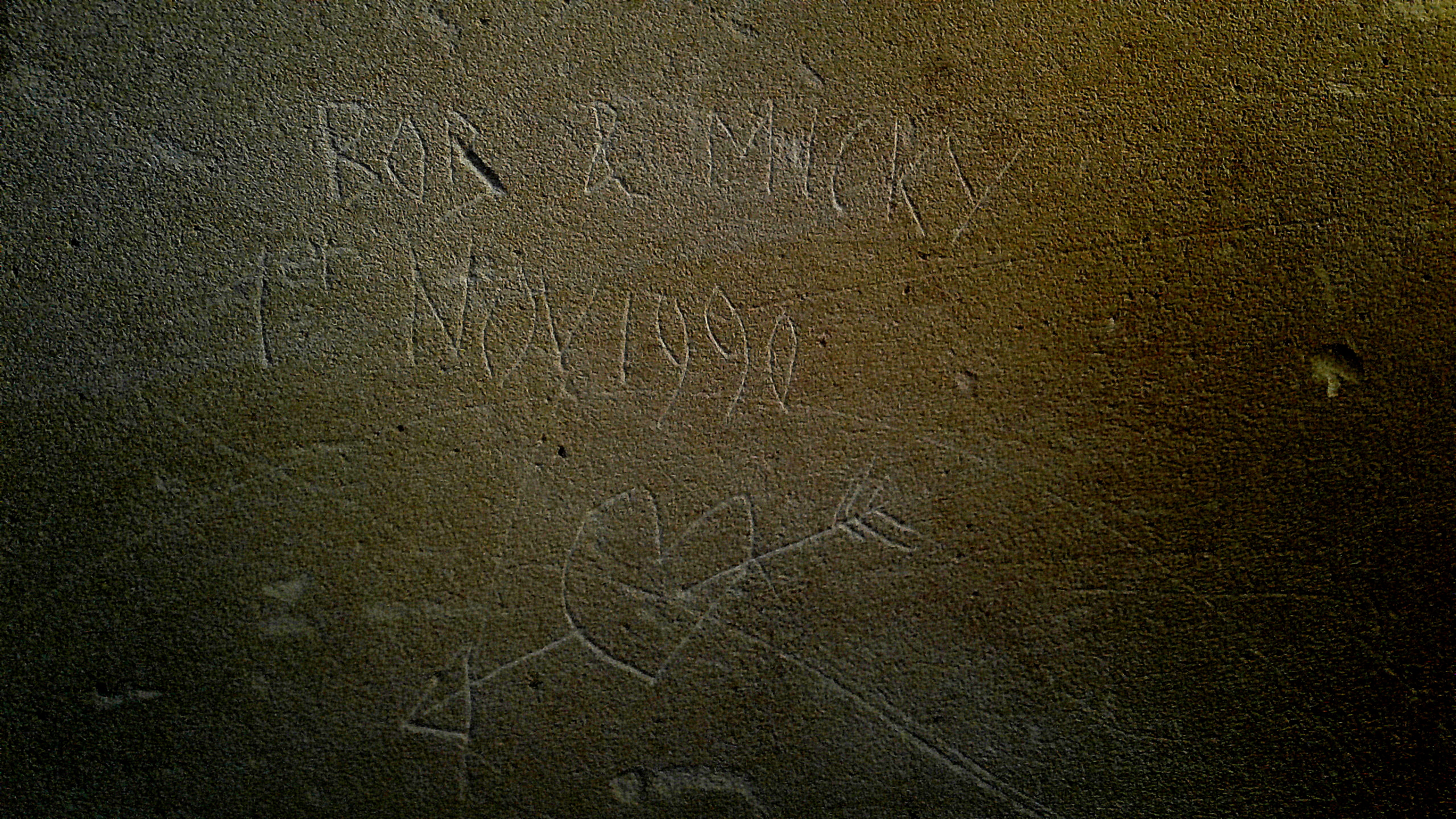« Clair de lune », 3 février 2018, Café de la danse

En remerciement de ma minipremière partie du 12 décembre, Jann Halexander m’a offert une place pour un concert-spectacle titulé « Clair de Lune », présenté comme une « ode à la beauté nous transportant au plus profond de nous-même », diable, et adressant la diaspora bénino-gabonaise sans exclusivité. Il s’agit d’un projet unique réunissant danse africaine, chanteur béninois et chanteuse gabonaise. C’est un plaisir de pouvoir se faufiler dans le public de prestations auxquelles on n’aurait pensé assister. C’est même un honneur, ce samedi-là car, à mon arrivée (en retard, certes, alors que Jann devait ouvrir la soirée, mais missa dura, sed labor est), le Café de la danse est plus que plein, en grande partie par ceux que cette ordure de Manu la Tremblotte appelle « les blancoss », et la tension commence à monter à l’extérieur tant les retardataires souhaitent entrer.
(Oui, je sais, j’aurais dû revendre très cher ma place et expliquer que j’avais fait un malaise dans le métro, mais bon, j’étais curieux et les banquiers sont sûrement patients. Sûrement.)
 Alphonse
Alphonse
Quand je débaroule, la troupe de danseuses coachée par le chorégraphe Alphonse Tierou – qui se présente comme « la référence mondiale de l’enseignement de la danse africaine », mazette –, entame sa quête symbolique du nom de l’enfant. Aux rythmes, toujours impressionnants, de deux percussionnistes-vocalistes, la dizaine de femmes plus ou moins jeunes, dont peu d’Africaines, euphémisme, vont évoluer pendant quarante minutes, avec un engagement sincère et une technique plus ou moins précise. On apprécie l’énergie, l’inventivité des mouvements du haut du buste (on a mal au dos pour les plus motivées d’entre elles), le respect des mutations chorégraphiques, mais on se demande si les trente-cinq minutes, au bas mot, de cette prestation de type « spectacle de fin d’année » n’auraient pas gagné à être resserrées pour parfaire la synchronisation et l’assurance des tableaux.
Serge
Après cette ouverture amatrice et l’entracte nécessaire à l’installation du plateau, Serge Ananou prend le lead. Comme il l’avoue d’emblée, ce Béninois vit « entre la ville et le village ». Il trouve que les tissus, spécialité et fierté nationales, sont moches, à la différence de la casquette dont il est inséparable ; aussi ne porte-t-il un textile du Bénin qu’en pagne (donc pas en ville, ô humour), pour se souvenir, selon les mots de son père, « d’où il vient ». Sa musique porte trace de cette tension entre ville et village. Si elle reste africaine, notablement lors des deux dernières chansons, elle a intégré avec brio les apports du funk, incluant unissons efficaces, rythmique prépondérante et breaks (tant rythmiques qu’harmoniques) virtuoses – on aurait pourtant applaudi, dans cette perspective « de ville », une guitare rythmique capable de s’adapter à ce style.

Les musiciens de Serge Ananou s’éclatent (sauf l’excellent batteur, qui a déstructuré son matos à la fin, mais c’est bon signe). Photo : Bertrand Ferrier.
Le début du set martèle trois titres dont on regrette la fin bâclée et le recours insistant, apparemment très africain, au solo de saxo qui, s’il est exécuté avec métier et enthousiasme par le quasi frère capillaire de Sylvestre Perrusson, ne porte pas au plus haut les couleurs de cette musique. Curieusement, la prestation finit plutôt doucement, comme si l’artiste signifiait : j’ai prouvé que je pouvais te faire groover, gars de la ville, mais je n’ai pas oublié non plus que je viens de la campagne. Partant, malgré des leçons consensuelles assénées avec une mâle distance (« si tu veux taper sur quelque chose, achète un djembé et épargne ta femme »), l’ensemble donne envie de connaître davantage le travail de ce guitariste-chanteur.
Tita
On retrouve le Béninois comme guitariste aux côtés de Tita Nzebi, figure de la musique gabonaise à Paris mais pas que (elle proposera un inédit créé à Calcutta). La formation qui accompagne la vedette du jour, avec plus d’une heure de concert, est quasi identique à la section précédente : guitare, choristes, saxophone, basse-contrebasse, batterie. Néanmoins, la musique, elle, est beaucoup moins « de la ville ». Un signe qui ne trompe pas : la chanteuse ne traduit pas ses chansons pour la partie, importante, du public seulement francophone – un seul hymne sera pour partie en français, puisqu’il s’agit de dénoncer aux Hexagonaux ignorants la mascarade démocratique gabonaise. Dès lors, tandis qu’une partie du public déclare forfait et qu’une autre partie s’enthousiasme, l’ignorant que je suis se rattache moins aux semi-mantras en dialogue soliste-chœur qu’aux sens des rythmes, merveilleusement exprimés par le batteur-percussionniste voire par son élève-remplaçant pourtant affublé d’un ridicule T-shirt des Red Hot, mais aussi suivis avec aisance par le public africain (battement des mains sur le cinq temps déjà utilisé par Serge Ananou : noire, noire, noire, deux croches, soupir).

Se mêlant au public, les danseuses de la première partie se sont hissées à la tribune pour danser sur les airs gabonais – en toute discrétion, cette fois.
Cette fois, on ne cherche pas à séduire les étrangers comme moi, mais à propulser, en France, une musique engagée, dont les enjeux chantés échapperont aux autochtones sans pour autant les empêcher de jouir de cette fête du contretemps et de l’itératif. Le musicien qui médit parfois en nous s’étonnera peut-être, notamment au début, de la tendance de Tita à chanter trop grave ce qui contraint son émission donc sa présence vocale ; mais, petit à petit, l’artiste monte en pulsations et se libère des contraintes de la ligne « théorique » pour donner libre cours à sa sensibilité de soliste et sa joie d’être sur scène… invitant les danseuses à revenir autour d’elle, et le public à la retrouver on stage ou backstage « pour ceux qui ne se couchent pas trop tôt ».

Tita Nzebi, des gens, une abeille avec des micros à la place des antennes et Jann Halexander. Photo : Bertrand Ferrier.
En conclusion
Une belle soirée, avec trois épisodes très différents, et un souci patent de donner zizir à tous : aux copines et aux parents venus voir les danseuses ; aux blancoss curieux d’une réunion allègre et originale (pour partie inclus dans la première catégorie) ; aux Béninois et aux Gabonais, tous venus en nombre faire un triomphe à cette production Bibaka. Merci, Jann, et bravo à Purple Shadow Agency pour la réussite de la date !
Daniel Kientzy (3/3), « Fender contre sax », Nova-musica
 Le principe
Le principe
Sept saxophones, un piano Fender-Rhodes, une guitare électrique Stratocaster, une guitare basse Precision-bass, les neuf (hors Fender) étant, au moins partiellement, joués par Daniel Kientzy. Sept créations sans concession, commandées et réalisées dans un disque Nova-musica par le multisoliste.
Le contenu
Est-ce pour « ne pas faire peuple », ainsi que Daniel Kientzy le revendique dans le petit livret de son disque Fender contre sax, édité en 2016 chez Nova-Musica (avec une traduction anglaise de Drake Mabry, également compositeur) ? Toujours est-il que, dès le titre d’ouverture, « Fender contre sax » de Jean-Yves Bosseur, l’artiste envoie son instrument fracasser les récifs des clichés sur cet instrument vampirisé par la pop. Comme le savent les lecteurs qui nous font la fierté de fréquenter parfois ce site, cet hurluberlu ne libère pas le sax à travers l’usage des classiques et du jazz avec grand orgue, façon Pierre-Marie Bonafos, mais grâce à l’interprétation de créations contemporaines. Partant, la première création présentée, « Fender contre sax », choisie pour titre de l’album, est radicale. Elle impose un discours déchiqueté, troué de silences et libéré de toute obsession de continuité discursive. Une Stratocaster, un Fender-Rhodes et une Precision-bass discrète semblent affronter le saxophone basse, façon fauves se tournant autour avant de lancer l’assaut, entre méfiance et intimidation. D’assaut, il n’y aura point, car Jean-Yves Bosseur a l’élégance de ne pas conclure sa pièce avec la ridicule coda attendu. Il préfère laisser ce round d’observation in-fini, comme pour mimer la lutte perpétuelle, menaçante, qui gronde entre les hommes et qui, en somme, construit la petite musique de notre Histoire ou, plus largement, le ronronnement insatisfait des interactions sociales.
Avec le même effectif d’accompagnement, imposé pour les sept pièces du disque, voici « Obsolescences programmées » de Marc Tallet. C’est assurément la pièce la plus accessible des sept – ce qui n’est, Dieu soit loué pour ça, pas une critique. Elle offre l’occasion au saxophone soprano de s’installer sur de faux rythmes qui surgissent et font pulser la pièce à l’aide de sons inattendus ou spécifiques. Là encore, peu de continuité du discours : la cohérence naît de la juxtaposition de structures reconnaissables par leurs six composantes (groove, circulation du rythme dans le quatuor, arrivée du sax, rupture, reprise, délitement). Des citations, des évocations (train qui passe, camion qui recule, téléphone qui sonne ou propose de renouveler notre appel), des formules récurrentes apparaissent puis se désagrègent, obsolètes, avant qu’un nouveau swing se propose selon une balance propre. Le saxophone s’impose à chaque fois mais, moins soliste qu’acteur de l’éclatement, finit toujours par basculer dans le vide ; et une autre rythmique, façon King Crimson années 2000, s’organise en boucles de hauteurs reconnaissables qui cascadent entre musiciens, se défont et reprennent. L’alto semble ici n’être qu’un pion dans un jeu plus inquiet qu’humoristique, même si tout s’achève sur une explosion glissée de Stratocaster, traduction supposée de notre vaine course aux objets forcément éphémères, et surtout de notre désir de vivre alors même que nous sommes informés de notre obsolescence programmée.
« Ombres emportées » de Matthias Leboucher (5’), complice habituel de Daniel Kientzy et claviériste du disque, se laisse porter par le plaisir du sax contrebasse envoyé dans les tréfonds. Dans un premier temps, les réponses monodiques du Fender et des grattes semblent dessiner une aura d’harmoniques étincelantes et sales autour des interventions du soliste. Un deuxième temps martèle une manière de marche funèbre (moment où les vivants emportent l’ombre de ce que l’on fut, sans que nous ne soyons toujours reconnaissables dans l’ombre de notre cercueil porté). Le troisième temps est suscité par la révolte du saxophone, refusant de se laisser étouffer. Cependant, la basse insiste et finit par étouffer notre velléité de survie. Ainsi, la pièce, dont on apprécie la narrativité, fût-elle fantasmée (et alors ? le titre imagé n’est-il pas là aussi pour donner impulsion à la capacité onirique que fournit la musique ?), meurt dans un dernier souffle.
Malgré son nom, « Estompe » de Jean-Marc Chouvel (6’) part avec envie, nous précipitant au milieu d’une conversation entre les quatre protagonistes, feat. cette fois le saxophone baryton. Comme souvent entre gens de moyenne compagnie, les débats prennent diverses directions jusqu’à ce qu’une formule ternaire imposée par le Fender recentre les échanges et remette un peu d’ordre. Le paysage musical devient alors lunaire : longues tenues du sax dans les aigus, aboiements du clavier, énoncés ternaires de la guitare, claquements de la basse. Les rudes envolées liminaires semblent renoncer à ressurgir de leurs silences ; un floutage maîtrisé s’installe ; le quatuor se brouille peu à peu avant de s’estomper dans un bruit de rotor partagé par les quatre complices, comme si le sable de nos déserts, transformé en tourbillon par notre agitation, effaçait la musique et répondait au titre de l’œuvre, qui préfigure son propre effacement.
La miniature « naKht » de Jean-Baptiste Devilliers (2’) propose de confronter le quatuor, en ensemble ou par de brèves interventions solistes qu’unifient les énigmatiques lamentations nocturnes du saxophone ténor. Lui répond la « Fantaisie » de Maria Kova (12’). La pièce la plus longue du disque démarre sur un faux rythme d’habanera, moteur d’un dialogue lisible entre, d’un côté, les saxophones soprano, alto et baryton, et, de l’autre, leurs accompagnateurs. Les motifs varient et se risquent parfois à frisotter une gaieté qui, au milieu du gué, agite par contamination guitare et Fender. L’hésitation sur l’humeur à garder s’exprime à travers un motif persistant de trois notes qui conduit à un martèlement de Precision-bass à peine allégé par les accords, entre médium et aigu, du Fender. Une dernière hésitation, où Rhodes et Stratocaster se répondent, conduit à un mouvement langoureux. La tristesse qui le parcourt est, heureusement, secouée par des apartés entre sax et basse qui bouclent le morceau en reprenant le motif liminaire.

Prolongeant la pièce précédente, « Rêves interrompus » de Mihail Vîrtosu (9’30) repart sur la même cellule de trois notes qui concluait la « Fantaisie ». Ce minirefrain passe de la basse au sax sopranino, qui tient la vedette, essentiellement en solitaire. Naviguant dans l’ensemble de la tessiture, entre sons détimbrés, souffle roulé et glissando, l’instrument attend le retour de ses complices – lesquels reviennent en effet en accords qui s’accélèrent puis s’évanouissent dans une pédale de Fender. Un son de flûte étonnant (4’) tente de se glisser dans ces échanges aux contours éthérés. L’artiste nous confirme qu’« il n’y a pas de flûte. Il s’agit du saxophone sopranino joué en mode Saxnay. Cela fait partie des modes de jeux que j’ai inventés et/ou rationalisés dans Saxologie. » Même rationalisé, le souffle brut étouffe régulièrement ces espoirs de mélopée, parfois colorés par des nappes montantes ou descendantes. Le son du sax reprend donc place, tandis que le motif entonné par la fausse flûte descend chez les accompagnateurs. La pièce alterne ainsi moments de surprise, de tension, de suspension, où le sax ténor se fraye un chemin final pour gribouiller quelques traits vains : quelque temps, basse et Stratocaster évitent de justesse le silence ; à son tour, le Fender risque une dernière apparition ; mais l’œuvre finit par se résorber, peut-être comme nos rêves.
En conclusion
Fender contre sax, qui clôt notre triple découverte de Daniel Kientzy, souligne l’intérêt du travail de ce drôle de zozo. Certes, les musiques qu’il suscite ne sont ni rigolotes, ni FMisables ; mais, par le souci d’explorer les possibles (toujours plus chic que « les possibilités », j’aime bien glisser un brin de snobisme pour ceux qui ont diagonalisé jusque-là) des sept saxophones, par le désir de proposer des pièces d’esthétique souvent proche mais jamais superposable, par la capacité à faire aboutir des projets qui dissonent aussi allègrement dans la médiocrité abrutissante qu’imposent, par inculture, paresse et bêtise, les médias de masse et qui, souvent, nous tente itou (et non nous tente igloo, ça ne voudrait rien dire), Daniel Kientzy souligne qu’une autre voie est possible – une voie où la musique, même hors des institutions spécialisées, ose l’expérimentation et l’exigence. Comme l’opéra n’est pas, ontologiquement, un truc réservé aux riches ou aux blancoss, cette perspective n’a rien ni de ringard (« on avait déjà ce genre de bruit qui se prend au sérieux dans les années 1960-1970 ») ni d’élitiste (« t’imagines le degré de confort qu’il faut pour apprécier des trucs où que même pas y a de la mélodie ? »). Sans doute aucun, une fine connaissance des enjeux, de l’histoire de la composition et des instruments permettrait-elle une appréciation plus délicate, plus pertinente, ou, à tout le moins, plus docte voire différenciante des œuvres présentées. Nous ne rendons compte, hic, hips et nunc, que de ce que nous nous rendons compte ; et nous ne racontons que ce que nous pûmes, crûmes, sûmes humer ou aimer, rien de plus, hélas.
(Enfin, non, pas hélas, plutôt tant mieux : ça donne déjà prétexte à de belles tartines. Pas la peine de rallonger la sauce, boudiu.)
Toutefois, en contrevenant au penchant qui nous fait souvent tomber exclusivement dans la musique de fond, en brouillant nos repères, en cassant nos habitudes d’écoute, en se risquant à nous surprendre, à nous disconvenir, à nous titiller tout en faisant preuve d’une maîtrise palpitante de ses p’tits copains cuivrés, la démarche créatrice et créative d’un Daniel Kientzy méritait, autant que nous en puissions juger, un triple p’tit coup de Klaxon dans ce monde policé de violes de gambe. Donc, c’est fait : pouët, pouët et repouët.
Cyprien Katsaris (2/2), « Transcriptions de Karol A. Penson », Piano 21
 Cette notule critique devait être la deuxième livraison d’une trilogie sur la transcription aujourd’hui. Ce sera la première, l’artiste sévissant dans l’autre disque nous ayant demandé de ne rien publier avant le 2 mars, jour de sortie. Tant mieux pour le suspense, supputera-t-on (laveur).
Cette notule critique devait être la deuxième livraison d’une trilogie sur la transcription aujourd’hui. Ce sera la première, l’artiste sévissant dans l’autre disque nous ayant demandé de ne rien publier avant le 2 mars, jour de sortie. Tant mieux pour le suspense, supputera-t-on (laveur).
La transcription, les transcriptions
Le disque des transcriptions de Karol A. Penson jouées par Cyprien Katsaris sera l’occasion d’interroger le cadre de cet exercice critique : que jauge-t-on quand on entend une transcription ? La fidélité à l’œuvre liminaire ? La créativité du transcripteur ? La virtuosité qu’elle exige de l’interprète ? La musicalité du rendu final ? La variété des sources transcrites ? Sans doute avons-nous un penchant pour les trois dernières hypothèses ; et c’est plutôt opportun, puisque les goûts éclectiques de Karol A. Penson le poussent à malaxer des pièces parfois tubesques (« Recuerdos de la Alhambra » de Francisco Tárrega, parfait pour tester la réactivité des marteaux d’un clavier !) ou presque (« Zueignung » de Richard Strauss, où l’on remercie une fille parce que « l’amour rend le cœur malade », c’est devant des fleurettes de ce style que l’on se dit que l’on a mal vieilli, bref) mais, souvent, plutôt obscures pour le mélomane inculte que nous sommes (Yuri A. Shaporin, Witold Friemann, Zygmunt Noskowski, ça ne me sonnait guère de cloches…). Dans un entretien entre l’interprète – lui-même transcripteur, comme on peut le voir ici – et le transcripteur, Karol Penson en rend raison selon trois axes : l’envie de jouer, donc la nécessité de transcrire, des pièces qui lui trottent dans la tête ; les goûts personnels (pianiste, il aime le répertoire pour guitare) et le hasard qui l’amène à découvrir des partitions rarement ouïes ; et le souhait de prolonger la tradition romantique de la transcription pour piano, sans la réduire à la « transcription salonnarde » jouable par n’importe quel amateur.
L’histoire, les histoires
L’entretien que contient le livret est aussi l’occasion pour Piano 21 de poser un joli storytelling lié aux « grands amateurs », ces musiciens de niveau exceptionnel qui ont choisi un autre métier que musicien. En effet, Karol Penson, dit la petite histoire, est « professeur de physique théorique à l’université Paris-VI et lauréat du Prix franco-allemand Alexander von Humboldt ». Cerise sur l’anecdote, il n’a écrit ses premières notes qu’à cinquante et un ans ! Dans l’entretien, l’homme rappelle par modestie que maths et physiques de haut vol ont toujours fait bon ménage avec grande musique. On pourrait se demander s’il ne s’agit pas plutôt d’un compagnonnage, lié à la reproduction sociologique pointeraient les adorateurs de Pierre Bourdieu, entre élites universitaires et grande éducation, laquelle incluait classiquement la pratique poussée de la musique. Ne raconte-t-on pas encore l’histoire de ce vieux prof de droit moqué par ses étudiants le jour où, devant faire cours dans un amphi de Paris-II dans lequel traînait un piano en vue d’un concert proche, il se fit accueillir par des : « Une chanson ! Une chanson ! » Grommelant, il se mit au piano en surjouant la mauvaise grâce… et fit taire les freluquets de bonne famille en donnant un récital aussi impromptu qu’échevelé. Ainsi cette tête chenue signa-t-elle son entrée dans la légende, c’est-à-dire des histoires qui méritent d’être lues, par opposition aux camelotes et à leurs camelots.
Les disques, le disque
Confortant le croustillant et prestigieux pedigree de l’arrangeur, le disque, qui s’appuie sur une base de transcriptions préalablement éditées sous le titre de « Piano Rarities », se promène dans la diversité des transcriptions produites par Karol A. Person, grâce à l’aisance digitale que l’on reconnaît à Cyprien Katsaris. Le propos est essentiellement tourné vers la musique romantique et post-romantique, avec quelques exceptions allant d’un bout de choral tel que rhabillé par Bach (« Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine », d’après la Passion selon saint Jean… et une première transcription d’Arthur Willner) jusqu’au « Chôro da saudade » d’Agustín Barrios Mangoré. Les inclinations du transcripteur ne sont cependant pas monochromes. On laissera les pointilleux vérifier si « Nell » de Gabriel Fauré paraît, au disque, aussi difficile à jouer qu’elle l’est, à en lire son interprète, pourtant pas à une difficulté près. Quant à nous, nous nous sommes pourléché les esgourdes, entre autres, grâce au jazz triste de « Dla zasmuconej » (Mieczysław Karłowicz), à l’interrogation inachevée que chante le « Nightingale » de César A. Cui, à l’exotisme tempéré des « Adieux de l’hôtesse arabe » (WD 72) de Georges Bizet qu’il faut des trésors de doigté pour laisser chanter, à l’envoûtement harmonieux de « Damunt de tu nomès les flors » de Federico Mompou, à la légèreté virevoltante de l’Allegretto tranquillo issu de la Sonate op. 13 n° 2 d’Edvard Grieg, à la liberté apparente qui enveloppe la « saudade » selon Barrios Mangoré, et à la solidité granitique du choral déclamant : « Reposez en paix, ossements que je ne continue pas à pleurer » – clairement, on n’est pas à la fête à Neuneu, avec cet oxymoron protestant tendant l’arc entre l’affliction devant la fatalité macabre et l’espoir, ressassé à outrance, comme pour croire, par l’effet hypnotique du mantra, au si improbable paradis.
Le bilan
« Karol A. Penson, Transcriptions », disponible dès le 9 février, est un disque qui s’entend, s’écoute et se réécoute avec intérêt et plaisir, association pas si fréquente. Certes, pour les enregistrements les plus récents, on retrouve par endroits les parasites signalés dans l’enregistrement précédemment recensé, ce qui est logique puisque les pistes concernées ont été captées lors de la même séance à Saint-Marcel (7, cliquetis sur le clavier, voir par ex. 0’14 à 0’16, ou 19, 1’13, etc. ; 14, grincements du siège, voir par ex. 2’47). Mais ces signes de vie, assez rares pour être bénins, n’enlèvent guère à la performance du pianiste, à l’ambition du transcripteur et à l’originalité d’un label qui ose commercialiser une monographie, certes inédite pour partie seulement, de transcriptions signées par un musicien peu connu. En somme, une curiosité qui surpasse l’idée de curiosité et se conseille sans ciller.
Jann Halexander, « À nos tendresses : Pauline Julien », rue Marc Seguin, 31 janvier 2018

Jann Julien et Pauline Halexander. Photo : Rozenn Douerin. (Avant, y avait une photo beaucoup plus mieux meilleure, mais l’artiste se trouvait horrible dessus. Comme on est sympa, parfois, voilà une alternative.)
Il faut toujours se méfier des adieux, leurs « jamais » vibrent souvent d’un « peut-être » comme le stipule parfois Joaquín Sabina en introduction de « Nos sobrán los motivos ». Un exemple ? Après un « dernier concert parisien », suivi de quelques autres, Jann Halexander revient à Paris pour préparer, dans l’intimité d’un concert privé, un nouveau projet autour de la figure de Pauline Julien.
Rappelons-le, Jann Halexander est un mulâtre. De peau, d’art, de cœur. C’est donc par « Le mulâtre » qu’il aborde son tour de chant où, aux couplets et refrains qu’interpréta « la Pauline », répondent ses propres fredonneries. Ce mélange construit la problématique et donne sa perspective à la performance. Et la question est : qui, ici, est l’étranger ? Le Franco-gabonais qui vécut à Ottawa et chante une Québécoise, ou les pièces chantées jadis par Mme Julien, pépites crépitantes plongées dans la pâte musicale du « local de l’étape », Mr Jann Halexander ? Ainsi, entre « Mulâtre » et « Étranger », le récital pose-t-il d’emblée la question de l’étrangeté, de son ontologie (l’étranger est-il étranger par sa nature, sa position ou son regard ?), de sa friabilité (est-on étranger à vie ou sait-on se désétrangéiser, fût-ce malgré soi ?), de sa désirabilité (l’étranger n’est pas que celui dont on a peur, c’est aussi celui qui nous grandit quand on l’accueille ou qui nous paraît formidable car différent, etc.) et de son indissolubilité (c’est quoi, le contraire d’un étranger ? un autochtone, vraiment ?). Le choix d’interpréter une interprète – Pauline Julien a beaucoup chanté les chansons des autres – est, lui aussi, une étrangeté : Jann Halexander ne chante pas un auteur-compositeur ; il restitue, partiellement, sans quête d’exhaustivité ou de pédagogie (ouf), sans ton mielleux rentabilisant la gloire passée de l’ex-vedette québécoise, un univers protéiforme où, aux paroles de Pauline Julien, se substituent souvent les paroles d’autres artistes, toutes posées sans façon sur le pupitre du piano, à la façon d’un prompteur acoustique cher à Jann Halexander. Or, ces artistes étrangers au duo Jann Julien nous séduisent aussi, nous déséquilibrant avec bonheur et nous renvoyant à nos propres errances, comme quand nous hésitons entre déménager, quitte à devenir un étranger, ou rester là, quitte à s’y sentir parfois si étranger (Ducharme/Charlebois).
Dans ces conditions, le doute joyeux de la musique partagée se distille dans l’esprit des spectateurs. Ce récital fond dans une même bouche les mots chantés par Pauline Julien et ceux fomentés par Jann Halexander, mais il questionne de la sorte notre impression d’être ou de voir des English men in New York. D’ailleurs, comment former une communauté avec nos semblables, ces gens aussi répugnants que nous, même si tous nos p’tits secrets n’ont « aucune importance, quoi qu’on en pense » ? Comment accepter de passer ensemble à table (ou d’aller ensemble au concert) quand on risque d’avoir un migrant dans son assiette (ou d’en croiser en sortant du récital), ainsi que dénonce dans une autre pièce le chanteur ? Les réponses se dérobent, malgré l’engagement d’hymnes seventies. Ainsi, doit-on encore rêver, sur une musique de Jacques Perron, d’un monde où il n’y aurait plus d’étranger ? Faut-il se réjouir que « les gens de couleur » soient des gens dénués d’extraordinaire – nous serions donc tous étrangers les uns aux autres et semblablement médiocres ?
La tension est assumée et parcourt le choix effectué dans les vastes répertoires de Pauline Julien et de son interprète, que l’on sent à l’aise, seul au piano, dans sa set-list bien pensée. Pas étonnant que l’artiste renonce à expliciter son amour du public en omettant son traditionnel bis en forme de déclaration d’amour – verbaliser l’effusion, ici, serait peut-être dissonant. Car, oui, amateur de sirop parfum barbe à papa, abandonne ici tout espoir : ici, on chantera l’amour universel, pourquoi pas, mais en revendiquant une étrangeté choisie, en l’espèce celle de l’indépendance nationaliste que « Le temps des vivants » de Gilbert Langevin exige contre « la prudence des troupeaux ». De même, le penchant étonné d’une « âme à la tendresse » est admissible mais il s’accompagne de la crainte de n’avoir plus rien à se dire, hormis la drôle de colère façon Anne Sylvestre, tonnant contre la connerie médiatique (« Dis-moi Pauline ») des journaleux prompts à se laisser fasciner par l’étranger qu’est ben fun vec ses hivers pis son accent exotique (pourtant pas la spécialité de Pauline Julien…), au détriment des locaux qui sont, pourtant, pas tous si pires quoi qu’ils viennent d’Alsace ou du quinzième, les tarés.
En somme, « À nos tendresses », judicieusement ramassé, est une invitation à, encore une fois, faire des vagues en s’émouvant devant des chansons que le temps patine ou happe dans sa danse légèrement vertigineuse. De la sorte, avec Gilles Vigneault, même si chacun se lève avec son étoile, nous veillerons à ne pas trop nous éloigner les uns des autres, tout en nous éloignant un peu quand même. Oui, nous « essayerons d’apprendre à revenir mais pas trop tard » ; cependant, il est juste et bon, parfois inspirant, de rester ce que Mama Béa Tekielski présente comme « d’étranges frères étrangers » dans le sublime « Visages ». Ce 31 janvier, pour peaufiner son spectacle dont la première est prévue le 9 mars à l’Atelier du Verbe, l’artiste avait réuni des étrangers qui entendaient de concert la voix de Pauline Halexander avant de retourner à « leur solitude encore » (Langevin / Cousineau). Ce n’était plus que du Julien, c’était plutôt du Halexander, et, vingt ans après un suicide désespéré, ce prolongement est, étrangement, joyeux.
Yves Henry, « Chopin : les années Nohant », Soupir éditions

Jadis, « Les années Nohant, 1839-1846 » fut un livre-disque. Désormais libéré de sa gangue textuelle, le travail d’Yves Henry, reconstituant six étés de compositions chopiniennes, revient sous forme d’un coffret de quatre disques disponible dès 29 € sur fnac.com et dès 25 € sur la marketplace d’amazon.com, par ex. L’occasion de faire revivre une série de grands enregistrements, réalisés entre 2004 et 2008, à travers le disque, donc, mais aussi à travers des concerts (comme à Villabé fin 2017) et des émissions de radio (comme avec le pénible sucré de service, aka Olivier Bellamy, le 12 janvier 2018, où Yves Henry le pédagogue bienveillant que nous applaudîmes tantôt, insiste, entre deux bêlements du mielleux, sur trois points : les genèses biographiques des œuvres, le rôle des pianos et l’importance de la transcription).
Soyons clairs : ce quadruple disque, porté par un Fazioli de folie et une remarquable prise de son de Joël Perrot, patron de Soupir éditions, soutenue aux trois quarts par la célèbre acoustique de l’église évangélique Saint-Marcel louangée (sans surprise) ici, est formidable pour trois raisons. Un, Yves Henry est un interprète aux moyens techniques hors normes ; deux, c’est un connaisseur superlatif de Chopin en général et de Nohant en particulier ; et trois, il sait transformer sa connaissance et sa jouissance pédagogique en musique. Ainsi admire-t-on le musicien pour… pour quoi, d’abord ?
Pour sa capacité à faire chanter la mélodie même quand pullulent les notes, fussent-elles contradictoires (« Nocturne » n°2 op. 36).
Pour sa conduite cohérente du flux diégétique (« Marche funèbre » de la Sonate n° 2 op. 35 en ABA).
Pour sa facilité à dérouler les pièces avec doigts (« Scherzo » n°4 op. 54), toujours dans la légèreté mais sans rechigner parfois à l’ivresse de la résonance (« Ballade » n°4, op. 52).
Pour sa triple marque de fabrique : clarté du discours (« Prélude » op. 45), autorité face au clavier (« Fantaisie » op. 49), et sensibilité sans affèterie même dans les tubes (« Polonaise » n°6 op. 53, « Valse » n°2 op. 64 pour conclure le coffret).
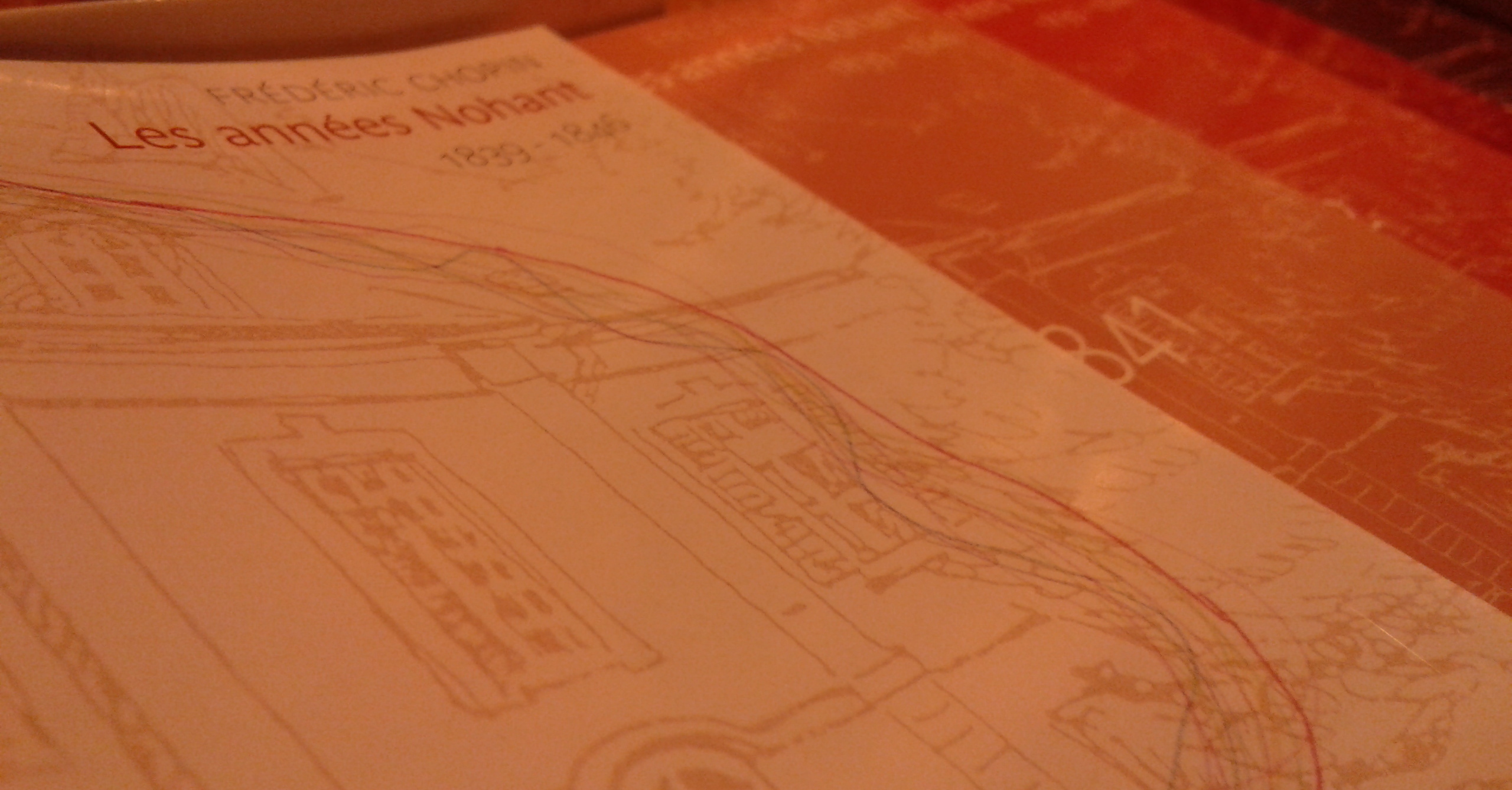
Sur un répertoire joyeusement rebattu, ici présenté autour d’une problématique géographique, Yves Henry démontre ou, plus chic, fait démonstration de son art interprétatif, qui va bien au-delà de son statut de patron du festival de Nohant. Pour s’assurer que je ne cire pas les pompes d’un produit il est vrai reçu en envoi presse, il faut, certes, entendre la délicatesse du premier « Nocturne » op. 55. Car le musicien peut autant éblouir par ses envolées digitales (brève « Valse » n°1 op. 64 : comment fait-il pour obtenir ce son si discret et pourtant si nourri à gauche et cette délicatesse perlée à droite ?) que happer l’auditeur dans son piano fascinant sans virtuosité extravertie (« Nocturne » n°2 op. 62). Surtout, il faut ouïr le souci de caractérisation narrative dans les œuvres plus longues (sonates 2 et 3, laquelle devient presque intéressante de bout en bout, finale compris, tant Yves Henry met de cœur dans le rendu des nuances et des dynamiques) et la singularisation spécifique à chaque pièce livrée en trilogies (mazurkas et études).
Dès lors, devant un tel coffret réédité à petit prix, on ne peut guère critiquer le soin médiocre apporté au détail du package, comme souvent pas vraiment au niveau du contenu. On regrette par exemple un dos perfectible (débord de la première de couv sur cette partie), la relecture imprécise (par ex. : guillemets de fermeture ouvrant la ligne 8 de la p. 2 ; ou itals, tirets et caps aléatoires p. 9), de nombreuses fautes d’orthographe (comme « Festival qu’y si déroule chaque été », p. 3 ou « bien sur » p. 10), des enchaînements souillés dans le livret (pp. 8-9), et un texte d’Irena Poniatowska qui, après un début instructif, dérape vers la distribution de bons points « géniaux » à l’intention d’un compositeur qui n’a pas besoin de ces flonflons lourdauds pour convaincre de son intérêt. Cependant, ces méchants détails restent, précisément, des détails, prouvant ainsi que leur nom leur tombe plutôt bien aux entournures. En effet, les parts les plus importantes, id sunt la prestation artistique et la réalisation sonore, sont, elles, autant que nous les puissions jauger, à la hauteur d’un interprète exceptionnel au service d’une œuvre forte dissolvant dans l’exigence de son talent les caricatures stéréotypées et les histoires de fesses auxquelles renvoie souvent le concept réducteur de George Sand. Bluffant et chaudement recommandable.
En attendant Valérie Capliez…
Komm Bach prétend être le plus petit festival international du monde, et il le prouve. Après la venue de la suprême soprano si américaine Jennifer Young et du merveilleux virtuose so british Peter Bannister (ouais, le même jour, mais ça swagait alors ça passe), ce samedi 27 janvier permettait d’applaudir nos invités italiens.
Des fous. Disons-le d’emblée. Trois jours in situ de registration, répétition et… accord des anches, Salvatore Pronestí étant à la fois organiste et facteur d’orgue. Et toujours le même sourire, la même motivation, la même exigence professionnelle couplée à la même attention aux autres.
- Photo : Rozenn Douerin
- Photo : Rozenn Douerin
Accueillir des artistes de passage aussi motivés, c’est recueillir des confidences, dont certaines restent à la tribune, d’autres pouvant souplement circuler – comme cette émotion de Laura Sarubbi avouant que « son vrai amour, c’est l’orgue ». C’est partager des moments avant les répétitions, après, avant le concert, pendant, after. Et constater la constance de ces personnalités passionnées de musique, peu troublées par la hhhaine que tel ou tel confrère peut professer à leur encontre. Et, surtout, goûter un concert formidable.
Le 27 janvier, entraient trois ingrédients dans le clafoutis de ce récital à quatre et huit pattes. Des pièces pour virtuose (Bach, la sixième de Mendelssohn et les « Litanies » de Jehan Alain, donc, sans que je n’y sois pour rien, including deux des compositions que je kiffe et qui exigent des doigts et du talent), des pièces pour créatif (improvisations, dont une sur Verdi, dont on regrettait l’anniversaire de la mort) et des marches symphoniques pour processions italiennes transcrites à vue (sinon, c’était trop simple).
- Le conducteur de la marche symphonique avant transcription à vue. Photo : Rozenn Douerin.
- Journée de la mérmoire. Hommage de Laura Sarubbi et Salvatore Pronestí. Photo : Rozenn Douerin.
Comme ça ne suffisait pas, les deux fous ont demandé de pouvoir jouer un bis. En effet, le 27 janvier étant la journée de la mémoire, ils ont proposé de jouer le thème principal de La Vie est belle. Émotion et enthousiasme. Grand moment. Merci aux présents. À eux et aux absents, rendez-vous le 10 février pour le prochain récital d’une énergumène, Valérie Capliez, délicieuse organiste, figure de l’instrument et personnalité atypique. C’est assez pour que l’on soit triste si vous ne vous faufilez pas par ici en tanzé aneur pour la plodir.
Daniel Kientzy (2/3) joue Cornel Ţăranu, Nova-musica

Depuis 1986, Daniel Kientzy travaille régulièrement avec des ensembles roumains, ce dont témoignent plusieurs disques, aux pochettes parfois quasi identiques, comme pour souligner la continuité du boulot entrepris. En 2017, en sus du projet « Hammond » chroniqué tantôt, est ainsi parue sur son label une monographie constituée par quatre compositions de Cornel Ţăranu. (Constituée de ? Constituée par ? Oh, pis mârde.) En voici quelques aperçus.
Diferencias pour sax baryton et orchestre (15’)
Concerto ou batalla ? La composition qui ouvre le disque raconte une histoire sanglante où les différences feutrées s’effacent derrière des dialogues résolument virils. Sur un motif rythmique sans cesse dupliqué, la musique se déploie, se cherche, s’emballe, s’éteint puis ressurgit dans des barrissements de sax baryton (des baryssements ?). L’instrument se risque petit à petit dans des galopades mourant dans un tapis de cordes. Surnage alors une clarinette basse qui ouvre la voie à une citation fuguée de Antonio de Cabezón, dont les diferencias sont fameuses. Le saxophone proteste contre cette intrusion. Alors, par grappes, l’orchestre commente les interventions du soliste. Aux deux-tiers du concerto, Cabezón est de nouveau convoqué, mais sa citation est ponctuée par des explosions que prolongent des gémissements saxophoniques. Le tempo en vient à se déliter, et le sax profite du retour au calme pour insuffler un début de tempête, nuance piano. Le souffle agite l’orchestre, avant que le motif liminaire zèbre cette harmonie jusqu’à transformer le baryton en didgeridoo grinçant. Plus personne ne rétorque. L’orchestre reprend par à-coups, et le baryton va chercher dans les aigus une réponse à cette quête initiale – celle qui prend fin mais ne se résout pas.
 Hommage à Bartók pour sax sopranino
Hommage à Bartók pour sax sopranino
et quintette à cordes (9’30)
Sur une cellule évoquant, selon le compositeur, « l’anagramme de BELA », le deuxième morceau, pourtant de quinze ans antérieur au premier, travaille une rhétorique proche de Diferencias : ressassement d’un motif reconnaissable, soli ponctués par l’orchestre, rhapsodie de moments distincts, usage rare mais caractéristique du saxophone comme percussion, utilisation sporadique du silence pour couturer la trame. Ici, cependant, sous la direction du compositeur, le quintette, plus sobre et souvent à l’unisson pour ponctuer l’élégie du soliste, aime à jouer les extrêmes, dans l’aigu ou dans la nuance douce. Les amateurs de mélodie passeront leur chemin, mais les auditeurs qui aiment qu’un morceau leur raconte une histoire afin de récompenser leur attention goûteront ce récit drrramatique aux accents modaux ouvertement transylvaniens.
Semper idem pour sax soprano et alto,
avec orchestre (17’)
L’œuvre la plus récente (2015), présentée comme une forme sonate, chère au compositeur, s’inscrit dans la continuité des éléments de langage exploités et explorés jusqu’alors. Au soliste, armé de deux saxophones et de sa voix, c’est pas rien, répond un orchestre hésitant entre des accents répétés, un tapis de cordes, des échos de cuivre, des reprises du leader, le tout s’impatientant dans un labyrinthe semblant semper idem. Cristian Brâncuşi est à la baguette pour guider les tensions oppressantes promises par la partition. L’inquiétude et les brisures du discours, auxquelles font écho des battements de timbales, plongent l’auditeur attentif dans l’exploration d’un monde sans issue, toujours pareil, que la forme ABA surligne. La voix du saxophoniste (12’20) tente bien de s’extirper de son instrument lors de la cadence, l’orchestre reprend son martèlement et lui impose silence.

Laudae pour sax soprano,
quatuor à cordes et piano (8’30)
Dans le livret, Cornel Ţăranu indique les trois singularités de cette composition parmi les quatre œuvres au programme : pédales de sons aux cordes typiques de la musique populaire roumaine (le thème en moins) ; écriture non mesurée ; structure partiellement aléatoire ; et bithématisme. La pièce permet à Daniel Kientzy de faire briller sa virtuosité puisque ce n’est que par la tenue de son timbre, sur toute la tessiture, que tient le discours, à la fois translucide (un même motif similaire guide quasiment toute la pièce) et déstructuré (à force d’être rabâché, le motif hache le propos et lui ôte toute linéarité). Laudae gagne donc à être écoutée à la fin de cette monographie, comme y incite le disque, car elle propose une synthèse de l’art du compositeur, libérée du pathos narratif qui faisait vibrer les précédentes compositions. Moins concertante que les autres pièces, elle propose un duel entre, d’un côté, un saxophone, de l’autre, un quatuor à cordes et un piano. Le résultat ne manque ni d’énergie, ni de virulence, grâce à la baguette de Carmen Cârneci, d’autant que la relative brièveté de la pièce et le triple contraste entre accents, nappes de cordes et envolées solistes, nourrissent l’intérêt de ces curieuses louanges.
Conclusion
N’en déplaise aux chastes oreilles, ce disque réjouit derechef notre curiosité. Non, les créations pour saxophone ne se résument pas à des cris de porcs que l’on égorge, comme on a pu lire çà ou là. Il faut reconnaître la spécificité de cette musique ainsi que la force d’un musicien aussi passionné de renouveler et de secouer son répertoire que Daniel Kientzy. Sur chacune des pièces, convoquant quatre sax différents, on apprécie les techniques de l’instrumentiste, son souffle qui semble parfois infini, sa précision rageuse et sa justesse anti-vulgarités dans l’ensemble des registres. Ces qualités sont soulignées par des ensembles toujours compacts malgré de nombreux breaks, et le tout bénéficie d’un son précis sans être sec. Encore une belle découverte pour mélomanes curieux.