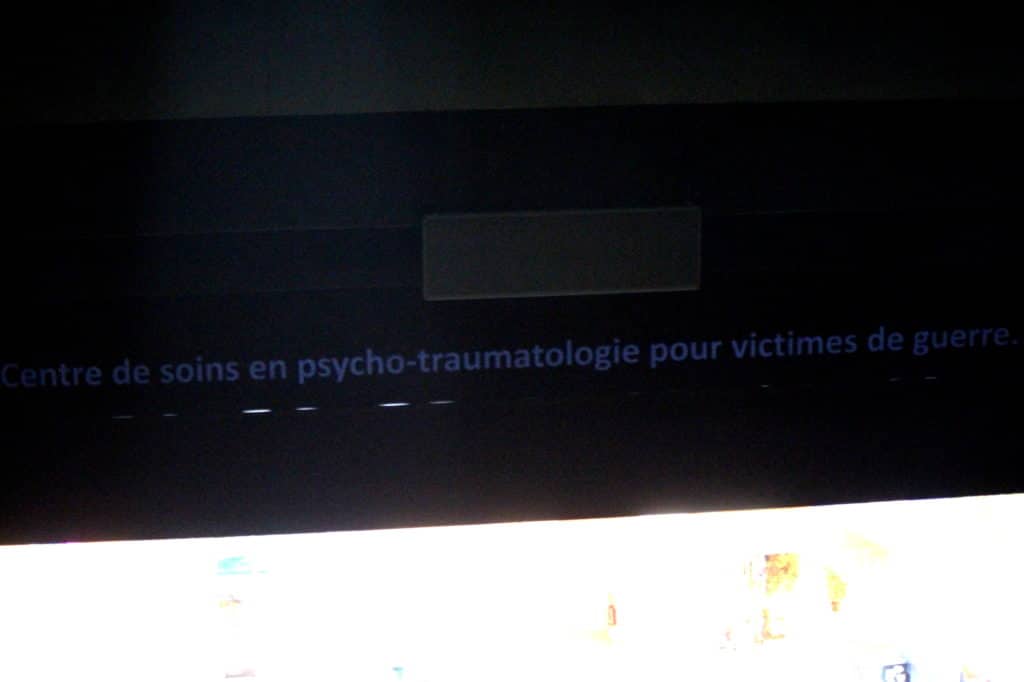Pierre Chastellain, « Pavillon large », VDE-Gallo
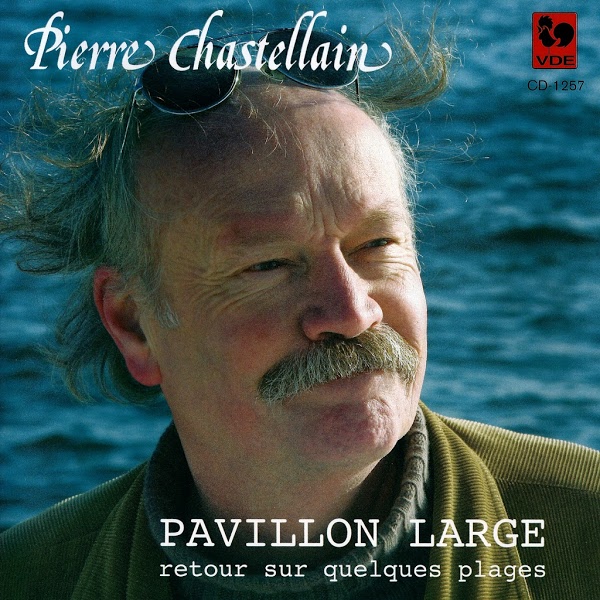
Grâce à la complicité d’Olivier Buttex, nous poursuivons de façon plus approfondie l’exploration du catalogue de VDE-Gallo, célèbre maison suisse de « musique savante » mais pas que. La preuve avec ce florilège de Pierre Chastellain, rassemblant « quelques plages » de 1976 à 1980, avant qu’il ne renonce à cette carrière. Signe, au besoin, que la chanson suisse de qualité ne s’arrête pas à Michel Bühler (même si, dans les crédits du présent disque, l’on retrouve un certain Léon Francioli, collaborateur de fond du sieur Bübü) ou à Sarcloret.
Lors de sa période d’activité chansonnistique, cet ex-sosie de Jean Ferrat développait alors une chanson volontiers poétique voire lyrique, tantôt comme auteur-compositeur-interprète, tantôt comme interprète de Pierre Ellenberger ou Gil Pidoux, côté textes, Alfred Thuillard côté musiques. D’emblée, on note la qualité du mastering signé Jean-Pierre Bouquet, qui transforme des vinyles de la fin des années 1970 en CD parfait (allez, pour montrer que l’on a écouté, il semble que le montage de la piste 9, 1’20, eût néanmoins pu être affiné ; et la reprise des cordes façon Jacques Walmond n’a pu clarifier miraculeusement la bande originale). Il faut bien ce travail, subtil car jamais dénaturant, pour apprécier la diction plus précise que précieuse du chanteur, pas très loin d’un Jean-Marie Vivier, l’emphase en moins (ce que certains apprécieront…). Le texte est si bien chanté que l’on s’amuse à repérer les moments où la langue a quasi fourché – comme pour ces « trompettes dernières » qui passent juste-juste, piste 3, 1’20 – toujours ce 1’20, comme pour la piste 9 : malédiction ou hasard scientifique ?
L’ouvrage est joliment travaillé, avec tantôt un côté Jean Ferrat, forcément, l’engagement profitable en moins, tantôt une verve façon Jacques Brel par certains accents d’amplification, voire, lors d’une amusante quasi-parodie québécoise, une once évoquant la vitalité du barde alsacien Jo Schmelzer (« Les amours parallèles »). Les arrangements sont-ils datés ? Souvent, logiquement, et c’est tant mieux ! Certes, l’on a goûté, grâce au formidable pianiste-et-pas-que Jean-Paul Roseau, les autoreprises de feu Jacques Serizier ; certes, l’on ne se réjouit pas moins des relectures tardives de feu Pierre Louki, de feu Ricet Barrier – dont les amateurs de Tel quel savent ce qu’il doit aux « d’mi-heures de spectacle filmées par la Télévision Suisse Romande » – ou de pas feu Gilles Vigneault, par exemple ; mais il est heureux que certaines chansons restent « dans leur jus d’époque ». Ainsi, « La centenaire » (« la condamnée de bas étage est une vieille maison (…) / car les maisons, c’est comme les gens : on les abat pour de l’argent ») pourrait-elle mieux faire sonner ses breaks typiques sans ses guitares électriques vintage ?
Porté par une inspiration polymorphe selon les auteurs, l’artiste, sans se ménager, balaye – que c’est drôle, mais bon – moult thèmes parmi lesquels : la nature, donc l’hiver ; l’amûûûr, y compris chez les Airbus, les 2CV, les baleinières ou les rames de métro ; la Suisse, si si, ce pays où, même à la fin d’un banquet, « l’on n’entend jamais : un homme à la mer », louait Ricet ; les grands sujets, les grands machins, selon l’expression d’Anne Sylvestre, avec « Amnistie ! » et « La petite Maïlam » (« à treize ans, les fill’ de chez nous, c’est marelle et billets doux / à treize ans, au pays des bambous, on la dépucelle à genoux ») ; les enfants et l’enfance, sans négliger ni les jeux de mots intertextuels (« Madame la chanson », avec son intro qui semble inspirée, peut-être fortuitement, par le son du génial Gentle Giant, façon « Turnin’ around », de 1977, soit deux ans avant la réalisation de la chanson), ni les questions essentielles comme : le lac Léman est-il une femme ? ou : y a-t-il meilleur refrain à une chanson d’amour que « lala, lala, lala », comme pour les violons de Kosma ? et : les eaux dormantes des miroirs parlent-elles de nous sans nous connaître ?
Dès lors, sous la pression de Pierre Ellenberger, l’artiste est souvent plus proche de la chanson poétique, parfois non loin d’un James Ollivier ou d’un Jean-Luc Juvin, que de la chanson « à texte » façon franco-québéco-belge. Voilà une séduisante manière, pour un musicien, de cultiver sa singularité en faisant fi des formatages opposant une certaine chanson à d’autres chansons incertaines – par ma foi, en faire fi, c’est plus chic que de les envoyer chier, même si l’un n’empêche pas l’autre. Le résultat d’ensemble ? Une chanson intelligente et intéressante à découvrir ici, pour la version YT, et là pour la version CD.
Jean Guillou, Widor et Vierne, Augure
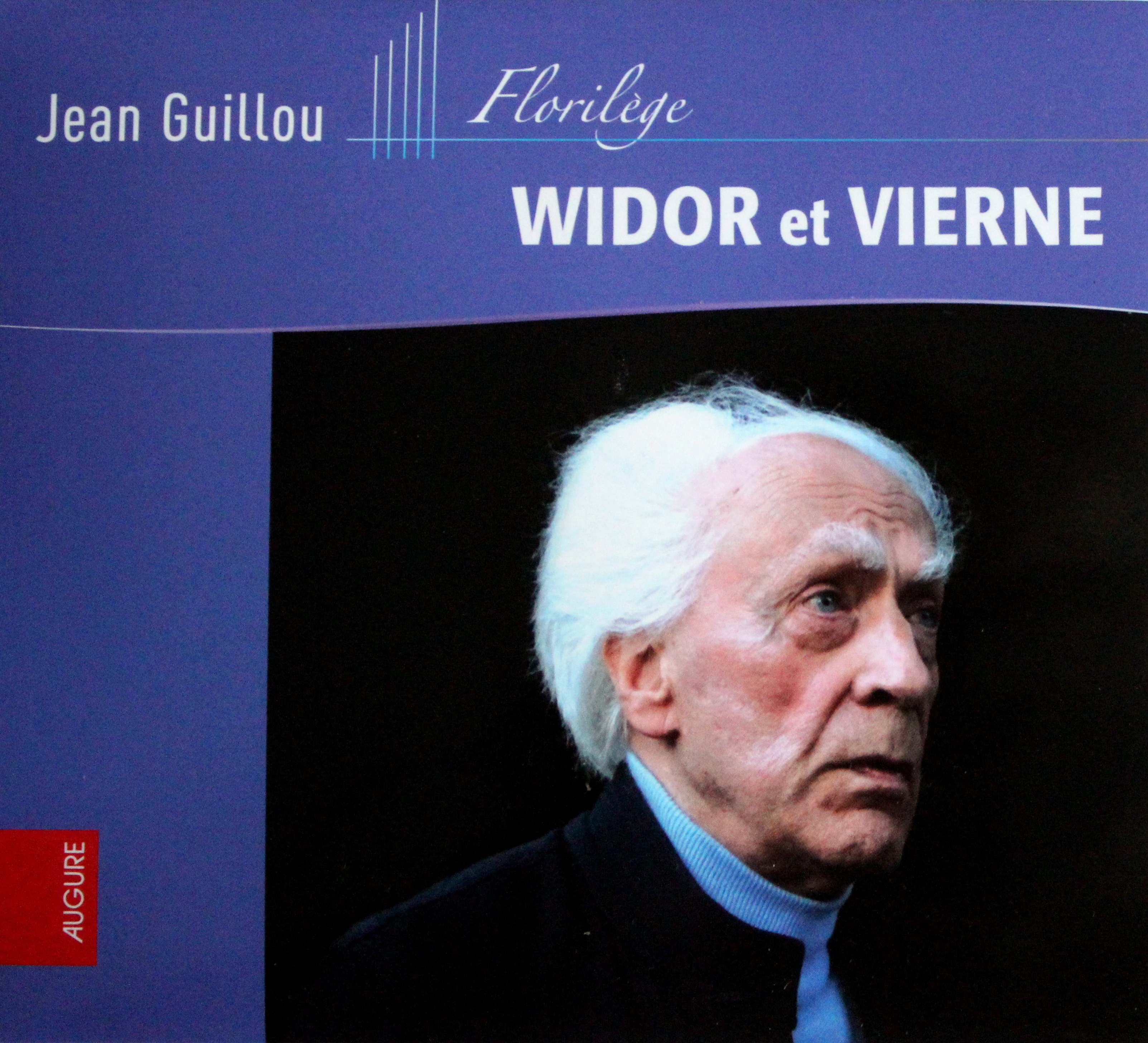
Augure nous faisant l’amitié de nous fournir notre pain guilloutique régulier, la série de chroniques posthumes commence vraiment avec ces quelques lignes de la onzième notule. En ce jour d’hommage à la vedette, célébré sans doute malgré lui à Notre-Dame, nous avons donc choisi à dessein d’ouvrir la fête mortuaire avec ce disque, dernier phonogramme compilé du vivant de l’artiste, avec son approbation et avec la générosité coutumière des disques d’Augure – le présent opus propose 78’ de sons. De patchwork, il sera question à propos de cette compil’ Widor + Vierne, puisque ce florilège assemble des prises dissemblables : live et prise unique, dans différents endroits… parfois même pour une même pièce. Ainsi, l’Allegro de la Cinquième symphonie de Charles-Marie Widor est capté à Saint-Laurent, à Rotterdam, tandis que les éditeurs ont choisi, pour la Toccata de la même symphonie, la version gravée à Saint-Matthias, à Berlin – sans doute parce que le second volume des lives à Saint-Matthias incluait déjà l’Allegro de la Cinquième. Bref, une question s’impose : cette œuvre de mémoire, qui s’inscrit dans le travail rigoureux et passionné de l’association Augure, vaut-elle comme trace d’un grand interprète ou mérite-t-elle aussi l’intérêt des mélomanes non guilloumaniaques ? Seule manière d’esquisser une réponse : écouter de toutes nos deux oreilles et, si l’émotion s’en mêle, du cœur itou.
L’Allegro de la Sixième symphonie de Widor (9’30 avec cadence !) est l’un des tubes des organistes. Enregistré en 1979, ce premier mouvement associe la solennité d’un tutti dynamique au quasi détaché qui permet à l’interprète de faire respirer et de rendre plus intelligibles les accords qui cinglent l’église. Le pari de l’exécution réside dans ce désir schizophrène de maintenir la pompe sans négliger la vitalité, la liberté et même la facétie : au-delà de la coquetterie d’un virtuose souhaitant montrer combien il virevolte avec aisance – il se le peut permettre, le bougre –, la registration de la pédale (20 jeux disponibles !) avec quelques jeux aigus (quatre registres de pédale entre un et quatre pieds !) ne manque pas d’ironie pour l’arrivée du passage en La. Une cadence pyrotechnique ajoute « beaucoup d’effet » à ce qui, déjà, n’en manquait pas. Celui qui n’a pas frissonné devant une telle débauche d’agilité puissante persillée de malice ne frissonnera décidément jamais et, après tout, tant pis pour sa mouille.
La Cinquième symphonie de Widor est expurgée de ses mouvements centraux pour n’offrir que le premier et le dernier de ses membres. Certes, dès l’Allegro (10’), on décèle çà et là des montages perfectibles (ainsi, celui de 0’07, piste 2, fait sursauter !) ; mais la qualité des bandes originales, déjà quadragénaires, est sans doute plus en cause que le travail de fourmi réalisé par Jean-Claude Bénézech et ses acolytes auguriens. Le mouvement premier permet d’entendre de nouvelles sonorités, des fonds aux petites flûtes que l’artiste éclaire de façon multiple en jouant habilement avec la pédale d’expression. Après quoi, le musicien s’éclate et transforme la partie-à-doubles-croches en « Vol du bourdon ». Ce n’est pas absurde, c’est croquignolesque, pétillant et éminemment spectaculaire. Les modulations sont enlevées avec évidence ; et, si le son n’est pas toujours parfait, l’éventuel manque de définition des graves n’empêche certes pas de suivre les débauches de virtuosité et d’élan vital, symbolisées par la pulsion des accords détachés de la coda avec, pour conclure, la p’tite tierce picarde qui va bien. Il faut alors bondir à Saint-Matthias de Berlin, en 1983, pour profiter d’une toccata enlevée en moins de 4’. Hénaurme tube d’organistes elle aussi, la pièce, jouée ici dans sa version de 1918, fonctionne autour d’un ostinato emporté tellement vite que l’on se demande si les claviers n’ont pas brûlé après le passage de ce grand malade de la vitesse, obligé de swinguer les accords répétés pour avoir le temps de les faufiler. Le jaloux pointera quelques arrangements avec la lettre de sa partition (par ex. à 2’20, changement d’octave de la pédale après le ré bémol, na), quelques confusions, la fatigue aidant (3’10). Le propos n’est certes pas là : cette toccata plaira aux amateurs de technique et de performance, comme elle pourra laisser sur la touche ceux qui aiment admirer des artistes associant une technique surhumaine à un souci de donner à entendre de la musique, pas uniquement des quadruples saltos vrillés. Il est clair que cette berlinade n’a point été effleurée par semblable souci… hélas, à notre très-pas-humble goût.

La Deuxième symphonie de Vierne est un monstre de 33’33 que Jean Guillou a enregistré le 3 juillet 2003 dans son fief de l’époque, Saint-Eustache. L’Allegro (7’) s’engage dans la voie de la liberté, chère au maître qui joue à domicile. Curieuse impression que cette ouverture dépenaillée : surprise, certes ; mais aussi gâchis apparent du groove qu’a réellement écrit Louis Vierne avec syncopes, échos, contretemps, etc., qui n’avait peut-être pas besoin que lui fussent ajoutés quelques déséquilibres apocryphes. Désarçonné, l’on profite davantage du voyage dans les multiples couleurs de l’orgue – alléluia, y a de quoi faire – que de la promenade viernoise. En fait, cette volonté de secouer la partition s’apaise petit à petit et nous permet de jouir, allons donc, de cette musique à la fois ressassante (un même motif pointé passe et repasse), inventive (ses déclinaisons ne manquent pas de stimuler l’écoute) et ambitieuse (elles font voyager l’auditeur dans l’instrument et dans la musique). Le Choral (8’) s’ouvre sur un majestueux trait de pédale dont l’artiste semble avoir évacué les huit pieds pour rendre d’emblée l’atmosphère – sombre – du mouvement, par opposition à celui qui a précédé, et ce, grâce au 32’ ou aux 16’ les plus sourds. La relative faiblesse de la prise de son rend ce discours plus suggestif que clair. Le propos peut justifier cette posture, oscillant de modulations en modulations, d’Agitato en Largo et retour, de flûtes tremblantes en ensemble d’anches. Une évidence : le crescendo final démontre une science de la registration fascinante. Le Scherzo (moins de 4’) est pris pied au plancher. On y gagne en énergie, en vitalité et en spectaculaire – il faut se le fader, ce mouvement, qui plus est à ce tempo ! – ce que l’on perd en poésie, en dépit des magnifiques sonorités de Saint-Eustache. Comme souvent avec le Jean Guillou interprète, l’appréciation de l’exécution ne relève guère du jugement mais révèle les préférences de chaque auditeur. Mais écou(r)te-t-on Vierne par Guillou pour entendre Vierne ou Guillou ? Vous avez demi-heure.
Le Cantabile (7’) ne laisse pas de défier le Larghetto grâce à l’allant de l’organiste, d’une part, et, d’autre part, grâce au toucher énergique marquant le lead confié d’abord au Cromorne. L’écriture, fort complexe (c’est un euphémisme), est un terrain de jeu gourmand pour l’ardeur de l’interprète qui fait en effet sonner le Wagner qu’il affirme déceler non sans convaincre (2’53, 3’33). Ce quatrième mouvement n’est sans doute pas le passage le plus sexy de Louis Vierne, faut l’dire, hein, on n’est pas dans du pomme-pet-deup, mais aussi bien joué sur un orgue aussi adapté, c’est sans doute l’un des plus émouvants. Le Final (moins de 8’) permet à l’interprète de renouer avec, et d’une, une virtuosité plus exubérante, et de deux, la liberté. Ici, les effets d’attente nous semblent, prétentieux que nous assumons d’être, mieux venus, moins outrés, plus au service du discours du compositeur que dans l’Allegro. Les cornets sonnent ; les basses grondent ; les ruptures de rythme et les contretemps instabilisent, je tente, joyeusement l’écoute ; les contrastes éblouissent ; les modulations passent comme courriel en 5G – hé-hé ! remotivation d’un syntagme figé, et hop ! – ; les progressions ou changements de registration rendent justice à l’orgue joué ; le détaché-alla-Guillou (6’27) fait merveille – bref, seul regret : une prise de son qui, seize ans plus tard, n’est évidemment plus à la hauteur des standards attendus, ni dans le dessin des graves, ni dans le ciselage des tutti (7’17, va-t’en entendre les traits de pédale…). Pourtant, la déficience phonographique porte témoignage et n’altère pas l’appréciation d’une performance techniquement impressionnante et musicalement incapable de laisser quiconque indifférent. En somme, cette version est à acquérir en seconde intention, pour contrebalancer l’idée que l’on a pu se faire, à partir d’interprétations plus sages, de ce qu’est ou de comment se joue une symphonie de Louis Vierne en général… et la deuxième en particulier.
Est venue l’heure des compléments de programme, à commencer par le Carillon de Westminster, mégahit extrait des Pièces de fantaisie de Louis Vierne. Avec une honnêteté amusante, l’éditeur avoue n’avoir pas su choisir entre deux versions… et propose donc ses deux finalistes – en les séparant sur la set-list pour éviter la lassitude de qui écouterait le disque en continu. La première est issue d’un enregistrement à Saint-Bavo de Haarlem en 1979. Foudroyée en 5’ (Olivier Latry la joue en 6’45, on n’est pas sur le même saucisson), cette version a l’intérêt de l’exceptionnel, au sens d’inouï. C’est au-delà du brillant et, pourtant, en dépit de la beauté de la pédale et de l’équilibre des registrations, cela nous paraît plus vain et confus qu’ébouriffant (écouter par exemple piste 9, autour de 3’11). Quoi que cela ne manque pas d’une certaine saveur, on imagine plus, à l’occasion d’un bis, une tentative de record du monde de vitesse qu’une interprétation sensée et profonde. Comme dirait notre chouchoute Esther Assuied proposant une interprétation autrement plus passionnante de la Danse de la mort de Franz Liszt : noise.
La seconde version, qui clôt le disque, est issue des gravures du 3 juillet 2003 à Saint-Eustache. Moins hâtive, moins soufflante que la première (« irrégularités dès la deuxième mesure, confusion dès la septième », note avec satisfaction le très-médiocre organiste bouffi de jalousie haineuse), cette proposition est beaucoup plus séduisante musicalement : les différents plans sonores sont caractérisés, les sonorités sont magnifiques malgré une moins bonne prise de son, l’énergie de la main droite ne contamine pas l’ensemble de l’exécution, les mutations de registration sont splendides, et les imperfections de cet enregistrement sans doute « dans les conditions du direct » (pédale à 4’21… et suivantes, par ex.) n’ont guère d’importance pour un tel document. Là, on entend de la musique, bon sang !

Dans la même série que le Carillon, l’Impromptu est aussi un tube d’organiste constitué d’une farandole qui s’ébroue irrégulièrement pendant près de 4’. Également enregistré le 3 juillet 2003 à Saint-Eustache, il débute sur un curieux hoquet dès la troisième note et s’accompagne de quelques broutilles qui, loin de faire oublier la qualité des justes notes, valorisent l’intérêt d’un enregistrement sinon à la va-comme-je-te-pousse, du moins à la bonne franquette, comme si l’artiste nous gratifiait d’un récital privé, une fois les portes de la grande église close. Donc ça sature parfois, ça bouscule sciemment, ça pose ou ça accélère quand ça veut, ça trébuche si ça s’présente (piste 12, 2’39, par ex.), mais ça vit, nom d’un p’tit mouton, ça vit ! Le Scherzetto, techniquement hypermoins ardu que les autres pièces, est joué (sur le 3 claviers-40 jeux de Middelbourg) de façon bousculée, comme pour cacher la relative facilité sous une urgence facétieuse… peut-être aussi excitée par la bruyante présence humaine audible piste 10, 0’13. S’inspirant de la registration officielle, Jean Guillou n’y ajoute pas moins sa marque avec les tremblants qui lui sont chers. Le résultat est plus personnel que susceptible de combler l’amateur guindé de Vierne – mais écoute-t-on une interprétation pour retrouver des notes en son ou pour écouter la cohérence entre les notes théoriques et la mise en pratique par un médiateur artistique ? (Nan, même moi, j’ai décroché en cours de phrase, pas de panique.) Enfin, la Toccata, enregistrée itou à Middelbourg, est lancée sur un rythme de fou. Ce devait être très, très spectaculaire en direct ; c’est à la fois vertigineux et guère intéressant à l’écoute, à moins de chercher sottement les scories (ainsi de la pédale à 1’05) de cette cavalcade démentielle et un peu creuse.
En somme, cette Toccata est à l’image du disque : Jean Guillou avait la virtuosité virevoltante qui le laissait libre de risquer des tempi de guedin. Certes, cette performance circassienne a beau marquer le petit musicien, elle peine, en soi, à l’émouvoir. En revanche, quand la technique superlative s’associe à une science de la registration et à un souci de faire palpiter une œuvre sans se contenter d’en faire un tremplin pour histrion, genre Tryphon Tournesol sur patins à roulettes, là, on tient quelque chose, et quelque chose d’une puissance que peu oseront défier. En ce sens, ce disque est doublement important pour qui veut connaître voire approfondir sa connaissance de l’interprète guilloutiste : il permet d’entendre ses fabuleux excès et d’écouter son art d’interprète. Les deux ne vont pas souvent ensemble, mais leur duel fait le prix de ce disque anthume, supérieurement édité avec un livret mentionnant la composition de chaque orgue et dévoilant une présentation trilingue qui associe les mots du maître à ceux de ses plus fervents et pertinents supporters.
Acheter le disque : ici.
Consulter nos précédentes chroniques de disques guilloutiques : là.
Komm, Bach!, épisode 57
Croirait-on qu’interpréter les Variations Goldberg de Johann Sebastian Bach puisse être, de nos jours, une provocation ? Sans doute pas si l’on n’a point suivi l’affaire çà ou là. Mais voilà que surgit Pascal Vigneron, le taulier du festival Bach et de l’orgue de Toul, le rganiss trompettiss, le policier facteur, dont nous avons chanté les louanges parfois, et parfois moins même si c’est pas sa faute. En vrai, il ne surgit pas seul en l’église Saint-André de l’Europe : il débaroule avec son orgue-à-lui, dont les lecteurs assidus ont aperçu l’arrivée.
Devant une église bien garnie de spectateurs, la question est : est-ce choquant d’introduire un mégasynthétiseur, appelé orgue Virtualis, alors que le festival invitant célèbre depuis octobre 2016 le come-back de l’orgue Delmotte-Béasse, restauré par la Manufacture Yves Fossaert ? À cette question légitime, on peut proposer trois réponses. La première est liée à la curiosité provocatrice : et pourquoi pas, surtout si cela fait bisquer les grincheux prompts à insulter sur les réseaux sociaux ? La deuxième est : où est l’artiste qui jouerait les Goldberg sur l’orgue local ? Qu’il m’envoie son CV (avec ses exigences), et l’on en reparle. La troisième est : le projet du festival n’est-il pas d’ouvrir le récital d’orgue à des propositions tant traditionnelles que musicalement puissantes et charpentées, répondant au projet d’une manifestation d’orgue-et-pas-que ? Cette expérience, unique sur Paris avec un tel dispositif technique, était une proposition qui nous a semblé légitime après cinquante-six concerts impliquant l’orgue du coin (qui reprend du service dès samedi 16 février).
Du coup, le concert était l’occasion de tester IRL le meilleur dispositif européen, pour une fois sans rapport avec la banque et la finance, d’orgue électronique via un monstre de Bach. Et, devant le distributeur de son disque, devant son attaché de presse (c’est pas dans l’édition – spéciale dédicace – que l’on verrait des pros se déplacer pour entendre à Paris une vedette de Lorraine-et-Alsace…), devant un public foufou d’enthousiasme même si parfois foufourbu, ça se comprend, par l’exigence de ces plus-que-trente miniatures, le zozo ne s’est pas dépantalonné. Précision des attaques, rigueur des doigts malgré la froidure, inventivité des registrations maison, sens de la suspension, Pascal Vigneron a fait vibrer l’audience par son ambition et sa maîtrise d’une partition qu’il habite plus qu’il ne la rrrrrelit.
Pour ce cinquante-septième grand moment du festival Komm, Bach!, l’artiste avait choisi d’associer l’exigence requise par le souffle du compositeur-qui-écrit-pour-un-insomniaque, la poésie de celui qui s’est inventé un instrument sur mesure, la jubilation de celui qui est capable de se cogner un monstre emblématique du Répertoire Klassik, l’audace du notable-de-province qui n’en a rien à carrer des pince-fesses de bon goût et la qualité du musicien qui sait jusqu’où aller trop loin dans la proposition musicale. Du coup, sans prétendre « imiter » un orgue véritable, c’est puissant, ça virevolte et ça souffle.
Au point qu’une minette a déboulé dans le narthex en cours de récital. Hypercourageux vu que j’ai déjà un procès aux fesses pour tentative d’homicide sur une intruse-de-concert, je me suis interposé sur l’air du : « Vous êtes sûre tu viens pour le concert ? » En fait, non, elle venait pas pour applaudir l’artiste mais « pour se repentir, car j’ai pêché, mon Père ». Sans la lâcher du regard, je l’ai laissée filer demander le pardon divin. Puisse le son de l’orgue Virtualis l’avoir aidée à retrouver le droit chemin, fût-ce par ironie.
Inconscient de son pouvoir rédempteur, Pascal Vigneron a reçu ses passionnés autour de son orgue. Présentation de l’instrument, démonstration sonore, explications musicologiques : comme le veut la tradition du festival Komm, Bach!, en dépit de la pression insupportable de ce stupide organisateur, la vedette ne s’est certes pas défilée. Proximité, simplicité, clarté et émotion n’ont certes rien ôté du mystère de cet instrument en plastique (surtout en chêne, en fait) ou de ce zozo capable de jouer les Goldberg, de gérer un hénaurme festival, de manager un label, d’enregistrer des disques d’exigence, de dispatcher des expositions autour de Bach, de s’occuper avec une gentille esclave du relationnel et de l’administratif tout en maintenant ses ambitions, saines et vertigineuses à la foi(s), d’artiste et de technicien-conseil en organologie. C’est ça aussi qui est fort, faut bien le dire.
Que ce soit autour d’un orgue, autour d’un verre (lui est sobre, c’est là où l’on se demande s’il est vraiment rganiss, policier ou trompettiss, mais bon), ou autour de disques à dédicacer a posteriori, le mec a fait le job. Il a même fait la pub pour ses concerts d’octobre 2019 à Toul, c’est dire s’il ne lâche rien. Sans jamais donner l’impression que c’est exceptionnel, mine de rien, de conduire le camion qui contient son Monstre, monter et démonter trois fois son orgue ou, en une journée, jouer deux fois en répète et une fois en concert (plus que fort bien, et non plus fort que bien, fi) les Goldberg. Le grand sosie de David Cassan et formidable musicien il signor Jorris Sauquet, associé à la grrrande soprano Emmanuelle Isenmann, la dame qui fait frissonner les pierres comme les humains, prendront sa suite le samedi 16 février à 20 h. Grand écran pour tout suivre en live, entrée libre, vrai orgue à tuyaux, chanteuse à deux cordes vocales même si on a l’impression qu’elle en a cinq ou dix, partant concert wow garanti. Contrairement à ce que laissent espérer cette cochonnerie de Pharaon Ier de la Pensée Complexe et ses sbires, il n’y a pas de magie, que des artistes. Merci, Mr Pascal !
Entretien avec Anne-Cécile Makosso-Akendengue, 1er février 2019
Elle débarque spécialement d’Angers pour rencontrer ses lecteurs parisiens : ce 1er février, Anne-Cécile Makosso-Akendengue s’est prêtée au jeu des questions-réponses et des interpellations spontanées. Le prétexte ? Son nouveau roman, Louisette s’invite à notre table (L’Harmattan), qui raconte le bouleversement d’un p’tit employé de banque bien français qui se découvre doté d’une aïeule gabonaise.
Avec sa verve amusée, l’auteur aborde, dans le roman comme dans l’entretien, les questions de l’étrange étrangeté, de la pulsion littéraire, de l’amour, de la joie narrative, de l’Afrique, du rapport entre argent et culture, bref, de la vie entre Angers et Port-Gentil. Une découverte pour beaucoup, un moment savoureux pour tous les curieux.
En camion, Simon
C’est le concert le plus polémique de la série Komm, Bach!, et c’est ce samedi à 20 h, avec un programme de fou accessible à tous (on change de morceau toutes les 2′ et c’est entrée libre). Komm, Bach! est un festival créé pour fêter le come-back de l’orgue de Saint-André de l’Europe après restauration. Comme l’orgue est sis dans le quartier de l’Europe, il impose aux artistes de jouer une œuvre de Johann Sebastian Bach ou en lien direct avec lui (au sens germanophone de : viens, Bach !).
Mais le festival est aussi animé d’une envie de ne pas s’en laisser imposer par les gens sûrs-d’être-bien. Il a accueilli assez de magnifiques musiciens pour que les leçons, on s’en fout. Du coup, quand le directeur du festival Bach de Toul annonce qu’il fomente l’orgue électronique le plus perfectionné d’Europe, sinon du monde, afin de jouer de l’orgue hors des églises, et que, du coup, il se fait conspuer par toutes les p’tites, bref, du domaine, ce pourquoi nous l’avons contacté pour lui dire, en substance : « Hé, zozo, tu veux pas jouer du Bach chez nous ? »
Et le mec a dit oui. Mieux : il a proposé de lancer son disque des « Variations Goldberg » (on parle pas de « Youp-la-boum »), distribué par Socadisc (on parle pas non plus de « ta grand-mère connaît son coiffeur, ça peut cartonner »), pour le festival Komm, Bach!. Et le mec stipula : « Et si y a des gens pas contents, j’m’en fous. » Bizarrement, au moins, c’est un langage qui nous parle. Donc le mec vient jouer un monstre de Bach, sur sa bestiole, en valorisant un disque enregistré sur un vrai orgue, pour donner du lustre à un festival défendant les vrais orgues et singulièrement celui de Saint-André. Ça vaut un tout p’tit peu de manutention.
Soyons corrects : nous défendons l’orgue à tuyaux. Nous pensons que l’orgue électronique à demeure dans les églises, c’est de la merde. Mais nous croyons, ce qui n’est pas si fréquent, à la démarche de Pascal Vigneron qui est de sortir-quand-besoin la musique d’orgue des églises sans prétendre que du balabam-balabam dans une salle des fêtes, c’est aussi mieux que dans un lieu sacré fait pour ça. Voilà.
Nous attendons avec curiosité sa prestation. Nous respectons l’artiste et le mec-qui-en-veut. Nous sommes fier d’accueillir un mec conspué par les béni-oui-oui-du-petit-milieu. Et, ça joue, nous n’avons rien à carrer des chouettes hululant dans le sens du vent qui huent voire nous menacent. Nous aimons juste la musique, et ceux qui veulent entendre l’orgue de Saint-André, bienvenue à tous : dès le 16 février, vous aurez une nouvelle occasion. Avec Jorris Sauquet aux manettes, et la magnifique soprano – c’est pas une insulte – Emmanuelle Isenmann à proximité, ce sera sublime. On vous attend déjà… dès ce samedi 2, 20 h !
Comme un insecte fou

Le 1er décembre 2018, en ouverture de son concert avec Cyprien Katsaris, Esther Assuied est entrée « Dans la lumière » de Robert M. Helmschrott. Aucune caméra n’ayant gravé l’interprétation du rare diptyque de l’octogénaire allemand honoré cette saison par le festival Komm, Bach!, elle a souhaité l’enregistrer pour le rendre disponible à tous. Voici le résultat. Accrochez vos ceintures !
Duo Lafitte, « Essaimer aux confluences du monde », Soupir éditions

Découvrir un disque de Soupir éditions est plus qu’une joie : presque un mystère. En effet, c’est d’abord ne savoir contre quoi l’on va cogner ses oreilles. D’autant que, cette fois, le titre de ce « duo de pianos », aux apparences sciemment énigmatiques, euphémisme (« Essaimer… aux confluences des mondes », oublions le jeu de mots graphique sur « est-ce aimer », d’accord ? le mauvais goût n’est pas réservé aux animateurs de C8, même moi je le chicote quoi que je ne sois ni un virtuose du piano ni une vedette du paf ministériel), n’est guère plus éclairant qu’une set-list partagée entre Rimsky-Korsakov, Mozart, Dvorák, Milhaud, Piazzolla et Nougaro-Datin pour le bis, on y reviendra. C’est ensuite s’enquérir du livret, souvent soigné – ici, prestigieux puisque signé Jacques Drillon, mais verbeux et peu fonctionnel (ha, ces « mondes impalpables qui, pour être immatériels, n’en sont pas moins furieusement vivants », ha, cette « énergie jubilatoire » faisant écho à la promo du site des artistes qui promet un programme « pétri de jubilation musicale », pfff ! ha, cette notice wikipédia sur « Piazzolla » en deux lignes et trois virgules ! mais rien sur la formation des pianistes, rien sur les transcripteurs, rien sur la conception des transcriptions, pourtant très différentes, rien sur la cohérence du programme !). C’est enfin se risquer à glisser le disque dans le mange-disques, avec la certitude de se régaler car, outre les choix du manager de label Joël Perrot, on a grande confiance dans le talent du preneur de son Joël Perrot.
De Shéhérazade de Nicolaï Rimsky-Korsakov, les sœurs Lafitte retiennent les deux premiers mouvements, en revendiquant une « adaptation » écrite par leurs soins – globalement fort proche de celle de Vladimir Stussoff, disponible sur Ismlp. « La mer et le vaisseau de Sindbad » présente leur approche de transcriptrices sans complexe à travers trois caractéristiques complémentaires :
- un, l’importance accordée au rythme et à l’accentuation des temps ;
- deux, un usage généreux de la pédale de sustain, ces deux éléments visant sans doute à « faire orchestre », pulsation et réverbération compensant l’absence de chair et d’embardées propres aux phalanges symphoniques ; et
- trois, bon équilibre des pianos, bien réglés par Jean-Michel Daudon : on apprécie la capacité à se répondre quasi à l’identique (attaque et énergie des triolets en écho) et à créer ensemble de remarquables decrescendi.
D’où l’étonnement devant la boulette du montage, laissant cinq secondes en trop après le premier mouvement, avec bruits de banquette et dialogues d’humains – soyons clair, ce minidétail est de nature à dissiper l’atmosphère que les artistes ont tâché de créer, grâce à une captation jusque-là très recommandable ; hélas, seul celui qui n’œuvre point ne se trompe jamais, etc. « Le récit du prince Kalender » offre aussi étalage des qualités des duettistes. Deux atouts supplémentaires : d’une part, l’énergie requise est là, donc la pédale « atmosphérique » est moins présente, ce qui souligne mieux la vigueur digitale des sœurs ; d’autre part, leur complicité de longue date permet aux interprètes d’associer la précision des attaques à la liberté de dilatation du tempo quand l’esprit de la partition l’exige. La partie centrale, gorgée de tensions, séduit particulièrement et, à son image, le finale brillant ne manque pas de mordant – en témoignent doigts légers, justes et toniques, dialogues réussis, breaks parfaits, mutations d’ambiance savoureuses, transcription sporadiquement personnalisée (ainsi du thème allégé à 7’42, piste 2, le piano 1 insistant sans accord sur les tierces descendantes pour ne pas surenchérir sur la rythmique du piano 2). De quoi aviver les regrets de ne pas entendre la suite de la suite… d’autant que le disque pesant 63’, y avait encore de la place ! Mais les sœurs Laffite préfèrent mix’and’matcher, si si la famille. Aussi, sur leurs traces, basculons-nous dans le monde magique de la Flûte.
De La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart, le duo Lafitte présente d’abord l’Ouverture dans la version de Ferruccio Busoni. L’occasion d’apprécier la qualité des Fazioli engagés, notamment dans les graves, et la tonicité des pianistes. Ceux qui souhaiteront une version plus souple, plus Steinway de la pièce, picoreront ailleurs : ici, c’est douceur des piani et puissance des accents, point d’entre-deux. Cela rend d’autant plus curieux d’ouïr les six airs – pardon, les six « arias » de l’opéra transcrits par le duo. Le premier (« Zu Hilfel! Zu Hilfel! ») oppose la rigueur liminaire à la rieuse luminosité qui sourd au mitan de la pièce pour précéder le moment où les trois nénettes s’intéressent au Tamino mimi tout plein. L’air de Papageno, qui rêve moins de pécho des oiseaux que des nénettes, est intelligemment joué en évitant de minauder. La piste suivante cherche les cloches du glockenspiel susceptibles de dissoudre toute opposition – Joël Perrot veille à ne point dissiper les basses afin de rappeler que l’histoire n’est carrément pas finie. L’hymne à la revanche maternelle donc infernale qu’est l’air de la reine de la nuit, est joué sans brusquerie mais avec la vivacité qui redonne du sens à ce tube souvent soufflé niaisement. Papageno révèle ensuite son kif : faute de poulettes en masse, j’traduis approximatif, une p’tite blondinette (ou, à défaut, « ein weiblicher Mund ») lui suffirait. Les deux blondinettes du disque lui donnent aubade en rendant avec rythme et poésie son fol espoir. Le chœur final nous promet que force, beauté et sagesse ont triomphé, et que nous pouvons le voir puisque nous avons pénétré la nuit : les pianistes rendent cette promesse – un brin fallacieuse, mais admettons que nous n’avons pas été initié – par des contrastes entre l’accompagnement et la mélodie qui court, sans négliger la martialité de l’air maçon.

Les golden hits du classique n’ont souvent fait fuir que les nigauds. Aussi le duo Lafitte propose-t-il de fricoter avec le premier mouvement de la Symphonie du Nouveau monde non point dans la transcription pour quatre mains du compositeur mais dans la « transcription pour deux pianos de Paul Juon » (1872-1940), dont la transcription pour piano seul est disponible sur Ismlp, mais dont la version dédoublée est proposée en « première mondiale ». On mentirait en prétendant que l’apport d’un deuxième piano paraît d’emblée essentiel, mais qui résisterait aux thèmes tubesques joués avec élégance, puis à la puissance permise par deux grosses machines ? De plus, la vitalité des modulations est rendue avec la fougue qui sied. Au point que le retour du motif principal dénonce la faiblesse des Fazioli au médium désaccordé (piste 10, 7’29, sera-ce pas l’un des la bémol qui craqua ?) : force reste à la musique, les instruments, conçus par des humains, restant, alléluia, friables.
Re-bond dans l’espace-temps avec trois minutes de Darius Milhaud, originellement pour deux pianos, via le « Souvenir de Rio », où Joël Perrot propose de laisser autant de place à l’accompagnement qu’à la mélodie sur cette sympathique historiette en ABA, et « Libertadora », qui soukousse à souhait. On passe un cap dans le latin spirit avec dix minutes d’Astor Piazzolla transcrites par l’américano-argentin Pablo Ziegler. Ouvre le bal la « Milonga del Angel », que l’on a entendu plus troublante voire suggestive, mais qui est rendue avec un patent souci de sensualité dont témoignent la profondeur des graves, la suggestivité des aigus et la passion des tutti. Second tube de l’Argentin, Libertango fuse et contre-tempise comme il sied : la technique des pianistes et leur interconnexion donnent son charme à cette option. Le bis final, attribué à Claude Nougaro et Jacques Datin alors que la musique, seule jouée ici, est de Jacques Datin sans le moindre apporte de Claudeuh (mais avec Dave Brubeck qui l’a largement « inspirée », bref). Facétieuse, cette version d’Isabelle Lafitte, aux odeur de quatre mains quoique pour deux pianos, inclut des éléments pour piano préparé (préparé trop tard, hélas, 0’33, piste 15 – ceci dit juste pour laisser croire que l’on a vraiment écouté le disque), et constitue une fin souriante adaptée à ce joyeux récital.
En conclusion, certes, l’on regrette que le livret n’ait pas, plus simplement, moins blablatiquement, exposé la logique de la set-list, qui plus est avec un titre aussi énigmatique. L’on aurait aussi aimé comprendre les choix de transcription (au sens : quelles techniques de transcription furent privilégiées par les interprètes ?) et les choix de transcriptions (au sens : pourquoi ces transcriptions et pas les transcriptions d’autres pièces… ou d’autres mouvements ?). Reste un disque original, inattendu, un brin mystérieux et joué avec un alliage de verve et savoir-faire : qui irait là contre ?
Denise, « Incontrôlable ! », Apollo Théâtre, 29 janvier 2019
Dans un théâtre-usine où l’accueil des spectateurs est, euphémisme, négligé, Mickaël Denis est Denise. Nous avons été invité à l’aller applaudir dans « Incontrôlable ! », son seul-en-scène comique donné depuis plus d’un an à travers la France.
Le pitch : Denise est un travesti hypocondriaque qui, tous les jours, prend en otage la salle d’attente de l’hôpital afin de passer à la radio(logie), de draguer Fabrice, le plus beau docteur Maison – comme le docteur House mais en plus sexy, de profiter d’un gynécologue qui, entre deux chorégraphies échographiques, lui fait profiter de sa main parkinsonnique, et de se former aux premiers secours – bref, de se donner en spectacle afin d’éviter de n’avoir de blues que blanches (c’est exact, elle est nulle, cette pseudoblague, mais je la risque quand même).
Le personnage apparaît de prime abord comme une pâle copie de Marie-Thérèse Porcher, dont elle reprend certains gimmicks ; on pourrait y ajouter des pincées de Catherine façon Alex Lutz et, la perruque en moins, de Gisèle Lapin version Jérôme Commandeur. L’acteur et ses co-auteurs Fonzie Meatoug, Vincent Aze et William Yag, ne masquent pas – ils auraient du mal – leur fine connaissance des concurrents et autres comiques à succès : çà et là, des brothers les mânes, pfff, planent sur le spectacle (Franck Dubosc en tête, avec un petit clin de zyeux à Pierre Palmade version Michèle Laroque pour les crèmes dépilatoires), mais celles des sisters ne sont point loin (Florence Foresti, Anne Roumanoff, Claudia Tagbo, quelques restes de Muriel Robin et bien sûr la réutilisation du « tu veux que j’vas te l’dire ? » de Julie Ferrier, par exemple).
Ce mix’n’match difracte, je tente, un humour pour Club Med, ce qui est plus une caractérisation qu’une stigmatisation, avec chansons ouvertement surannées et interactions chargées de rendre le public mal à l’aise puis complice quand le tête-de-Turc a été désigné. Signalons-le : la salle pleine, qui compte de nombreuses personnes encore plus âgées que moi et un joyeux paquet d’invites, est largement hilare. Pour notre part, nous débutons la traversée avec froideur – le bref lever de rideau de Jason façon stand-up et l’humour de Denise ne sont pas notre verre de Cornas préféré. Puis nous reconnaissons volontiers la force d’entraînement d’un acteur qui s’active sans cesse durant toute la première partie. La suite perd hélas en intensité et, du même coup, nous perd, avouons-le avec humilité.
Les insultes tellement déjà-vu contre les catholiques, l’embourbement autour du Sexodrome, topos d’humoristes en manque de minutes, le bis niaiseux et infini (c’est une estimation) sur le bouche-à-bouche du docteur Maboul et l’appel à la tolérance homophile (mais rappeler que les Chinois ont une petite teub ou que les Antillais sont lents, c’est tolérant), bref, le fond de vulgarité volontaire, tantôt nauséeuse, tantôt plate, que ne parvient pas à dissiper le réel métier de l’acteur – peut-être pas aussi à l’aise dans l’interaction qu’il ne s’imagine, quand il tombe sur des spectateurs au bagout malin et à la répartie percutante – nous empêchent de jeter aux orties notre prévenance liminaire… tout en admettant que ce spectacle semble susceptible de faire « se pisser », selon le marocanisme du copieur Gad Elmaleh tant les jeunes homos qui se sont rencontrés grâce à IG que les mamies en goguette. Et puis, cette expérience nous permettra de dire aux lecteurs dénonçant notre humour de merde : « Vous n’aimez pas mes blagounettes ? Croyez-moi, je sais ce que c’est, de ne pas trouver drôle ce qui est censé l’être. »
PS en guise de private joke : Denise, désolé, j’ai essayé de faire comme tu as dit, mais j’avais plus de coke. Ni de W&W’s, c’est dire.
Les Troyens, Opéra Bastille, 28 janvier 2019
Honteuse ou sans vergogne ? Difficile de choisir le qualificatif capable de cerner notre indignation à l’issue de cette nouvelle production de l’ère Lissner. Et pourtant, avec un opéra entre Verdi et Wagner, des voix superbes, un orchestre lustré et un chœur choyé par le compositeur – on y repère avec plaisir des supplémentaires presque régulières comme Marie Saadi, qui rayonne de joie scénique –, y avait de quoi faire du beau !
L’histoire
Cassandre (Stéphanie d’Oustrac) lit l’avenir mais nul ne la croit. D’autant qu’elle annonce la fin de Troie alors que, au contraire, les Grecs viennent de lever le siège en abandonnant un hénaurme cheval. Malgré les avertissements de la miss et le prodige laminant le prêtre ayant agressé la Bête, les Troyens font entrer le cheval dans la ville. Les soldats cachés dans la sculpture creuse défoncent tout le monde sur leur passage, y compris le roi Priam (Paata Burchuladze) et Chorèbe (Stéphane Degout), futur époux de Cassandre. Ladite prophétesse convainc presque toutes les autochtones de se suicider – normalement, elles meurent par l’épée, ici, elles s’aspergent d’essence – pour ne pas se faire enculer par les Grecs armés de fusils mitrailleurs, au moins selon l’abruti qui met en scène.
Seuls Énée (Brandon Jovanovich), Ascagne (Michèle Losier) et quelques pleutres ont le courage virgilien des lâches, genre De Gaulle : ils fuient « pour fonder un autre empire en Italie » (c’est « La prise de Troie », actes I et II, 1 h 25, 45’ d’entracte). À Carthage, Didon (Ekaterina Semenchuk) a remis de l’ordre chez les Tyriens qui ont pu se tirer avec elle. Sa nouvelle cité fleurit, à ceci près que la monarquette est veuve. Heureusement, Énée débarque avec sa suite. Le leader et la lidérette font l’amour. Puis Énée décide qu’il a des affaires plus sérieuses à mener : il doit fonder un empire (actes III et IV, 1 h 20, 30’ d’entracte). Énée part, Didon est triste, elle se suicide (fin des « Troyens à Carthage », acte V, 45’).
- Décor des « Troyens à Carthage », détail. Photo : Bertrand Ferrier.
- « Les Troyens à Carthage » vus par Dmitri Tcherniakov, aperçu 1. Photo : Bertrand Ferrier.
- « Les Troyens à Carthage » vus par Dmitri Tcherniakov, aperçu 2. Photo : Bertrand Ferrier.
- « Les Troyens à Carthage » vus par Dmitri Tcherniakov, aperçu 3. Photo : Bertrand Ferrier.
La représentation
Deux décors. Pour la première partie, à cour, un salon bourgeois, façon « Au théâtre ce soir », petit mais en couleurs, surmonté d’un fil d’infos, façon rue américaine où l’on informe en français et en anglais de l’avancée des opérations ; à jardin, des immeubles gris, inquiétants, où s’ébattra le chœur, gris, par opposition aux solistes, colorés. Pour les deuxième et troisième parties, une maison de retraite « pour traumatisés de guerre » où l’on joue au ping-pong, fait du yoga, regarde la télé afin de connaître les cours de Wall Street, prouve son identité troyenne grâce à des photos sur smartphone, ou brandit des pancartes, façon MJC, pour indiquer qui est qui (« Prêtre de Pluton », « Didon », etc.) ou quoi est quoi (« Toge », « Sceptre », etc.) en substitution de l’écran explicatif liminaire. De la mise en abyme ? Soit. Et alors ? Où est le drame ? Où est la résonance millénaire ? En quoi cette pseudo modernisation surie remet-elle l’émotion scénique au centre de l’intertexte conventionnel ? Sera-ce pour mimer la déréliction de ces codes culturels dans le système mondialisé, où L’Énéide ne serait plus qu’une attraction secondaire dans un EHPAD ? Du coup, pourquoi dépenser autant de pognon si on ne croit ni à la force théâtrale de la représentation, ni à la puissance émotionnelle du chant, ni à rien qui propulse Hector Berlioz vers les spectateurs de 2019 ?
Inévitablement, et c’est sans doute le but, la troisième partie s’ouvre sur la bronca du public, entre spectateurs furieux qui auraient préféré une version de concert et défenseurs de l’art chargés, par leur ouverture d’esprit, d’insulter ces rétrogrades fascistes. On imagine que cette provocation et ses conséquences sont la raison du « léger différé » promis pour la représentation du 31 janvier à 22 h 50 sur Arte. Ce soir, pour la deuxième exécution, l’échange dure assez pour que Philippe Jordan, qui avait sans doute préparé ce gag, subtilise un chiffon blanc à un violoniste et l’agite. Ce trait d’humour bienvenu trahit l’incrédulité des acteurs eux-mêmes devant l’immondice auquel ils sont contraints de participer. Est-il besoin de dire que cette insulte à la musique opératique, à la culture littéraire et, presque accessoirement, au public, mérite plus qu’une bronca, par exemple un crachat dans la gueule du salopard qui a commandé une telle ignominie à Dmitri Tcherniakov… et, donc, à celui qui l’a berné en toute connaissance de cause ? Car, assumons cette position de vieux crouton engoncé dans sa bourgeoisie structurelle, le résultat est aussi consternant que passe-partout, aussi ringard que mal avisé, aussi stupide que gorgé de fatuité inculte. En témoigne le fait que, alors qu’il n’y a qu’une distribution, cela s’accompagne d’une direction d’acteurs à la hauteur – solistes empruntés, allant et venant, caressant le mur pour montrer l’émotion, réduits à fumer pour passer le temps… Juste, disons-le, de la merde. Logique : pourquoi se fatiguer à coacher des artistes quand on chope des budgets en prenant les clients pour des trouducs ?
Car cette médiocrité méprisante s’accompagne d’autres déceptions, encore plus importantes que les ciseautages appliqués à la partition. Certes, l’on se réjouit d’entendre une Stéphanie d’Oustrac très investie par son rôle ; Stéphane Degout ne déçoit pas en Chorèbe ; Cyrille Dubois joue une fois de plus les utilités brillantes dans le rôle bref mais exigeant de Iopas qu’il a déjà fréquenté ; Aude Extrémo fait valoir ses puissants graves en Anna, sœur de Didon ; et l’on retrouve avec plaisir Bernard Arrieta, promu dans le petit rôle de Mercure. Pour le reste, deux difficultés.
D’une part, l’orchestre, pourtant animé avec précision et une certaine énergie par Philippe Jordan, peine à séduire tant il sent le public ébaubi, incrédule et consterné. La beauté des timbres (tutti et ensembles de cuivres, cordes magnifiques, clarinettes, harpes…) est remarquable ; pourtant, en dépit d’un résultat de premier ordre, il manque, à cause des circonstances, ce petit supplément de nuances et d’émotion qui ferait frissonner. Peut-être parce que nous avons décroché de l’émotion, hypothèse très fondée… mais peut-être pas que.
D’autre part, les deux rôles principaux sont confiés à des non-francophones, comme souvent, et ce soir, c’est épouvantable. Non qu’ils chantent mal : les voix sont somptueuses, le souffle est long plus qu’à souhait, la technique est exceptionnelle, la résistance à l’effort est parfaite ; seulement, il est difficile de déterminer dans quelle langue chantent Brandon Jovanovich (même si l’on reconnaît parfois telle ou telle syllabe) et Ekaterina Semenchuk (les voyelles toujours et les consonnes la plupart du temps semblent un détail qui n’intéresse pas la cantatrice). De même, dans ce parterre de voix toutes très honorables, on applaudit aussi Christian Van Horn, Narbal impressionnant ; mais le français, bon sang, le français ! Comment ne pas être exaspéré par ce massacre linguistique qui est tout sauf un détail ? Peut-être en ne venant plus assister à des représentations d’opéra français chanté par des étrangers ? Sauf que Joyce DiDonato et Michael Spyres ne s’en sortaient pas si mal dans la version strasbourgeoise de 2017 – il est vrai qu’ils n’étaient pas encombrés par une mise en scène aussi odieuse…

Quand tu es tellement consterné que la seule photo qui vaille, in fine, c’est celle qui valorise vachement le soin avec lequel la voisine de devant a fait pailleter son ongle. Photo : Bertrand Ferrier.
La conclusion
Difficile de ne pas repartir de cet opéra massif (5 h 10 dont 3 h 55 de musique) avec la colère et la tristesse opposant l’envie d’aller applaudir les opéras sur scène et la consternation devant tant de spectacles lissnériens. Il est vrai que « cette production est donnée en hommage à Pierre Bergé », ce qui laissait présager du pire… eût ironisé Cassandre que, désormais, l’on croira plus volontiers.
- Ekaterina Semenchuk en canari. Costume : Elena Zaytseva. Photo : Bertrand Ferrier.
- Brandon Jovanovich. Costume : Elena Zaytseva. Photo : Bertrand Ferrier.