Pascaliens espaces infinis

La photo n’est pas bonne, mais on peut y voir le désarroi en personne ou le soulagement d’un soir.
En fait, tu sais que tu es organiste quand tu arrives en courant pour jouer la messe, inquiet d’être peu en avance, mais, en fête, quand tu entres dans l’antre, tu découvres ça. Alors, en un sens, ça va.
Le zinzin, c’est moi
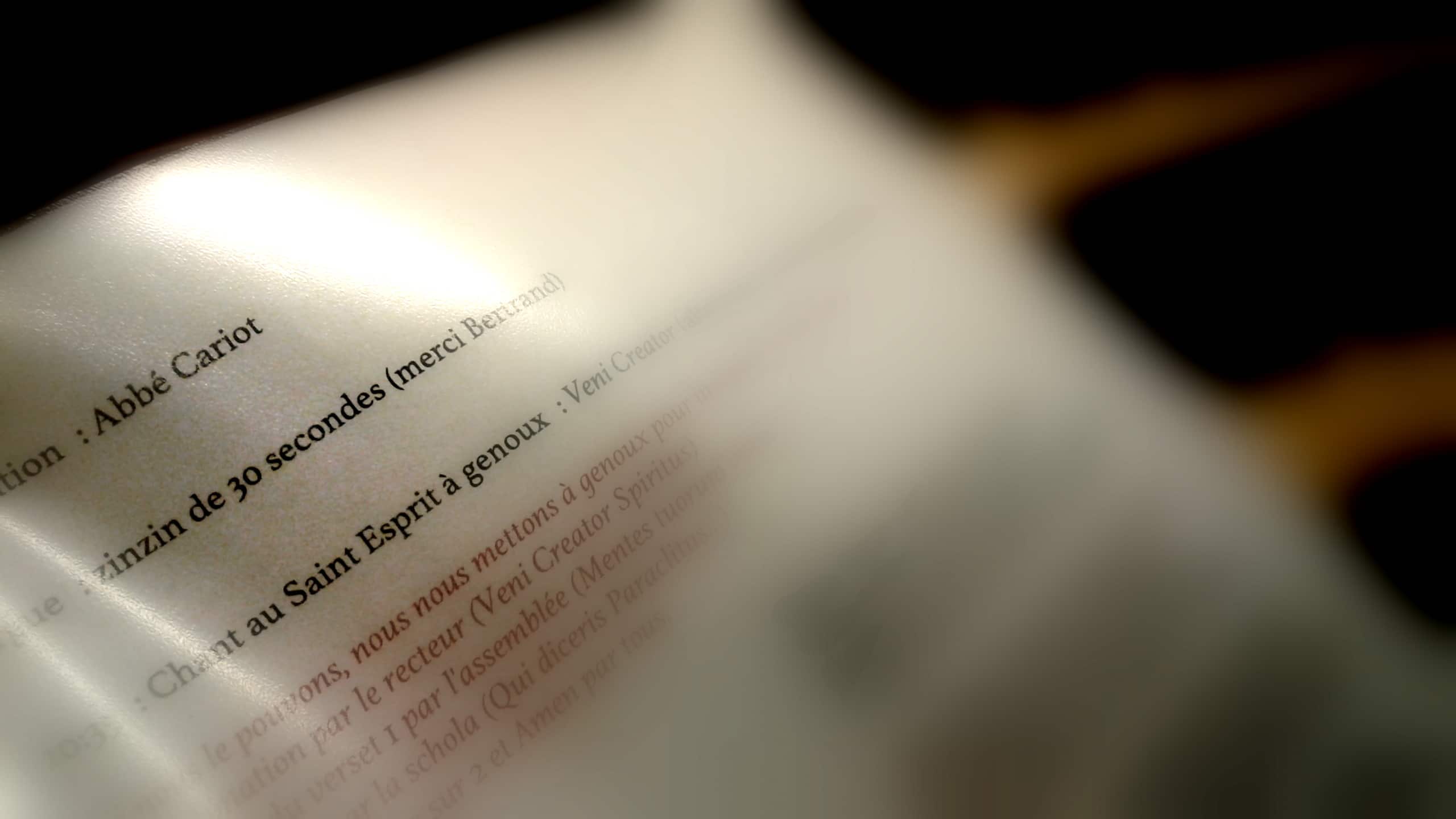
Le respect et l’humour ne sont que convention. Par exemple, moi, être un zinzineur de trente secondes, en fonction des patrons, ça peut m’aller sans souci – là, par exemple, c’est rigolo, c’est précis, ça donne même place à l’orgue alors que c’est le remplaçant qui ploum-ploume, c’est donc une marque de confiance traduite avec amitié : bizarrement, ça passe. Comme quoi, ben, le respect et l’humour ne sont que blablabla, et pourtant ça compte sa mère. Va-t’en comprendre.
L’Élixir d’amour, Opéra Bastille, 30 octobre 2018

Vittorio Grigolo (Nemorino) et Lisette Oropesa (Adina), des bottes, des lampes et des chaises. Photo : Bertrand Ferrier.
La plus longue pub de luxe pour la picole bordelaise est de retour à Bastille. À l’occasion de sa quarante-quatrième représentation dans la mise en scène de Laurent Pelly, nous l’allâmes applaudir. Voici ce que nous en pensâmes.
L’histoire
Adina (Lisette Oropesa) est la riche du coin. Nemorino (Vittorio Grigolo) la voudrait bien épouser, mais la coquine préfère se gausser de lui. Pis, elle se propose d’épouser un militaire de passage, Belcore (Étienne Dupuis). Pour retourner la situation, Nemorino s’en remet à l’élixir du docteur Dulcamara (Gabriele Viviani), idéal pour les cors aux pieds comme pour les séductions en berne. En réalité, il s’agit d’un méchant vin de Bordeaux. Pour s’en offrir une bonne rasade, le loser décide de s’engager dans la troupe de son rival. La potion marche du feu de Dieu : toutes les filles courent après le mec censé être bourré… en fait parce que, révèle Giannetta (Adriana Gonzalez), il vient d’hériter d’un gros paquet de pognon – ha, les femmes ! Même Adina finit par racheter son engagement auprès de Belcore et par épouser son soupirant. Quelqu’un connaît-il une meilleure critique œnologique ?
Le spectacle
Tout se joue autour ou sur des bottes de paille signées, et pourquoi pas, Chantal Thomas. Tout, c’est-à-dire pas grand-chose. Laurent Pelly se contente de faire entrer des gens, un chien parfois et, souvent, des engins, motorisés (tracteur, camion de foire, Solex) ou non (vélos), derrière un rideau de pub à la gloire du charlatan, entre cinéma d’antan et journaux à l’ancienne. Autant dire que, en dépit d’une musique enquillant les airs, l’on s’ennuie sec, sec, sec, personne dans la régie ne semblant s’inquiéter de faire pétiller un tant soit peu ce « melodramma giocoso » qui n’est peut-être pas ce que Gaetano Donizetti a écrit de plus passionnant – ce qui serait une raison de plus pour se secouer les saucisses afin de le parer d’un charme supplémentaire justifiant une mise en scène.
Le plateau
Le tapis orchestral est lustré, sans prise de risques, par Giacomo Sagripanti. La partition manque peut-être de sequins pour permettre aux artistes de briller à pleins feux. Ce nonobstant, musiciens comme chanteurs, chacun travaille du mieux qu’il peut. Lisette Oropesa, dans une tenue alla Barbara Hannigan, donc très inutilement échancrée par le costume de Laurent Pelly (ben tiens), minaude comme il sied, laissant supposer que, malgré les envolées de la fin du second acte, ses airs ne sont qu’une brillante promenade de santé – et comme aucune direction d’acteurs digne de ce nom n’enrichit son rôle, ben, elle fait le job : elle chante. Vittorio Grigolo est cantonné à un personnage de nunuche larmoyant, ce dont il s’acquitte avec une aisance tout aussi fascinante, avant d’exploser, en bon Italien, lors des saluts. Idéal pour renforcer, malgré lui, l’ire des spectateurs contre une mise en scène peu soucieuse de valoriser l’expressivité des chanteurs et l’espièglerie de ce zozo en particulier.
Étienne Dupuis, seul Français parmi les solistes, campe un Belcore fat et faraud comme un militaire. À l’instar de Gabriele Viviani (Dulcamara), il nous semble parfois un peu court dans le registre grave, mais il exécute sa tâche avec la fermeté satisfaite que l’on attend de lui. La Giannetta d’Adriana Gonzalez, petit rôle mis en valeur à la fin, n’a pas grand-chose de la jeune paysanne requise par la partition ; sa relation avec l’assemblée des femmes n’en reste pas moins correcte. Les seuls à paraître s’amuser sont les choristes de l’Opéra, toujours ravis d’incarner leurs rôles tant en groupe qu’individuellement. À eux seuls, ils redonnent vie de ci de là à une œuvre dont, en l’espèce, la mise en scène manque de sapidité et de pétillance, pour ainsi dire, comme, deux jours après son ouverture, un crémant mal rebouché.
- Étienne Dupuis (Belcore). Photo moche : Bertrand Ferrier.
- Adriana Gonzalez (Giannetta). Photo moche : Bertrand Ferrier.
- Gabriele Viviani (il dottor Dulcamara). Photo moche : Bertrand Ferrier.
La conclusion
En bref, est proposée une interprétation à la fois honnête et décevante. Honnête, car chanteurs et musiciens font leur possible ; décevante, car la platitude du résultat, le manque d’enjeux dramatiques, l’absence d’inventivité et de jubilation ne contribuent pas à passionner les spectateurs. Ceux-ci ont déjà dû voir en masse cette production très moyenne, si l’on en croit les nombreux sièges restés, une fois de plus, vides.
Libres, un max…
J’voudrais parler d’ma vie, c’est rare mais bon. On aura besoin d’un peu plus que d’un moment ; toutefois, la lecture étant libre, optionnelle et sans contrôle de bonne compréhension à la fin, plongeons-nous dans un épisode tout frais, tout pas beau.
1.
Le contexte
Il m’arrive durant mon existence de critique sporadique que des attachés de presse me contactent pour m’envoyer des disques à chroniquer. Je réponds toujours : « Avec plaisir, mais je vous préviens que j’écris ce qu’il me semble, prétentieusement, pertinent d’écrire, y compris quand ce ne sont pas des éloges sucrés. » Je ne reviens pas sur le snobisme égoïste du critique – les nouveaux curieux et les curieux oublieux pourront voleter çà pour retrouver le post traitant du sujet.
Or, rebondissement en cette veille de Toussaint. J’ai mis en ligne à minuit un article louangeur – un critère d’appréciation : à c’t’ heure où j’écris, il n’a recueilli que des cœurs sur son relais Facebook, fait rarissime. L’un des cybercorrespondants, compositeur roué, a même admis que « ça donne envie d’écouter » ce qui, avouons-le, était le but.
2.
Les faits
L’attachée de presse du disque chroniqué m’appelle vers 10 h du matin (non, je ne dormais pas, hélas, je répétais), doublant son appel d’un courriel offusqué. Dans la conclusion de l’article, la dame a relevé un point qui la chagrine, euphémisme puisqu’elle souhaite la suppression d’abord de la sentence qu’elle désapprouve, bientôt de l’article en entier. De quoi s’agit-il ? Le disque de Philippe Chamouard ayant été enregistré essentiellement avec l’orchestre de Plovdiv, j’avais griffonné cette phrase :
Saluons le courage d’un label soucieux de poursuivre la publication symphonique d’un compositeur français – certes sans préciser les conditions de rémunération des musiciens bulgares, que l’on imagine hélas désastreuses.
La seconde partie de la phrase est donc très claire : « Sans préciser », « On imagine ». Comme attaque personnelle et information revendiquée, on fit plus sec. Pourtant, cette incise a motivé en chaîne plusieurs appels courroucés, bien que j’eusse précisé que j’étais en répétition toute la journée et ne pouvais donc échanger verbalement dans l’immédiat (« Nouvelle génération qui n’ose plus parler », me flatte néanmoins la dame dans un énième message pour le moins virulent, à 21 h 54 – nan, pas nouvelle génération, juste gens qui bossent et qui, le soir, ont mieux à inventer, voire rien, que de s’embrouiller oralement sur des polémiques idiotes qui leur font perdre leur temps). De plus, le contenu des messages paraissait me confondre avec un influenceur aux ordres de la marque, ce que, alléluia, je ne suis pas. Le plus significatif des courriels tonnait ainsi : « Merci de retirer cette phrases!!! Elle ne correspond absolument pas à la réalité !!! D’où sort cette information? » À la pause de midi, j’ai synthétisé mon propos. Voici, infra, mon courriel, reproduit tel qu’envoyé, donc avec ses maladresses de réponse rapide.
Journée très chargée en répétitions, donc peu propice pour dialogue – j’en quitte une, d’où le délai de réponse [de deux heures], et j’en retrouve une autre promptement.
Le bout de phrase que vous citez vise à souligner que beaucoup de musiciens d’orchestre de l’Est sont, à l’aune française, sous-payés. Il est de notoriété publique que cela permet d’enregistrer des pièces à des tarifs défiant toute concurrence hexagonale donc, parfois, de les enregistrer tout court. L’extrait qui vous chiffonne ne participe donc pas de la dénonciation d’une production spécifique, comme vous semblez le craindre, mais récuse, au passage, un système qui, certes, contribue à la rémunération de talentueux instrumentistes sis en Europe de l’Est, certes permet à des œuvres d’exister en dehors des grands circuits de distribution, mais contribue également – en même temps, aurait stipulé notre Président – à l’existence d’une Europe – musicale, mais pas que : sociale aussi – à plusieurs vitesses, quelque conformes à la législation locale aient été les contrats (mais voyez un exemple : le violoncelle solo n’est pas cité, ou alors si discrètement que je n’ai pas vu son nom – imagineriez-vous semblable oubli dans un contexte moins oriental ?). J’ajoute que la délocalisation de la musique symphonique à l’Est n’aide pas non plus à développer les orchestres hexagonaux – comme ceux qui ont contribué à l’exposition d’autres symphonies de Philippe Chamouard. Il ne s’agit donc pas d’une embardée contre IndéSENS!, label pour lequel je crois avoir marqué mon intérêt du mieux que j’ai pu, mais bien d’une réflexion à la fois connexe et habitée par une certaine conscience politique.
Bien entendu, si vous souhaitez rédiger une réponse et pointer l’erreur que j’ai pu commettre en imaginant que l’on n’allait pas en Bulgarie que pour la spécificité de la curiosité orchestrale – au sens : l’orchestre est curieux de pièces moins fréquentées par chez nous – mais aussi pour des raisons économiques, je ne manquerai pas de la mettre en ligne très rapidement, en bonne et due place.
D’autres appels irrités ont néanmoins plu sur mon répondeur, jusqu’à ce courriel presque amusant :
Vous allez recevoir dans les jours à venir deux CD de nos labels. Les labels ne souhaitent pas que vous écrivez un article. Merci de me les renvoyer. Je vous rembourse les timbres.
À 14 h 15, un nouveau SMS envoyé par courriel (si, si), tonnait :
Bertrand, il faut retirer l’article tout de suite de Facebook [où il n’est pas] et de votre blog SVP !
3.
Le bilan
Alors, soyons précis. J’adore recevoir du courrier (0’58), surtout des cadeaux – même si tout cadeau de ce type mérite remerciement, en l’espèce une chronique mobilisant quatre à cinq heures de travail a minima. Mais me croit-on si fétichiste, lâche et veule au point que je cède à un chantage grotesque entonné sur l’air du « sois gentil et t’auras des disques, ou alors », tiens, oui, ou alors quoi ? Au contraire, partant de cet écart d’appréciation et admettant que je pusse me leurrer, je trouvais fort belle l’occasion donnée à un producteur d’exposer, pour ce cas précis, ses contraintes, sa pratique, ses engagements sociaux, sa logique, etc. Ce type d’échange s’est articulé dans d’autres cas avec des artistes de haute volée.
Las, peut-être, cette fois-ci, première hypothèse, l’autre côté du disque a-t-il jugé le présent site trop peu important pour perdre son temps avec lui – et pourquoi pas ? Peut-être aussi, deuxième hypothèse, complémentaire, les interrogations soulevées ont-elles touché un point réellement sensible d’une certaine économie du disque orchestral. Peut-être enfin, troisième hypothèse, les menaces d’ester en justice pour des « informations opposables » étaient-elles censées m’effrayer d’emblée. Or, il m’est arrivé de rectifier une notule suite à une erreur ; ici, il n’y a pas d’erreur, il y a une question large sur l’impact de la délocalisation dans l’industrie de la musique.
J’ai donc proposé de laisser un « droit de réponse », comme je l’ai fait, dans certains cas, à un interlocuteur qui souhaitait apporter un autre éclairage. Le plus poussé fut celui accordé à Éric Roux, patron de la Scientologie en France, qui avait réagi à un entretien avec Cyprien Katsaris qui lui-même constituait un droit de réponse approfondi ! Lorsque l’on ne partage pas les mêmes opinions mais que chacun s’exprime avec dignité, pas en commençant par réclamer la destruction d’un document sous des menaces à peine voilées de procès, l’intérêt de l’échange me semble y gagner un chouïa. En l’occurrence, il est dommage que l’occasion d’écouter l’autre versant de l’affaire ait été écartée (voir la réponse fournie en fin d’article).
4.
La conclusion
C’est promis, d’autres critiques débarouleront bientôt sur ce site. Ébaubies, louangeuses, impressionnées, mitigées, furibondes, sceptiques, les six parfois pour le même prix gratuit, mais toujours debout et le plus honnêtement possible, avec mes compétences et mes naïvetés, mes critères partiaux et mon souci de rendre compte – car j’ai la clé, j’ai l’phono, j’ai l’sourire et, parfois, j’ai quelques choses à vous dire.
J’ai.
Moi.
Enfin, moi et d’autres, quand ils acceptent mon invitation et ont des témoignages saisissants, profonds, inattendus, pourquoi pas dissonants à partager avec un p’tit site et ses lecteurs. Quant à moi, malgré les menaces, provocations, messages comminatoires et enfantillages (« Merci de me renvoyer les CD, même en port dû ») fêtant mon retour du travail, j’ai deux convictions. D’une part, par ces temps de froide pluie, laissons pisser le mérinos ; d’autre part, tout cela passera, et nous n’avons qu’une vie. En attendant les suites, un seul mot d’ordre – les uns avec les autres, musique !
Update : le 31 octobre, à 20 h 30, j’ai reçu un énième courriel issu d’un « mail de Philippe Chamouard ». Le bref extrait, qui nous a été fourni sans contexte, disait – nous ne retouchons rien : « Oui, en effet, c’est scandaleux car l’orchestre à lui même fixe le budget global, que je nài pas discuté ni négocié. » J’ai répondu à l’intermédiaire que je publierai cette réponse même si, « à mon sens, elle ne répond pas vraiment à la question ». Partant, bouclons l’affaire :
- non, je ne retirerai pas la notule qui suscite cette folle (j’ai pas fini) envie de censure ;
- non, je ne renverrai pas les disques chroniqués – d’autant qu’ils ont monté un Comité Sud-CGT-FO sous prétexte qu’ils sont bien ici, avec leurs nouveaux potes, et que reprendre, c’est voler ;
- non, je ne répondrai plus aux vitupérations citées et à venir, notamment afin de ne pas me laisser entrer en tentation de malséance inspirée par tant de rodomontades et d’injonctions à mon sens peu adaptés ;
- et tant pis pour les disques que je ne découvrirai pas, nous trouverons d’autres sujets de posts facétieux, yalllllah !
Philippe Chamouard, Le Vagabond des nuages, IndéSENS!
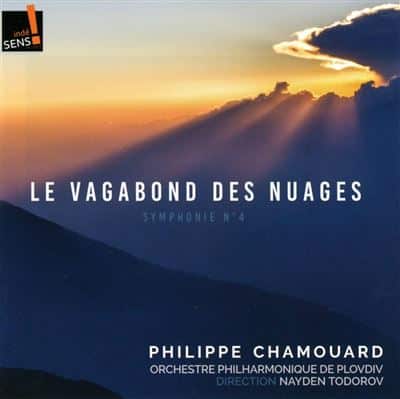
Des compositeurs français pouvant se vanter de faire entendre leur quatrième symphonie (parmi dix !) sur le marché discographique autochtone, il n’y en a pas des millions – d’autant que, en sus de la cinquième précédemment parue chez IndéSENS!, nombre d’autres symphonies persistent chez Hortus, après que le label a abandonné l’aventure. On ignore quels dieux taoïstes bénissent Philippe Chamouard, mais c’est du sérieux ! Quand, en plus, le compositeur en question ne revendique aucun grand prix incontestable de conservatoire prestigieux, l’affaire intrigue. Aussi acceptons-nous, en homme incroyablement généreux, d’y jeter une oreille curieuse, sans le snobisme susceptible de faire sourire celui qui, lisant le CV de l’orchestre bulgare, constate que sa plus grande fierté est d’avoir vu une de ses membresses intégrer un grantorchestre – me rappelle quand, à Jules-Ferry, on nous montrait lors d’une réunion destinée aux naïfs hypokhâgneux, « un admissible » au côté de Delphine, la plus jeune bachelière de France, Niçoise expatriée, bref.
La symphonie « Le Vagabond des nuages », dont le titre fait craindre un temps la proximité avec la voleuse – mais épouse sacémique opportune – si grassement payée pour pondre, en dépit de sa crasse incompétence qui fait encore rire les musiciens créateurs du bousin en présence de Sa Cochonnerie première Manu El Blancoss, le Messager des étoiles (rien à voir, sinon le goût pour la tonalité, ouf), s’ouvre sur un premier mouvement titulé « Le monde de poussière ». La prise de son d’Ivayki Yanev séduit par sa capacité immersive (même sans grande technologie, on se sent englobé dans le flux) et étonne par sa précision trop précise (cliquetis des bois). Le langage musical est furieusement tonal, ce qui n’est pas une critique mais une indication. Entre caisse claire martiale mais légère, cordes envoûtantes et flûte exagérant son vibrato, l’atmosphère résolument cinématographique aspire à figurer, à l’instar des « murs de poussière » cabréliques, le nuage d’ignorance et de sottise qui enveloppe les hommes, leur « agitation incessante », leur « fragilité » et leur caractère consubstantiellement « éphémère », le tout autour de la tonalité, basique, d’ut. La solennité simple n’exclut pas l’éclatement du nuage (piste 1, 4’). Les brefs moments de tension se dissipent pour mieux faire sentir le grondement de l’agitation, ponctué par une timbale sobre et précise. Un snob dénoncera à bon droit la simplicité d’un langage revendiquant le sens de l’efficacité ; un auditeur honnête se réjouira de suivre avec plaisir un film sans visuel. Tous devraient reconnaître la pertinence du compositeur, qui n’hésite pas à faire brièvement swinguer son orchestre (8’10) façon big band d’université américaine, avant que le nuage ne retombe, comme il nous ensevelira tous sous nos basses préoccupations matérielles, selon la conviction taoïste défendue par Philippe Chamouard.
Le deuxième mouvement est plus dramatique. Forcément, il se titule « La porte étroite » et se réfère au chameau de saint Luc. Après un tutti réduit à des cuivres puis à des cordes, effet wagnérien s’il en est (piste 2, 0’06), le compositeur décrit le désarroi de « celui qui se présente devant la porte étroite et s’aperçoit qu’elle se referme ». De brefs soli de basson ou de violoncelle, dialoguant avec hautbois, clarinette et flûte, sont autant de constats d’échec : ça passe pô. De tutti en envolées lyriques, le compositeur offre à l’orchestre, personnage malléable, la possibilité d’exprimer désarrois et espoirs, tensions et épuisements, en les marquant du sceau rythmique des cordes.
Du coup, faute d’ouverture, l’homme s’ouvre à la pensée soufi, celle du troisième mouvement titulé « Le regard intérieur ». Les contrebasses se concentrent sur leur tenue obsédante. La déploration se développe sans prendre son essor – mais assez précise pour que l’on sursaute lors de l’attaque terriblement fausse du mi-ré sur piste 3, 3’07. Elle cherche dix solutions, en un mot ou en deux, dans le collectif orchestral ou dans les soli des premiers nommés, violon inclus. Pourtant, le regard intérieur a beau s’animer des doubles croches des cordes, il s’épuise à scruter l’indicible, « l’inaccessible étoile » de Jacques Brel, frappant sans cesse contre le cœur battu des timbales, qui absorbe cette quête et la désamorce : le regard intérieur n’est rien d’autre que l’introspection, souvent vaine, d’un individu perdu dans son ego.
Une cloche signale la venue, sans apostrophe, des taoïstes du quatrième mouvement, baguenaudant dans la montagne pour « étudier les propriétés des plantes, celles du thé en particulier ». Un solo orientalisant de flûte, toujours aussi vibratoire, symbolise ces « anachorètes », nom classe des ermites provisoires. Il faut passer outre cette signification que sceptiques jugeront, sans doute à juste titre, réductrice donc agaçante – un peu comme ces crétins de la radio israélienne qui s’excusent quand ils diffusent du Wagner : le compositeur indique des ressorts d’écriture, mais cela ne réduit pas sa composition aux seuls adeptes de sa spiritualité, de même que l’on peut saluer le métier d’Alain Krotenberg sans être franmac. Comparaison d’autant moins gratuite que celui qui n’entend pas Tristan à piste 4, 4’12, mérite félicitations pour sa concentration exclusive sur l’œuvre qu’il écoute. Des à-plats orchestraux traduisent la contemplation à peine troublés par quelques notes de trompette. La partition refuse le spectaculaire, comme en témoigne le fragile solo entre le hautbois et le violon soliste. Les propositions se délitent dans le tapis des cordes qu’ornementent flûte, sorte de cor anglais et manière de contrebasson.

Prend la suite un petit concerto pour violoncelle, intitulé Madrigal d’été « puisqu’il fut créé en juillet 2017 », juillet, c’est l’été, rien à redire. Ce nonobstant, il y a de l’oxymoron dans l’air puisque « madrigal » originait (pourquoi pas ?) l’a capella. Curieusement le ou la soliste violoncelleiste n’a droit à aucune mention spécifique, si nous avons bien lu. C’est d’autant plus navrant que le résultat est tout à fait charmant, et l’on éprouve curieusement la nécessité de préciser que cette remarque n’a rien de péjoratif, avec ce qu’il faut de dissonance sporadique assumée (plage 5, 4’42 – oui, ce sont de vraies références, pas des trucs au pif), démontrant un sérieux savoir-faire. Les fade-off qui nous semblent un peu maladroits (7’35, mais il y en a moult) sont anodins : voilà de la belle musique jouée avec probité, si trop de vibrato pour notre goût sans doute fasciste, mais qui peine à nous bouleverser en dépit de notre bonne volonté, donc à convaincre qu’elle surperforme celle d’autres excellents compositeurs français moins produits – pensons au tout aussi tonal Serge Ollive.
Le disque s’achève curieusement, mais cette curiosité est une joie, sur un Salve Regina qu’interprète a capella, pardonnez du peu, le Madrigal de Paris dirigé par Pierre Calmelet. L’occasion d’admirer le métier du compositeur : le musicien sait comment en demander trop mais pas trop à ses exécutants, comment valoriser une dissonance (1’58, 2’38…) grâce aux basses en grande forme quand les pupitres aigus semblent parfois avoir du mal à remettre le moteur en route (« O clemens » et 10’07, cruel), comment détacher une mélodie – accord plein en bas et ligne supérieure flottante, comment relancer le discours (4’40), assurant toujours un respect du texte fondamental et ce que Yes aurait appelé une « magnification », etc.
En conclusion, trois points. Un, saluons le courage d’un label soucieux de poursuivre la publication symphonique d’un compositeur français – certes sans préciser les conditions de rémunération des musiciens bulgares, que l’on imagine hélas désastreuses. Deux, dénonçons le livret encore une fois tellement perfectible (malgré l’arnaque, appuyée par cette ordure de Pharaon Ier de la Pensée complexe, de « l’entreprise individuelle », le correcteur devait être payé aux conditions françaises : est-ce la raison de cette faille ?). Le compositeur est évoqué après la notice sur le madrigal… et avant la notice sur le Salve Regina, ce qui n’a aucun sens ; les fautes orthotypo pullulent (le numéro des siècles doit être inscrit en petites capitales, le « e » en exposant, pas à la va-comme-je-te-pousse comme p. 6), etc. Quel dommage ! Trois, applaudissons le savoir-composer de Philippe Chamouard (qui a droit, sur le livret, à aussi peu de place que Pierre Calmelet, alors que son importance dans le présent enregistrement méritait davantage). Donc, quoi que le résultat ne réussisse pas à nous submerger d’émotion, insensible que nous sommes, incitons les lecteurs à la découverte, si une musique pimpante, bien écrite et vaillamment exécutée, les attire. Passionnés de pouët, de jdiboujdiboujboïng et de boulèzeries électroacousmatologisticiennes, passez votre chemin, de grâce !
Soutiens le regard…

… et non regard de soutien. Plutôt : « Bon, tu es nul, ta répétition est pourrie, je fais rien que m’ennuyer avec dix mille fausses notes dans les esgourdes. On y va ? » C’est lucide, c’est sincère, mais ce pas-comique de répétition est un chouïa désagréable, surtout pendant une répétition hyperpourrie, en effet. That’s the so called man’s best friend for you, anyway.
Saint-Bernard de la Chapelle, 28 octobre 2018

Alors, bon, ce qu’est-ce que je vais dire, ça va peut-être pas beaucoup plaire aux sots, mais je vais l’dire quand même car on va pas se mentir. Grâce à Bruno Beaufils de Guérigny, écrivain et rganiss ayant enregistré pour quelques grands labels, remplaçant dans quelques-unes des plus belles églises parisiennes et artiste Komm, Bach!, j’ai pu me substituer à l’une des p’tites titulaires qui monte, qui monte, qui monte dans la capitale. Du coup, la nuit précédant l’événement, j’me suis r’levé pour préparer les objectifs de l’appareil photo que l’on me prête, ce que j’avais prévu de faire long de temps avant mais bon, j’ai pas à me justifier, ça va bien aller.

Suite à cette préparation très pro, j’ai bien sûr oublié l’appareil photo, ce qui évite aux zyeuteurs de ce site d’admirer des photo hyper symboliques mais moches siglées « Photo : Bertrand Ferrier ». I mean, y a un minimum de dignité. J’étais surtout là pour accompagner la liturgie, donc le « Happy Birthday, Josette » en Eb improvisé par les fanatiques de la vedette locale, avec applauses en sortie, en tapotant sur l’un des Cavaillé-Coll massifs de la capitale. Ce qui était d’autant plus joyeux que l’accueil et le désaccueil, dans cette paroisse, sont fort chaleureux.
Et puis, jouer une belle bête – y compris en solo pour l’offertoire, ce qui devient rare dans la liturgie catholique – même quand elle souffre, c’est chouette. Vivement l’hypothétique prochaine. [Inch’Allalalalah, cette foi(s), j’oublie pas mon appareil si on me le prête toujours.]














