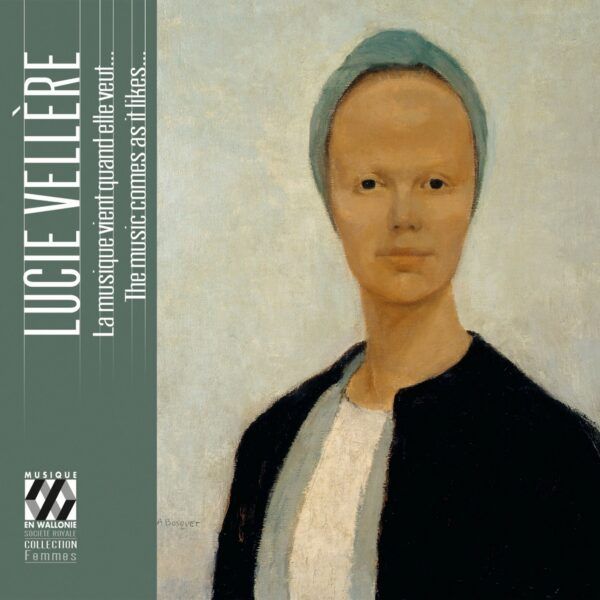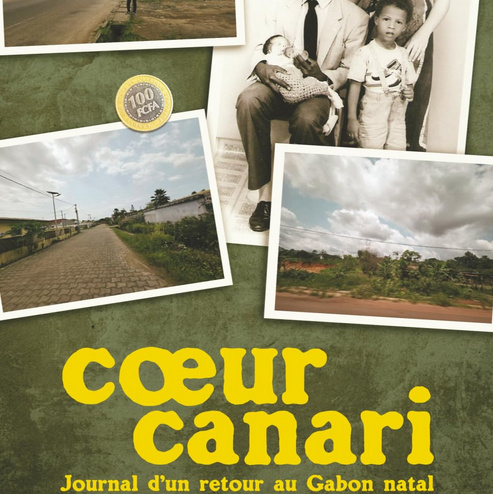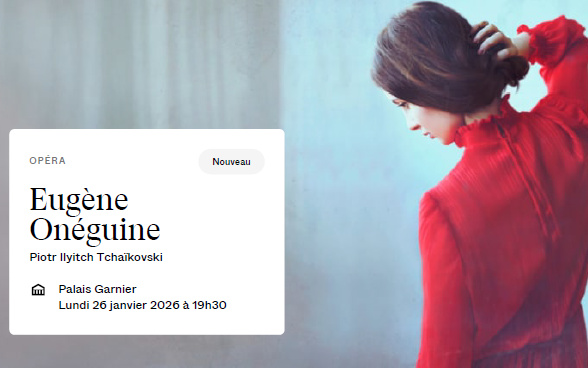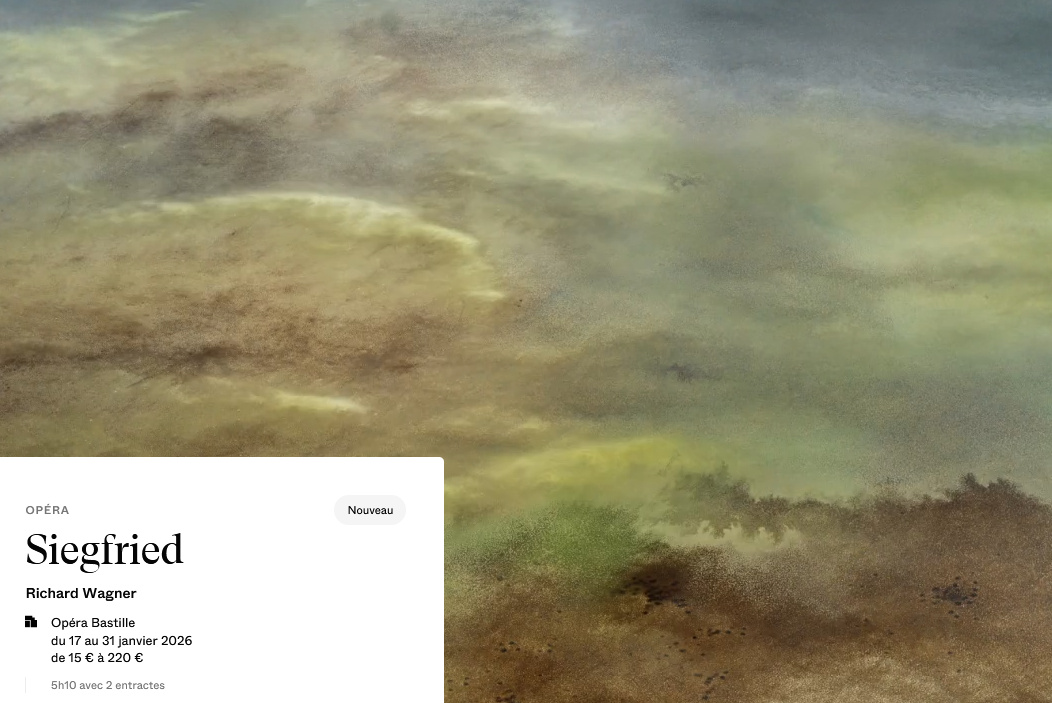Après
- quinze ans de scène,
- plusieurs centaines de concerts,
- plus d’un millier de chansons « avec du texte et de la musique dedans » colportées de bistros en théâtres,
j’ai éprouvé l’envie de donner un concert bilan… mais en mieux. Évidemment en mieux, voyons. Tsss, tsss. J’ai donc décidé de suivre le mantra d’Alexandre Astier, lequel clamait :
Je vois pas l’intérêt de faire ce métier si c’est pour péter au niveau de son cul : je veux faire des grands trucs, les p’tits trucs m’intéressent moins que les grands.
Résultat, un double concert, ce mercredi 18 mars, dans un coquet théâtre où je ploume-ploume depuis quelques années :
- à 19 h, « classiques et favoris », soit un florilège des chansons qu’il a le plus poussées sur scène ;
- à 21 h, « raretés et nouveautés », soit une poignée de nouvelles fredonneries et d’hymnes moins connues.
J’ai décidé de privilégier la matrice piano-voix que je préfère… mais en mieux. Évidemment en mieux, voyons. Tsss, tsss. Aussi ai-je invité des complices de longue date, dont cinq ont finalement pu être du voyage :
- Pierre-Marie Bonafos (et son bonnet) au sax,
- Sébastyén Defiolle le guitariste fou,
- Jean Dubois, le chanteur et néopianiste,
- Jann Halexander le « petit mouton noir et frisé de la chanson française », et
- Claudio Zaretti, le gratteux que tout Paris ou presque surnomme il Professore.
Dans un méli-mélo d’influences allant de la chanson rive gauche à la pop en passant par des chansons-fleuves voire expérimentales alla Higelin, j’espère proposer un moment joyeux, secouant et multiple associant
- sourires,
- bonne intelligence et
- vibrations tonifiantes.
Infos pratiques
Où ? Théâtre du Gouvernail | 5, passage de Thionville | Paris 19 | Métro : Laumière ou Crimée
Quand ? Le mercredi 18 mars.
Mais encore ? 19 h : classiques et favoris | 20 h 15 : entracte | 21 h : raretés et nouveautés | 22 h 15 : fin.
Comment réserver ? Ici pour l’intégrale, çà pour le concert de 19 h, là pour le concert de 21 h.
Un secret ? Avec vous serait un plus.