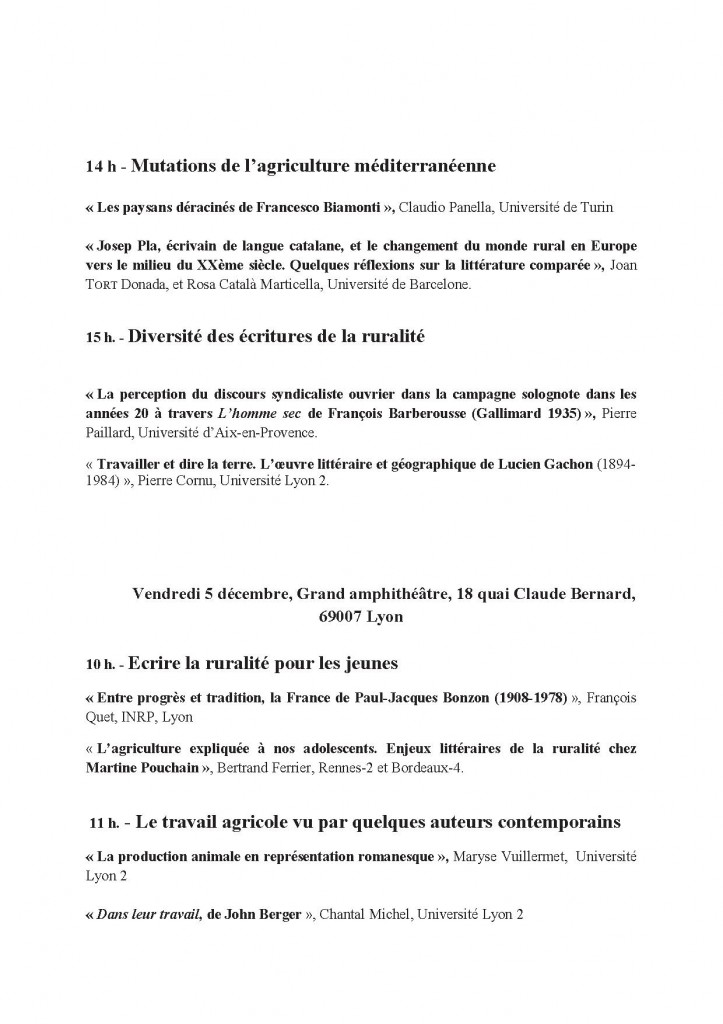Noëls en musique 1/4 : galerie d’improvisations
 Splash ! Improvisations, tableaux en libre accès visuel (?), orgue et chocolat chaud : que demande le peuple ?
Splash ! Improvisations, tableaux en libre accès visuel (?), orgue et chocolat chaud : que demande le peuple ?
Jean Dubois au Limonaire
Jean Dubois, c’est la chanson française comme on l’aime : c’est Renaud pas bouffé par l’alcool, c’est Dylan pas grommelant, c’est Brassens shooté aux amphètes, c’est notre Charlebois à nous, avec son côté “chanson à texte”, “chanson rock” et trouvailles musicales. Ces cinq mardis de décembre, il est au Limonaire, un resto parisien à chansons où l’accueil n’est pas chaleureux, la programmation pas toujours au top niveau, mais où les vedettes de la chanson intelligente viennent, où la boustifaille est savoureuse pour des plats à 10-13 €, le Côtes-du-Rhône crapuleux à souhait et le service interrompu pendant le concert. Des conditions idéales pour applaudir, moyennant entrée libre et sortie au chapeau, Jean Dubois et ses “accompanieurs” (cajon-charleston, contrebasse esthétisée et lead guitare).
Les quatre zozos, qui n’ont pas sévi ensemble depuis l’enregistrement de leur album cet été, sont parfaitement au diapason. Pour ce concert intitulé “chansons d’amour et danses de caractère”, les classiques de Jean Dubois (mec que l’on peut retrouver en plus jeune collé au-dessus des toilettes, nous confirme Claudio Zaretti) se mêlent aux chansons tout juste enregistrées mais bien connues des fans, avec une palanquée de trouvailles : intros remixées, instrumentaux pour ouvrir le bal et remplacer “Rendez-vous à Izmir” (“on a gardé l’essentiel”, commente le chanteur, comme en écho à Charlebois expliquant “on avait trop de paroles” pour introduire “Les Américains”, chanson sans texte), set-list sans défaut. Impossible de ne pas être emporté par les qualités superlatives de ce concert : des chansons (dont des tubes imparables, incluant des anciens ou des plus récents comme “Faut que j’te voie”) tour à tour folk, rock, rageuses, sentimentales et pourtant toujours intelligentes sinon ironiques ; les intermèdes parlés, rares, volontiers antithétiques comme aime faire Jean (“c’est une chanson pour les victimes d’inondation”, lance-t-il par exemple avant “Splash” – “c’est quoi ce délice, tout d’un coup, splash, en plein oasis, tant pis si ça glisse… et tant mieux si ça tache”), toujours percutants ; l’interprétation “libre comme l’art”, impeccable de bout en bout – mémoire et feeling ; les soli d’Arnaud Le Coq, l’intervention subtile de Sylvain Gravé (jeu délicat des différentes sonorités et de la cymbale), la précision de Julien Drillon ; l’énergie du concert, la colère amoureuse et désenchantée du chanteur, et la bonne idée d’un CD enregistré brut “comme à la maison” vendu cinq euros la douzaine de titres – avec un bonus sincère en cadeau.
Bref, Jean Dubois, c’est le chanteur que l’on rêve de faire découvrir autant que l’on rêve d’être si on fredonne des notes musicales avec des paroles verbales : toujours intelligent, juste, mélodique, rythmique, bien entouré, euphorisant, simplement excellent. Comme à l’impossible le commun de nous n’est pas tenu, il reste quatre occasions d’aller profiter de ce mix entre Bob Dylan, Woodie Guthrie, Calvin Russell… et Séchan. Improbable, revigorant et puissant.
(Oui, je sais, j’ai mis “improbable” et “superlatif” dans un même article. Franchement, j’m’en fous, j’fais c’que j’veux avec mes ch’veux et même avec ma calvitie, mârde.)
Demain, Paris, peut-être
Brouillon pour une chanson sur un sujet crânement original : Paris. Et pouwkwa pas, les chéwis ?
Es-tu de ma famille, de mon ordre et de mon rang ?
 Ces 27 et 28 novembre, rendez-vous à Paris-XIII puis à l’Institut International Charles-Perrault, à Eaubonne. On y causera d’histoires de famille, et j’y parlerai spécifiquement de ces familles que l’on trouve à foison dans l’œuvre de Martine Pouchain – dont, oui, les romans en valent toujours deux, puisque un Pouchain égale deux. Gnagnagna.
Ces 27 et 28 novembre, rendez-vous à Paris-XIII puis à l’Institut International Charles-Perrault, à Eaubonne. On y causera d’histoires de famille, et j’y parlerai spécifiquement de ces familles que l’on trouve à foison dans l’œuvre de Martine Pouchain – dont, oui, les romans en valent toujours deux, puisque un Pouchain égale deux. Gnagnagna.
Salle Pleyel, 13 novembre 2014
Bientôt tonnera le scandale absolu de la gabegie que constitue la Philharmonie de Paris : 400 millions d’euros dépensés pour rien, sinon le bénéfice de Bouygues et consorts, des sociétés d’étude et des destinataires des rétrocommissions que l’on suppute énormissimes. Bientôt, donc, la salle Pleyel cessera, par exigence de l’État, de diffuser de la musique classique. Ça a même un nom, ça s’appelle la “déclassification”. S’il y a une raison pertinente d’exterminer les ministres socialistes de la culture et la maire socialiste de Paris, en voilà une belle.
Par chance, ce 13 novembre, abonné fan de cette salle, je fus invité à jouir d’un dernier concert donné par l’Alma Chamber Orchestra, une phalange composite et provisoire dirigée par la famille de l’industriel Boudemagh (Zouhir, Sabrina et Misha sont aux premiers postes de l’organigramme) et, musicalement, sous la baguette de Lionel Bringuier. Programme joyeux, sans chichi mais bien construit. Dès la première partie, l’Ouverture d’Egmont du sieur Ludwig van Beethoven propose un apéritif solennel et, sinon spectaculaire puisqu’on l’a connu plus percutant, du moins sobre et propre. C’est la ligne de netteté choisie par le chef pour la Symphonie n°4, dit “Italienne”, de Felix Mendelssohn : à défaut de tonitruant, du net. Les musiciens s’amusent donc plus dans les mouvements rapides (aisance des violoncelles, virulence des cordes dans la fugue finale) que dans les mouvements lents, un peu mous à notre goût). L’ensemble reste agréable, ce qui n’est pas une insulte, avec de belles interventions des quatre cors, notamment au troisième mouvement, par opposition à la synchro bois/vents par moments perfectible.
Après la pause bien agréable, quoi ? taboulé-bière mais c’est pô la question (enfin, cocktail pour les invités des sociétés ou de la République), la seconde partie propulse la Symphonie en ut majeur de Georges Bizet. Belle ouvrage de l’orchestre, même si l’on eût aimé plus de tensions voire de fureurs ponctuelles. L’ensemble démontre que les membres de l’orchestre ne sont pas des rigolos, et que Lionel Bringuier sait tenir son monde – même en cas de dérapage attendu des deux cornistes dans l’adagio (un pouët défaillant n’a jamais rien de honteux : l’ensemble est précis, beau et même impressionnant dans les nuances intermédiaires). Un bis de haute tenue ose conclure le concert sans esbroufe ; c’est osé, musical et plutôt poignant.
En conclusion, un beau moment dans une belle salle. Et une question : pourquoi fûmes-nous invités, pour la première fois après plus de cinq ans d’abonnement dans cette salle ? On n’ose penser que la présence d’Anne Gravoin, Mme Manuel Valls dans la vraie vie, premier violon et “directrice artistique” de l’ensemble, justifie cette générosité afin de remplir la salle. Quand bien même ce serait le cas, je n’aurais nulle honte à avoir bénéficié de ce moment intelligent et fort agréable.
Non mais.
Tosca à l’Opéra Bastille
C’est entendu, l’Opéra de Paris n’est pas près de reprogrammer des créations d’opéra contemporain. L’annulation de spectacles moins mainstream que d’autres témoignent d’une prudence digne d’un petit opéra de province (alors que, en province, certains osent bien plus). La longuissime suite de dates pour Tosca va dans ce même sens, mais j’m’en fous, moi, j’avais jamais vu cette œuvre, alors bon.
L’histoire : acte I (45′), Floria Tosca (Béatrice Uria-Monzon), cantatrice de son état, est jalouse parce que Mario Cavaradossi (Massimo Giordano) parlait avec quelqu’un dans la chapelle où il réalise une fresque. En fait, il ne parlait pas avec une fille mais avec Cesare Angelotti (Carlo Cigni), tout juste en cavale. Alerté, le grand méchant baron Scarpia (Sebastian Catana) débarque, mais un peu tard. Tant pis, il se promet de choper l’évadé, le traître et sa superbe fiancée. Acte II (40′), Scarpia chope Tosca quand elle sort de scène. Dans la pièce toute proche, il fait torturer son mec pour savoir où est l’évadé. Afin de préserver son chéri, Tosca accepte de coucher avec Scarpia. Mais à deux conditions : un laisser-passer pour elle et son fiancé, et la promesse que son fiancé ne sera fusillé qu’avec des balles à blanc, pour garder les apparences. Scarpia accepte, signe les papiers, et se fait poignarder quand il veut consommer. Acte III (25′), le meurtre étant caché, Tosca peut rejoindre son homme avant la fausse fusillade. Sauf que Scarpia avait quand même prévu une vraie fusillade. Cavaradossi meurt donc, et le meurtre du tyran est révélé dans la foulée. Partant, Tosca file se suicider – hors scène, hélas.

André Heyboer, Carlo Cigni, Sebastian Catana, béatrice Uria-Monzon, Massimo Giordano, Éric Huchet, Andrea Nelli et Luciano Di Pasquale. (Photo : Rozenn Douerin)
La production : dans un décor saturé par une énorme croix praticable au I avant de surplomber les actes suivants, les chanteurs évoluent sans véritable direction d’acteur. C’est dommage car la mise en scène de Pierre Audi nous épargne les conneries habituelles (pas de soldats nazis, pas de femmes jouées par des acteurs chibre à l’air, pas de tanks à Marengo : on a les réjouissances que l’on peut). Les lumières de Jean Kalman donnent un peu de chair à l’acte III, dont on imagine qu’il n’a pas été très long à régler – trois équipes de chanteurs se succèdent dans les rôles pour l’ensemble des représentations, ceci expliquant peut-être la faiblesse de cela. Rien, donc, d’horripilant, et cependant, quelle déception devant le manque d’incarnation des personnages ! Rarement l’on vit chanteurs si peu concernés par leur composition. Sebastian Catana, après un premier acte quasi inaudible, joue certes les patibulaires patauds mais à coffre au II ; Béatrice Uria-Monzon montre que, à défaut d’avoir l’étoffe d’une mémorable Tosca (c’est un peu court dans certains passages de tessiture), le rôle ne lui échappe jamais totalement. Toutefois, deux castés se détachent joyeusement du lot : Massimo Giordano, spectaculaire dans chacun de ses airs (quel premier air magnifique ! quelle constance à chacune de ses interventions !), séduit par la perfection de sa voix… mais déçoit par son manque de charisme scénique ; à l’inverse, Carlo Cigni, en évadé mal dans sa peau, rôle secondaire mais important, manque peut-être de temps pour séduire mais convainc par son jeu d’acteur, ce qu’il n’avait pas fait un an auparavant. Dans l’ensemble, le plateau est digne (l’éternel troisième rôle des grandes scènes, qui mérite sans aucun doute mieux, Éric Huchet, fait le travail, comme Luciano Di Pasquale, André Heyboer et, brièvement, Andrea Nelli), le chœur réduit aux utilités ne déçoit pas, l’orchestre travaille sans excès de zèle (décalage bois-vents audible dès l’ouverture, sans conséquence sur la suite), et la représentation se passe sans encombre, sans miracle non plus. Avec un beau regret : pourquoi pas plus de Français en France ?
En conclusion : après tant de productions scandaleuses, on est heureux de pouvoir profiter d’un opéra version grand public, oui, mais qui ne crache pas du je-m’en-foutisme-et-yé-t’encoule-en-faisant-n’importe-quoi, façon Clara Halter, cette garce sponsorisée dégueulassement par l’État français, comme gage d’artistisme. Musicalement et dramatiquement, il faut espérer que l’on a vu et entendu mieux, plus risqué, plus prenant, pour cette pièce ; mais, à l’ère actuelle de l’Opéra Bastille, on a envie de dire, presque honteusement, que, malgré le manque d’engagement de la plupart des acteurs et scénomanes, l’on a passé une belle et intelligente soirée. Youpi.