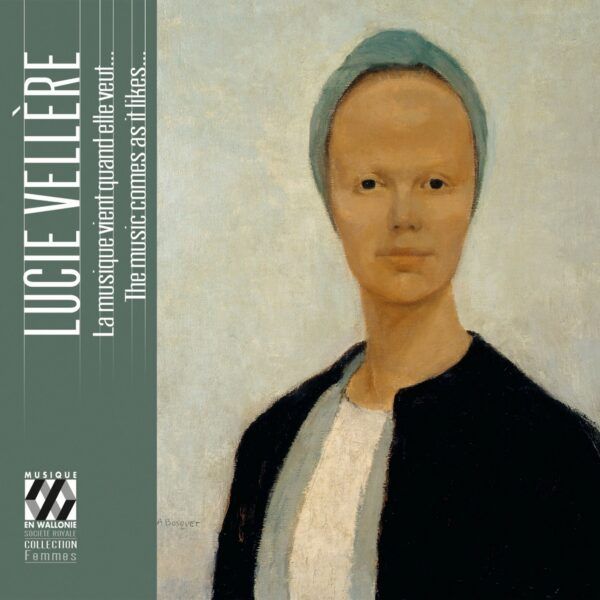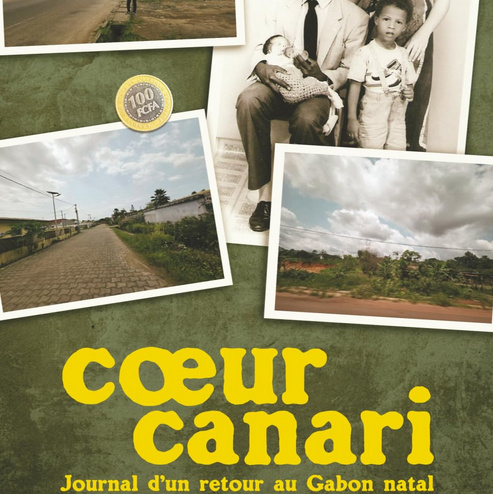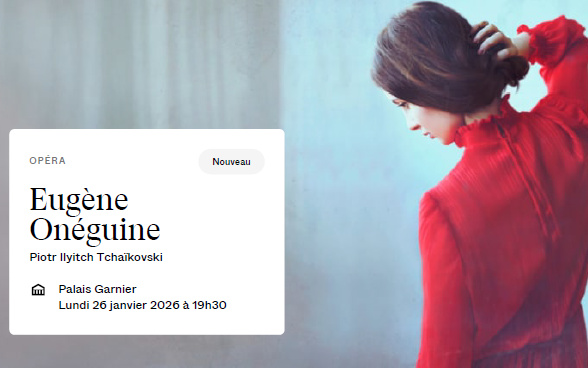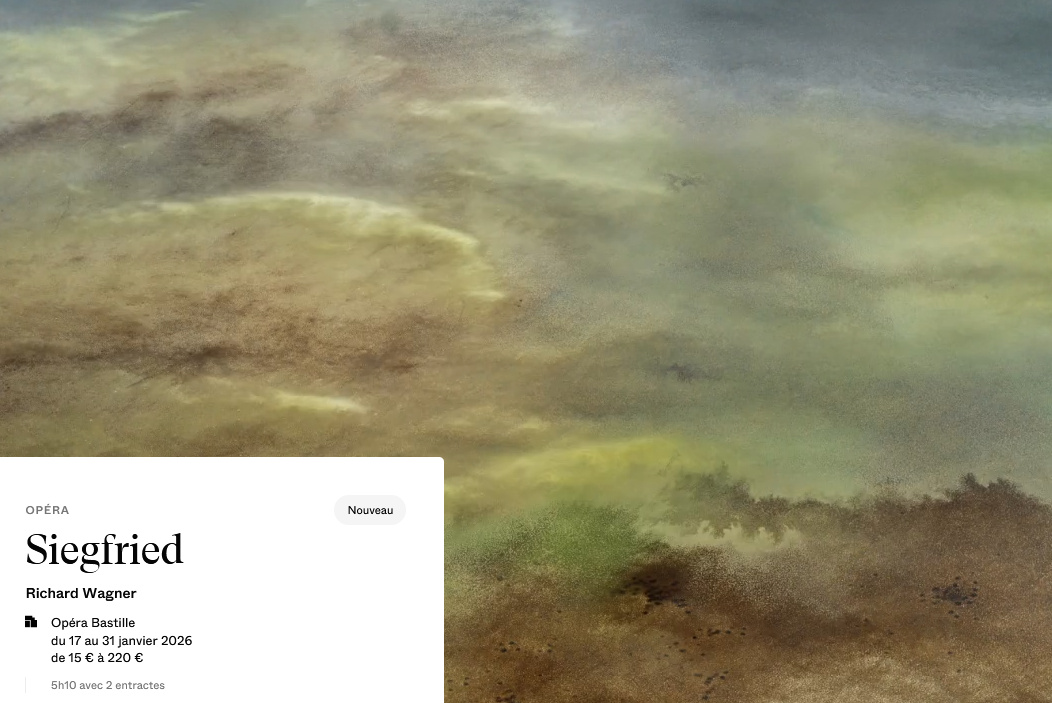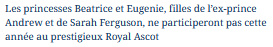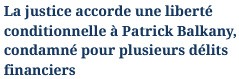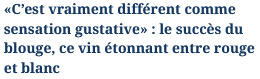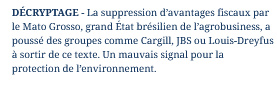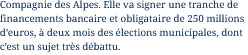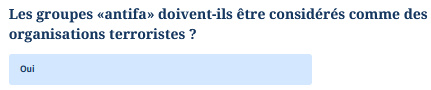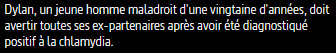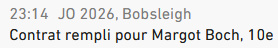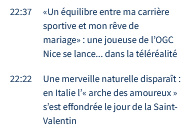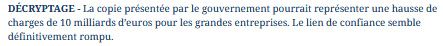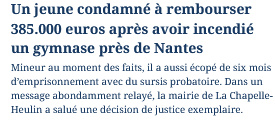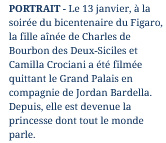Devant un parterre presque plein (banal pour l’artiste, pas si fréquent pour la salle Cortot), Irakly Avaliani, récemment diminué par une forte fièvre, s’avance avec un de ces coups d’éclat qu’il apprécie : son copieux récital Brahms et Chopin s’ouvre sur… les Variations op. 27 d’Anton Webern. L’écriture radicale secoue l’oreille plus que le clavier tant sa logique interne est à peu près imperceptible à celui qui n’a pas étudié la question et compulsé de lourds grimoires de musicologie après avoir étudié la musique pendant soixante-dix ans vingt-six heures par jour a minima.
Irakly Avaliani nous fait grâce de tout mode d’emploi, Dieu merci : s’il a choisi de jouer – par cœur, ce qui ne doit pas être une mince affaire même si l’œuvre est courte – cette pièce en trois mouvements, c’est sans doute qu’il croit au pouvoir expressif de sa musique. Aussi laisse-t-il l’auditeur l’appréhender telle qu’il la reçoit et, le cas échéant, l’apprivoiser. Pourtant, ici, rien ne ressortit de l’univocité. Le musicien
- fait frémir l’intranquillité sous la douceur,
- préserve une part du mystère sonore dans les jaillissements,
- esquisse par son toucher une cohérence derrière l’apparente destructuration d’un propos.
Fors toute considération dodécaphonique, réservée aux experts spécialistes sachants, l’oreille est attirée par les oxymorons que l’interprète pourrait bien suggérer : on entend
- la suggestion dans l’assertif,
- la tonicité dans le contraste et
- la vigueur dans la fragmentation.
À travers cet avènement d’une musique en vitrail, l’on peut déguster la précision
- des durées,
- des attaques,
- de la pédalisation et
- des nuances…
ainsi que l’audace d’ouvrir un récital Radio Classique compatible par cette musique non-consonante. En effet, avant une seconde partie Chopin, qui fera l’objet des deux prochaines notules, s’annonce la solide tétralogie des Ballades op. 10 de Johannes Brahms – un cycle dit « de jeunesse », donc, que le storytelling enveloppe de rose people en rappelant que Brahms écrit ces quatre pièces alors qu’il en pince pour la femme de son protecteur, madame Clara Schumann en personne, même si cela ne nous regarde pas. Bah, un peu de gossip affriolant ne fait jamais de mal… ou presque. Dans l’andante en ré mineur, Irakly Avaliani séduit par sa capacité à
- poser le son pour le suspendre,
- valoriser la couleur de chaque registre en les agençant plutôt qu’en les opposant, et
- monter un long crescendo sans se priver de l’orgasme des fortissimi puissants : subtilité, oui oui, bourrinage de l’exutoire aussi !
Dans l’andante en Ré, l’interprète se laisse aller – et il a bien raison, autant que nous en puissions juger – au plaisir
- de faire miroiter les nuances de demi-teinte,
- d’utiliser le potentiel percussif du Kawai mis à sa disposition,
- de faire grésiller la dissonance qui ragaillardit l’écoute, et
- de préserver tant le côté taquin car imprévisible d’une ballade folâtrant jusqu’à friser la concaténation rhapsodique, et hop, que la capacité de surprise qui réside dans des mutations de motifs abouchées par des tuilages particulièrement soignés.
L’intermezzo en si mineur, la plus brève des quatre ballades, évoque l’urgence et le désir – les désirs, même, ceux
- de vivacité,
- d’impulsivité,
- de voltes-faces thymiques et
- d’énergie qui se dégoupille.
L’andante con moto en Si dure deux fois plus que son prédécesseur. « Con moto », cela ne veut dire ni avec un deux-roues (je sais, mais pas pu m’en empêcher) ni en précipitant les choses, ce qui ne serait guère la patte avalianienne. À l’agitation, l’artiste réfère la motricité du clapotement dont il inonde le clavier. Le voici qui peint un paysage paisible puis tourne casaque et impulse une nouvelle dynamique. Néanmoins, tout paraît pensé autant que ressenti. Le colosse septuagénaire confirme sa capacité
- de méditation,
- de contemplation et
- d’intériorisation.
Elle lui permet de rendre raison d’un Brahms
- grave,
- presque minimaliste et, as far as we are concerned,
- fort méconnu.
La première partie confirme la haute opinion qu’Irakly Avaliani a de la musique et de son devoir. Nulle recherche
- de séduction,
- de brio ni
- de clinquant.
L’homme offre à ses auditeurs d’écouter de la musique, simplement. La dernière note avalée, notre voisine nous glisse que plusieurs de ses amis se préparent à aller écouter à la Philharmonie de Berlin un pianiste dont elle a oublié le nom. Cellulaire en main, elle le retrouve : c’est Sofiane Pamart. Résumons la chose en disant qu’Irakly Avaliani est l’anti-Sofiane Pamart. À lui de le confirmer après l’entracte, lors d’une seconde partie 100 % Chopin. À suivre !
Pour retrouver nos 56 – oui, 56 – chroniques précédentes sur Irakly Avaliani, c’est ici.