
Surgir. S’enjailler. Se décontenancer. Suspendre. Y retourner. Tester. Réexaminer. Changer de point de vue. S’en amuser. Être déçu. Se décevoir. Vivre. Faire de la musique, en somme. Et, bientôt, en vivant ici.
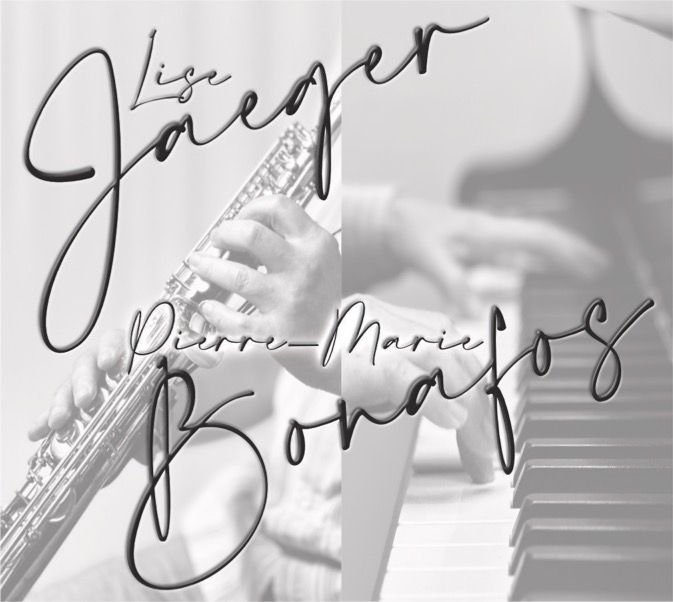







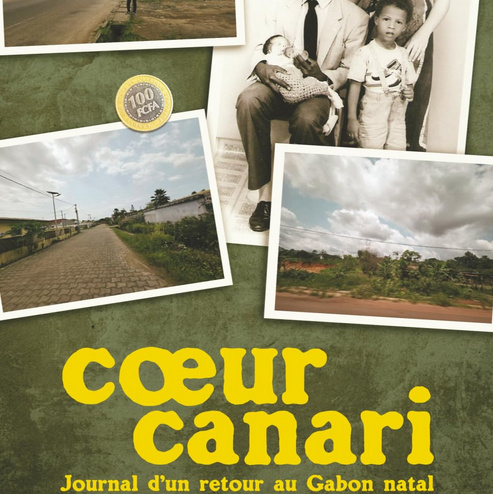





























Surgir. S’enjailler. Se décontenancer. Suspendre. Y retourner. Tester. Réexaminer. Changer de point de vue. S’en amuser. Être déçu. Se décevoir. Vivre. Faire de la musique, en somme. Et, bientôt, en vivant ici.

Gros son et virulence au Point Éphémère, ce 19 février. Quatre groupes s’y succèdent, pivotant autour du hardcore (nous ne pourrons hélas assister au set prometteur d’Insurgent).
Ouvrant la marche, Kibosh déploie un hardcore vigoureux, qui sait breaker à l’occasion et se distordre comme il sied. Il y a à peine plus d’un an, ils expliquaient avoir du mal à jouer plus de vingt minutes. Cette fois, il leur faut tenir une bonne quarantaine de minutes, mais les gars ont dû assez tourner depuis pour avoir de quoi envoyer du pâté, malgré des interchansons parfois longuettes comme souvent dans ce style de musique.
Les Bordelais réussissent pleinement leur prise de contact avec le public parisien. La salle n’est pas encore remplie ? Tant mieux : les spectateurs sont peinards all around, les danseurs peuvent pogoter à fond dans la fosse. Les mouvements sont rustiques et sévères (c’est le début du show programmé sur six heures, dont deux de DJ, les chorégraphes spontanés ont encore la pépêche et l’envie de marquer leur territoire). Ils sont encouragés par des zicos qui
La température est joliment montée pendant leur prestation, de sorte que l’entracte nécessaire au changement de plateau est le bienvenu. Durant cet interstice, le batteur sollicité pour un autographe offre ses deux baguettes défoncées à un jeune fan breton qui taquine le même instrument que lui. Y a le beau geste.
S’avance alors Mascara, groupe local qui fignole son premier album complet après moult EP. Le set commence sur un trompe-l’oreille : on note le contraste entre une rythmique vitaminée et une voix, souvent accompagnée de son duo, dont l’expression traînante rappelle les langueurs d’Oasis. Cependant l’énergie est suffisante pour nous inciter à trouver la recette sinon affriolante, du moins originale. La suite nous fera déchanter et calmera aussi le bassiste, bondissant au début, plus mesuré au fil des fredonneries qui passent.
La présence superfétatoire d’une espèce de DJ, propulseur d’interchansons
n’a rien non plus pour séduire l’amateur de headbanging. On regrette aussi les passages où le chanteur quitte son personnage de Mancunien dépressif pour reprendre sa voix et sa posture de gentil garçon pendant le set même, renforçant le sentiment d’artificialité de la posture voire de la pose.
Cerise flétrie sur le faux gâteau Delacre acheté chez Action et périmé depuis mille ans que sort mamie au moment du café, comme Kibosh (et comme, bientôt, Split, mais plus discrètement), Mascara tient à préciser qu’il est très contre les fascistes, ce qui est d’une audace politique presque aussi spectaculaire qu’un cacique LFI plaidant contre l’islamophobie (un drapeau palestinien est d’ailleurs déployé sur scène). Bref, cette proposition qui, sur un malentendu, aurait pu passer pour audacieuse, jette un froid dans la salle de concert du Point Éphémère bien que, à son habitude, la foule désormais plus dense soit globalement indulgente.
Quand les Rouennais de Split arrivent sur scène, tout est à refaire. Les titres au programme ne cachent rien de l’état d’esprit du groupe : « Coward », « World sucks », « Stained Soul », « Vicious Soul », « I feel nothing more » font partie des uppercuts sélectionnés par le groupe qui lance ainsi dans la capitale son premier disque, Violence breeds violence, dont on ne sait s’il s’agit d’un avertissement de sage ou d’une promesse gourmande de mauvais garçon. Enfin, on a bien sa petite idée, mais bon.
Deux tonalités pour le programme, reprenant le nouvel album et le complétant : Ut ou Ré. On subodore que l’affaire va se jouer ailleurs que dans
Dans ce contexte, ce n’est pas a priori déplaisant. Au nombre de photographes et caméramen plus ou moins officiels, dont une fille aux cheveux roses couverte de tatouages et un preneur d’images n’hésitant pas à secouer sa tignasse entre deux enregistrements, l’on suppute aussi que le combo, en ascension, a de l’ambition. Aussi se lance-t-on avec plaisir dans la découverte d’un répertoire rugueux qui ne manque pas d’envie d’en découdre.
Émergeant des profondeurs, « Coward » dissout l’intro bruitiste dans une rythmique solide où la basse bat la mesure jusqu’à ce que les éructations consubstantielles (bah, si) au genre débrident la boîte de vitesse. Le bolide rugit et les premiers « Fuck you! » s’abattent sur le Point Éphémère. L’atmosphère s’enflamme aussitôt, dopée par l’instabilité rythmique qui fait le charme de « Good cop », par exemple, titre dont l’essentiel du texte tient en une extended version d’ACAB : « A good cop is a dead cop ».
Certes, peu d’originalité dans l’esthétique et les problématiques de ces jeunes gens passionnément bruyants, mais des choix intéressants dans les variations

Le chanteur n’hésite pas à se jeter dans la fosse pour haranguer la foule en ébullition, ou à tendre son micro au front row pour le laisser finir ses punchlines les plus évidentes. Guitaristes et section rythmique se démènent avec la rigueur qui va bien. Les instructions chorégraphiques sont assez claires (« Foutez le bordel, et foutez-le bien ! ») pour que le pit essaye de s’y coltiner. Les preneurs d’images, en manque d’inspiration, finissent par se photographier entre eux.
Pas de quoi empêcher le récit splittien de dérouler sa diégèse, et hop, en listant les gens contre lesquels s’impose la révolte, mais aussi les attitudes qui doivent nous rendre vigilants. Ainsi, après le taedium vitae de « For Fuck’s Sake », « Stained Soul » invite à se détacher de l’exigence
dans laquelle « on » peut nous bassiner, voire dont « on » peut polluer éternellement nos petites caboches.
Jusqu’au bout de ces trois quarts d’heure, Split envoie du boudin tout en veillant à distiller quelques pastilles de surprise dans la machine à laver où il compte bien essorer son public. Ainsi du dernier titre, « I feel nothing more », dont la bipolarité séduit, non sans laisser s’échapper un texte parlé où la jubilation de la grandiloquence prolonge le plaisir de la violence (si, mais si, puisqu’on vous dit que si), privilégié jusqu’à présent, quand le narrateur murmure : « I find you perfect but I gave you my life cause I had nothing left to offer ». Du bon boulot,
Le fait que les gars soient, de surcroît, très avenants avec leur public au stand merchandising après le set ajoute, évidemment, des brava à leur performance.

Pour la seconde partie de son récital incroyable donné au profit de l’association Coline en Ré, l’improbable Diana Cooper dégaine du Chopin, mais pas que du Chopin Radio Classique : du Chopin qui la donc nous bouscule. En effet, elle envoie le très connu opus 22 bicéphale et la passionnante troisième sonate en si mineur. Quel programme !
Premier épisode, l’andante spianato et la grande polonaise brillante op. 22, soit un quart d’heure monstrueusement difficile à jouer et à rendre sensible pour le public.
la dame nous happe dans l’andante. Loin d’être nivelé, le mouvement en Sol est, sous les doigts de l’interprète, une furibonderie paisible qui ne nie pas les sursauts mais parvient à garder une cohérence que seuls peuvent rendre les musiciens pénétrés de l’esprit du compositeur. Diana Cooper en est, et elle veut à l’évidence nous partager le résultat de
La grande polonaise brillante en Mi bémol (avec sa transition) offre une impressionnante palette de
Maîtrisant les hérissements techniques de la partition, l’interprète peut se concentrer sur la musicalité qui consiste, entre autres, à
Le résultat ne se contente pas de faire une bon job qui clinque. C’est
La massive troisième sonate (près d’une demi-heure) emprunte elle aussi ce chemin coopérique. L’allegro maestoso fait montre d’une autorité libéré de tout hiératisme componctueux. La dame sait où elle va. Elle arbitre entre trois synonymes :
Rien, ici, d’anodin. À tout instant,
La capacité de Diana Cooper à penser la partition ébahit. Tout paraît
Scéniquement, la musicienne est concentrée sur son propos et non sur le show des mauvais comédiens. Elle ne joue pas
Son buste est immobile, elle se laisse « juste » traverser par une musique qu’elle
Fascinant. Après que les gens ont applaudi, le bref scherzo semble souffler sur les ailes de Diana Cooper.
tout captive et charme. Le largo change la donne en frictionnant
L’artiste rend
En démonstration, elle associe irrésistiblement
Le finale presto ma non tanto s’impose
Dans l’expression virtuose de la pianiste, il y a
Diana Cooper nous arrache à la vraie vie. Plus question de se dire qu’il faut
tout est bien. Une valse de Chopin et une sonate de Scarlatti gâchée par les organisateurs plus passionnés par les préparatifs bruyants du coquetèle que par la musique (d’ailleurs, avec une grossièreté assez crasse, l’ex-président interrompra les applaudissements pour presser les spectateurs vers les festivités) concluent avec force ce moment. Désormais, on sait que Diana Cooper s’affirme comme un maousse phénomène du piano.
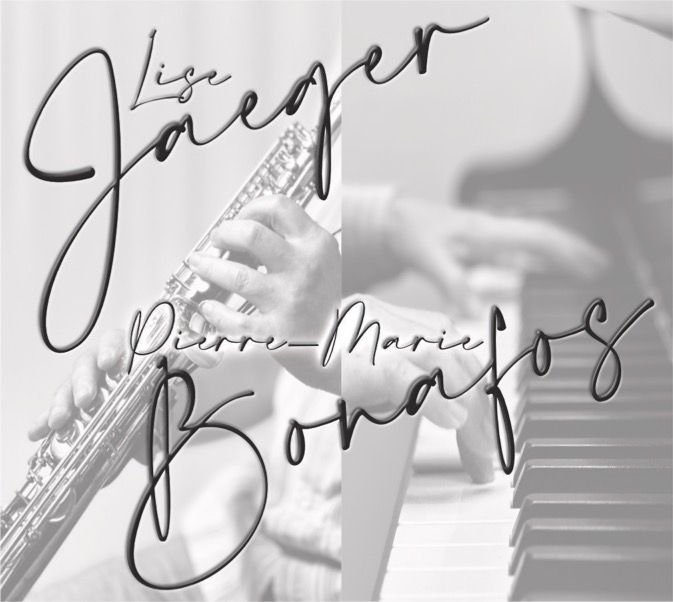
C’est d’abord
Le saxophoniste Pierre-Marie Bonafos ouvre en solitaire son quatre-titres aux allures de démo avec « Falling Grace » du bassiste et contrebassiste Steve Swallow. Lise Jaeger le rejoint avec un piano posé et riche en harmonies.
les musiciens font de la musique. À l’échelle des musiques improvisées contemporaines, c’est loin d’être un pléonasme. La prise de son de Jean-Baptiste Brunhes valorise ce pari, même si le mix nous paraît mettre trop en avant le piano pour que tout nous parvienne toujours aussi net que joué.
Hommage au calamar (?), « Lulas » est le premier des deux thèmes composés par Pierre-Marie Bonafos et enregistrés sur cet EP. Au piano de lancer le récit avec une main gauche articulée que semble affectionner Lise Jaeger. On aime sa façon
Le compositeur propose lui un travail sur le son qui irise son thème entre
Les soli explorent les recoins du thème en l’éclairant avec curiosité. On suit d’autant plus volontiers ces baguenaudages que c’est vraiment le thème que l’on parcourt et non la technicité des musiciens. Maîtrisant leur art, ils confirment se ficher complètement d’impressionner l’auditeur par un débit de mitraillette ou des élucubrations moins farfelues que grotesques.

Ambiance clairement big band (l’une des spécialités de PMB) avec « Scrupules », second thème du saxophoniste.
ce jazz-là ne cherche pas à désarçonner l’auditeur, féru de musique improvisée où mélomane de passage. Le confort d’écoute permis par cette clarté encourage à savourer les soli comme des aires de liberté où
ouvrent le paysage sonore sur des espaces joyeusement aérés. La balade se termine avec « Alfonsina y el mar » d’Ariel Ramirez, exposé par le piano et les arpèges à trois temps chers à Lise Jaeger. Il y a de la délicatesse dans la façon qu’a le duo de jouer un thème
mais cette délicatesse sait se teinter tour à tour
parfaitement argentins. La réexposition du thème commentée par le saxophone boucle avec goût ce parcours disponible dans une pochette de CD… avec une clef USB à l’intérieur, permettant d’écouter la musique sur son format favori. De quoi mettre en appétit pour entendre les partenaires en concert. En attendant, signalons que la relecture extraordinaire des Tableaux d’une exposition par Pierre-Marie Bonafos est en vente ici pour un prix assez cocasse.

Comme un écho offert à « Alborada del gracioso » qu’elle vient de jouer : ainsi apparaît l’Allegro de concierto d’Enrique Granados, monstruosité virtuose épicée par ses sept accidents sans compter les doubles altérations. Pourtant, en l’intégrant à sa set-list, Diana Cooper semble vouloir le débarrasser de ses oripeaux clinquants pour ramener l’épouvantail à sa substantifique moelle qui n’est rien d’autre que la musique.
Loin d’écraser l’exercice de concours sous le poids des difficultés techniques au programme, la pianiste prend l’allegro au sérieux et démontre que, même quand on a dompté un étalon, on n’est pas obligé de passer son temps à le chevaucher à fond de train : on peut aussi en admirer
Cette foi dans la musicalité de l’injouable passe par une maîtrise qui n’est jamais rigidité. La cavalière
Résultat, crinière ébouriffée, la salle hennit de plaisir à la dernière note. L’artiste prend alors la parole pour présenter la troisième sonate de Šimun-Čarli Botica, audace contemporaine que se permet l’instrumentiste, entre deux golden hits du répertoire Radio Classique – elle a bien raison. « Flashes and Glimpses », composée en 2023, revendique de marcher sur deux thèmes, l’un éclatant, l’autre suggestif. Diana Cooper nous promet qu’ils vont être
Thèse, antithèse, synthèse, mais avec un dialogue entre la thèse et l’antithèse, en somme. La pièce en un mouvement s’ouvre sur une fulgurance trouée d’explosions graves. Très vite,
secouent la partition. Le paysage sonore ne nous paraît que dans l’urgence de l’éclatement ou dans le flou d’un regard myope. Même les passages intérieurs sont fragiles, troublés voire déstructurés par
Un substantif s’impose : l’intranquillité. Celle-ci est
Diana Cooper sait articuler
Ainsi nous présente-t-elle une proposition à l’écriture rouée, qui parvient à jouir des possibles pianistiques sans sombrer dans le catalogue exhaustif de
propres au clavier en faux ivoire. Le résultat est
Et pourquoi pas ? Sous les doigts de Diana Cooper, l’affaire est intéressante, même si les amateurs de musique plaisante ou d’exploration inventive – qui peuvent être les mêmes – risquent de rester sur leur faim. La promesse d’une troisième partie Chopin devrait leur permettre de tenir pendant l’entracte ou jusqu’à la prochaine notule qui bouclera ce compte-rendu !

C’est une fable bien réelle, et ça commence dans
Eurielle Soun-Fragnol, infirmière née en 1983,
pour sa patiente et son planning. Satie en sourdine chante gymnopédie et « niossienne » car la professionnelle joue du piano (on regrettera que l’interprète ne soit pas crédité in fine, nous semble-t-il, et qu’une musique sans intérêt boucle le documentaire alors qu’un retour à Satie eût été plus signifiant et moins chpoufi-chpoufa). C’est fin décembre dans une Bretagne extrême. Eurielle file entre ses patients. Elle en a un peu moins que soixante-dix à voir par jour, la bienheureuse. Donc elle commence dans la nuit du petit matin et termine plus ou moins vers 21 h 30.
Dans les échanges, ça parle plus de crèche (on est près de Noël en Bretagne, on n’a pas peur de fêter l’avènement du Christ) que de médecine. Dans un rare moment intime pour l’héroïne, ça évoque Juliette la fistonne puis ça refocalise sur une patiente donc ça cite le code PIN 1234. Des portes s’ouvrent, des boîtes se ferment, des piqûres cognent des patients qui font semblant que ça va, des mouettes gueulent, on est à Saint-Brieuc donc il fait gris.
L’infirmière rentre les poubelles car la tempête souffle. Et le documentaire part dans son tourbillon d’une heure chrono. On doute du téléphone. On teste, teste, test son, merci Pascal. On court. On coche ce qui est fait. On a mal aux dents donc on aimerait avoir le temps de prendre rendez-vous chez le dentiste avant que la fin d’année n’écluse les rendez-vous.
On marche sous la pluie. On emploie le mot « terracotta » comme à Paris – le clivage Bretagne / Île de France est assumé – on emploierait « taupe », ces fameuses couleurs qui n’existent pas. On fait des câlins, thérapeutique non nomenclaturée. On prend la tension. On provoque en proposant de voler des guirlandes pour Frédérique. On aime les ragots. On regrette les p’tits ballons de rouge qu’on offrait jadis aux infirmières de passage. On se souvient du temps où l’hôpital faisait son boulot (sujet grave que le documentaire a la finesse d’oublier pour raconter une histoire sans se perdre dans un débat). On a aimé entendre L’Internationale à l’orgue. On ne décourage pas le passage des patientes chez Burger King. On ne condamne pas les chats pour une boule de lymphe. Malgré un diplôme d’infirmière et un DU « Plaies et cicatrisation », on voudrait reprendre des études mais c’est pas simple. On aide les gens à ne pas mourir tout de suite. On suit des patients pendant quinze ans, donc on finit pas ses phrases. On s’émeut quand ça fait de la tarte aux pommes entre mère et fille. On pose les mêmes questions et les mêmes questions avec la même ingénuité et la même ingénuité.
On a décidément mal aux dents.
On survit grâce à la Xylocaine et aux pansements presque discrets. On parle d’hypotension orthostatique. On affirme que la plus belle des choses est l’amour. On n’aime ni les fachos, ni Bachar al-Assad, le contraire aurait sans doute bloqué le film. On voit les proches des souffrants. On trouve qu’Erik Satie, même s’il oblige la senestre à se balader sur le clavier, c’est quand même quelque chose, merde. On dit « merde », d’ailleurs. On cherche des médicaments manquants. On craint de devoir appeler les pompiers. On court après
On envoie les gens en HDJ, antichambre d’une mort qui piaffe. On écoute les gens pleurer quand la vraie vie revient (c’est l’affiche du film). On se demande quel est le moment le plus agréable de ce qui ne sera plus. On ne sait plus quel jour on est ni si c’est le matin ou la nuit (on est à Saint-Brieuc, ça joue). On évacue les mégots de Frédérique. On fait saigner les berges des plaies. On rêve même de créer « une maison de cicatrisation » pour dynamiser le territoire. On applaudit celle qui va chez le coiffeur pour s’offrir un carré plongeant. On craint qu’une coupe girly fasse serpillière, mais un descendant désamorce le stress. On rigole des bourrasques. On interdit de mourir à un homme de 93 ans à cause qu’il y a des boutures à faire mais, hors caméra, l’intéressé ne tardera pas à désobéir. Puis on avoue que l’on a fait un malaise chez un client et que l’on s’est senti mal à l’aise de s’arrêter. Des plaies s’ouvrent. Feignons qu’elles se cicatrisent d’elles-mêmes.
Alors on repart. On se gratte le dos contre un mur « comme un ours ». On demande des blagues à ChatGPT. On offre des chocolats qui seront thésaurisés pour être « mangés après manger ». On essaye de se souvenir de la blague de canards de ChatGPT tout en restant dans l’étang. On continue de dicter ses messages à son smartphone comme un radiologue parle à son dictaphone, ses hénaurmes revenus en moins.
On n’a plus mal aux dents.
On vapote. On en revient à l’art de la cicatrice et à son corollaire souvent impensé qu’est la cicatrisation. On sait que, après la blessure, physique ou intime, reste toujours une trace. Symboliquement et pas que, on espère que « la clef n’est pas dans la serrure ». On conseille aux gens donc à soi d’être apaisé. On a deux chiens, un chat, quatre poules avec des prénoms signifiants pour soi, surtout Solange. On propose aux gens dont le papa aurait guéri du cancer de « boire un coup ».
Et puis, c’est la vie, on décide que ça suffit. On dit au revoir. En français macroniste, ça se dit : on revend ses parts dans le cabinet. On s’enfuit avant de s’encroûter. On veut cicatriser, même si la vie prouvera qu’une vie à mille à l’heure, pour
ça n’est carrément pas sans conséquence.
En travaillant sur la spécularité réciproque
le réalisateur, caméra à l’épaule, explore une pulsion qui ne s’appellerait plus le voyeurisme mais le regardisme – et hop – et qui désignerait l’envie d’en apprendre plus sur les gens que l’on aperçoit, soient-ils vedettes ou figurants. Pour cela, comme l’ambitionne dans un temps fissuré le réalisateur, il faudrait ne plus les voir mais les regarder. En ce sens, le cinéma de Guillaume Vatan participe d’une redistribution de l’attention par l’émotion. En témoigne le travail sur le cadrage, souvent très serré donc ambigu : il est certes serré pour saisir l’expression ou le rictus qui parle sans mot dire, donc pour dévoiler l’intimité, mais il est aussi serré pour ne pas dévoiler excessivement l’intimité des personnes filmées, en l’espèce leur intérieur (la géographie des espaces reste souvent mystérieuse, et l’on ne saura rien de l’habitation de la visiteuse). L’intime et l’intérieur sont l’un des grands sujets du film.
D’autant que, prolongeant cette spatialisation fragmentée, le temps se déstructure lui aussi. La tournée de l’infirmière est filmée comme en continu, sautant de visite en visite, c’est la première chronologie ; cependant, elle est aussi filmée sur plusieurs jours voire plusieurs semaines, et cette chronologie tacite s’interpole avec la première, comme si le temps se diffractait, donnant une impression d’affolement et d’étouffement – qui n’est pas qu’une impression : la soignante fera un burn-out puis, après le film, une série d’accidents graves de santé. Presque innocemment, le film saisit
L’adieu d’Eurielle à ses patients après quinze ans de course folle est aussi
Trois autobiographies, en somme :
Triple aussi est l’art du réalisateur :
S’entrelacent ainsi
dans ce qui est à la fois
Le résultat, loin d’un « Strip-tease » télévisuel (ce qui ne serait déjà pas si vergogneux), donne au spectateur de quoi
L’essai est transformé.

J’ai conscience que ce qui suit n’est pas d’une grande, grande douceur, mais si quelqu’un avait eu
d’énoncer préalablement cette évidence, je n’aurais pas le déplaisir de le stipuler.
Le problème d’un récital méga high level caritatif, en dépit de l’accueil très cordial réservé aux spectateurs et notamment aux spectatrices en ce jour de Saint-Valentin, c’est pas qu’il soit caritatif, c’est qu’il donne l’occasion aux chefs de bénévoles sans doute très dévoués de fouler une scène pour leur quart d’heure warolhien et qu’il leur permet, sous prétexte de sensibiliser un public forcément déjà acquis à la cause, de se pavaner avec un contentement contreproductif. Le fondateur de Coline en Ré, qui vient d’abandonner son titre de président, tient à rappeler cette vérité universelle à qui l’aurait refoulée, transformant la première demi-heure de la soirée en assemblée générale des membres seniors du comité des fêtes ou des amis du cassoulet aux épices de Trifouilly-sous-Lèz. Un moment de malaise absolu.
le personnage s’étale, flaque flasque de contentement sans digue, avant de passer la parole à on n’a pas très bien compris qui, d’une autre association, laquelle développe un discours beaucoup plus structuré – mais une conférence sur la malnutrition à l’heure d’un récital et avant un joyeux coquetèle est-elle bien à sa place ?
Invité, j’avais tenu à préciser que je payerais la seconde place que j’avais sollicitée, car je risquais de priver l’association d’une rentrée d’argent ; je m’y suis résolu au terme du concert mais, un temps, je l’admets, j’ai hésité à régler mon dû moral tant ce à quoi j’avais été contraint d’assister non seulement me paraissait peu appétissant mais, surtout, me semblait relever d’un manque de conscience de l’exigence de ce qui allait suivre. Mettre le niveau scénique au ras des pâquerettes pendant demi-heure alors qu’une pianiste superlative est attendue, c’est incroyable
Néanmoins, il a bien fallu passer par cette gave péniblissime et ses moments de grande gênance
pour assister au récital maousse costaud que Diana Cooper a fomenté au profit de Coline en Ré. L’artiste a choisi d’ouvrir le bal avec la quarante-septième sonate en si mineur de Joseph Haydn. Un quart d’heure, trois mouvements, et un allegro moderato liminaire qui saisit dès les premières secondes. Sur un beau Fazioli et dans une salle sans réverbération, l’interprète pose de suite sa patte sur la musique. Grâce à elle,
font paraître presque courts redites et ressassements qui ne manquent pas. Dans ce jeu assuré, il y a
Alors qu’un bébé tousse puis proteste (les géniteurs l’exfiltreront gracieusement, stipulons-le), s’élancent le menuet et son trio.
permettent d’incarner la danse avec grâce. Le finale, presto, émoustille grâce
Nous voilà séduit, davantage par l’interprétation que par une partition saturée de formules à notre goût trop récurrentes.
Diana Cooper ose alors un grand écart habile pour stimuler l’écoute en sautillant de Haydn jusqu’à Maurice Ravel, dont elle propose deux extraits des Miroirs. Les « Oiseaux tristes » avaient été conseillés par le bavard satisfait du début (« fermez les yeux et vous verrez vraiment des oiseaux tristes », wow !). Or, l’artiste déjoue le danger du planplan, un planplan ravélien ne fût-il pas un pléonasme. Dotée d’un toucher exceptionnel, elle semble travailler moins le rendu programmatique que la friction entre traits surgissants et atmosphères harmoniques qui s’installent. Dès lors, on se laisse envoûter tant par les temps longs auréolés par une pédalisation parfaite, que par les jaillissements pianistiques
« Alborada del gracioso » ne met nullement la musicienne en danger. Dans un même élan, elle en saisit
Diana Cooper se pourlèche les mimines
Ébaubi, l’auditeur se goberge d’une sensation
qui grésille joyeusement longtemps, longtemps après que les mains ont quitté le piano. D’autant que la dame a ajouté à la set-list initialement annoncée l’allegro de concierto d’Enrique Granados – mais ça, ce sera l’un des sujets d’une prochaine notule, faut bien créer un peu de suspense voire de teasing quelquefois…

Son mantra, affiché sur son site : « Une musique d’aujourd’hui pour tous. » Loin du cliché du « musicien contempourrien » indifférent de l’émotion de l’auditeur, Denis Levaillant n’a de cesse d’explorer, avec exigence et souci de penser la musique comme un lien entre l’art et le gourmand de vibrations auditives,
ce qui ne l’empêche pas d’explorer des pistes canoniques de la musique savante. Sous le titre de Passions, il regroupe trois pièces pour chœur a capella, dont la première est le Tombeau de Gesualdo. L’œuvre est interprétée par l’ensemble Musicatreize (où sévit parmi ses pairs l’ami et néanmoins excellent ténor Vincent Lièvre-Picard) et le contre-ténor Leopold Gilloots-Laforge, dirigés par Roland Hayrabedian. Vingt minutes, quatre mouvements, un texte du compositeur inspiré par le tombeau que Jacques Roubaud a écrit pour feue son épouse. Le premier mouvement est une élégie intitulée « Mourir je ne saurais ». Le texte fissuré cherche à saisir l’ineffable par
Denis Levaillant joue sur le mélange
Les voix deviennent vraiment instrument et explorent la multiplicité
L’expressivité de l’ensemble est également requise pour le blason intitulé « À l’impur à l’étrange ». Le texte y esquisse une putréfaction des éléments :
En dépit des tentatives d’échappée vers les inaccessibles suraigus des soprani, la partition se goberge
La méditation intitulée « Et au profond s’étend » ressasse à nouveau le va-et-vient entre
Ainsi Denis Levaillant fait-il fructifier le titre de son disque, rejoignant ici
Dans une partition moins onctueusement magistrale que grondante de trouvailles, les interprètes passent progressivement
Le chœur semble quêter une unité intérieure – peut-être celle des profondeurs évoquée par le titre – sans s’abstraire des charmes
Le récit intitulé « La nuit en elle » repose sur une série
L’écriture de Denis Levaillant renforce l’impression de chambre d’écho où résonne ce que fut l’être aimé. Les
participent d’une fêlure luttant mystérieusement pour une impossible réunion sans cesse rendue impossible par
C’est de cet impossible que naît la nécessité de la musique, semble nous suggérer le compositeur. Dans une mesure certaine, on ne saurait lui donner tort.
Pour entendre l’intégralité du disque gratuitement, c’est ici.
Pour commander le disque contre 15 €, port compris, c’est là.

En 2026, j’ai invité le saxophoniste Pierre-Marie Bonafos à venir danser en musique dans les églises entre orgue et piano. À partir d’un tronc commun, nous déclinons un répertoire diversement dansant depuis la première en l’église Sainte-Anne de Marseille, le 18 janvier, concert dont est extrait la suite qui suit, comme l’indique son nom. Retrouvons-nous à Paris autour de cette envie de nous mouvoir harmonieusement, par exemple

Juste le plaisir.
Comme à chacune de nos expériences à l’ex-Loco pour un concert de metal,
De quoi découvrir des groupes dont on ignore tout, pour un prix d’entrée cossu (30 balluches) mais un service rendu impeccable. La surprise va venir de God Complex, groupe qui se produit juste avant les vedettes canadiennes. Surprise pour le public mais aussi pour les musiciens, le chanteur répétant qu’il ne s’attendait pas à une telle ambiance pour leur « dernier concert en Europe » avant la tournée au Royaume-Uni. Le son est sévère, réduit à
Avec des guitares inaudibles, tout se joue sur
Les leveurs de rideau ferraillent sans temps mort, de sorte que les spectateurs s’enjaillent de plus en plus, tant dans la salle qu’en crapahutant sur scène entre zicos et preneur d’images. Le répertoire semble peu connu des métalleux, mais les Anglais envoient du son sans relâche, et la magie du mouvement fonctionne. Le triomphe fait au groupe, disproportionné en théorie, est parfaitement justifié : on a bien bougé les cervicales.
Counterparts se présente vers 21 h 35. Côté plus, seize ans d’activité, sept albums au compteur ; côté moins, nihil novi sub sole depuis 2024 et une formation instable. Le groupe déverse une musique essentiellement incarnée par le chanteur, où les torrents de décibels s’éclairent parfois de quelques breaks permettant de presque entendre une guitare saignante à souhait. Le set paraît maîtrisé mais trop monolithique, presque mécanique, jusque dans la manière de s’adresser au public et dans la hâte de chasser les spectateurs – pourtant disciplinés – s’aventurant quelques secondes sur scène. De même, le jeu de lumières, léché, ne compense pas le sentiment que, ce soir-là, manque la flamme du live susceptible d’envoler les spectateurs.
Pourtant, les soixante-cinq minutes de concert assument un univers affirmé et spécifique, entre dark et gore. En émergent des suppliques de survie sanguinolente où dialoguent
Les textes, inaudibles en concert, dessinent un imaginaire torturé (« With loving arms disfigured »), obsédé par la dimension concrète de la mort (« Wings of nightmares ») et l’abandon qui fout la rage (« Now I want to watch your skin rust and slowly grow discoloured » dans « Choke », ou « If I could, I’d murder you myself » dans « Unwavering vow »). L’auteur est envahi par la conviction d’être mort avant même de l’être (« Paradise and plague »). Dès lors, c’est la colère qui les inspire, lui et ses acolytes, notamment dans « Thieves », censée être une fredonnerie contre les abus en tout genre. Le chanteur s’y dépeint comme un redresseur de tort qui envisage de « remove the arms of unrepentant thieves ».
Plus globalement, les grommellements expriment une sensation de toute-puissance oxymorique car à la fois divine et destructrice (« I will absolve you of your sins and hurl you into hell myself » dans « Your own knife », ou « Purgatory burned as I fought alongside the flame » dans « To hear of war ») s’exprimant par une aspiration indécrottable à la violence extrême (« No lamb was lost, no love was lost, I’d kill to keep them both alive » dans la chanson éponyme). L’horizon est la mort, la mort, toujours recommencée. Le plus grand rêve du narrateur serait même d’être endormi dans un cercueil de verre pour que l’on se souvienne du sourire d’un homme happé par la noirceur de ses inclinations (« Stranger ») le poussant
Pour boucler le concert, « Heaven let them die » reprend des bouts de texte de « A Martyr left alive », dont il constitue la seconde partie. Lui succèderont deux bis expédiés : « Love me » spécifiant toutefois qu’il n’y a plus rien à aimer… même si le chanteur finit en criant son amour pour son fils Kuma, un temps à l’article de la mort suite à un cancer. Du travail sérieux mais
pour susciter l’enthousiasme que l’on aurait aimé exprimer. Entre bien et wow, il y a un fossé qui, à notre impression pas humble mais honnête, n’a été ni comblé ni franchi ce soir-là par Counterparts.