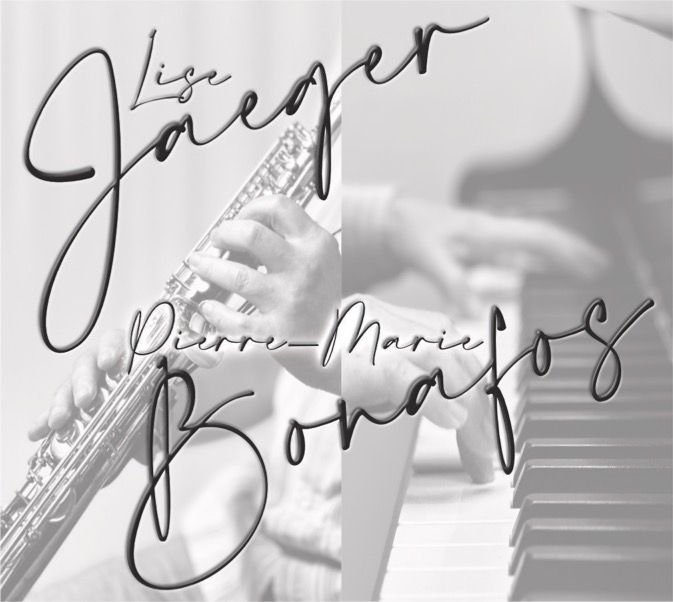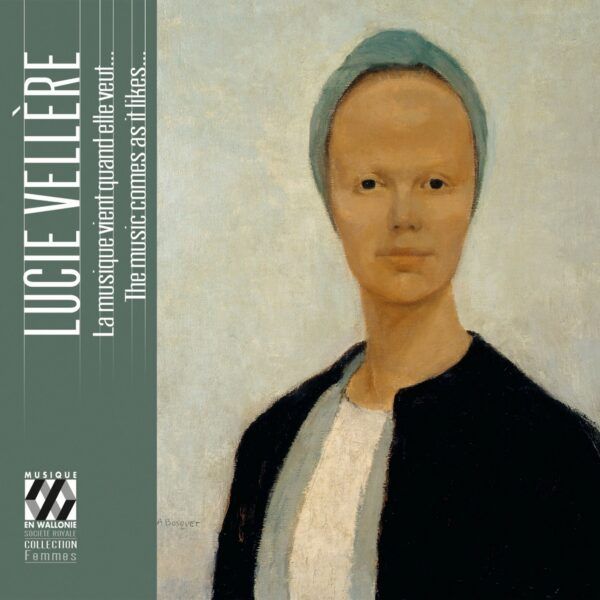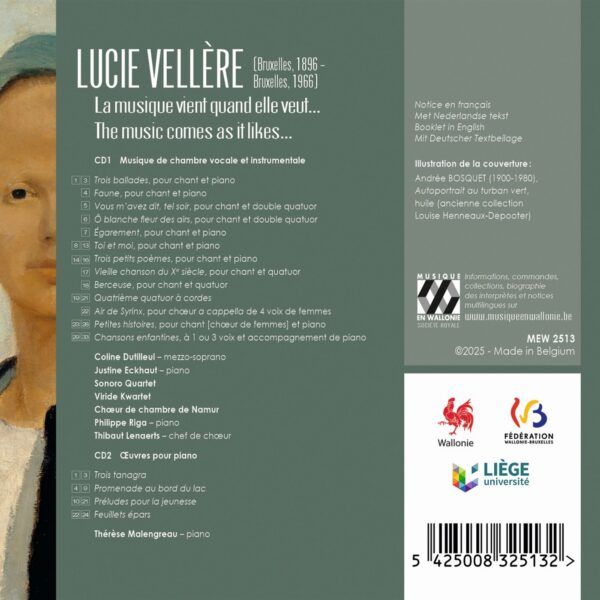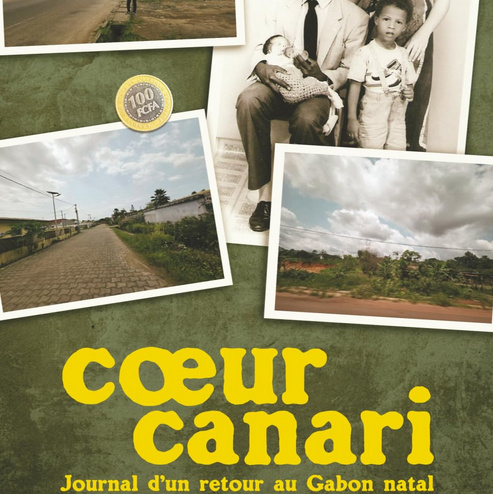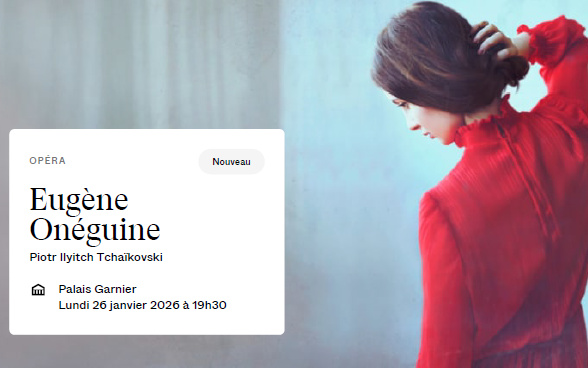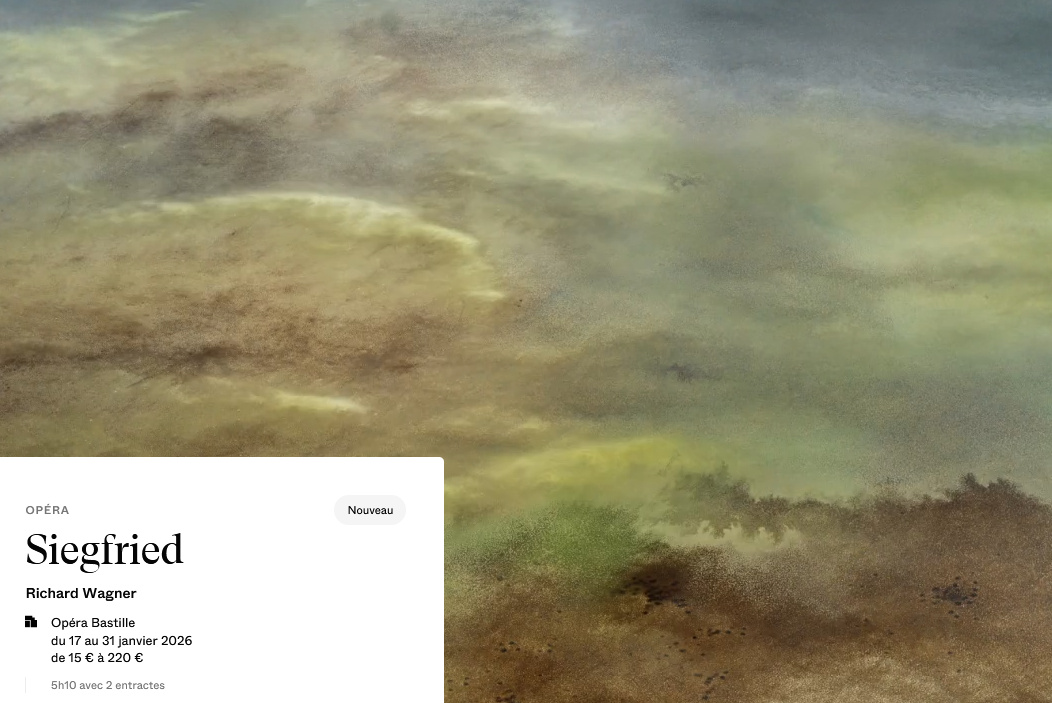Gros son et virulence au Point Éphémère, ce 19 février. Quatre groupes s’y succèdent, pivotant autour du hardcore (nous ne pourrons hélas assister au set prometteur d’Insurgent).
Ouvrant la marche, Kibosh déploie un hardcore vigoureux, qui sait breaker à l’occasion et se distordre comme il sied. Il y a à peine plus d’un an, ils expliquaient avoir du mal à jouer plus de vingt minutes. Cette fois, il leur faut tenir une bonne quarantaine de minutes, mais les gars ont dû assez tourner depuis pour avoir de quoi envoyer du pâté, malgré des interchansons parfois longuettes comme souvent dans ce style de musique.
Les Bordelais réussissent pleinement leur prise de contact avec le public parisien. La salle n’est pas encore remplie ? Tant mieux : les spectateurs sont peinards all around, les danseurs peuvent pogoter à fond dans la fosse. Les mouvements sont rustiques et sévères (c’est le début du show programmé sur six heures, dont deux de DJ, les chorégraphes spontanés ont encore la pépêche et l’envie de marquer leur territoire). Ils sont encouragés par des zicos qui
- envoient de quoi tabasser les esgourdes,
- maîtrisent les changements de rythme au sein de leurs chansons, et
- déroulent un set propre et efficace.
La température est joliment montée pendant leur prestation, de sorte que l’entracte nécessaire au changement de plateau est le bienvenu. Durant cet interstice, le batteur sollicité pour un autographe offre ses deux baguettes défoncées à un jeune fan breton qui taquine le même instrument que lui. Y a le beau geste.
S’avance alors Mascara, groupe local qui fignole son premier album complet après moult EP. Le set commence sur un trompe-l’oreille : on note le contraste entre une rythmique vitaminée et une voix, souvent accompagnée de son duo, dont l’expression traînante rappelle les langueurs d’Oasis. Cependant l’énergie est suffisante pour nous inciter à trouver la recette sinon affriolante, du moins originale. La suite nous fera déchanter et calmera aussi le bassiste, bondissant au début, plus mesuré au fil des fredonneries qui passent.
- Les langueurs traînent en longueur,
- les tempi se délitent pour friser la contemplation,
- le groove fait défaut au point que nous n’entendons plus de musique mais un mélange de bruits et de feulements proches de la chougne.
La présence superfétatoire d’une espèce de DJ, propulseur d’interchansons
- répétitives,
- lénifiantes et, tant pis pour l’oxymoron,
- infiniment longues
n’a rien non plus pour séduire l’amateur de headbanging. On regrette aussi les passages où le chanteur quitte son personnage de Mancunien dépressif pour reprendre sa voix et sa posture de gentil garçon pendant le set même, renforçant le sentiment d’artificialité de la posture voire de la pose.
Cerise flétrie sur le faux gâteau Delacre acheté chez Action et périmé depuis mille ans que sort mamie au moment du café, comme Kibosh (et comme, bientôt, Split, mais plus discrètement), Mascara tient à préciser qu’il est très contre les fascistes, ce qui est d’une audace politique presque aussi spectaculaire qu’un cacique LFI plaidant contre l’islamophobie (un drapeau palestinien est d’ailleurs déployé sur scène). Bref, cette proposition qui, sur un malentendu, aurait pu passer pour audacieuse, jette un froid dans la salle de concert du Point Éphémère bien que, à son habitude, la foule désormais plus dense soit globalement indulgente.
Quand les Rouennais de Split arrivent sur scène, tout est à refaire. Les titres au programme ne cachent rien de l’état d’esprit du groupe : « Coward », « World sucks », « Stained Soul », « Vicious Soul », « I feel nothing more » font partie des uppercuts sélectionnés par le groupe qui lance ainsi dans la capitale son premier disque, Violence breeds violence, dont on ne sait s’il s’agit d’un avertissement de sage ou d’une promesse gourmande de mauvais garçon. Enfin, on a bien sa petite idée, mais bon.
Deux tonalités pour le programme, reprenant le nouvel album et le complétant : Ut ou Ré. On subodore que l’affaire va se jouer ailleurs que dans
- les circonvolutions des mélodies,
- l’enrichissement des harmonies et
- le tuilage des différentes cadences.
Dans ce contexte, ce n’est pas a priori déplaisant. Au nombre de photographes et caméramen plus ou moins officiels, dont une fille aux cheveux roses couverte de tatouages et un preneur d’images n’hésitant pas à secouer sa tignasse entre deux enregistrements, l’on suppute aussi que le combo, en ascension, a de l’ambition. Aussi se lance-t-on avec plaisir dans la découverte d’un répertoire rugueux qui ne manque pas d’envie d’en découdre.
Émergeant des profondeurs, « Coward » dissout l’intro bruitiste dans une rythmique solide où la basse bat la mesure jusqu’à ce que les éructations consubstantielles (bah, si) au genre débrident la boîte de vitesse. Le bolide rugit et les premiers « Fuck you! » s’abattent sur le Point Éphémère. L’atmosphère s’enflamme aussitôt, dopée par l’instabilité rythmique qui fait le charme de « Good cop », par exemple, titre dont l’essentiel du texte tient en une extended version d’ACAB : « A good cop is a dead cop ».
Certes, peu d’originalité dans l’esthétique et les problématiques de ces jeunes gens passionnément bruyants, mais des choix intéressants dans les variations
- d’intensité (« For Fuck’s Sake », qui dénonce la mollesse tristo-fataliste tueuse de couples et dont la version officielle a été enregistrée dans les studios de la salle de spectacle),
- de durée (surgissement de « World sucks », éloge du « fuck » évidemment destiné notamment aux policiers et aux fachos), et
- de type d’intro
- (rugissement frontal,
- opposition entre lento et prestissimo, ou
- lancement progressif).

Le chanteur n’hésite pas à se jeter dans la fosse pour haranguer la foule en ébullition, ou à tendre son micro au front row pour le laisser finir ses punchlines les plus évidentes. Guitaristes et section rythmique se démènent avec la rigueur qui va bien. Les instructions chorégraphiques sont assez claires (« Foutez le bordel, et foutez-le bien ! ») pour que le pit essaye de s’y coltiner. Les preneurs d’images, en manque d’inspiration, finissent par se photographier entre eux.
Pas de quoi empêcher le récit splittien de dérouler sa diégèse, et hop, en listant les gens contre lesquels s’impose la révolte, mais aussi les attitudes qui doivent nous rendre vigilants. Ainsi, après le taedium vitae de « For Fuck’s Sake », « Stained Soul » invite à se détacher de l’exigence
- de soumission,
- d’indifférence et
- d’arrivisme
dans laquelle « on » peut nous bassiner, voire dont « on » peut polluer éternellement nos petites caboches.
Jusqu’au bout de ces trois quarts d’heure, Split envoie du boudin tout en veillant à distiller quelques pastilles de surprise dans la machine à laver où il compte bien essorer son public. Ainsi du dernier titre, « I feel nothing more », dont la bipolarité séduit, non sans laisser s’échapper un texte parlé où la jubilation de la grandiloquence prolonge le plaisir de la violence (si, mais si, puisqu’on vous dit que si), privilégié jusqu’à présent, quand le narrateur murmure : « I find you perfect but I gave you my life cause I had nothing left to offer ». Du bon boulot,
- efficace,
- maîtrisé et
- ne tournant pas le dos sporadiquement à une certaine quête de musicalité.
Le fait que les gars soient, de surcroît, très avenants avec leur public au stand merchandising après le set ajoute, évidemment, des brava à leur performance.